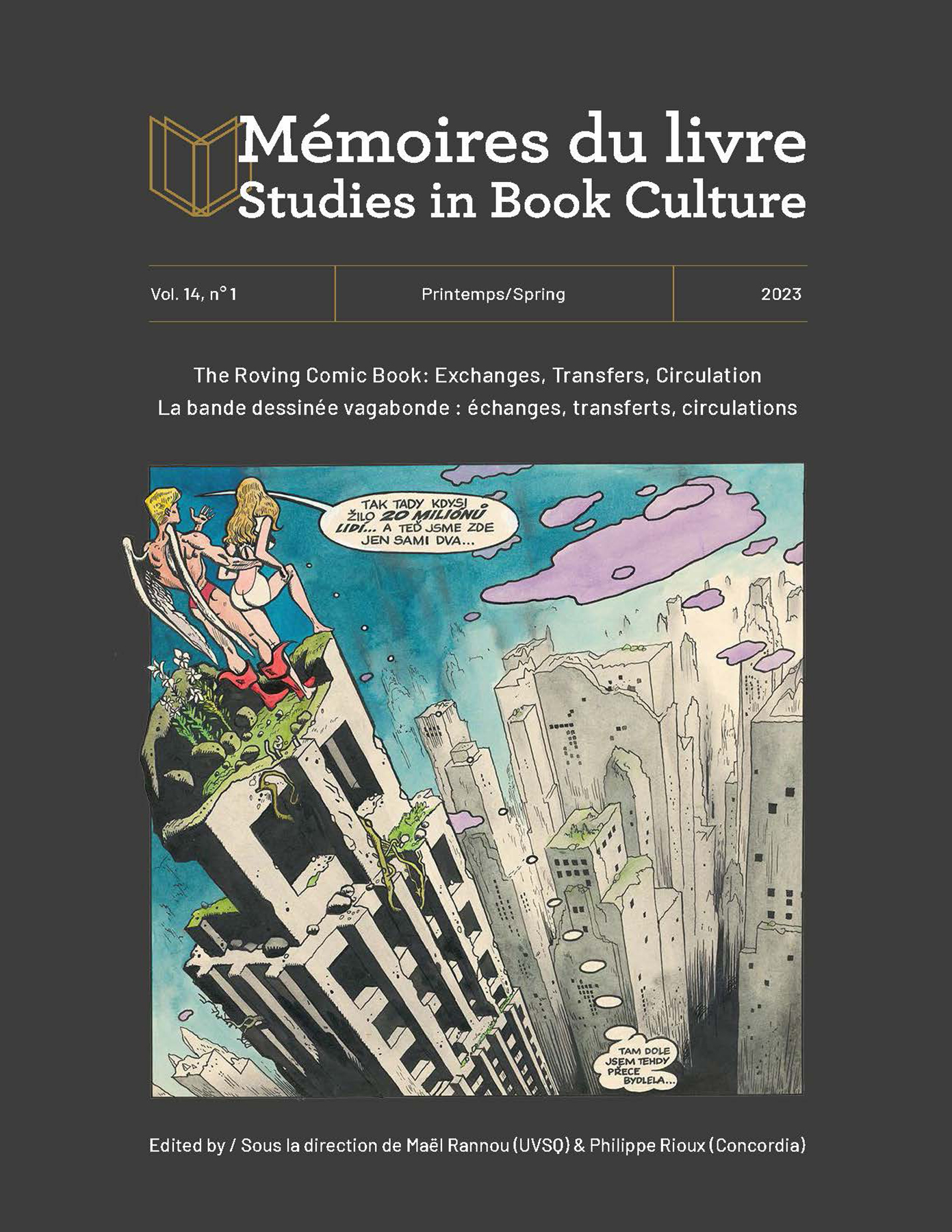Abstracts
Résumé
Cet article se penche sur l’origine et la réception des Nombrils, série créée par les Québécois Marc Delaf et Maryse Dubuc dans le magazine pour adolescents Safarir en 2004, avant de s’exporter l’année suivante dans Spirou, magazine belge largement diffusé en France. En vue de cette exportation, des choix conscients sont effectués pour rejoindre un public à la fois nouveau et plus jeune : la série perd ses éléments québécois (notamment le vocabulaire) et adoucit sa virulence. Au moyen d’une analyse détaillée des huit albums parus, mais aussi des entretiens avec les dessinateurs adjoints, et d’un examen des échanges des auteurs avec leurs fans, notamment via la page Facebook qu’ils administrent, cet article vise à mettre en lumière la stratégie d’effacement de la québécité pour l’adaptation de la série à un public européen francophone. Au fil de la parution, alors que Les Nombrils obtiennent un grand succès public, les signes québécois réapparaissent sporadiquement dans les décors ou les références culturelles, mais demeurent discrets sur la question de la langue. Désormais plus visiblement américaine, la série n’en est pas pour autant perçue comme québécoise.
Mots-clés :
- Bande dessinée,
- franco-belge,
- Québec,
- circulation,
- Spirou
Abstract
This article examines the origin and reception of Les Nombrils, a series created by Québécois authors Marc Delaf and Maryse Dubuc in the teen magazine Safarir in 2004, before being exported the following year to Spirou, a Belgian magazine widely distributed in France. During the exportation process, conscious choices were made to attract a new and younger audience: the series’ Québécois elements (notably vocabulary) disappeared and its nastiness was softened. Through a detailed analysis of the eight albums released, interviews with drawing assistants and a review of the authors’ exchanges with their fans, notably via the Facebook page they administer, this article aims to highlight strategies used to erase the series’ Québécois elements in order to adapt it for a French‑speaking European audience. Over the course of the publication, while Les Nombrils achieved remarkable public success, Québécois characteristics reappeared sporadically in sets or in cultural references, but remained discreet around the question of language. Now more visibly American, the series’ nature is no longer perceived to be Québécois as such.
Keywords:
- Comics,
- franco-belgian,
- Quebec,
- Circulation,
- Spirou
Article body
Apparu dans Spirou pour la première fois en mai 2005 (n° 3501), Les Nombrils de Delaf et Dubuc s’affirme rapidement comme l’un des grands succès de la bande dessinée franco‑belge post‑2000. Cette série n’est pourtant ni française ni belge, mais québécoise, et quelques pages publiées dans la province dès 2004 montrent qu’un processus d’adaptation a eu lieu pour passer d’un continent à l’autre. Une analyse du discours des auteurs révèle qu’il s’agit d’une stratégie consciente. Néanmoins, au fil des tomes, des traces d’une québécité de plus en plus marquée apparaissent, qu’il s’agisse de décors (façades, structures routières, écureuils, etc.), du vocabulaire ou d’indices culturels (conduite à 16 ans, campagnes étudiantes, notation scolaire, etc.). Dans cet article, nous avons tenté de relever ces traces, mais aussi de mettre au jour les processus de masquage, puis d’acceptation, de l’identité québécoise dans la série. Pour cela, outre plusieurs exemples parlants tirés des albums, nous nous sommes fondés sur l’analyse d’entretiens avec les auteurs, d’échanges directs avec leurs fans sur la page Facebook officielle de la série, ainsi que de deux entrevues inédites réalisées pour l’occasion avec Pascal Colpron et Fabio Lai, assistants au dessin pour plusieurs volumes de la série.
Après sa parution initiale dans Spirou, Les Nombrils devient rapidement l’un des nouveaux succès de l’éditeur belge, et se range aux côtés de titres rénovant un peu l’image du journal, en s’appuyant à la fois sur un public plus adolescent et sur une construction en gags portant un récit global où les personnages évoluent. On peut à ce titre comparer la série à TamaraBoula (de Darasse et Zidrou, également chez Dupuis) ou Lou (de Julien Neel, chez Glénat).
Dès la sortie du premier tome, en 2006, le site de référence ActuaBD parle de « série vedette[1] », puis évoque des ventes de 26 000 exemplaires l’année suivante[2], avant que le millionième exemplaire soit dépassé au cinquième tome[3]. Un rapide relevé permet de qualifier ce succès de « phénoménal[4] », d’« historique[5] » ou d’« international[6] ». Ce dernier article, publié dans le pays des auteurs, met en lumière une origine largement ignorée des nombreux lecteurs qui, si elle est parfois indiquée ici ou là, ne semble pas un marqueur constitutif de la saga. Il s’agit pourtant d’un succès manifeste de la bande dessinée québécoise, mais que la forme comme les pratiques de publication inscrivent dans la bande dessinée franco‑belge, invisibilisant cette origine nationale. En dehors de la presse généraliste ou spécialisée, le seul article universitaire consacré à la série est publié dans un ouvrage centré sur la bande dessinée canadienne, dont le sujet n’est pas lié à la question nationale. L’analyse produite, pour intéressante qu’elle soit, porte avant tout sur la représentation de l’adolescence et de ses tensions, chose somme toute assez logique quand on s’intéresse au fond de la série[7].
La lecture des Nombrils laisse en effet peu de place à des représentations spécifiquement québécoises, donnant à penser à un effacement maîtrisé et stratégique en vue d’une exportation en Europe francophone. L’existence d’une éphémère version québécoise bien différente accrédite cette hypothèse. La série Les Nombrils est‑elle donc québécoise à son corps défendant, à la manière d’un Guy Delisle, dont la nationalité québécoise n’a jamais été un secret, mais est totalement absente de son oeuvre? Celle‑ci a ainsi été largement ignorée des lecteurs français, pour qui la publication de Chroniques de jeunesse (Delcourt, 2021), qui donne à voir le Québec géographiquement et linguistiquement, est apparue comme une révélation[8].
Pour étayer cette intuition, nous avons relu finement la série[9], en cherchant et listant les différents éléments pouvant dénoter une québécité. Si cette recherche porte principalement sur les éléments de décors et de vocabulaire, elle englobe également d’autres signes culturels, comme l’évocation de lois ou de règlements d’organisation scolaire inexistants en Europe. Nous les avons étudiés afin d’envisager l’évolution de cette présence au fil de la série. Puis, nous avons observé divers entretiens et expressions directes des auteurs (notamment via la page Facebook officielle[10]) et réalisé, enfin, des entrevues avec les deux dessinateurs adjoints ayant travaillé sur la série, Pascal Colpron et Fabio Lai.
Pour exploiter cet ensemble de données, nous poserons d’abord le contexte général de la série, de ce qui se déroule au sein de l’environnement de parution. Puis, nous aborderons les différents éléments suggérant un effacement québécois volontaire, avant d’en relever une imprégnation toutefois présente et de plus en plus visible à mesure que la série progresse, sans jamais être au premier plan.
Le contexte de création des Nombrils
Marc Delafontaine, dit Delaf (dessin et participation aux scénarios), et Maryse Dubuc (scénarios), qui signe de son seul nom, sont tous les deux nés à Sherbrooke, où ils se sont rencontrés. La série Les Nombrils est très liée à ses auteurs, qui sont longtemps apparus comme indissociables, dans une situation accentuée par le couple médiatique qu’ils ont formé durant plus de deux décennies et par l’arrêt de la série après leur séparation en 2020, même si les deux auteurs disent espérer la poursuivre un jour[11]. L’origine sherbrookoise des auteurs n’est pas anodine, car c’est dans le cégep de cette ville que Richard Langlois, figure tutélaire de la réflexion sur la bande dessinée au Québec, donne son cours de « Figuration narrative », auquel les deux jeunes adultes assistent. Par la suite, Langlois va fortement défendre le travail de ses anciens étudiants et publier plusieurs articles sur la série.
C’est également lui qui a permis à Delaf, en 1996, de faire partie des huit auteurs retenus par le Musée des beaux‑arts de Sherbrooke pour son exposition sur La bande dessinée made in Sherbrooke. Alors âgé de 25 ans, Delaf est le plus jeune des participants et il côtoie des auteurs déjà largement implantés comme Al+Flag, Daniel Shelton ou Albert Chartier, ce dernier publiant depuis 1937 et faisant figure d’incontestable pionnier de la bande dessinée québécoise (BDQ). Une petite publication d’oeuvres inédites accompagne l’exposition[12] et Richard Langlois en rédige le catalogue, où il évoque le parcours précoce de Delaf : premier fanzine dès l’âge de 12 ans, rédaction en chef d’un magazine étudiant (LaTurbine), divers prix et concours qui l’amènent à publier quelques pages dans l’importante revue Croc. Sa carrière professionnelle est également bien avancée avec divers albums éducatifs, parfois traduits en anglais, et une activité de coloriste ponctuelle, même s’il n’a aucunement la notoriété qui viendra plus tard. Au détour d’un paragraphe, Langlois nous apprend que l’équipe qui créera Les Nombrils est déjà constituée :
Avec la scénariste et chromiste Maryse Dubuc, Delafontaine travaille présentement à un projet pour développer son personnage vedette Smoofee. Ce dernier est apparu en 1995 dans une revue marginale destinée aux adolescents du nom de Bédélirium, dont le contenu provocateur avait de quoi faire rougir certains parents et professeurs[13].
Qualifiée de « chromiste », Dubuc réalise en effet la mise en couleurs de différents albums alors qu’elle est encore aux études, et elle travaille d’ailleurs parfois avec Delaf : un curieux album publicitaire mettant en vedette le chanteur Garou les crédite en effet à la couleur[14]. En sus de la couleur, Dubuc ne s’est pas contentée de scénariser Smoofee; elle est aussi engagée dans des activités d’écriture et publie des textes à partir de 2002, notamment des romans jeunesse chez des éditeurs canadiens[15]. La première version des Nombrils est d’ailleurs pensée sous cette forme, mais l’autrice considère après réflexion que « l’histoire de ces deux garces fonctionnait mieux du point de vue de l’humour que du drame, et qu’elle serait meilleure sous forme de bande dessinée[16] ». Le choix du média est alors guidé par le genre humoristique, propice à un séquençage en gags, et ce, alors même que la densité narrative au long cours s’affirmera au fil de la série. L’action en est relativement simple et, pour la poser, nous empruntons le résumé de Philippe Van Meerbeeck, paru peu après la sortie du cinquième tome, qui jette bien les bases même si la série évolue ensuite nettement :
Jenny et Vicky sont les pires chipies que la Terre ait portées. Elles se prennent pour le nombril du monde et pour peu, elles le seraient vraiment. Avec leurs vêtements sexy, leur maquillage provocateur et leur coiffure toujours impeccable, partout où elles vont, les regards sont hypnotisés, la musique s’arrête. On ne voit et on n’entend plus qu’elles. Et heureusement! Parce que Jenny et Vicky sont prêtes à tout pour être le centre d’attraction. Leur amie, la trop grande Karine, l’apprend à ses dépens lorsqu’un certain Dan s’intéresse à elle. Jenny et Vicky ne sont pas du genre à accepter la compétition! Les lettres de Dan n’arriveront jamais à destination, ses invitations tomberont toutes mystérieusement à l’eau. Pauvre Karine! Dans un monde qui privilégie l’enveloppe plutôt que son contenu, elle ne peut qu’être le souffre‑douleur des deux autres. Et si un jour Karine s’émancipait? Qu’adviendrait‑il de ce trio dépareillé? L’amitié survivrait‑elle[17]?
Jusqu’alors, la carrière des deux auteurs est essentiellement québécoise, ou américaine (pour une série d’albums anglophones d’apprentissage du français langue seconde). Dubuc publie ses romans jeunesse chez Vent d’Ouest, un éditeur situé à Gatineau qui n’a aucun lien avec son homonyme français[18], et ses livres ne sont pas distribués en France. Facétie de l’histoire, c’est le Vent d’Ouest français qui fait paraître le premier livre de Delaf en mars 2005 : Le guide junior pour bien élever les parents, scénarisé par Jacky Goupil et Sylvia Douyé. Dubuc participe aux couleurs de cet album qui, s’inscrivant dans une série de Guides aux thèmes divers dont le principal objet est de servir de cadeau, n’est pas vraiment une création personnelle. La véritable entrée en Europe francophone de Delaf et Dubuc aura bel et bien lieu avec Les Nombrils quelques mois plus tard. La série a pourtant déjà eu une courte existence québécoise en 2004, mais si le public n’est certes plus celui du roman jeunesse, ce n’est pas non plus celui auquel sera destinée la série dans le futur. Les quelques planches publiées alors le sont dans Saf‑BD, supplément du magazine Safarir, lointain héritier du magazine Mad, qui mêle bandes dessinées et articles humoristiques pouvant verser dans le scabreux et le graveleux. Pour ce magazine ciblant plutôt adolescents et jeunes adultes, les auteurs adoptent un dessin moins rond et représentent des situations plus violentes. Pour ce qui est du vocabulaire, il comporte des distinctions linguistiques sur lesquelles nous reviendrons, mais aussi la trace de cet autre public. Ainsi, le personnage de Murphy, « le dépressif », est ici surnommé « le suicidaire », ce qui est autrement brutal. Michel Viau, qui dirigeait alors le supplément BD de Safarir, se souvient d’avoir reçu les pages et d’avoir tenté d’en publier deux par numéro, mais d’avoir dû se résoudre à n’en publier qu’une à la fois, les éditeurs de Safarir se montrant réticents. S’il ne détaille pas les raisons de cette résistance, on peut imaginer que ces pages ne leur semblaient pas correspondre à l’esprit du magazine, ce qui était « trop trash » pour un journal pour enfants ne l’étant peut‑être pas assez pour un journal satirique. L’expérience est de toute manière brève puisque Saf‑BD s’interrompt assez vite, Viau quittant le magazine fin 2004. En fin de compte, seules cinq pages de cette version originale sont publiées dans le magazine, des numéros 197 à 201 (Saf‑BD, n° 20 à 24) d’octobre 2004 à février 2005. La série ayant été réfléchie et bien préparée, le duo cherche à la replacer, et c’est vers l’Europe que leurs regards se tournent.
D’une rive à l’autre : un effacement québécois
Delaf et Dubuc évoquent alors le sujet avec Marc Cuadrado, un collègue franco‑canadien de Safarir, qui publie la série Parker & Badger dans Spirou depuis 2002. Cuadrado propose le dossier des Nombrils à Spirou, que les auteurs ne visaient pas vu sa cible jeunesse, mais l’éditeur répond très vite[19]. Ainsi, la collaboration commence et Cuadrado est dûment remercié pour son rôle d’entremetteur dans le premier tome. Le magazine historique de Marcinelle n’est pas un cadre spontané pour la série, et les auteurs, s’attendant à devoir retirer des éléments, préparent leurs arguments pour défendre leurs choix. Pourtant, ce n’est pas exactement ce qu’il se passe. Dans un entretien à Bodoï, Delaf indique :
Quand nous sommes venus présenter la série à Dupuis, éditeur du magazine Spirou, nous avions établi une liste des éléments que nous étions prêts à ôter et de ceux qui n’étaient pas négociables. J’avais du mal à imaginer Les Nombrils dans la veine de L’Agent 212 ou Cédric. Finalement, c’est justement cette rupture par rapport au ton du journal qui a été appréciée[20].
En réalité, les pages de Safarir et de Spirou diffèrent tout de même. Nous avons déjà évoqué l’aspect graphique, plus proche des codes de l’animation jeunesse, secteur dans lequel Delaf a travaillé, ainsi que certains termes, jugés inappropriés dans une série jeunesse. Il reste que si Murphy n’est plus « le suicidaire », il ponctue la plupart de ses conversations de menaces de suicide parfaitement explicites. Cette représentation de certaines affres de l’adolescence est plus sombre et directe que la plupart des séries franco‑belges plus classiques, qui correspondent cependant à une évolution éditoriale claire du Spirou de cette période. De la même manière que, au tournant des années 1980, une nouvelle génération importe un onirisme doux‑amer et un intimisme inattendu dans Spirou, avec notamment Frank Pé (Broussaille), Marc Wasterlain (Docteur Poche) ou Hislaire (Bidouille et Violette), le tournant 2005 voit un certain nombre de séries s’adresser à un public plus adolescent, et embrasser des thèmes plus sociaux et sociétaux. C’est au numéro 3487 du 9 février 2005 que Tamara (ex‑Tamara Boula, de Christian Darasse et Zidrou) apparaît sur une première couverture faisant directement référence à sa sexualité, puisqu’elle s’applique avec un air gourmand à détacher le pantalon d’un garçon lui déclamant son amour. Il ne s’agit plus de simples gags présentant « les filles » comme des êtres mystérieux à l’image du Petit Spirou (Tome et Janry), mais bien du désir sexuel des adolescents, puis de leur vie sexuelle à proprement parler, y compris celle d’une fille ne correspondant pas aux canons de beauté habituels. Plus tard, la série Tamara posera d’autres questions ancrées dans les débats de société, faisant par exemple intervenir une amie musulmane et voilée. C’est aussi au tout début 2006 qu’apparaît la série au long cours Seuls (Bruno Gazzotti et Fabien Vehlmann), qui met en scène des enfants dans un monde où tous les humains ont disparu et qui tient plus de Sa Majesté des mouches (William Golding) que de Spirou et Fantasio.
Ce contexte permet donc une démarche d’adaptation relativement minime selon les auteurs. De fait, la comparaison avec les premiers gags indique avant tout une différence graphique : les sujets peuvent évoluer avec le public, mais le dessin doit encore rester dans l’axe franco‑belge. Rapidement, la série remporte du succès : le premier volume s’inscrit dans les meilleures ventes jeunesse de l’année et la série est attendue chaque semaine sans coup férir dans le journal. Le quatrième tome, Duel de belles, paru en septembre 2009 mais prépublié les mois précédents dans Spirou, amorce de nombreux tournants. C’est à ce moment que Delaf prend un assistant graphique, Pascal Colpron, qui accompagne la série durant six ans avant d’être remplacé par Fabio Lai. C’est aussi dans ce volume que la construction en gags entreprend de porter un long récit à suivre, devenant au fil du temps de plus en plus haletant, jusqu’à flirter avec une ambiance d’enquête policière. Enfin, de manière externe à l’oeuvre, c’est en 2009 que la page Facebook officielle des Nombrils est lancée. Au‑delà des simples annonces promotionnelles, elle permet une communication directe des auteurs avec leurs fans.
Si l’adaptation des Nombrils depuis une revue satirique vers un public jeunesse apparaît relativement simple, et passe d’abord par une transformation graphique, ce n’est pas le seul changement que doit subir la série lors de son exportation en Europe. Série québécoise publiée en Belgique pour un lectorat massivement français, elle croise trois francophonies et deux aires culturelles qui ne se connaissent pas toujours. Pour les critiques comme les lecteurs, Les Nombrils se rangent assurément dans la « bande dessinée franco‑belge », terme générique désignant aussi bien le support de prépublication qu’un certain format éditorial (le « 48 CC », album de 48 pages cartonné et en couleurs, théorisé par Jean‑Christophe Menu[21]), et ce, alors que les auteurs ne sont d’aucun de ces deux pays. La chose a déjà pu être vue avec Titeuf, très large succès de la bande dessinée franco‑belge des années 1990 qui repose pourtant entièrement sur Zep, un auteur suisse. Mais la Suisse est un pays européen et sa production évolue dans l’ère franco‑belge depuis les années 1960. On ne peut pas en dire autant du Québec.
Les personnages évoluant dans la série Les Nombrils semblent vivre dans une ville fictive et pseudo‑universelle, comme cela a pu être décrit ailleurs, et peu de choses dans les décors indiquent à première vue qu’il s’agirait d’une vie québécoise. Au début de la série, l’action se déroule principalement dans une école; les maisons et l’institution d’enseignement rappellent plutôt au lectorat européen une sorte de lycée de télésérie nord‑américaine, un peu fantasmatique et universellement reconnu. L’action extérieure est campée dans des parcs, où pointent quelques détails identificateurs mais qui échappent au lecteur ne connaissant pas le Québec – comme la présence d’écureuils, chose atypique dans les villes européennes. Peu de bâtiments extérieurs évoquent le Canada. Une des rares occurrences de pareils détails architecturaux présentes dans le premier volume est un aperçu des escaliers extérieurs typiques de l’Amérique du Nord qui se trouvent devant les façades de quelques maisons, à l’occasion d’un plan large du lycée depuis le ciel[22].
Image 1
Des escaliers extérieurs typiques d’une certaine américanité. Les Nombrils. 2.Sale temps pour les moches, Marcinelle, Dupuis, 2007, p. 1.
En trouver si peu n’est pas un hasard et, si ces quelques éléments ont pu échapper aux auteurs, la discrétion est une stratégie parfaitement consciente. Dans un entretien à la version canadienne de la Sélection du Reader’s Digest, Maryse Dubuc raconte même avoir souhaité une version francophone universelle pour la série : « Chez Dupuis, on nous a d’abord suggéré de faire deux versions, une québécoise et une européenne[23]. Nous avons plutôt opté pour un français international dans tous les albums, en gommant la plupart des régionalismes. Bref nous avons décidé de doter nos personnages d’un vocabulaire à eux[24]. »
La notion de « français international » est un sujet connu des linguistes et sa définition peut être facilement résumée, à la manière de Davy Bigot et Robert A. Papen : « Il y a 40 ans, l’OLF préconisait une norme axée sur le “français international”, c’est‑à‑dire le français de Paris[25]. » Le français « international » n’est jamais qu’un euphémisme pour « français de France », d’autant plus sensible dans une revue elle‑même née dans une zone francophone périphérique de la France, qui n’a jamais laissé grande place à ses régionalismes[26]. Les échanges directs avec les auteurs via la page Facebook de la série insistent sur ces choix conscients. Ainsi d’une planche inédite publiée sur la page le 5 mars 2012, dont le style graphique indique clairement qu’elle a été dessinée à l’époque de Saf‑BD, et qui n’a pas été réutilisée pour les publications européennes, contrairement à ses comparses[27]. Il s’avère que le gag entier repose sur la température hivernale et le fait d’aller faire de la moto par ‑15 °C, une température à ce jour encore rare dans la zone de diffusion principale de Spirou. Par contre, sur cette planche comme dans des rubriques s’adressant aux lecteurs dans le journal, les auteurs n’hésitent pas à jouer justement avec ce décalage, comme dans un gag sur un chasseur de dédicace ne comprenant pas la langue des auteurs (publié le 22 février 2012 sur la page Facebook[28]) ou tout simplement par un bref dessin illustrant les différents types de français pour expliquer le choix assumé d’un français « de France » et d’une France non régionalisée (13 mars 2016[29]). Dans cette bande, publiée en ligne après plus de 10 ans de série en Europe[30], l’explication est un peu appuyée mais éloquente : ce français normé est celui qui permet de toucher le plus large public. Dans sa vaste étude sur la représentation du français parlé chez les auteurs montréalais contemporains, Anna Giaufret note pourtant que :
presque tous les jeunes auteures et auteurs québécois sont porteurs de marques linguistiques « identitaires », composées de français québécois et d’une « interparole » anglaise qui les distingue de leurs homologues européens. Ce code est assez transparent pour le public européen pour que leurs oeuvres soient publiées en France et en Belgique (le décodage de l’écrit étant plus facile et ne présentant pas les mêmes difficultés que les produits audiovisuels[31]).
Certes, les auteurs des Nombrils sont un peu plus âgés que ceux étudiés par Giaufret, mais seulement de quelques années, et ne viennent pas de Montréal, mais de Sherbrooke. Cette ville reste un centre urbain (il s’agit de la 6e ville la plus peuplée du Québec), même si moins métissé linguistiquement, et l’on peut donc imaginer que le sentiment des auteurs n’était pas si différent à l’origine. Toutefois, il s’avère que même lorsqu’une soudaine velléité « identitaire » se manifeste, elle semble freinée. Par exemple, une publication du 18 septembre 2012 présente une image ainsi légendée[32] : « Extrait du tome 6 : Quand Gary est fâché, il trahit ses origines… » L’image est nette, le musicien fracasse sa guitare au sol en s’accompagnant d’un virulent « Tabarnac! », un québécisme clairement assumé par les auteurs, et signalé dans ce rapport direct au lectorat. Pourtant, en ouvrant le sixième tome, on ne trouve plus de sacre québécois, mais un « ‘Chier!! » nettement plus européen. Il semble que la norme ait finalement repris le pouvoir.
Image 2
Comparatif de la publication du 18 septembre 2012 et de la page 10 des Nombrils. 6.Un été trop mortel, 2013.
Malgré cette vigilance, le Québec transparaît ponctuellement dans la série, et d’une manière qui semble de plus en plus assumée au fil des volumes. L’expansion de la géographie des personnages, qui quittent de plus en plus les couloirs du lycée et se déplacent même dans d’autres villes, impose des choix plus nets. Le succès permet sans doute aussi une plus grande liberté, et les éléments sont cependant visibles dès l’origine avant de se distiller au fil de la série; nous allons tenter de les repérer.
Une imprégnation québécoise malgré tout
Nous avons déjà évoqué l’important tournant du quatrième tome dans la série. En passant à un grand feuilleton, toujours rythmé en gags, le récit général prend plus d’ampleur. Cela se fait également sentir dans la représentation spatiale : avec l’évolution de l’histoire, des nouveaux lieux sont introduits, et les décors varient, ce qui révèle des espaces moins cloisonnés, dont la diversité se rapproche parfois d’une iconographie québécoise. C’est aussi à partir de la page 18 de ce volume qu’un premier dessinateur adjoint, qui se spécialisera rapidement dans les décors, commence à intervenir dans les planches. Interrogé à ce sujet pour le présent article, Pascal Colpron explique n’avoir eu aucun lien officiel avec Dupuis, ne travaillant qu’avec les auteurs. Les scénarimages étaient validés par l’éditeur, mais sa part de travail reposait sur un contrat entre lui et le dessinateur. Colpron précise n’avoir pas reçu de grandes indications sur les décors :
Les consignes les plus dures étaient de respecter l’esprit de continuité. On avait des décors qui étaient établis depuis un moment comme la chambre de Karine, celle de Vicky ou encore le lycée, de son intérieur comme l’extérieur avec sa muraille. Si ce n’est pas une consigne de l’éditeur, c’est que peut‑être inconsciemment Marc l’a faite pour internationaliser. Nous on a des clôtures en grillage autour des écoles secondaires mais pas de murailles[33].
Cependant, ce travail à trois crée, logiquement, du dialogue. Les deux auteurs se plaisent à placer des gags dans les décors, l’assistant s’amusant particulièrement avec les actions de second plan des écureuils, dont la présence massive dans les parcs, nous l’avons déjà évoqué, est une spécificité nord‑américaine. Au cours de notre entretien, ce dernier nous a également indiqué avoir eu un grand souci de réalisme et cherché à coller à ce qui pouvait avoir inspiré les auteurs. Allant en bas de chez lui ou sur leurs traces, il introduit alors nécessairement une plus grande présence québécoise dans l’oeuvre :
Marc montre des lieux qu’il a fréquentés avec Maryse comme l’hôpital qui peut faire penser à l’hôpital de Sherbrooke, il y a aussi le pont qui m’a fait penser à un pont de chemin de fer à Kahnawake, réserve amérindienne à côté de là où j’habitais quand j’étais petit. Le parc qui était un peu nord‑américain, les bancs sont typiques du parc La Fontaine à Montréal et Maryse et Marc habitaient pendant longtemps à côté. […] Les fondations dans les bâtiments, je voulais que tout soit « plus réaliste ». Il y a aussi les véhicules, je représentais des voitures plus canadiennes que françaises. […] J’ai constaté après coup que les gens nous faisaient remarquer que les décors étaient très américains[34].
Alors que la volonté première des auteurs était apparemment d’européaniser les décors, l’arrivée d’un assistant cherchant le réalisme graphique réinsère le Québec dans la série. Ces choix sont validés par les auteurs puisque les planches sont publiées, cette affirmation nouvelle pouvant s’expliquer aussi bien par une plus grande liberté de création, le succès étant désormais au rendez‑vous. Par la suite, Fabio Lai, qui reprend le soutien au dessin à partir du septième tome, se fond lui aussi dans les décors de Colpron. Italien vivant en Europe et n’ayant jamais mis les pieds au Québec, il cherche pourtant à reproduire activement des décors montréalais au moyen de recherches en ligne[35]. Ses décors en témoignent amplement et il a nécessairement fallu un effort réel à quelqu’un n’ayant jamais visité la province pour représenter des carrefours routiers où les feux rouges sont positionnés d’une manière bien différente de celle de l’Europe (t. 8, p. 47), chose qu’on ne voyait que très peu avant. Par cette action volontaire, il confirme que l’ancrage québécois des décors est clairement assumé par les assistants.
Image 3
Un croisement de rue typiquement québécois, entre ses bancs de neige de fin de saison et ses feux de croisement placés de l’autre côté des routes. Les Nombrils. 8.Ex, drague et rock’n’roll!, Marcinelle, Dupuis, 2018.
Les références au Québec sont donc graphiques : de grandes avenues américaines, un pont gigantesque évoquant ceux de Montréal[36], des joueurs de baseball et des écureuils. Ces derniers sont toutefois colorisés en marron et non en gris, couleur typique des écureuils du Québec, rappelant que même si le dessin est clair, une intervention ultérieure peut toujours le replacer dans un champ plus européen, divers filtres se mettant en place depuis l’assistant au dessin jusqu’à l’éditeur. Dans le même esprit, plusieurs lecteurs ont repéré à la page 15 du cinquième tome une boîte aux lettres atypique pour le lectorat européen : de fait, c’est une parfaite reproduction des boîtes postales de Postes Canada. Leur système d’ouverture et leur couleur rouge les rendent bien différentes des boîtes françaises, quand celles de Belgique partagent avec les boîtes canadiennes la couleur, mais pas le système d’ouverture. Face à un signe culturel pouvant créer la confusion chez le lectorat, même s’il est aisément identifiable dans le gag, Colpron confirme une des rares modifications directement apportée à la demande des éditeurs : une inscription « La Poste » bien française (alors même que l’éditeur est belge, rappelons‑le) s’est trouvée ajoutée sur la boîte; quant au logo, il ne reprenait directement aucun des logos existants, tout en les évoquant.
Image 4
Une boîte postale internationalisée, et donc conforme à aucune région du monde. Les Nombrils. 5.Un couple d’enfer, Marcinelle, Dupuis, 2013, p. 15.
La trace québécoise ne se limite cependant pas aux signes graphiques : nous l’avons vu, le vocabulaire est globalement normalisé, même s’il peut en exister quelques survivances, comme une cantinière utilisant le mot « jaser » (t. 5, p. 33). Or, on est là bien plus dans l’exception que dans la règle. S’il est relativement facile de lisser un vocabulaire, d’autant que des correcteurs payés pour la relecture vont s’attaquer assez naturellement aux régionalismes et anglicismes[37], et plus complexe de toucher au dessin, un vaste territoire se situe entre les deux. Cette zone, qui recouvre de multiples cas, est celle de ce que nous appellerons des « indices culturels ». Les écureuils et les tenues de baseball déjà évoqués, ou l’équipement de football américain (qui sont relativement présents au huitième tome), graphiquement repérables, y appartiennent en partie. Cela peut aussi concerner des graphies potentiellement corrigeables, mais qui ont été conservées, comme un certain nombre de sommes en dollars qui apparaissent au fil des albums, ou une notation scolaire en pourcentage (t. 6, p. 11) – commune au Québec et à la Belgique, mais pas à la France qui note sur 20.
Image 5
Un exemple d’un indice culturel : la notation en pourcentage. LesNombrils. 6.Un été trop mortel, Marcinelle, Dupuis, 2013, p. 11.
Parmi ces indices culturels les plus délicats, et qui auraient pu être évités par des choix scénaristiques, deux exemples semblent frappants. Dans le quatrième tome, page 10, la mère de Vicky lui raconte comment elle a décidé de séduire son père alors qu’« il venait d’être élu président du conseil étudiant par une majorité écrasante ». Si les élections de représentants lycéens existent aussi en France, ce n’est assurément pas le sujet de ferveur que représente l’image : l’élu est acclamé par une foule, réalisant un discours de victoire et jouissant par ce statut d’une grande popularité. À la page suivante, Vicky va donc draguer Fred, le président du conseil étudiant actuel, pour devenir « first lady ». Cet imaginaire apparaît un peu ésotérique en Europe, et l’intention des auteurs n’était sans doute pas de marquer cette différence. Certes, le quatrième tome est celui où la québécité/américanité se fait subtilement plus visible, mais dans le septième tome, c’est une autre affirmation qui est proposée : lors de la fête d’anniversaire de Vicky, on apprend que celle‑ci a 16 ans avant de voir que son cadeau est une voiture neuve (p. 40‑41). Il s’agit là d’abord de montrer encore une fois l’extrême richesse de cette famille, et la scène n’a pas à surprendre outre mesure, le permis de conduire étant accessible dès 16 ans au Québec. Il en est cependant différemment en Europe, et dans notre aire d’étude, seule la Suisse permet la conduite à 17 ans sous des conditions particulières. Ce choix, peut‑être non réfléchi par la scénariste mais forcément repéré par les éditeurs sans avoir été corrigé, contrairement à l’exemple de la boîte postale, campe à coup sûr la série comme une aventure américaine. De la même manière que les dollars, qui s’affichent sans complexe depuis quelques dizaines de gags. Sans complexe, mais sans toutefois préciser qu’il s’agit de dollars canadiens, et non américains!
***
Répondant à tous les codes de la bande dessinée franco‑belge bien que québécoise, la série Les Nombrils laisse de plus en plus voir au fil des albums sa géographie et culture de création. Cette réapparition du Québec plusieurs années après la « déquébécisation » des planches de Safarir est d’autant plus notable qu’elle contrevient à un acte d’effacement identitaire initialement conceptualisé par les auteurs. L’hypothèse la plus probable est celle d’une double conjonction permettant une réaffirmation au fil de l’eau, mêlant action interne et externe. En effet, le développement de la série nécessite d’élargir le décor pour éviter la redondance, et lui donner un certain souffle épique. Dans ce cadre, les nouveaux lieux et nouvelles focales du récit imposent des choix de décors et des marqueurs plus reconnaissables. D’un autre côté, on peut imaginer que le succès réel de la série a aussi pu donner plus de latitude aux auteurs, désormais à même de représenter plus simplement le Québec de leur quotidien. Une latitude d’autant plus importante que de nouveaux intermédiaires, les assistants au dessin, venaient ajouter de l’information et des décors plus précis, donc plus référencés. Il reste que cette réapparition du Québec peut, vue d’Europe, d’abord être celle de l’Amérique. Pour un public adolescent, qui n’a pas une connaissance fine des différences interaméricaines, les grands carrefours routiers, les ponts massifs d’acier ou la représentation interne de l’établissement scolaire peuvent plus facilement évoquer une réalité étatsunienne. Le marqueur québécois le plus évident pour un public connaisseur, c’est‑à‑dire le vocabulaire ou les expressions idiomatiques, reste quasi invisible, et rien des débats identitaires québécois n’est directement transmis dans la bande dessinée. Cette lecture amène à s’interroger sur une possible réception erronée de la série, non seulement comme une série d’origine européenne par son format type et son premier journal de prépublication, mais de surcroît comme une série européenne tentant de mettre en scène des adolescents aux États‑Unis, d’autant plus que les auteurs ont affirmé à plusieurs reprises être de grands consommateurs de téléséries étatsuniennes[38]. Une déclaration qui souligne encore la porosité des frontières et les difficultés de classification de créations de plus en plus marquées par des circulations et des échanges rendant désuètes les volontés de catégorisation nationale, très présentes dans la bande dessinée où les formats de création sont souvent liés à des histoires éditoriales géographiquement situées. Si classifier a toujours sa pertinence et son utilité, cette étude ne peut que confirmer l’importance de mettre en question le terme canonique de « bande dessinée franco‑belge », obsolète quasiment depuis sa création – l’histoire européenne de la bande dessinée la faisant débuter par les créations du Suisse Rodolphe Töpffer au xixe siècle.
Appendices
Notes biographiques
Maël Rannou est élève conservateur des bibliothèques à l’Institut national d’études territoriales (INET), ancien directeur des bibliothèques de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et du service de lecture publique de Laval (France), auteur et critique de bande dessinée. Doctorant en sciences de l’information et de la communication (Université Paris-Saclay/Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines), sa thèse porte sur la bande dessinée québécoise et ses circulations dans et avec l’espace francophone européen, et ses recherches sur le fanzinat et les formes d’édition marginales. Éditeur du fanzine Gorgonzola, mêlant articles sur la mémoire de la BD et création, intervenant dans diverses formations en métiers du livre, il a dirigé Bande dessinée en bibliothèque (Cercle de la Librairie, 2018) et publié Pif Gadget et le communisme (PLG, 2022) et, avec Stéphanie Khoury, Les bibliothèques de proximité (Presses universitaires Blaise Pascal, 2022).
Noémie Sirat est diplômée en histoire de l’art de l’Université Toulouse-Jean Jaurès, et a soutenu en 2022 son Master « Patrimoines et Cultures Numériques » à l’Université d’Avignon. Son travail de recherche porte sur la médiation par la bande dessinée pour le jeune public au sein d’un musée. Tout en cherchant un poste en bibliothèque ou en musée, elle écrit des articles sur le manga pour le Journal du Japon.
Notes
-
[1]
Richard Langlois, « Les Nombrils – T1 : Pour qui tu te prends? – Par Delaf & Dubuc – Dupuis », ActuaBD, 2 mars 2006, https://www.actuabd.com/Les-Nombrils-T1-Pour-Qui-tu-te-Prends-Par-Delaf-Dubuc-Dupuis (consulté le 26 avril 2023).
-
[2]
Nicolas Anspach, « Les Nombrils – T2 – Sale Temps pour les moches – Par Delaf & Dubuc – Dupuis », ActuaBD, 16 février 2007, https://www.actuabd.com/Les-Nombrils-T2-Sale-Temps-pour-les-moches-Par-Delaf-Dubuc-Dupuis (consulté le 26 avril 2023).
-
[3]
Nicolas Anspach, « L’Ambassadeur du Canada en Belgique rend hommage aux “Nombrils” », ActuaBD, 23 novembre 2011, https://www.actuabd.com/+L-Ambassadeur-du-Canada-en-Belgique-rend-hommage-aux-Nombrils (consulté le 26 avril 2023).
-
[4]
Marianne St-Jacques, « Delaf & Dubuc : “Nous aimons surprendre le lecteur” », ActuaBD, 15 novembre 2008, https://www.actuabd.com/Delaf-Dubuc-Nous-aimons-surprendre-le-lecteur (consulté le 26 avril 2023).
-
[5]
Olivier Renault, « Les Nombrils, c’est un succès historique », Ouest-France, 12 octobre 2009, https://lemans.maville.com/actu/actudet_--b-i-Les-Nombrils-i-b-c-est-un-succes-historique-_-1106554_actu.Htm (consulté le 26 avril 2023).
-
[6]
Hélène de Billy, « Les Nombrils : une BD québécoise, un succès international! », Sélection du Reader’s Digest Canada, avril 2016, https://www.selection.ca/reportages/les-nombrils-une-bd-quebecoise-un-succes-international (consulté le 26 avril 2023).
-
[7]
Annick Pellegrin, « VICKY: Young, Rich, Popular, Sexy, Gay, and Unhappy », dans Dominick Grace et Eric Hoffman (dir.), The Canadian Alternative. Cartoonists, Comics, and Graphic Novels, Jackson, University Press of Mississippi, 2018, p. 83-97.
-
[8]
Dans une communication, Chris Reyns-Chikuma aborde cette québécité effacée : « Guy Delisle est né en 1966 et a grandi à Québec (au Québec au Canada). [...] Il a toutefois installé sa base en France dès les années 1990 pour ne revenir que très épisodiquement au Québec ou au Canada. Il y a trouvé son premier milieu de travail et son éditeur, L’Association. Le Québec n’apparaît que très peu dans son oeuvre même comme arrière-fond-décor et moins encore comme thème »; Chris Reyns-Chikuma, « Les BD de Guy Delisle sont-elles canadiennes et/ou québécoises et/ou cosmopolites? », journée d’étude de l’Association québécoise pour l’étude de l’imprimé, 21 avril 2023. Nous remercions M. Reyns-Chikuma de nous avoir transmis son tapuscrit d’intervention.
-
[9]
Nous comprenons dans cette étude les huit tomes de la série principale (Dupuis, 2006-2018), mais pas les deux tomes de la série LesvacheriesdesNombrils (Dupuis, 2017-2019). Ceux-ci se déroulent chronologiquement dans le passé et reviennent à un format gag simple, s’apparentant plus selon notre lecture à un produit dérivé qu’à des titres appartenant réellement au canon, de la même manière que les novélisations, pourtant en partie réalisées par Maryse Dubuc.
-
[10]
Page Facebook officielle « Les Nombrils », https://www.facebook.com/lesnombrils (consultée le 26 avril 2023).
-
[11]
Réjean Blais, « Qu’adviendra-t-il de la BD Les Nombrils? », Radio-Canada, 15 octobre 2021, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831325/delaf-dubuc-les-nombrils-rejean-blais (consulté le 26 avril 2023).
-
[12]
On peut d’ailleurs y noter le projet d’une série avec Jocelyn Boisvert, futur scénariste de la série Mort et déterré chez Dupuis, dessinée par Pascal Colpron après sa période de dessinateur adjoint pour Les Nombrils.
-
[13]
Richard Langlois, « Marc Delafontaine (Delaf) », La bande dessinée made in Sherbrooke, catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 1996, p. 55-62.
-
[14]
Forg et Jean-François Simard, Les aventures de Garou – La Menace Fantasse, Montréal, CDA Artistique, 2002.
-
[15]
La fille parfaite (2003), Ma voisine est une vedette (2004) et Vert avril (2005) paraissent tous dans la collection « ADO » de Vent d’Ouest avant la parution du premier tombe des Nombrils. Elle a aussi travaillé pour les éditions scolaires Modulo.
-
[16]
Allison Reber, « Les Nombrils : l’humour vache, ça marche! », Bodoï, 2 octobre 2009, http://www.bodoi.info/les-nombrils-lhumour-vache-ca-marche (consulté le 26 avril 2023).
-
[17]
Philippe Van Meerbeeck, Ainsi soient-ils! À l’école de l’adolescence, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2012, p. 205-206.
-
[18]
Vent d’Ouest est une maison d’édition fondée en 1981, rachetée par Glénat en 1991, et ayant aujourd’hui avant tout une existence de label ou de collection.
-
[19]
Nicolas Anspach, « Marc Cuadrado : “J’aime me servir des petites choses de la vie pour en faire un gag” », ActuaBD, 16 mai 2007, https://www.actuabd.com/Cuadrado-J-aime-me-servir-des-petites-choses-de-la-vie-pour-en-faire-un-gag (consulté le 26 avril 2023).
-
[20]
Allison Reber, « Les Nombrils : l’humour vache, ça marche! », Bodoï, 2 octobre 2009, http://www.bodoi.info/les-nombrils-lhumour-vache-ca-marche (consulté le 26 avril 2023).
-
[21]
Jean-Christophe Menu, Plates-bandes, Paris, L’Association, coll. « L’Éprouvette », 2005.
-
[22]
Maël Rannou, « La bande dessinée québécoise et ses liens avec l’Europe francophone : une histoire artistique et critique encore à établir », Études canadiennes/Canadian Studies, n° 90, juin 2021, https://doi.org/10.4000/eccs.4774 (consulté le 26 avril 2023).
-
[23]
Après l’arrêt de Saf-BD, la publication des Nombrils continue en effet dans Safarir, ce qui aurait pu justifier deux versions, mais il s’agit dès le début de la reprise des mêmes versions que dans Spirou. La série paraît ponctuellement dans d’autres magazines, mais le support éditorial initial reste toujours Spirou. On relève notamment des pages dans le magazine québécois pour adolescentes Cool ou dans W.I.T.C.H., magazine de Disney remplaçant Minnie Magazine, ce qui indique un ciblage du public féminin.
-
[24]
Voir Hélène de Billy, « Les Nombrils : une BD québécoise, un succès international! », Sélection du Reader’s Digest Canada, avril 2016, https://www.selection.ca/reportages/les-nombrils-une-bd-quebecoise-un-succes-international (consulté le 27 avril 2023).
-
[25]
Voir Davy Bigot et Robert A. Papen, « Sur la “norme” du français oral au Québec (et au Canada en général) », Langage et société, vol. 4, n° 146, 2013, p. 115-132.
-
[26]
Cela malgré le fait que « Spirou » soit directement un statalisme wallon, désignant un écureuil et, au sens figuré, une personne vive et espiègle.
-
[27]
Nous ne pouvons le présenter pour des raisons de droits, mais la page est toujours consultable sur le compte Facebook officiel : https://www.facebook.com/lesnombrils/photos/a.130144874412/10150657711399413 (consulté le 26 avril 2023).
-
[28]
https://www.facebook.com/lesnombrils/photos/a.130144874412/10150632583924413 (consulté le 26 avril 2023).
-
[29]
Nous invitons particulièrement à aller lire cette bande, qui touche au coeur de notre sujet : https://www.facebook.com/photo/?fbid=10154027032589413&set=a.130144874412 (consulté le 26 avril 2023).
-
[30]
Il est probable qu’elle ait été publiée précédemment dans Spirou comme dessin d’animation, mais nous n’en avons pas retrouvé trace.
-
[31]
Anna Giaufret, Montréal dans les bulles. Représentations de l’espace urbain et du français parlé montréalais dans la bande dessinée, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Voies du français », 2021, p. 194. Plus globalement, on lira avec intérêt les chapitres 4 et 5 pour notre sujet.
-
[32]
Voir la publication sur la page Facebook des Nombrils : https://www.facebook.com/lesnombrils/photos/a.130144874412/10151174654044413 (consultée le 26 avril 2023).
-
[33]
Entretien inédit avec Pascal Colpron, en visioconférence, 19 juillet 2022.
-
[34]
Entretien inédit avec Pascal Colpron, en visioconférence, 19 juillet 2022.
-
[35]
Entretien inédit avec Fabio Lai, par courriel, le 10 septembre 2022.
-
[36]
Pour ce qui est de la perception européenne, l’expérience personnelle des deux auteurs permet cependant d’imaginer que, pour des enfants lecteurs de Spirou, ce pont pouvait très bien être confondu avec celui de San Francisco, et les grandes avenues ou gratte-ciel s’apparenter parfaitement à ceux des séries télévisées étatsuniennes, se mêlant dans une vague image de l’Amérique du Nord. Les représentations sont bien différentes, mais il ne faut pas minimiser l’influence sur nos imaginaires d’alors du manque de connaissance d’autres américanités que celle, grand public, des séries télévisées à succès.
-
[37]
On peut à ce sujet lire l’intéressant chapitre sur les interventions des correcteurs dans Anna Giaufret, Montréal dans les bulles.Représentations de l’espace urbain et du français parlé montréalais dans la bande dessinée, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Voies du français », 2021.
-
[38]
Voir par exemple la publication « Influences... » sur la page Facebook « Les Nombrils » le 26 mai 2012 : https://www.facebook.com/lesnombrils/photos/a.130144874412/10150935344169413 (consultée le 26 avril 2023).
Bibliographie
- « Les Nombrils », https://www.facebook.com/lesnombrils.
- Entretien en visioconférence avec Pascal Colpron, 19 juillet 2022.
- Entretien par courriel avec Fabio Lai, 10 septembre 2022.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 1. Pour qui tu te prends?, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2006.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 2.Sale temps pour les moches, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2007.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 3.Les liens de l’amitié, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2008.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 4.Duel de belles, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2009.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 5.Un couple d’enfer, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2011.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 6. Un été trop mortel!, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2013.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 7. Un bonheur presque parfait, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2015.
- Dubuc et Delaf, Les Nombrils. 8.Ex, drague et rock’n’roll!, Marcinelle, Dupuis, coll. « Tous publics », 2018.
- Nicolas Anspach, « Les Nombrils – T2 – Sale Temps pour les moches – Par Delaf & Dubuc – Dupuis », ActuaBD, 16 février 2007, https://www.actuabd.com/Les-Nombrils-T2-Sale-Temps-pour-les-moches-Par-Delaf-Dubuc-Dupuis.
- Nicolas Anspach, « L’Ambassadeur du Canada en Belgique rend hommage aux “Nombrils” », ActuaBD, 23 novembre 2011, https://www.actuabd.com/+L-Ambassadeur-du-Canada-en-Belgique-rend-hommage-aux-Nombrils.
- Nicolas Anspach, « Marc Cuadrado : “J’aime me servir des petites choses de la vie pour en faire un gag” », ActuaBD, 16 mai 2007, https://www.actuabd.com/Cuadrado-J-aime-me-servir-des-petites-choses-de-la-vie-pour-en-faire-un-gag.
- Davy Bigot et Robert A. Papen, « Sur la “norme” du français oral au Québec (et au Canada en général) », Langage et société, vol. 4, n° 146, 2013, p. 115-132.
- Réjean Blais, « Qu’adviendra-t-il de la BD Les Nombrils? », Radio-Canada, 15 octobre 2021, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831325/delaf-dubuc-les-nombrils-rejean-blais.
- Hélène de Billy, « Les Nombrils : une BD québécoise, un succès international! », Sélection du Reader’s Digest Canada, avril 2016, https://www.selection.ca/reportages/les-nombrils-une-bd-quebecoise-un-succes-international.
- Anna Giaufret, Montréal dans les bulles.Représentations de l’espace urbain et du français parlé montréalais dans la bande dessinée, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Voies du français », 2021, p. 194.
- Forg et Jean-François Simard, Les aventures de Garou – La menace Fantasse, Montréal, CDA Artistique, 2002.
- Richard Langlois, « Les Nombrils – T1 : Pour qui tu te prends? – Par Delaf & Dubuc – Dupuis », ActuaBD, 2 mars 2006, https://www.actuabd.com/Les-Nombrils-T1-Pour-Qui-tu-te-Prends-Par-Delaf-Dubuc-Dupuis.
- Richard Langlois, « Marc Delafontaine (Delaf) », La bande dessinée made in Sherbrooke, catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 1996, p. 55-62.
- Annick Pellegrin, « VICKY: Young, Rich, Popular, Sexy, Gay, and Unhappy », dans Dominick Grace et Eric Hoffman (dir.), The Canadian Alternative: Cartoonists, Comics, and Graphic Novels, Jackson, University Press of Mississippi, 2018, p. 83-97.
- Maël Rannou, « La bande dessinée québécoise et ses liens avec l’Europe francophone : une histoire artistique et critique encore à établir », Études canadiennes/Canadian Studies, n° 90, juin 2021, https://doi.org/10.4000/eccs.4774.
- Allison Reber, « Les Nombrils : l’humour vache, ça marche! », Bodoï, 2 octobre 2009, http://www.bodoi.info/les-nombrils-lhumour-vache-ca-marche.
- Olivier Renault, « Les Nombrils, c’est un succès historique », Ouest-France, 12 octobre 2009, https://lemans.maville.com/actu/actudet_--b-i-Les-Nombrils-i-b-c-est-un-succes-historique-_-1106554_actu.Htm.
- Chris Reyns-Chikuma, « Les BD de Guy Delisle sont-elles canadiennes et/ou québécoises et/ou cosmopolites? », journée d’étude de l’Association québécoise pour l’étude de l’imprimé, 21 avril 2023.
- Marianne St-Jacques, « Delaf & Dubuc : “Nous aimons surprendre le lecteur” », ActuaBD, 15 novembre 2008, https://www.actuabd.com/Delaf-Dubuc-Nous-aimons-surprendre-le-lecteur.
- Philippe Van Meerbeeck, Ainsi soient-ils! À l’école de l’adolescence, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2012, p. 205-206.
Sources
Ouvrages et articles
List of figures
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5