Abstracts
Résumé
Cet article propose d’analyser la trajectoire de Julie Doucet en tant que révélatrice des dynamiques et enjeux relatifs aux sphères de production culturelle dans lesquelles elle s’inscrit. Depuis ses débuts dans la bande dessinée « underground » montréalaise dans la deuxième moitié des années 1980 jusqu’à son prétendu « adieu » au média à la fin de la décennie suivante, Julie Doucet a parcouru quelques-uns des lieux les plus importants de la bande dessinée nord-américaine et européenne. De Montréal à Berlin, en passant par New York, Portland (Oregon) et Paris, suivre cette trajectoire équivaut à cartographier le renouveau de la bande dessinée au cours de la décennie 1990, des deux côtés de l’Atlantique. L’oeuvre de Doucet a été largement étudiée et est considérée comme emblématique de la bande dessinée des années 1990, car elle épouse quelques-unes des caractéristiques principales de l’époque : dimension autobiographique; travail sur le corps, la sexualité et l’abject; et un penchant féministe. À ces thématiques, nous proposons d’ajouter celle de l’éclatement du média qu’elle opère par des formes et techniques nouvelles. À cet effet, une attention particulière sera d’ailleurs accordée à la place qu’occupe la bande dessinée de Doucet dans un ensemble plus grand de pratiques, notamment la relation qu’elle entretient avec les marges de la production culturelle. La production de zines de Doucet - tant avant sa professionnalisation au tournant des années 1980 et 1990 qu’après son retrait au tournant 1990-2000 - en est le signe le plus évident. Il s’agit d’ailleurs d’une question qui travaillera notre article de manière souterraine : comment se négocie le rapport de la marge au centre pour une artiste comme Doucet, particulièrement au regard de l’intégration tardive de la bande dessinée au champ culturel? De ce point de vue, un opérateur central de travail de Doucet se révèle : le jeu avec le positionnement d’outsider. Cet opérateur est perceptible à la fois à la lecture interne des oeuvres (le choix des thèmes, de la langue, et l’exploration formelle au coeur de sa démarche), et dans les choix éditoriaux et stratégiques de l’autrice (le rapport à la bande dessinée sur la longue durée et le retour au zine, la mobilité, les commentaires de Doucet sur son parcours et son oeuvre). Cet article présente finalement, et pour la première fois, une bibliographie exhaustive des publications de Doucet, incluant toute sa production autoéditée, de la deuxième moitié des années 1980 à aujourd’hui.
Mots-clés :
- Julie Doucet,
- Zines,
- Bande dessinée,
- Transferts,
- Marginalité
Abstract
This article studies Julie Doucet’s trajectory as a revelation of the dynamics and issues related to the spheres of cultural production in which the artist is embedded. From her beginnings in the Montreal “underground” comic scene in the second half of the 1980s to her so-called “farewell” to the medium at the end of the following decade, Julie Doucet has journeyed through some of the most important venues in the world of North American and European comics, from Montreal to Berlin, via New York, Portland (Oregon) and Paris. Doucet’s work has been widely studied and is considered to embrace some of the characteristics of 1990s comics: body representation, sexuality and the abject; and a feminist inclination. To these themes, we propose adding the fragmentation of the medium in which she operates brought about by new forms and techniques. Particular attention will be given to the place that Doucet’s comics occupy in a larger set of practices, notably the close relationship that she maintains with the margins of cultural production. The relationship is most obvious in the production of Doucet’s zines - both before her professionalization at the turn of the 1980s and 1990s and since her withdrawal at the turn of 1990-2000. Our article addresses, in a somewhat subversive manner, the following question: how is the relationship between the margin and the center negotiated for an artist like Doucet, particularly in light of the late integration of comics into the cultural field? Examining Doucet’s work from such an angle reveals a central operator: her play with the outsider position. This operator is perceptible both in the internal reading of the works (the choice of themes and of language, and the formal exploration at the heart of her approach), and in Doucet’s editorial and strategic choices (the relationship to comics over the long term and the return to the zine, her mobility, her personal comments on her career and her work). Finally, our article presents an exhaustive ground-breaking bibliography of Doucet’s publications, including all of her self-published works, from the second half of the 1980s to the present.
Keywords:
- Julie Doucet,
- Zines,
- Comics,
- Transfers,
- Marginality
Article body
Depuis la remise du Grand Prix de la ville d’Angoulême en 2022, l’oeuvre de Julie Doucet suscite un intérêt renouvelé. Cette récompense accordée à une oeuvre que beaucoup considéraient à la fois trop underground, trop ouvertement féministe ou choquante et, surtout, interrompue depuis une vingtaine d’années, a été qualifiée de surprenante, inattendue, voire « paradoxale[1] ». Il a été noté depuis longtemps qu’après une carrière fulgurante pendant les années 1990, Doucet a « abandonné[2] » la bande dessinée à la fin des années 1990. Se détournant du média, l’artiste passe donc au second plan. Or, l’exposition qui lui a été dédiée à Angoulême en marge de l’édition 2023 du festival ‑ chaque année le récipiendaire du prix de l’année précédente voit son travail célébré dans une exposition de grande envergure ‑ a révélé une part considérable de l’oeuvre de Doucet qui était restée dans l’ombre pour la plus grande partie du public[3]. Gravures, collages, arts imprimés, films d’animation : c’est bien une oeuvre foisonnante débordant largement le cadre de la bande dessinée qui est ainsi donnée à voir.
Cet article propose une remise en cause du discours dominant sur l’oeuvre de Julie Doucet, notamment en mettant en lumière l’importante production suivant la soi‑disant « rupture » du tournant 1990‑2000. Ce sera, on le verra, l’occasion de revisiter cette oeuvre à la lumière de sa récente consécration, en nous demandant plus précisément dans quel champ l’inscrire, et de quelle manière redécouper la périodisation de son travail. Le parcours de Doucet est marqué par des allers‑retours constants entre le centre et les marges; plus encore, l’observation de sa trajectoire artistique sur une période de plus de 35 ans permet même de redéfinir ce qui constituerait une position liminaire. Nos questionnements concernent à la fois la sociologie du champ de l’art et la sociologie de la littérature : il s’agit dans cet article d’interroger l’esthétique de Doucet à la lumière de ses « déplacements » sociologiques. Dans L’absence du maître, Michel Biron qualifie la littérature québécoise de liminaire. C’est afin de prolonger les thèses de Jacques Dubois sur l’institution littéraire que Biron propose l’idée d’une littérature québécoise qui se détourne des hiérarchies sociales, où tout est proximité horizontale, tel un « monde carnavalesque par défaut, un monde qui ne s’élabore pas contre la structure, mais dans l’absence de structure[4] ». Si cette hypothèse concerne en premier lieu un imaginaire de l’espace social chez Saint‑Denys Garneau, Ferron et Ducharme, elle trouve aussi son écho dans un champ littéraire où « la domination esthétique est ambiguë, car elle ne s’accompagne que d’un pouvoir de consécration relatif[5] ». Cette méfiance des institutions dont l’écrivain québécois fait l’expérience, cette éternelle marginalité à laquelle il est confiné, et dans laquelle il trouve son confort, n’est pas une boutade avant‑gardiste : elle est le nom d’un investissement de l’« espace des possibles[6] », selon l’expression d’Anna Boschetti.
Nous chercherons ici à attirer l’attention sur des aspects formels et thématiques de l’oeuvre de Doucet qui n’ont pas, jusqu’à présent, attiré l’attention de la critique. Nous insisterons sur les effets induits par les différentes éditions et rééditions de son oeuvre, ainsi que par les transferts d’un support à l’autre. Nous verrons également que certains éléments esthétiques qui prévalent dans son oeuvre, tels que l’utilisation de techniques mixtes ou l’importance du collage, ne sont pas sans lien avec cette cohabitation de diverses formes médiatiques, ainsi qu’avec la langue et sa circulation internationale. C’est la notion de transfert (intermédial, linguistique) qui nous permettra de rendre compte de sa position liminaire dans plusieurs champs distincts (celui de l’art, de la bande dessinée), dans des lieux éditoriaux variés (maisons d’édition hautement institutionnalisées, fanzinat, etc.) et dans plusieurs espaces nationaux, et de redéfinir la manière dont Doucet se positionne par rapport à ces divers centres géographiques et symboliques, ainsi que par rapport aux marges sociales et artistiques. C’est en effet depuis une position liminaire que Doucet explore les genres, les thèmes et les formes de chaque champ distinct qu’elle investit. Chaque « déplacement » est pour Doucet un nouveau « possible » qu’elle explore en fonction de sa position. Et c’est pour cette raison que l’attention que nous porterons au fanzinat est une clé de voûte de notre analyse.
Nous entreprenons d’abord un examen de la réception universitaire de son travail. Ensuite, nous reconstituons la trajectoire de Doucet à la faveur d’une périodisation inédite. La conclusion de l’article est suivie d’une bibliographie complète de son oeuvre publiée, accompagnée d’un bref commentaire. Cette étude a donc avant tout comme objectif de nuancer le discours critique sur l’oeuvre de Doucet, mais également de tirer quelques leçons méthodologiques de l’analyse d’un corpus qui ne saurait être assigné à une littérature nationale spécifique, ni à un seul genre, ni à un seul support. Nous proposons enfin d’intégrer dans les études sur l’oeuvre de Doucet une portion considérable de son travail laissée jusqu’ici dans l’ombre, soit quasiment l’ensemble de sa production depuis la fin des années 1990, représentant, paradoxalement, la plus grande part de l’activité créatrice de l’artiste.
Études universitaires
Au sein du corpus des auteurs et autrices de la bande dessinée québécoise, Julie Doucet est sans doute l’artiste la plus étudiée. Les travaux qui lui sont consacrés se sont cependant cantonnés à la bande dessinée, et laissent plusieurs angles morts qui oblitèrent sa trajectoire d’ensemble. L’essentiel des études sur Doucet se concentre sur la première partie de son oeuvre, allant de la publication du zine Dirty plotte en 1988‑1990 jusqu’à son « adieu » au champ de la bande dessinée, à la fin de la décennie 1990. Le « récit officiel » qui sous‑tend toute analyse de la trajectoire de Doucet enferme son oeuvre dans un cadre très strict. Après des débuts dans le fanzinat (l’underground) à la fin des années 1980, Doucet fait une entrée fracassante dans les champs américain, puis français de la bande dessinée. En tant que rare femme dans un monde d’hommes, porteuse d’une esthétique crue, d’un style unique, dans une forme autobiographique inédite, elle aurait grandement contribué à révolutionner le monde de la bande dessinée et à en établir les codes pour les décennies à venir. Puis, soudainement, elle « disparaîtrait » autour de 2000, quittant un monde « hostile » pour une retraite inattendue et inexpliquée. Cette mise en récit, bien que s’appuyant sur un ensemble de faits vérifiables et d’analyses que nous partageons, présente un problème de cadrage en situant l’ensemble de l’oeuvre de Doucet autour d’un seul pôle : le champ de la bande dessinée, que ce soit aux États‑Unis ou en France. Cette assignation a instauré des biais considérables. Le plus évident est la réduction qu’elle opère. De la production de Doucet, vaste et très diverse, seule une fraction est prise en compte. La très grande majorité des études portent en effet sur des oeuvres produites et publiées sur une période d’une dizaine d’années, entre 1988 (le début de la série de zines Dirty plotte) et 1998‑1999 (la fin du comicsDirty plotte édité par Drawn & Quarterly et la republication de Changements d’adresses/My New York Diary en album, novembre 1998/mai 1999)[7]. On verra dans la deuxième partie de notre article, et à partir de la bibliographie complète des travaux de Doucet que nous présentons, l’imposante production rendue de ce fait invisible[8].
Les études portant sur l’oeuvre de Doucet ont plusieurs traits en commun. La plupart sont signées par des universitaires américains et américaines appartenant à la discipline des comics studies. De façon générale, les analyses présentées se limitent donc à la bande dessinée disponible en langue anglaise, et se concentrent sur l’une ou plusieurs de ces thématiques : la dimension autobiographique ou autofictionnelle, le rapport au corps et à la sexualité, notamment son traitement par le grotesque, et la relation de Doucet au féminisme. Dans une moindre mesure, certaines études abordent également la circulation internationale de Doucet, en particulier sa place en tant que dessinatrice québécoise dans les champs américains et français de la bande dessinée[9].
Brogniez, Cardell, Chase, Engelmann, Lamothe, MacLeod, Pendergast et Stark ont tous insisté sur la dimension autobiographique de la bande dessinée de Doucet. Sans surprise, ses oeuvres autobiographiques les plus connues ‑ Changements d’adresses ou son Journal (avril 2004; traduit en 365 Days, 2007) ‑ attirent de ce point de vue le plus l’attention. On y note sa contribution au renouveau du genre autobiographique en bande dessinée dans les années 1990, qualifiée par les expressions peu heureuses d’« autobioBD[10] » ou d’« autobiocomics ». Selon plusieurs, le principe autobiographique dépasse largement chez Doucet le cadre de la stricte mise en récit de soi. Brogniez affirme par exemple que « la quête de soi ne semble pas avoir de fin[11] » dans son travail, et est marquée par un engagement ferme envers l’authenticité du discours. Pendergast, pour sa part, explore l’hypothèse que même les récits les plus fictionnels de Doucet exigent avant tout d’être lus au prisme de l’autobiographie : « Doucet’s stories show that an author can be more “present” in fiction than in autobiography[12]. » Anne Elizabeth Moore fait d’ailleurs du rapport à soi la clé de voûte de sa monographie sur la bande dessinée de Doucet ‑ la seule à avoir été dédiée au travail de l’autrice à ce jour ‑, ce qu’indique parfaitement le titre des chapitres : « The Actual Self », « The Imagined Self », « The Dreamed Self », « The Not‑Self‑At‑All », « The Unknown Self »[13].
Le corps, la violence et la sexualité sont également des thèmes importants dans les études sur Doucet[14]. La notion d’abject, telle que théorisée par Julia Kristeva[15], et celles de grotesque et de carnavalesque, telles que développées par Mikhail Bakhtine[16], y sont mobilisées pour analyser les planches les plus violentes, ou jugées les plus subversives. Cette caractérisation du rapport au corps est, à son tour, tantôt inscrite en continuité avec la bande dessinée underground américaine (on pense à Crumb, notamment), tantôt chevillée à la dimension féministe de son travail, question tout aussi centrale dans les études la concernant[17]. Pour Vincent, c’est par la confrontation entre une représentation grotesque du corps féminin et la mise en scène, singée, d’un idéal féminin que la bande dessinée de Doucet peut se comprendre comme une prise de position féministe :
En le réduisant à de la matière charnelle et en le soumettant à une violence explicite, Doucet arrive à opposer son corps‑matière au corps social, figé et déterminé par la norme. Démembrement, défiguration, cannibalisme, automutilation : le corps chez Doucet se construit dans la violence. Tous ces procédés servent à repenser le corps féminin et la féminité[18].
Tinker souligne plus explicitement que les autres la connivence entre les planches de Doucet et l’esthétique et les propositions politiques du mouvement Riot Grrrl, souvent considéré comme l’instigateur du féminisme dit de « troisième vague », au tout début des années 1990[19]. Le fait que la série de zines Dirty plotte précède le début « officiel » de ce mouvement plaide en faveur d’une certaine clairvoyance de la part de Doucet, qui serait parvenue à saisir un sentiment partagé avant même qu’il ne s’exprime clairement dans une mobilisation à grande échelle. Les études les plus convaincantes sur la bande dessinée de Doucet s’intéressent par ailleurs à l’entrecroisement de ces thèmes dans un cadre autobiographique ou autofictionnel[20].
Si ces remarques, et en particulier le nouage entre représentation du corps, démarche autobiographique et prise de position féministe, offrent un regard satisfaisant sur la bande dessinée de Doucet, il semble important de noter que l’autrice elle‑même a souvent pris la parole pour rejeter en partie ces cadres d’analyse. L’inclusion aux corpus autobiographique ou féministe semble particulièrement problématique pour Doucet. Cette dernière hésite en effet sans cesse à ranger sans équivoque son travail dans l’une ou l’autre de ces catégories. Cette ambiguïté est par ailleurs un topos récurrent dans le discours de Doucet sur son oeuvre. L’artiste insiste sur l’importance de dépasser la tentation autobiographique, et la difficulté de faire une oeuvre autobiographique intéressante :
I think autobiography ‑ it’s sort of a mental illness. [Mok laughs.] Yeah, in a way! You can do it for a while, but you have to move on to something else, unless you’re somebody like [King‑Cat cartoonist] John Porcellino who has a very special and personal vision about how to do it[21].
Dans un même temps, Doucet signale elle‑même à plusieurs reprises son incapacité à s’affranchir complètement de l’autobiographie. La comparaison avec la maladie mentale met bien en lumière cette tension entre le désir et l’incapacité de dépasser la référence autobiographique dans son travail :
Je crois que je suis incapable de faire autre chose (rires). J’ai essayé de faire de la fiction avec « L’Affaire Madame Paul », et là encore j’ai été obligé [sic] de m’accrocher à quelque chose de réel qui partait de ma vie car je n’arrivais pas vraiment à faire de la fiction[22].
On trouve le même positionnement ambigu pour ce qui est du caractère féministe de son travail. Ces propos, rapportés par Andrea Juno dans son livre Dangerous Drawings. Interviews with Comix and Graphix Artists (2007), en témoignent:
Of course I’m a feminist, even though that can mean so many things. I would say « yes », because of what I do. And my own position is not to let anybody forbid me to do what I want. You have to be yourself and do whatever you want to do. But I’m not really a feminist in the sense that I’m not going to write about it and try to convert people, saying, you should think this way or that way, blah blah blah. Trying to make people think your way by banging on their heads with a hammer is no good[23].
Cette hésitation est visible dès le départ, alors que Doucet fait ses premières armes sur la série de zines Dirty plotte. Le zine porte ainsi différentes mentions éditoriales au fil des numéros, qui signalent une hésitation : de « Fanzine féministe de mauvais goût » (no 4 et 5, décembre 1988 et janvier 1989), on passe à « Fanzine féminin de mauvais goût » (no 6, février 1989), puis à une disparition de toute référence au féminisme ou au genre pour les numéros suivants (« Bandes dessinées » ou « Comics » « de Julie Doucet »).
On peut voir, dans ce refus d’une adhésion complète au militantisme féministe, une tension entre les formes de valorisation et de distinction propres au champ de la bande dessinée, et celles propres au champ politique. Cette tension n’est pas rare pour la bande dessinée qualifiée d’underground, où la transgression morale joue un rôle esthétique fondamental. Doucet affirme explicitement être une héritière de ce genre[24]. Cette tension en redouble une autre, plus spécifique au féminisme en bande dessinée. Galvan note que « feminism within comics has always been out of sync with mainstream feminism. Feminist underground comics creators of the 1970s were consistently denied space in feminist bookstores and magazines[25] ». Cette expérience est d’ailleurs confirmée par Doucet elle‑même, évoquant s’être fait refuser la vente en consignation du zine Dirty plotte parce que jugé trop sexiste[26].
La posture favorisée par Doucet ne refuse donc pas complètement l’assignation au genre autobiographique ou au discours féministe. Il s’agit plutôt de se positionner à l’intérieur de ces catégories sans y adhérer pleinement. Sur le plan politique, l’autrice cherche à préserver une certaine autonomie dans le travail artistique, tout en reconnaissant l’évidence de son caractère féministe. Sur le plan esthétique, elle souligne les limites du genre auquel on tente parfois de contraindre son oeuvre, tout en l’y rattachant. Par ces positionnements ambigus, Doucet occupe une position liminaire, en marge de l’espace où elle se situe, à la limite du dedans et du dehors du discours encadrant son oeuvre.
On se trouve donc ici face à un problème fondamental dans le regard porté sur l’oeuvre de Doucet. En un sens, l’artiste déjoue elle‑même le regard critique et théorique sur son oeuvre. On verra, en plaçant la bande dessinée dans sa trajectoire d’ensemble, comment la liminarité déborde largement son rapport à l’autobiographie et au féminisme, pour recouvrir la totalité de ses positionnements éditoriaux (entre le fanzinat et l’autoédition d’un côté, entre l’édition indépendante et l’institution éditoriale de l’autre), son appartenance à plusieurs champs culturels nationaux (québécois, américain, français), ainsi qu’à plusieurs segments de ces champs culturels (le champ de la bande dessinée, le champ de l’art, voire, dans une certaine mesure, le champ littéraire). C’est à partir de ce positionnement que Doucet est en mesure de bouleverser les codes de chacun des espaces qu’elle traverse tout au long de sa trajectoire.
Périodisation
Le récent retour de Doucet à la bande dessinée, marqué par la publication de l’anthologie Maxiplotte chez L’Association en 2021, puis par l’obtention du Grand Prix de la ville d’Angoulême et la publication de Time Zone J l’année suivante, a suscité une grande surprise et montre bien la vitalité du travail de l’artiste.
Nous identifions trois périodes distinctes dans l’oeuvre de Doucet : 1) sa première carrière dans le champ de la bande dessinée, démarrée avec la participation à de nombreux zines menant à la publication de Dirty plotte (1988‑1990), et s’achevant par son retour à Montréal et son « abandon » du support à la fin des années 1990; 2) un retour aux arts imprimés (que Doucet a étudiés à l’Université du Québec à Montréal au milieu des années 1980) et une importante diversification de son travail, caractérisé par l’exploration de techniques de travail (sérigraphie, gravure) et l’introduction au monde de l’art contemporain, instaurée par la série de zines Sophie Punt (2000‑2005); 3) une consolidation de son inscription dans le fanzinat, cette fois marquée par une volonté de s’approprier les outils de son travail et de gagner en autonomie, amorcée par la publication de la série Der Stein (2010‑2012) et poursuivie avec le projet de « monoéditeur » Le Pantalitaire lancé en 2013. Les dernières années, et en particulier son retour marqué dans le champ de la bande dessinée, laissent quant à elles entrevoir le début d’une nouvelle période qu’il serait trop hâtif de caractériser en détail. L’analyse que nous dégageons de cette périodisation de l’oeuvre de Doucet s’appuie sur sa production de zines. En suivant l’évolution de sa participation au fanzinat, il devient en effet plus facile de noter les inflexions centrales de sa trajectoire au cours des 35 dernières années.
Dirty plotte et les années 1990
La première période rassemble l’essentiel de son travail des années 1980. On y trouve notamment la série de zines Dirty plotte, publiée de 1988 à 1990, et ensuite en grande partie reprise dans la réédition en comic books par Drawn & Quarterly (1991‑1998). C’est au cours de cette première période que le travail de Douet atteint une reconnaissance internationale, et c’en est, encore à ce jour, essentiellement la seule partie à être connue et reconnue tant par le public que dans les études universitaires. Malgré la reconnaissance et la circulation importantes dont elle profite rapidement, Doucet continue pendant toute cette période d’entretenir des liens forts avec le fanzinat, principalement de bande dessinée. C’est d’ailleurs à travers les canaux du fanzinat que son travail se fera d’abord connaître aux États‑Unis et en Europe. Via Factsheet Five, un « métazine » rassemblant des centaines de recensions de zines et tirant à plus de 10 000 exemplaires, Doucet fait connaître la première mouture de Dirty plotte aux États‑Unis. Son zine tombe entre les mains des éditrices et éditeurs de Rip Off Press et de leur Wimmen’s Comix (janvier 1989), puis d’Aline Kominsky‑Crumb, alors éditrice de Weirdo (septembre 1989), qui éditeront les premiers ses planches aux États‑Unis. De la même manière, Doucet se taille rapidement une place dans le champ de la bande dessinée française en participant à plusieurs zines importants de l’époque, notamment Sortez la Chienne (octobre 1989), Peltex (janvier 1990) ou S2 L’Art? (janvier 1990). Jean‑Christophe Menu, membre fondateur de L’Association, découvre le travail de Doucet dans les pages de S2 L’Art? avant de lui offrir de publier un album compilant des planches d’abord publiées dans Dirty plotte[27]. Cet album, Ciboire de criss! (juin 1996), sera le premier de L’Association réalisé par une femme, et le premier par une bédéiste étrangère.
Pour bien apprécier l’importance de l’ancrage de Doucet dans le fanzinat, il ne suffit donc pas de rappeler qu’elle y a fait ses premières armes. Les planches de Doucet sont en effet souvent d’abord autopubliées dans des zines avant d’être reprises par des maisons d’édition. Le contenu du zine Dirty plotte sera ainsi presque intégralement republié dans le magazine Dirty plotte (1991‑1998) publié par Drawn & Quarterly. Ses albums en anglais (Lève ta jambe mon poisson est mort! en octobre 1993, Monkey and the living dead en février 1994, My most secret desire en 1995, Ciboire de criss! ou Changements d’adresses en novembre 1998) sont entièrement faits de planches déjà publiées dans Dirty plotte, dans ses versions zine ou magazine. En aval, ses planches seront également amplement reprises dans un grand nombre de zines à cette même époque. Malgré ses succès dans les champs américain et français de la bande dessinée, Doucet gardera pendant la décennie des liens forts et actifs avec le fanzinat.
Doucet bouge elle‑même beaucoup pendant cette période. De Montréal, elle déménage à New York au début de la décennie (sur laquelle elle reviendra dans Changements d’adresses), puis à Seattle. Elle part pour Berlin en 1995, où elle restera jusqu’en 1998. Elle ne retournera s’installer définitivement à Montréal qu’en 1999, abandonnant du même coup sa place dans le champ de la bande dessinée pour renouer avec la publication de zines.
Les années 1990 placent donc Doucet dans une position liminaire, au croisement de la bande dessinée dite « alternative » (ou « roman graphique », d’abord aux États‑Unis), qui profite alors d’une légitimité et d’une reconnaissance croissantes, et du fanzinat, resté cantonné aux marges du champ culturel, et du champ de la bande dessinée en particulier. Cette position sur les deux plans ‑ zinester dans le champ de la bande dessinée, bédéiste professionnalisée dans le fanzinat ‑ lui permet de réinvestir dans le milieu du zine la reconnaissance bientôt internationale dont elle profite en tant que bédéiste. La publication de la série Monkey and the living dead montre bien que cette circulation ne se fait pas dans un seul sens. D’abord publiés en anglais dans le magazine Dirty plotte édité par Drawn & Quarterly (no 1 à 5), les cinq épisodes sont ensuite réédités en France, toujours en anglais, dans le zine de Stéphane Blanquet, Chacal Puant (no 5 à 7), en 1992‑1993. Le même Blanquet éditera, traduite en français cette fois, la série rassemblée en un album (février 1994), accompagnée d’un long entretien avec Doucet qui situe son travail entre le fanzinat et la bande dessinée, entre le Québec, les États‑Unis et la France. En avril 1999, L’Association la republie finalement dans sa collection « Mimolette », achevant pour ainsi dire l’intégration de la série au champ de la bande dessinée française. On voit bien comment, à partir de cet exemple, Doucet joue sur tous les fronts, et tire profit de sa position liminaire : usant de son positionnement d’entre‑deux pour faciliter la circulation internationale de son travail.
Cette approche est bien sûr favorisée par sa présence dans plusieurs espaces nationaux et linguistiques sur la période ‑ le Québec et le Canada (francophone mais également anglophone, via Drawn & Quarterly), la France, les États‑Unis (côtes est et ouest), l’Allemagne. Son rôle en tant que Québécoise aux États‑Unis ou en Europe, souvent mis en scène dans sa bande dessinée, supporte une stratégie fondée sur une position liminaire. Son travail sur la langue en témoigne. On peut citer rapidement, comme exemples, les titres que Doucet donne à ses bandes dessinées : le bilingue Dirty plotte (qui demande d’ailleurs une explication pour les publics non québécois, fournie dans l’incipit du premier numéro du comic bookDirty plotte en janvier 1991); le français de Lève ta jambe mon poisson est mort pour son premier album en anglais en octobre 1993; le québécisme de Ciboire de criss! pour son premier album en France en juin 1996, etc. La republication par L’Oie de Cravan de l’intégrale des zines Dirty plotte, à l’été 2013, montre bien que ce jeu avec les langues ne se limite pas aux titres. Cette édition bilingue, intitulée Fantastic plotte!, fait le pari de publier les planches dans leur langue originale, puis de les reproduire en version traduite dans le même livre. Le résultat est à l’image du zine Dirty plotte : un mélange souvent improbable de québécois et de mauvais anglais. Dans l’introduction, Doucet raconte avoir écrit ses premières bandes dessinées en anglais « avec mon rapidographe et ce qui me restait de mon cours d’anglais du secondaire cinq comme seuls outils », ajoutant : « Écrire dans une autre langue, c’est amusant et très reposant : on ne passe pas son temps à retourner chaque mot dans tous les sens, on fait ce qu’on peut et c’est tout » (été 2013, non paginé).
Sophie Punt et les années 2000
Avec son retour à Montréal à la fin des années 1990, Doucet cherche à renouveler sa pratique non seulement en se détournant du dessin et de la bande dessinée, mais également en organisant différemment son travail sur le plan matériel. Elle devient membre de l’Atelier Graff à l’automne 1999[28], où elle retourne aux arts imprimés. Elle y apprend la sérigraphie, puis la gravure. Après plusieurs années d’absence, Doucet retrouve pour ainsi dire son milieu d’origine : la scène culturelle alternative montréalaise. Avec Benoît Chaput, fondateur des éditions de L’Oie de Cravan, elle participe au Mouvement Lent. Elle contribue à la Revue des animaux, éditée par Chaput (juin 2000). La publication du premier numéro de Sophie Punt, en octobre 2000[29], est contemporaine de son adhésion à ce mouvement aux contours délibérément flous.
Sophie Punt est la série de zines la plus diverse sur le plan formel de l’oeuvre de Doucet. Chaque numéro prend une forme différente des précédents, allant du recueil d’illustrations sérigraphié d’un format A5[30] relativement standard (le même que la plupart des numéros du zine Dirty plotte) au livre d’artiste, en passant par une pléthore de formats et présentations atypiques. Ce côté exploratoire se reflète jusque dans la numérotation[31]. Doucet expérimente sur tous les plans : dans les matériaux utilisés, dans la langue employée, et dans les modes de circulation privilégiés. Les numéros 2 et 3 (« spécial astrologie » et « spécial mode : costume de bain », respectivement) sont imprimés sur le papier récupéré d’un journal italien montréalais, et contiennent du texte (notamment à partir de collages) en anglais et en français. Le numéro 5 ‑ « spécial Distroboto » ‑ est conçu spécialement pour le projet Distroboto, mis sur pied par Archive Montréal, qui transforme des machines distributrices de cigarettes en machines distributrices de zines et autres oeuvres d’art de petit format. Les numéros 58, « Käännöstoimisto » (novembre 2002; « bureau de traduction » en finlandais), et 16, « C’est fini ‑ Loppu » (mai 2003), sont rédigés en « mauvais finnois » et circulent dans des machines distributrices similaires, à Helsinki en Finlande[32]. Les numéros 9 (« La lenteur. Conseils pratiques et choix d’outils ») et 11 (« La création de l’univers. Variations ») rapprochent nettement la pratique de Doucet du livre d’artiste. Le premier est imprimé sur les pages d’une encyclopédie illustrée en anglais, et présente une série d’outils nécessaires à la vie selon les principes du Mouvement Lent : « Le soulier modérateur », « la botte nonchalante RECULEZ SANS CALCULER! », etc. (décembre 2002). Le numéro 11 signale l’aboutissement de la série et met en lumière le chemin parcouru depuis 2000. Il prend la forme d’un livre d’artiste d’une centaine de pages rassemblant collages de textes et d’images, dessins abstraits ou d’observation, poèmes réalisés à partir de coupures de journaux et magazines, explorations avec les impressions. L’ensemble offre une synthèse impressionnante du travail de Doucet depuis son retour à Montréal.
Un autre exemple de la créativité caractéristique de cette période : le projet d’installation‑performance‑boutique Le Magasin. Organisé à deux reprises, en juin 2003 et mai 2004, l’événement rassemble Doucet, certaines collègues de l’Atelier Graff, ainsi que des acteurs et actrices du milieu culturel alternatif montréalais. Doucet produit, à ces occasions, une panoplie d’objets, dont des biscuits de fortune personnalisés (juin 2003), des faux disques vinyles en carton du groupe Les Slow (du Mouvement Lent) avec Benoît Chaput (2003, 2004), un masque en forme de nez géant (avril 2004), des autocollants sérigraphiés (juin 2003), des flyers (avril 2004), et autres babioles du même genre. Une partie de cette production est d’ailleurs documentée dans les pages de Lady Pep, et on peut trouver un compte rendu du premier événement dans le Journal (avril 2004, 01.06.03‑04.06.03).
De la même manière que les planches du zine Dirty plotte sont le socle de son travail en bande dessinée édité par des maisons reconnues, les zines de Sophie Punt servent de base aux livres Long Time Relationship (juillet 2001) et Lady Pep (décembre 2004) publiés chez Drawn & Quarterly. Le premier titre reproduit d’ailleurs des gravures de Doucet, faites à partir de photos trouvées à Berlin, et qui approvisionneront ensuite son livre coécrit avec Benoît Chaput, Melek (2001). La maison d’édition de Brooklyn Picture Box republie quant à elle le 11e numéro de Sophie Punt en décembre 2006, sous le titre Elle‑Humour.
Ce rapprochement de l’édition d’art s’accompagne, en France, d’un rapprochement de l’édition littéraire. Doucet publie, aux éditions du Seuil, des gravures illustrant les Chroniques de New York de Jean‑François Jouanne (septembre 2003). C’est également au Seuil qu’elle fait paraître son autobiographie en poèmes faits de collages, J comme Je (janvier 2005). Toujours en France mais en marge de l’institution éditoriale, elle produit un graphzine (un genre de zine composé d’images, souvent sérigraphié, très présent en France) avec Le Dernier Cri, un acteur majeur du fanzinat français. La création des Copieuses (septembre 2003), racontée dans le Journal, rassemble d’ailleurs les artistes avec qui elle collabore à l’Atelier Graff, et avec qui elle avait déjà réalisé un graphzine à Montréal le mois précédent : Ruby Red (août 2003). On retrouve d’ailleurs une partie des collaboratrices dans le livre d’artiste 963, édité plus tard par l’Atelier Graff (avril 2006).
La période entamée par la publication de la série Sophie Punt est donc marquée à la fois par des ruptures et une extension considérable du domaine d’activité de Doucet ‑ retour à Montréal, éloignement du dessin et de la bande dessinée, explorations formelles et techniques ‑ et par une certaine continuité, en particulier dans sa participation aux fanzinats québécois et français. La parution du film My New New York Diary, film d’animation réalisé par Michel Gondry à partir de dessins de Doucet, puis édité sous la forme d’un livre par Picture Box (novembre 2010), clôt ainsi clairement cette période. On y trouve en effet à la fois la trace de son travail des années 1990, constamment réactivé par les rééditions de ses bandes dessinées pendant la décennie 2000, et la mise à distance de cette première période, notamment par l’exploration de pratiques nouvelles.
À partir de la deuxième moitié des années 2000, Doucet déplace le travail d’exploration amorcé avec Sophie Punt dans le champ des arts visuels. À l’école de l’amour montre bien cette évolution dans la continuité. L’oeuvre prend d’abord la forme d’une exposition à la galerie Clark, présentée d’août 2005 à avril 2006. Doucet y expose une série de sculptures, accompagnée de poèmes en collages sur le thème du chagrin amoureux. Le recueil de poèmes lui‑même s’apparente à un livre d’artiste composé de cinq bandeaux, rassemblés dans une boîte en carton sérigraphiée et portant le titre de Poèmes d’amour (2006). À intervalles réguliers, Doucet réarrange les sculptures et donne à lire une nouvelle partie du livre/zine sur lequel les poèmes sont imprimés[33]. Ce travail sera ensuite republié sous le titre À l’école de l’amour en 2007 par L’Oie de Cravan, ainsi que dans plusieurs ouvrages collectifs[34].
D’autres projets restent pour leur part cantonnés au circuit local du fanzinat et des scènes culturelles alternatives montréalaises, tout en témoignant des acquis des années précédentes. C’est le cas du couple Chevalladar/Autrinisme de règlohnette : grandamme (septembre 2005/mai 2005). Comme les titres le laissent soupçonner, on a affaire à une oeuvre assez cryptique : le premier est un journal écrit (sans illustrations) couvrant les cinq premiers mois de l’année 2005. Sa lecture est compliquée par le fait que s’y mélangent au français des mots d’une langue inventée par Doucet, le règlonhette. Pour décoder Chevalladar (« journal » en règlonhette), il faut donc l’autrinisme, le dictionnaire abrégé. Plus la lecture de Chevalladar avance, plus la règlonhette remplace le français, rendant progressivement plus difficile sa compréhension, et demandant donc un réel investissement du lectorat. Il est intéressant de comparer ces deux publications au Journal, l’une des oeuvres les plus lues et étudiées de Doucet. Si leur contenu est comparable, leur circulation, radicalement différente, en altère complètement le sens. Rédigé en partie dans une langue inventée, tiré à 22 exemplaires distribués directement par l’artiste, ce journal particulièrement intime illustre parfaitement le paradoxe de la publication semi‑privée qui caractérise une bonne partie du fanzinat[35]. L’effet est par ailleurs redoublé par le fait que Chevalladar n’ait jamais été réédité, et donc que la seule copie accessible au public soit disponible, sur rendez‑vous, dans la collection de livres d’artistes et d’ouvrages de bibliophilie de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ‑ Rosemont. Plus encore, les pages du journal n’ont jamais été découpées, problème auquel le protocole de conservation de la collection nationale interdit bien évidemment de remédier. La lecture de ce journal, couvrant une période cruciale dans le parcours de Doucet et faisant preuve d’un travail considérable d’encryptage de la part de l’artiste, est donc compliquée à la fois par son écriture dans une langue inventée, par son accessibilité très restreinte, ainsi que par la contrainte matérielle des pages non découpées.
Du point de vue de la bande dessinée, les années 2000 représentent une rupture forte dans l’oeuvre de Doucet, souvent résumée par un « abandon » du support, voire par la « disparition » de l’artiste. L’artiste se tourne vers de nouvelles techniques, s’associe à des maisons d’édition opérant dans différents créneaux (dans des aires culturelles et géographiques différentes, de tailles variées, dans des champs culturels distincts, s’adressant à divers publics, etc.), étend son activité aux champs des arts visuels et de la littérature, et consolide les réseaux internationaux qu’elle a tissés au cours de la décennie précédente. Prenant en compte l’importance de cette rupture dans le parcours de l’artiste, nous tenons cependant à insister sur la forte continuité qui caractérise sa démarche de fond. Malgré de grands changements, sa position liminaire et les stratégies qu’elle permet restent au coeur de l’approche de Doucet. On retrouve ainsi le travail sur la langue de la décennie précédente, poussé à l’extrême par le couple Chevalladar/Autrinisme de règlohnette, ou encore les allers‑retours entre l’édition reconnue et le fanzinat avec la série Sophie Punt, republiée par divers éditeurs dans des livres d’art et d’illustration. Plus qu’une clôture, les années 2000 sont, pour l’oeuvre de Doucet, une période d’ouverture : ouverture à de nouvelles techniques, de nouveaux milieux, de nouveaux publics, qu’elle confronte à une approche développée au cours de la décennie précédente, et supportée par une position liminaire à la jonction de plusieurs espaces de production culturelle.
Der Stein et Le Pantalitaire (2010‑2019)
À partir de 2010, une troisième période s’amorce avec la publication de Der Stein (2010‑2012). Cette nouvelle période d’expérimentation marque une mise à distance du monde de l’art, et un investissement redoublé dans le fanzinat. Ce repositionnement s’articule sur plusieurs plans ‑ linguistique, éditorial, économique, esthétique. La période s’ouvre sur la publication d’une série de zines entièrement écrits en allemand, et voit Doucet mettre sur pied une structure éditoriale unique, Le Pantalitaire. En parallèle, la collaboration de l’artiste avec ses éditeurs est pour l’essentiel mise en suspens, si ce n’est pour la republication de ses bandes dessinées, dans des anthologies dédiées à son travail (été 2013, avril 2016 et novembre 2017, octobre 2018, mars 2020, novembre 2021).
On peut reconnaître dans les neuf zines de Der Stein certains aspects déjà présents dans le travail de Doucet des années précédentes. Les zines sont sérigraphiés à l’Atelier Graff, et incorporent souvent des collages de textes et de photographies. Les numéros 3 et 5 (septembre 2010, janvier 2011) prennent la forme de récits autobiographiques racontant des voyages (en Suisse, en Abitibi). On peut en un sens les lire en relation avec les publications les plus autobiographiques de Doucet (Changements d’adresses, Journal, J comme Je, Chevalladar), et on y revoit des personnages déjà connus (la cousine Martine, Jean‑Christophe Menu, Jean‑François Jouanne, Stéphane Blanquet, etc.). On retrouve également l’humour caustique que Doucet avait développé dans Dirty plotte, mais qui avait pris une forme nouvelle avec À l’école de l’amour, reconnaissable dans les numéros 6 et 7 (mars et juin 2011), notamment. Dans l’ensemble cependant, Doucet tient un propos assez nouveau dans Der Stein, nommément une critique de l’art, des artistes et du milieu artistique. Tous les numéros incluent un passage ironisant sur l’art, parfois au prix de longs détours indiquant une volonté claire de l’artiste d’aborder la question. Le premier et les deux derniers numéros y sont entièrement dédiés. Le premier présente une série de courts poèmes humoristiques sur l’art, et annonce The Adorable Little School of Art of Canada (été 2014). « Der Stein sagt: jetzt reicht’s!!! Danach verlässt der Stein Kunst an der Autobahn und nie wieder zurückkommt[36]. » Le numéro 8 ‑ sous‑titré « histoires vraies » ‑ propose une série de courts textes brossant le portrait d’artistes et parodiant le milieu de l’art. Le diagnostic reste le même : « Macht Kunst Ihren Magen “sauer”? Der Stein räumt den Magen auf[37]. » Mais c’est avec le dernier numéro que la rupture paraît la plus franche. Sous‑titré « Die Suche nach Kunst[38] », il annonce la volonté de Doucet de quitter définitivement le milieu. Ce n’est pourtant pas la pratique artistique elle‑même qui semble la rebuter. Le zine est magnifiquement réalisé : il s’agit sans doute de l’une des plus belles publications de Doucet. Ses pages présentent des abstractions géométriques, imprimées en sérigraphie. Les jeux avec les couleurs, la composition, les trames, la perspective et les contrastes sont particulièrement réussis. Au fil des pages, de courtes phrases semblent mettre en scène une voix, perdue dans le dédale des pages, un espace abstrait représentant l’art, le monde de l’art. « Der Stein ist auf der Suche nach Kunst / Wird der Stein die Kunst finden? / Wo ist die Kunst? / Die Kunst? Wo ist die versteckt? / Woher ist die weggegangen? / Der Stein ist ganz verzweifelt. / Der Stein lässt es fallen. Der die Suche gibt auf. Ende[39]. »
La critique du monde de l’art puis la rupture annoncée dans Der Stein ne sont pas qu’affaires de discours. Dans les années suivantes, Doucet quitte l’Atelier Graff, fonde son projet d’édition Le Pantalitaire, et suspend ses collaborations avec les galeries d’art et les musées. Si les années 2000 l’avaient vue se rapprocher du monde de l’art, la décennie suivante la voit s’en éloigner, et s’engager plus fermement dans le fanzinat. Le parti pris d’une série de zines rédigés en allemand confine également Der Stein aux marges, et exclut la possibilité d’une republication chez les éditeurs avec lesquels Doucet travaille habituellement. Même Reprodukt, la maison d’édition allemande avec laquelle elle commence à collaborer alors qu’elle habite Berlin, ne publie que de la bande dessinée, et ne s’intéressera pas à la série de zines. S’il y a donc continuité dans la démarche ‑ Doucet joue après tout avec les langues depuis la fin des années 1980 avec la première série Dirty plotte ‑, l’artiste se retranche dans le fanzinat et les marges du milieu culturel.
C’est dans ce contexte que voit le jour le projet du Pantalitaire. Le Pantalitaire se présente comme un « mono‑éditeur qui ne publie qu’un seul auteur, une seule auteure : julie doucet[40] ». Doucet l’enregistre légalement en mai 2013, notamment afin de pouvoir produire ses propres ISBN. Si elle avait l’ambition initiale de publier et distribuer ses propres livres, l’ampleur de la tâche lui intime plutôt de réserver Le Pantalitaire à la publication de zines. En examinant les publications de Pantalitaire de plus près, on peut noter un pic vers 2015. Les premières années du projet se caractérisent non seulement par une production importante de nouveaux titres (Nouilles/Noodles, mai 2013; Un, deux, trois, je ne suis plus là, mai 2013; La mémoire se mange, printemps 2014; The Adorable Little School of Art of Canada, été 2014; Art Scrap Craft, octobre 2014; Sauve‑qui‑peut!, septembre 2015; Going Somewhere?, novembre 2015), mais également par la republication de zines publiés précédemment. Ainsi de Skizzenbuch ‑ d’abord publié par Reprodukt sous le titre de Schnitte (mai 1996/automne 2013) ‑ de même que de 99‑plus suicide projects (septembre 2012/septembre 2013), le révolution (novembre 2011/septembre 2013), J’aime (septembre 2012/hiver 2014), rémi eurelec et les autres (septembre 2012/2014).
À partir de 2016, les zines publiés au Pantalitaire reflètent la plus récente inflexion dans le travail de Doucet. Dans le numéro 3 de Poirette (juillet 2018), Doucet renoue avec l’autobiographie. Le zine est constitué presque uniquement de photographies, des portraits de l’artiste, prises entre 1978 et 2018. La série de 24 photos, organisée en ordre chronologique, va de la photo de classe au portrait pris dans un photomaton, et montre l’artiste traversant les âges. Si, on l’a vu, l’idée d’un « abandon » du dessin et de l’autobiographie par Doucet est largement exagérée, on peut tout de même noter que le numéro 3 de Poirette marque le premier effort d’autoreprésentation visuelle depuis la parution de My New New York Diary en novembre 2010, et annonce à sa manière les pages couvertes d’autoportraits de Time Zone J/Suicide total (avril 2022/janvier 2023).
Dessins à main levée avec correcteur (août 2016) laissait présager quant à lui déjà le retour au dessin pour Doucet, qu’elle n’avait pas touché depuis le même My New New York Diary[41]. Les 18 portraits présentés dans le zine, datés d’avril à juillet 2016, collent au « réel » de façon marquée, se distinguant de ses croquis de la deuxième moitié des années 1990. On y retrouve d’ailleurs, une touche de réalisme en moins, un style que Doucet avait déjà exploré dans Long Time Relationship (juillet 2001), notamment pour un autoportrait réalisé en gravure sur bois à partir d’une des photos ensuite publiées dans le numéro 3 de Poirette. Le dessin qu’elle propose dans son plus récent livre de bande dessinée rappelle celui des Dessins à main levée.
Dans l’ensemble, la pratique de Doucet pendant les années 2010 fait montre d’une évolution de son rapport à l’édition et l’autoédition. On l’a vu, le contenu des zines des séries Dirty plotte et Sophie Punt a été presque intégralement republié dans des comic books et des livres par des éditeurs reconnus. Les zines de cette troisième période ne feront quant à eux pas l’objet de republications. Le fossé se creuse entre la publication de zines et de livres. En 2016, Doucet publie chez Drawn & Quarterly Carpet Sweeper Tales, seul livre proposant un contenu inédit de la décennie. Le livre fait écho à certains zines du Pantalitaire (Going Somewhere?, novembre 2015, ou, plus encore, Kpsake, hiver 2016, viennent immédiatement à l’esprit). La série d’histoires courtes, réalisées à partir de vieux photoromans italiens, peut être analysée comme la suite logique des recherches formelles que Doucet a entreprises avec le collage, ou encore en continuité directe avec son travail sur la langue et le langage. Cependant, et contrairement à la plupart des livres qu’elle a précédemment publiés, Carper Sweeper Tales présente un contenu entièrement original, n’ayant jamais fait l’objet d’une première publication dans le fanzinat ou dans le monde de l’art. Ce fossé entre sa production de zines autoédités et de livres chez des éditeurs reste vrai pour Time Zone J/Suicide total.
Le Pantalitaire donne une idée à la fois de la cohérence et des multiples ruptures et repositionnements à l’oeuvre dans la trajectoire de Doucet depuis les années 2000. Par son nom, d’abord, qui provient d’un mot inventé par Doucet pour une série de cinq zines et/ou livres d’artiste publiée au rythme d’un par mois, de juin à octobre 2007. Doucet reprend ensuite ce titre pour sa participation à la Triennale québécoise 2008 Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Elle le réutilise par la suite pour son projet le plus éloigné des champs de la bande dessinée et des arts visuels jusqu’alors. Ce transfert est d’ailleurs signalé par le fait que le premier zine publié sous l’étiquette du Pantalitaire, Un, deux, trois, je ne suis plus là (2013), a lui aussi vu le jour dans le monde de l’art, sous la forme d’une exposition présentée à la Biennale de Montréal, en 2007. En ce sens, la critique et la mise à distance du monde de l’art entamées par Der Stein s’accomplissent dans les éditions du Pantalitaire, en prenant la forme d’un réinvestissement de son expérience des années précédentes dans le fanzinat et l’autoédition.
Les années 1990 marquaient une incursion dans le champ de la bande dessinée, les années 2000 une autre, dans le champ des arts visuels et, dans une moindre mesure, dans le champ littéraire. Dans les deux cas, Doucet n’abandonne jamais complètement son attachement à l’autoédition, au fanzinat et au milieu alternatif. Au contraire, son travail des années 2010 est caractérisé par une tentative de consolidation autour du « monoéditeur » Le Pantalitaire, qui se soldera finalement par un échec. Un échec qui souligne, encore une fois, l’importance d’un positionnement multiple s’appuyant sur la liminarité comme stratégie éditoriale et artistique, mais aussi comme catalyseur et moteur de création chez Doucet. Du fanzinat, elle se lance d’abord dans le champ de la bande dessinée. Revenue au fanzinat à la fin des années 1990, elle se tourne ensuite vers le champ des arts visuels, avant de s’en détourner pour retourner à la publication de zines. Les années 2010 la voient donc, via Le Pantalitaire, tenter de concentrer sa production dans le fanzinat seul. Son retour en force dans le champ de la bande dessinée au début des années 2020 montre bien, il nous semble, que Doucet revient sans cesse à l’entre‑deux, se maintenant toujours à la fois dans la marge de l’underground et au coeur du sous‑champ de production restreinte.
Transferts
Sur la base de la réception critique présentée plus haut et de la périodisation que nous proposons, il convient à présent de voir comment la logique de transfert qui préside à ses positionnements successifs dans divers champs trouve son incarnation dans les choix esthétiques de Julie Doucet. Il nous semble clair que les différentes ruptures dans son oeuvre sont à chaque fois le signe d’un transfert qui touche les stratégies tant éditoriales (les positionnements entre différents champs et marchés) qu’esthétiques de l’artiste. Les déplacements entre diverses formes médiatiques, via notamment les rééditions de son travail, et les jeux avec les différentes langues en sont les signes les plus évidents.
Comme nous l’avons vu précédemment, les lectures critiques de Doucet sont grandement influencées par la circulation de certaines de ses oeuvres dans des territoires spécifiques fluctuant au rythme des rééditions et des oeuvres à diffusion restreinte. Sa présence dans le champ américain illustre cette tension entre un contexte de production initial (le fanzinat) et la diffusion élargie d’oeuvres rééditées (par des maisons d’édition reconnues). C’est en effet aux États‑Unis que l’oeuvre de Doucet est d’abord connue et célébrée : elle publie rapidement chez les éditeurs les plus reconnus des deux côtes, ce qui fera dire à Dan Nadel qu’elle traverse toutes les scènes américaines les plus importantes de son époque : « Weirdo, Pictopia, Buzzard, Heck!, Snake Eyes, Wimmen’s Comix, Rip Off Comix, and of course Drawn & Quarterly itself. Raw excepted, she managed to cross into every comics scene available in North America at the time[42]. » Ce qui n’est, d’ailleurs, pas tout à fait vrai, puisque Doucet collabore bel et bien à Raw, pour l’Exquisite Corpse (cadavre exquis) dirigé par Art Spiegelman (janvier 1995). Par sa position liminaire ‑ fraîchement sortie du fanzinat, Québécoise aux États‑Unis, femme dans un monde largement masculin ‑, Doucet profite d’ailleurs d’une mobilité plus importante que la plupart de ses collègues bédéistes, au point de parfois franchir des clivages importants à l’intérieur du champ. On peut penser, par exemple, à la rivalité entre les deux « clans » féministes issus de la rupture entre Trina Robbins, et Aline Kominsky‑Crumb et Diane Noomin. Doucet publie autant dans le Wimmen’s Comix de Robbins (janvier 1989) et la maison Rip Off Press qui y est associée (octobre 1990), que dans le Weirdo d’Aline Kominsky‑Crumb (septembre 1989, mars 1990) et l’anthologie Twister Sisters de Diane Noomin (novembre 1991). On retrouve d’ailleurs la même capacité à passer outre les clivages dans le champ français, où Doucet collabore autant, on l’a vu, avec Stéphane Blanquet qu’avec Pakito Bolino et Le Dernier Cri (mai 2002, 2003, septembre 2003), alors que les deux artistes et éditeurs sont des antagonistes déclarés.
Dans le contexte américain en particulier, le travail de Doucet est principalement connu par l’entremise du comic bookDirty plotte ou via des republications dans des magazines et anthologies. La période pendant laquelle elle est le plus active aux États‑Unis, les années 1990, est également celle où sa production de zines est à son plus bas, et Doucet n’aura jamais le même ancrage dans le fanzinat américain dont elle dispose au Québec et en France. Si elle reste malgré tout associée au fanzinat ‑ peu ignorent que Dirty plotte a d’abord été autopublié dans une série de zines ‑, son travail se diffuse surtout via la publication chez des éditeurs. Quand elle retourne à Montréal à la fin des années 1990 et réinvestit le fanzinat, son travail continuera de circuler aux États‑Unis, mais encore une fois via les rééditions de Sophie Punt par Drawn & Quarterly (Long Time Relationship, juillet 2001; Lady Pep, décembre 2004) ou Picture Box (Elle‑Humour, décembre 2006). Pour ce qui est des zines ‑ des séries Sophie Punt, Der Stein ou, plus tard, du Pantalitaire ‑, ils circulent depuis Montréal, Doucet en assurant la distribution elle‑même.
C’est donc tout le rapport au fanzinat et à l’autopublication qui est oblitéré par une lecture de son oeuvre faisant fi des transferts intermédiaux. Dans la plupart des cas, l’engagement de Doucet dans le fanzinat n’est pas connu ou reconnu. Dans les meilleurs, il est mentionné, mais toujours en rapport avec la bande dessinée, alors même que la plus grande partie de la production de Doucet ne prend pas cette forme. On trouve quelques exceptions. Moore parle des autres publications, en signale plusieurs et note même différents moments dans l’ensemble de son oeuvre; elle distingue l’abstraction, les collages, le photoroman Carpet Sweeper Tales, etc. Elle avance même que ce dernier titre, publié en 2016, a attiré plus d’attention de la critique que tout autre avant lui[43]. D’autres ont également des intuitions fortes quant à l’importance du fanzinat, mais toujours en rapport avec Dirty plotte comme contexte d’origine de sa bande dessinée, effaçant la production subséquente. Vincent relève, à juste titre, la portée du fanzinat dans la trajectoire de Doucet :
Doucet produit une oeuvre indépendante « […] that teaches girls how to be cultural producers, rather than consumers […] By making a zine, girls learn that if they do not like the cultural products offered to them, they can produce their own » [Schilt, 2003]. En effet, en produisant une oeuvre alternative et radicale qui transgresse les frontières de la culture dominante, Doucet offre de nouvelles perspectives sur les images produites sur les femmes. Avec son humour décapant et transgressif, elle tire une langue triomphante à une société qui l’enferme dans une conception de la féminité qu’elle refuse en exposant son instabilité[44].
Elle néglige en revanche toute la partie suivante de l’oeuvre de Doucet. En bref, Doucet est toujours abordée à partir de sa production de bande dessinée, et quand on mentionne ses oeuvres subséquentes, c’est généralement suivant cette perspective. Quand on évoque le fanzinat ‑ voie permettant à notre avis de lire l’ensemble du travail de Doucet ‑, ce n’est qu’en rapport avec la bande dessinée, les autres zines de Doucet (proportionnellement beaucoup plus nombreux et occupant une part beaucoup plus importante de sa période d’activité) étant ignorés. Nous avons pris dans cet article le fanzinat comme point de départ pour comprendre l’oeuvre de Doucet, restituant sa participation au champ de la bande dessinée comme une parenthèse. Y apparaît une oeuvre d’une grande cohérence sur le plan de la stratégie éditoriale.
On pourra d’ailleurs interpréter à nouveaux frais les éléments les plus étudiés du travail de Doucet ‑ son rapport à l’autobiographie, au féminisme, le travail sans tabous sur le corps ‑ en lien avec la culture du zine. Le fanzinat se caractérise notamment par une circulation restreinte, un contact privilégié et réduisant au minimum les intermédiaires entre les créatrices et créateurs et leurs publics, une prise en charge de l’ensemble du travail d’édition par une seule personne et une valorisation de la mise en commun des intimités[45]. De ce fait découle une interprétation plus large de la part autobiographique dans son oeuvre, la personne de l’autrice ou de l’auteur étant souvent directement en contact, voire connue, de son lectorat. Le rapport au tabou est également bousculé par l’édition de zines, les mécanismes de censure et d’autocensure étant partiellement contournés par une circulation en dehors des circuits conventionnels dans un espace entre le public et le privé, ainsi que par une mise à distance des exigences légales de l’institution éditoriale (ISBN/ISSN, dépôt légal, lois encadrant la liberté d’expression, la diffamation, l’atteinte aux moeurs, etc.). Finalement, il est important de noter que le fanzinat a joué un rôle essentiel dans le développement et la diffusion des « nouvelles » idées féministes et queers depuis le milieu des années 1980, et de façon croissante au long des années 1990 et 2000. En d’autres mots, on peut jeter un regard nouveau sur les aspects les plus étudiés de l’oeuvre de Doucet en la resituant dans son contexte d’origine, que la republication dans l’édition conventionnelle efface.
La même chose peut être dite du rapport aux langues, également vecteur de transferts. Une incompréhension persiste sur cette question. Plusieurs études notent que Doucet est francophone dans un milieu anglophone[46]. On voit là une explication de son regard particulier, ou une forme d’exotisme, avec les mots en joual, le mauvais anglais, etc. D’autres critiques, au contraire, n’ont pas conscience du rapport complexe à la langue dans le travail de Doucet, comme on peut le voir par exemple dans l’entretien de 1997 avec Juno. Doucet affirme être intéressée par les explorations linguistiques: « That’s more the stuff I’m trying to do ‑ drawing with colored inks, and text in bad German » (elle fait ici référence à Schnitte ‑ Caricature of Love, publié en mai 1996 chez Reprodukt, à Berlin). Juno s’empresse de répondre : « No, stick with English for me[47]! » Ce que Juno ne perçoit pas à ce moment, comme beaucoup d’amatrices et d’amateurs ou de critiques, c’est que leur contact est toujours médié par la traduction, une bonne partie des planches qu’ils connaissent et aiment ayant été traduites pour leur republication et leur distribution sur le marché américain, que ce soit via le comic bookDirty plotte ou les republications en albums. Cette ignorance et ce « rejet », de la part de Juno, d’une partie importante du travail de Doucet montrent à quel point il est impératif de saisir les transferts intermédiaux afin de rendre raison des transferts linguistiques correspondants qui sont autant de déplacements géographiques.
***
Cet article a donc cherché à reconstituer la trajectoire de Doucet dans son ensemble en identifiant des continuités plutôt que des ruptures, et surtout en utilisant comme clé de voûte la logique de transferts marquant à la fois le support matériel de ses oeuvres et leur circulation. Si nos conclusions s’appliquent de manière restreinte à l’oeuvre de Doucet, il n’est pas interdit d’y voir un cas paradigmatique pour l’étude d’oeuvres qui se situent tour à tour en marge du champ éditorial et en son centre, ou qui n’appartiennent pas en propre à un seul champ en raison d’explorations de genres ou de supports médiatiques divers. Sans compter que l’appartenance nationale de certains artistes reste parfois une question épineuse. Suivant la perspective de l’histoire du livre contemporaine (l’appellation « étude de l’imprimé » serait en l’occurrence plus appropriée), la trajectoire de Doucet ne peut être restituée adéquatement qu’en portant attention à la variété des supports qu’elle utilise, au caractère tentaculaire des réseaux dans lesquels elle s’inscrit, aux effets de distorsion créés par les rééditions et traductions, par la circulation internationale (et forcément « arythmique ») de son oeuvre.
La question de la liminarité renvoie donc à la fois à la position de départ de Doucet et aux différents déplacements qui marquent son parcours. Si, suivant Biron, l’on accepte que la littérature québécoise soit toujours dans une position institutionnelle et esthétique de relative marginalité, il devient intéressant de voir comment Doucet embrasse cette position tout en la réfutant. Si, de fait, elle fuit les hiérarchies et les institutions, elle ne reste pas pour autant captive de ses communautés premières (le Québec, le français, le fanzinat). La notion de transfert peut être à lue à l’aune de cette position, car elle désigne des mouvements latéraux (des transmédiations, des traductions, en somme : des déplacements) qui sont à chaque fois des résistances, voire des trahisons à des communautés d’appartenance. Martine‑Emmanuelle Lapointe, dans une étude sur l’oeuvre de Réjean Ducharme, notait que le personnage ducharmien n’était « ni propriétaire, ni locataire, squatteur autorisé à la rigueur [et disposant] d’un capital fondé sur un héritage à venir, dépourvu de testament qui plus est[48] ». Il nous semble que la figure d’outsider qu’incarne Julie Doucet n’est pas étrangère à cette figure du squatteur, et permet de l’inscrire tout à fait dans un récit qui objective à la fois sa position sociologique et son engagement dans diverses formes artistiques. Sa position liminaire est le nom d’une relative indépendance économique sur le plan des conditions de production de son oeuvre (tout particulièrement depuis la fondation du Pantalitaire). Elle est aussi le nom d’une posture de sincérité, d’un « cela va de soi » qui, s’il révèle un refus d’autothéorisation de l’oeuvre et d’une « carrière artistique » organisée, rend néanmoins compte d’un engagement sérieux dans de multiples médias et sphères d’activité.
Appendices
Annexe
Bibliographie
Quelques précisions s’imposent à propos de la bibliographie des oeuvres de Doucet qui suit. Nous avons recensé, au meilleur de notre capacité, l’ensemble de l’oeuvre publiée de Doucet. Cela inclut tant les ouvrages autoédités (zines, livres, livres d’artiste) que les livres, magazines ou comic books édités par des maisons. En raison de la grande mobilité et du caractère multiforme de cette oeuvre, une réelle exhaustivité reste cependant impossible.
Nous avons également inclus des participations à des collectifs (zines, magazines et revues, livres), ainsi que des rééditions et des traductions, pour autant qu’elles soulignent des inflexions importantes dans la trajectoire de Doucet. À titre d’exemples, nous avons recensé les premières publications en langues ou pays étrangers, la participation à des collectifs ayant mené à des collaborations ultérieures, ainsi que les rééditions présentant du contenu original, ou un accès à un nouveau public. Les innombrables republications de son travail, notamment de sa bande dessinée, n’ont pas été retenues systématiquement. Le travail considérable de bibliographie que cela représenterait rendrait cependant une image plus juste de l’impressionnante circulation de son oeuvre.
Une part considérable du travail de Doucet ne figure pas dans cette bibliographie, soit : 1) la production éphémère, incluant flyers, affiches, objets et accessoires, etc. 2) les expositions d’art, films, et autres activités n’ayant pas mené à une publication ultérieure. Le cas du Magasin, déjà mentionné dans cet article, illustre le défi posé par la première catégorie. Éphémère par définition, cette production est impossible à recenser intégralement, et pose la question de toute une partie de la production de Doucet qui ne figure pas ici. Nous avons cependant jugé bon d’en inclure quelques exemples, parmi lesquels la production retrouvée ou documentée du Magasin ou encore certaines affiches signées par Doucet, que ce soit celle pour la rencontre française du graphzine Éléphant Zine (1990), première collaboration avec le graphzineur Éric Heilmann, ou encore celle de l’édition 2013 d’Expozine (novembre 2013). Pour ce qui est de la deuxième catégorie, on peut en voir la trace dans certaines publications présentées plus bas : l’exposition À l’école de l’amour, tenue à la galerie Clark d’août 2005 à avril 2006 et ayant mené à la publication d’À l’école de l’amour (2007); le film My New New YorkDiary (2010) et les courts métrages de Nouilles/Noodles (mai 2013), réalisés avec Anne‑Françoise Jacques. Doucet a monté d’autres expositions et produit d’autres films d’animation n’ayant pas fait l’objet de republications sous forme de livres ou de zines, et ne figurant donc pas ici.
Finalement, nous n’avons recensé qu’une poignée de commandes et d’illustrations réalisées par Doucet : des illustrations pour certaines éditions de L’Oie de Cravan (1999, 2001), l’édition qu’elle illustre du roman classique de Louisa May Alcott, Little Women (2007), ou encore son travail pour les catalogues et publications du Théâtre des Écuries (septembre 2012, hiver 2013, septembre 2013). Ce ne sont là que quelques exemples ayant attiré notre attention.
Ce travail bibliographique n’aurait pas été possible sans les collections d’Archive Montréal, de BAnQ (collections de périodiques, de livres d’artiste et d’ouvrages de bibliophilie), et d’Artexte. Les catalogues de BAnQ et d’Artexte nous ont été particulièrement utiles. Le catalogue de la Fanzinothèque de Poitiers et le site web personnel graphzines.net, tenu par Pascal Tassel, ont également servi, notamment pour les publications de Doucet dans des zines, revues ou livres collectifs européens. La bibliographie des bandes dessinées de Doucet, publiée dans l’anthologie de Drawn & Quarterly, Dirty Plotte: The Complete Julie Doucet (octobre 2018), a aussi été précieuse. Nous avons cependant pu noter quelques erreurs et quelques lacunes, mineures. Certaines informations présentées ici contredisent donc celles présentées par Drawn & Quarterly, par exemple lorsque la première publication d’une planche a pu être retrouvée, à une date antérieure, dans un zine ou une revue. Nous devons également souligner la grande aide d’Éric Heilmann, animateur de l’encyclopédie en ligne gravezone.fr, où l’on retrouve une version complémentaire de la bibliographie présentée ici, comportant des numérisations des premières de couverture des oeuvres ainsi que des informations relatives aux formats, tirages et techniques d’impression.
La bibliographie a été organisée en ordre chronologique en précisant, autant que possible, le mois de publication en plus de l’année. Présentée de la sorte, elle permet de suivre le travail de Doucet, et d’en restituer au mieux les inflexions. Elle se veut un complément aux efforts bio‑bibliographiques déjà tentés, en particulier celui d’Anne Elizabeth Moore dans Sweet Little Cunt (2018). Elle permet à la fois d’évaluer l’intense rythme de production de Doucet pendant certaines périodes et de signaler, en creux, le travail plus considérable que lui demandent certaines publications. Son retour à Montréal à la fin des années 1990 montre ainsi une très nette accélération du nombre de publications, alors que le ralentissement des dernières années annonce la publication de Time Zone J en 2022, de loin son oeuvre la plus aboutie depuis longtemps.
Suit une bibliographie des études sur l’oeuvre de Doucet, des entretiens accordés, une sélection de critiques journalistiques et autres commentaires et témoignages, publiés en anglais ou en français. Sans être exhaustives, ces bibliographies donnent une idée générale du métadiscours entourant l’oeuvre de Doucet, et de l’environnement dans lequel s’inscrivent cet article et cette bibliographie.
Sources
1986
Julie Doucet, « Dans la série des impavides, c’était Depraved Jack », Tchiize (bis), no 2, printemps 1986, Montréal, Les Éditions du Phylactère, p. 30‑31.
Julie Doucet, « Sans titre/Dans la série L’Artiste cet inconnu, nous vous présentons Dulie Joucet “Les trippes à l’air…” », Tchiize (bis), no 3, automne 1986‑hiver 1987, Montréal, Les Éditions du Phylactère, 1ère de couverture et p. 38‑39.
1987
Julie Doucet, « Mohawk Mémé », Tchiize, édité par Yves Millet, Montréal, 1987.
Julie Doucet, « La fille qui était ailleurs avec qui, qui n’existait pas », [Tchiize?], 1987.
Julie Doucet, « Kirk and Spock in a New Spot/Sex Carence », Tel Quel, vol. 1, no 2, automne 1987, édité par Jodkoin et Jacqueline Carrière, Montréal, Le Chien roux, p. 16‑25.
Julie Doucet, « Mais qui est donc Cat Canaille/Mais c’est Cat Canaille/Mama Miaw It’s Cat Canaille », Tchiize (bis), no 4, octobre 1987, Montréal, Les Éditions du Phylactère, p. 57‑59.
1988
Julie Doucet, « Charming Periods/Kirk and Spock in A New Spot/A Washing Day with Martin/En Manque! », Stamp Axe, vol. 4, no 1, printemps 1988, édité par Pier Lefebvre, Montréal, Société de diffusion Stamp Axe, p. 39 et 4e de couverture.
Julie Doucet, « Aujourd’hui on mange des pattes de grenouille », Tchiize, no 6, juin 1988, Montréal, Les Éditions du Phylactère, p. 9‑11.
Julie Doucet, « Collier de dents », Tchiize, no 7, automne 1988, Montréal, Les Éditions du Phylactère, p. 31‑33.
Julie Doucet, By the Way, Montréal, Promotions JD, septembre 1988.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 1, Montréal, autoédité, septembre 1988.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 2, Montréal, autoédité, octobre 1988.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 3, Montréal, autoédité, novembre 1988.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 4, Montréal, autoédité, décembre 1988.
1989
Julie Doucet et Martin Lemm, Cold Vomi, Montréal, autoédité, 1989.
Julie Doucet, « [Untitled: “Bazooka Gum Story”] », Wimmen’s Comix, no 15, janvier 1989, édité par Phoebe Gloeckner et Angela Bocage, Auburn (CA), Rip Off Press, p. 12.
Julie Doucet, « A Night/Dec 31: Family Party », Heck! Comic Art of the Late 1980’s, janvier 1989, édité par Bruce Hilvitz et Lloyd Dangle, Auburn (CA), Rip Off Press, p. 60‑61.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 5, Montréal, autoédité, janvier 1989.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 6, Montréal, autoédité, février 1989.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 7a, « Mini plotte », Montréal, autoédité, mars 1989.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 7b, « Mini plotte », Montréal, autoédité, mars 1989.
Julie Doucet, « Joe mon ami », Rectangle, vol. 2, no 1, avril 1989, édité par Martin Lemm, Montréal, Le Trait indélébile, p. 18‑19.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 8, Montréal, autoédité, avril 1989.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 9, Montréal, autoédité, mai 1989.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 10a, « Mini plotte », Montréal, autoédité, juin 1989.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 1, no 10b, « Mini plotte », Montréal, autoédité, juin 1989.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 2, no 1, Montréal, autoédité, septembre 1989.
Julie Doucet, « Heavy Flow », Weirdo, no 26, septembre 1989, San Francisco, Last Gasp Eco‑Funnies, p. 45‑48.
Julie Doucet, « A Night », Sortez la Chienne, no 4, octobre 1989, édité par El Rotringo (alias Jean Jacques Tachdjian), Lille, Éditions Sortez la Chienne, p. 17.
Julie Doucet, « Les Bérurier noir s’en viennent », Rectangle, vol. 2, no 4, octobre 1989, Montréal, Le Trait indélébile, 1ère de couverture.
1990
Julie Doucet, « Éléphant Zine » [affiche du festival], Saint‑Quentin, La troupe folklorique Hilare Moderne, 1990.
Julie Doucet, « Oh la la j’ai fait un drôle de rêve! », Rectangle, vol. 3, no 3, 1990, Montréal, Le Trait indélébile.
Julie Doucet, « Sans titre [“Pis là ben Ticoune s’est envolé…”] », Ticoune Ze Whiz Tornado, no 3, hiver 1990, édité par Luc Giard, Montréal, Les Éditions du Phylactère, p. 4.
Julie Doucet, « Je n’ai pas la conscience tranquille », Peltex, no 8, « lettre H », janvier 1990, édité par Dominique Leblanc, Strasbourg, Model‑Peltex.
Julie Doucet, « Oh la la j’ai fait un drôle de rêve/Cauchemar », S2 L’Art?, no 11, janvier 1990, édité par Sébastien Morlighem, Formerie, Éditions S2 L’Art?.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 2, no 1, « Dead plotte », Montréal, autoédité, janvier 1990.
Julie Doucet, « Ma Tête Est Une Boîte/Sans Titre [La Fille Au Frigo]/The Magic Necklace », Weirdo, no 27, mars 1990, San Francisco, Last Gasp, p. 28‑29 et 42‑47.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 2, no 3, Montréal, autoédité, mars 1990.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 2, no 3 [insert « Mini plotte – Spécial Scars »], Montréal, autoédité, mars 1990.
Julie Doucet, « Oh la la What A Strange Dream! », Iceberg [nouvelle série], vol. 1, no 1, printemps 1990, insert, Montréal, Éditions Iceberg.
Julie Doucet, « Sans titre [Portfolio] », Melody, no 5, avril 1990, de Sylvie Rancourt et Jacques Boivin, Princeton (WI), Kitchen Sink Press, p. 33.
Julie Doucet, « Det frosar », Pox, vol. 6, no 4, avril 1990, Suède.
Julie Doucet, Dirty Plotte, vol. 2, no 4, « Mini plotte », Montréal, autoédité, juin 1990.
Julie Doucet, « Tonight: I’m Gonna Go See the Bottle Surgeon », Buzzard, no 1, juin 1990, Hudson (MA), Cat‑Head Comics, p. 17‑19.
Julie Doucet, « L’agression », La Pomme de discorde, no 7, été 1990, édité par Frank Garcia, Paris, Terrain vague productions, p. 11‑15.
Julie Doucet, « Sans titre [Un jour, j’ai été visiter un ami que j’avais pas vu depuis longtemps…] », État de choc, no 2, août 1990, Montréal, p. 9.
Julie Doucet, « So Why I Had That Stupid Dream? », Rip Off Comics, no 28, octobre 1990, Auburn (CA), Rip Off Press, p. 4‑6.
Julie Doucet, « Je n’ai pas peur du cancer du sein/Lévitation », Psikopat, no 9, novembre 1990, Paris, Éditions du Zébu, p. 10 et 48‑49.
Julie Doucet, « La seringue », Logique de Guerre Comix, novembre 1990, Paris, L’Association, p. 11‑14.
1991
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Suuri Kurpitsa, no 38, 1991, Tampere (Finlande), Kurpitsa, p. 12‑18.
Julie Doucet, « The Fatal Kiss/Maybe I Don’t Really Exist », Drawn & Quarterly, no 3, janvier 1991, Montréal, Drawn & Quarterly, p. 18‑32.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 1, Montréal, Drawn & Quarterly, janvier 1991.
Julie Doucet, « Quand je vais au cinéma/En manque! », Psikopat, no 10, janvier 1991, Paris, Éditions du Zébu, p. 18‑19 et 28‑29.
Julie Doucet et Doc JPP, « Sans titre [La fille au frigo] », Atomik, no 16, janvier 1991, Paris, Masque à gaz associés, p. 14‑15.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 2, Montréal, Drawn & Quarterly, mars 1991.
Julie Doucet, « Tampax Again/J’aime la viande », Psikopat, no 11, mars 1991, Paris, Éditions du Zébu, p. 10 et 28‑29.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 3, Montréal, Drawn & Quarterly, avril 1991.
Julie Doucet, « A Happy Ending Nightmare », Drawn & Quarterly, no 5, juin 1991, Montréal, Drawn & Quarterly, p. 13‑15.
Julie Doucet, « Vol/Robbery », The New Comics Anthology, édité par Bob Callahan, New York, Collier, août 1991, p. 103‑104.
Julie Doucet, « Stubborn Flower », Drawn & Quarterly, no 6, octobre 1991, Montréal, Drawn & Quarterly, p. 20.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 4, Montréal, Drawn & Quarterly, octobre 1991.
Julie Doucet, « Julie Doucet (“Heavy Flow”; “The Magic Necklace”; “My Conscience Is Bugging Me”; “Vive La Différence”; “So Why I Had That Stupid Dream?”) », dans Twisted Sisters: A Collection of Bad Girl Art, édité par Diane Noomin, New York, Penguin Books, novembre 1991, p. 120‑138.
Julie Doucet, « What an Intense City! », NY Press, vol. 4, no 47, novembre 1991.
1992
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Strapazin, no 29, 1992, Zurich, Édition Moderne, p. 85‑96.
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », dans 2000‑8 : compte à rebours (vers la bande dessinée de l’an 2000), Angoulême, Festival international de bande dessinée, 1992.
Julie Doucet, The Real Dope [Seattle], Seattle, autoédité, 1992.
Julie Doucet, « Monkey and the Living Dead [1ère partie] », Chacal Puant, no 5, janvier 1992, édité par Stéphane Blanquet, Conflans, Chacal Puant, p. 44‑49.
Julie Doucet, « Le Baiser », Drawn & Quarterly, no 7, mars 1992, Montréal, Drawn & Quarterly, p. 14.
Julie Doucet et Dennis P. Eichhorn, « Dinner at Dave’s », Real Stuff, no 6, avril 1992, Seattle, Fantagraphics, p. 1‑6.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 5, Montréal, Drawn & Quarterly, mai 1992.
Julie Doucet, « The Love Dolls », Snake Eyes, no 2, mai 1992, Seattle, Fantagraphics, p. 37‑39.
Julie Doucet, « Monkey and the Living Dead – Part II & III: “Search of the Mysterious Faucet” & “Monkey Gogo Girl!” », Chacal Puant, no 6, juin 1992, édité par Stéphane Blanquet, Conflans, Chacal Puant, p. 46‑57.
Julie Doucet, The Real Dope [New York], New York, autoédité, été 1992.
Julie Doucet et Doc JPP, « Duo [Julie Doucet et le Docteur JPP seront‑ils le couple de l’année?] », Atomik, no 18, novembre 1992, Paris, Masque à gaz associés, p. 25‑26.
Julie Doucet, « Julie Doucet invitée d’honneur du 7e festival de bande dessinée de Montréal/If I Was A Man », Iceberg, vol. 2, no 4 [10e anniversaire], octobre 1992, Montréal, Éditions Iceberg p. 20‑21.
1993
Julie Doucet, « Manon Lescaut », dans Alice in Comicland, Zurich, Édition Moderne, 1993, p. 39.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 6, Montréal, Drawn & Quarterly, janvier 1993.
Julie Doucet, « Monkey and the Living Dead Parts IV & V: “Monkey’s Act” & “Conclusion” », Chacal Puant, no 7, janvier 1993, édité par Stéphane Blanquet, Conflans, Chacal Puant, 1ère de couverture et p. 35‑43.
Julie Doucet, « Regret. A Dream by Julie Doucet », Lapin, no 3, janvier 1993, Paris, L’Association, p. 37‑41.
Julie Doucet, « The Naked Truth. Sketches by Julie Doucet », Melody, no 8, janvier 1993, de Sylvie Rancourt et Jacques Boivin, Princeton (WI), Kitchen Sink Press, p. 2.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 7, Montréal, Drawn & Quarterly, juillet 1993.
Julie Doucet, « [Sans titre] », dans Mickey l’Ange à colorier, édité par Éric Heilmann, La Capelle, septembre 1993, p. 4.
Julie Doucet, « [Sans titre] », Real Stuff, no 15, « Dennis P. Eichhorn’s Ongoing Oenomelism », octobre 1993, Seattle, Fantagraphics, 1ère de couverture.
Julie Doucet, Lève Ta Jambe Mon Poisson Est Mort!, Montréal, Drawn & Quarterly, octobre 1993.
1994
Julie Doucet, Jos olisin mies ja muita kertomuksia, Tampere (Finlande), Kurpitsa, 1994.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 8, Montréal, Drawn & Quarterly, février 1994.
Julie Doucet, Monkey and the living dead, Conflans, Chacal Puant, février 1994.
Julie Doucet, « So Why I Had That Stupid Dream?/If I Was A Man », Chacal Puant, no 8, février 1994, édité par Stéphane Blanquet, Conflans, Chacal Puant, p. 15‑17, 25.
Julie Doucet, « [Sans titre] », dans Twisted Sisters Comics, vol. 3, édité par Diane Noomin, Princeton (WI), Kitchen Sink Press, juillet 1994, 1ère de couverture.
1995
Julie Doucet, My Most Secret Desire, Montréal, Drawn & Quarterly, 1995.
Julie Doucet, « [Sans titre] », dans Narrative Corpse: A Chain‑Story by 69 Artists!, édité par Art Spiegelman, New York, Raw Books, janvier 1995, n. p.
Julie Doucet, Wahre Haushaltscomics, Berlin, Reprodukt, janvier 1995.
Julie Doucet, « J’ai besoin d’un chum », La Monstrueuse, no 1, janvier 1995, édité par Stéphane Blanquet, Conflans, Chacal Puant, p. 20‑21.
Julie Doucet et Siris, « N [On était drôlement tassés dans cet avion] », Baloney, no 1, printemps 1995, édité par Siris, Montréal, Go Go Guy Publications, p. 12‑14.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 9, Montréal, Drawn & Quarterly, avril 1995.
Julie Doucet, Là Là, Chu Tanney Là !!!... Ou Le Rêve Récidiviste, [versions en anglais et en français], Saint‑Lambert, Mille Putois, coll. « Les Taureaux Des Îles », mai 1995.
1996
Julie Doucet, « Nån förort i juni 1983 », Galago, no 44, janvier 1996, Stockholm, Atlantic Förlags, p. 60‑69.
Julie Doucet, « Julie‑la‑terreur se meurt », La Monstrueuse, no 2, janvier 1996, édité par Stéphane Blanquet, Conflans, Chacal Puant, p. 33‑34.
Julie Doucet, « Let’s Laugh ein Bißchen », Die Tageszeitung, mars 1996, Berlin, TAZ, p. 20.
Julie Doucet, Schnitte, no 1, Berlin, Reprodukt, avril 1996.
Julie Doucet, Schnitte – Caricature of Love, Berlin, Reprodukt, mai 1996.
Julie Doucet, « ¿Confias en mi? », Nosotros somos los muertos, no 2, mai 1996, Barcelone, Monograma Ediciones, p. 39‑44.
Julie Doucet, Ciboire de criss!, Paris, L’Association, coll. « Ciboulette », juin 1996.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 10, « Purity Plotte », Montréal, Drawn & Quarterly, décembre 1996.
1997
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », El Vibora – Underground Comix Special Issue, Barcelone, Ediciones La Cúpula, 1997, p. 40‑43.
Julie Doucet, « RRRREMIXXXX », Lapin, no 14, janvier 1997, Paris, L’Association, p. 18‑19.
Julie Doucet, « Julie the Tough Guy Is Dying », Stripburger, no 14, avril 1997, Ljubljana, Stripburger, p. 43‑44.
Julie Doucet, Schnitte, no 2, Berlin, Reprodukt, avril 1997.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 11, Montréal, Drawn & Quarterly, septembre 1997.
Julie Doucet, « Monsieur Pinpon », dans Association des Amis de la Vraie Bande Dessinée Française, Hommage à Monsieur Pinpon, coll. « Arrière‑Boutique », Paris, L’Association, décembre 1997, p. 29.
1998
Julie Doucet, « Super M », ¡Qué Suerte!, « chica, fille, girl », janvier 1998, Madrid, Olaf Ladousse, p. 5.
Julie Doucet, « Robert el ascensorista », Nosotros somos los muertos, no 5, avril 1998, p. 59‑63.
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Mano, no 4, avril 1998, Bologne, Mano Edizioni, p. 127‑141.
Julie Doucet, Si yo fuera hombre, Barcelone, Camaleón ediciones, mai 1998.
Julie Doucet, « Alone Again with Julie Doucet », Stripburger, no 19, septembre 1998, Ljubljana, Stripburger, p. 43.
Julie Doucet, « [Sans titre] », Stripburger, no 22, « XXX », septembre 1998, Ljubljana, Stripburger, 1ère de couverture.
Julie Doucet, Changements d’adresses, Paris, L’Association, coll. « Ciboulette », novembre 1998.
Julie Doucet, « [Sans titre] », La revue des animaux, no 9, « Spécial Pitounes », décembre 1998, Montréal, L’Oie de Cravan, 1ère de couverture.
Julie Doucet, Dirty Plotte, no 12, « Purity Plotte », Montréal, Drawn & Quarterly, décembre 1998.
1999
Julie Doucet, « L’affaire Madame Paul », Ici, Montréal, Quebecor, mars à novembre 1999.
Julie Doucet, Monkey and the living dead, Paris, L’Association, coll. « Mimolette », avril 1999.
Julie Doucet, My New York Diary, Montréal, Drawn & Quarterly, mai 1999.
Julie Doucet et M. Ferreyrol, Manuel pratique pour la fabrication rapide et économique des liqueurs et des spiritueux sans distillation, Montréal, L’Oie de Cravan, 1999.
Julie Doucet et Max, « Sans titre », Comix 2000, « Hors collection », Paris, L’Association, décembre 1999, p. 446‑449.
2000
Julie Doucet, Les hommes d’aujourd’hui : ou un certain milieu artistique, Paris, Les Étoiles et les Cochons, coll. « Schokoriegel », 2000.
Julie Doucet et Leyla Majeri, Sans Titre [Decorative Borders MI368], Montréal, autoédité, 2000.
Julie Doucet, L’affaire Madame Paul, Montréal, L’Oie de Cravan, février 2000.
Julie Doucet, « Horoscope 1999 », La revue des animaux, no 10, « Passage », juin 2000, Montréal, L’Oie de Cravan.
Julie Doucet, The Madame Paul Affair, Montréal, Drawn & Quarterly, juillet 2000.
Julie Doucet, Manuel d’abstraction, Lachine, Panique Letters, septembre 2000.
Julie Doucet, « La B.D. Peut‑on en sortir? », Revue Ferraille, no 16 [Ferraille International no 1], octobre 2000, édité par Marc Pichelin, Albi/Montréal, Les Requins Marteaux, p. 3.
Julie Doucet, L’affaire Madame Paul, Paris, L’Association, coll. « Éperluette », octobre 2000.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 1, Montréal, L’Oie de Cravan/Le Mouvement Lent, octobre 2000.
2001
Julie Doucet, Traumgeburten, Berlin, Reprodukt, 2001.
Julie Doucet, Carte de membre – Le Mouvement Lent, Montréal, L’Oie de Cravan, 2001.
Julie Doucet, Jeu de 54 cartes, Montréal, Atelier Graff, 2001.
Julie Doucet, « [Sans titre] », dans Benoît Chaput, Le démon familier, Montréal, L’Oie de Cravan, 2001, 1ère de couverture.
Julie Doucet et Leyla Majeri, Manuel d’abstraction [2e édition], Lachine, Panique Letters, 2001.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 2, « Spécial astrologie », Montréal, L’Oie de Cravan, janvier 2001.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 15, Montréal, Atelier Graff, mai 2001.
Julie Doucet, Long Time Relationship, Montréal, Drawn & Quarterly, juillet 2001.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 3, « Spécial mode : costume de bain », Montréal, autoédité, août‑septembre 2001.
Julie Doucet, J’chu Pas Capable [Looking for Something?], Montréal, autoédité, septembre 2001.
Julie Doucet, « At Last the World Has Become Slow… Thanks to the…: Slow Action Movement », Stripburger, no 31, décembre 2001, Ljubljana, Stripburger, p. 39.
2002
Julie Doucet, El Caso Madame Paul, Palma, Inrevés edicions, 2002.
Julie Doucet, My New York Diary, Tokyo, Press Pop Gallery, 2002.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 5, « Spécial Distroboto », Montréal, autoédité, 2002.
Julie Doucet et Benoît Chaput, Melek, Montréal, L’Oie de Cravan, février 2002.
Julie Doucet, « [Sans titre] », Vagina Mushroom, no 2, mai 2002, édité par Les Amazones du DC, Marseille, Le Dernier Cri, coll. « Dos carré », p. 53, 62‑63, 86.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 4, « Collages », Montréal, L’Oie de Cravan, mai 2002.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 22, « Le futur », Montréal, Le Mouvement lent, août 2002.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 58, « Käännöstoimisto », Montréal/Helsinki, autoédité, novemre 2002.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 9, « La lenteur. Conseils pratiques et choix d’outils », Montréal, Atelier Graff/Le Mouvement Lent, décembre 2002.
2003
Julie Doucet, « [Sans titre] », Vagina Mushroom, no 3, 2003, édité par Les Amazones du DC, Marseille, Le Dernier Cri, coll. « Dos carré », 1ère de couverture et pages intérieures (n. p.).
Julie Doucet et Benoît Chaput, Les Slow, Montréal, Le Mouvement Lent, 2003.
Julie Doucet, Votre carte de membre!/Your Starter’s Kit! [pour Le Magasin], Montréal, Le Mouvement Lent, mars 2003.
Julie Doucet, Chronomètre retardateur à ondes. Récepteur/Émetteur [pour Le Magasin], Montréal, Le Mouvement Lent, mars 2003.
Julie Doucet, Ustentil Kit [pour Le Magasin], Montréal, Le Mouvement Lent, mars 2003.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 16, « C’est fini‑Loppu », Montréal/Helsinki, Sarjakuva, mai 2003.
Julie Doucet, Basta/Ça va faire [autocollants sérigraphiés; pour Le Magasin], Montréal, Le Mouvement Lent, juin 2003.
Julie Doucet, Le Fortune Kookie/The biscuit présage [pour Le Magasin], Montréal, Atelier Graff/Le Mouvement Lent, juin 2003.
Julie Doucet, L’objet mystère? [pour Le Magasin], Montréal, Le Mouvement Lent, juin 2003.
Julie Doucet et Benoît Chaput, Chapugadget, no 0, Montréal, L’Oie de Cravan, juin 2003.
Julie Doucet, Marie‑Ève Laneville, Nina Logan, Dominique Pétrin et Johanna Rojola, Ruby Red, Montréal, Atelier Graff, août 2003.
Julie Doucet, Johanna Rojolà, Marie‑Ève Laneville, Nina Logan et Dominique Pétrin, Les Copieuses, Marseille, Le Dernier Cri, septembre 2003.
Julie Doucet et Jean‑François Jouanne, Chroniques de New York, Paris, Seuil, septembre 2003.
Julie Doucet, « [Sans titre] », dans Jean‑Marie Parisis (dir.), Reiser Forever, Paris, Éditions Denoël, novembre 2003.
2004
Julie Doucet et Benoît Chaput, Le retour des Slow, Montréal, Le Mouvement Lent, 2004.
Julie Doucet, Journal, Paris, L’Association, avril 2004.
Julie Doucet, Le projet Bookmobile/The Magasin [flyer], Montréal, autoédité, avril 2004.
Julie Doucet, Le Big Nose prêt‑à‑porter [pour Le Magasin], Montréal, autoédité, avril 2004.
Julie Doucet, Le Fortune Kookie/The biscuit présage [pour Le Magasin], Montréal, Atelier Graff, mai 2004.
Julie Doucet, New Yorker Tagebuch, Berlin, Reprodukt, mai 2004.
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Lapin, no 34, Paris, L’Association, juin 2004.
Julie Doucet, Lady Pep, Montréal, Drawn & Quarterly, décembre 2004.
2005
Julie Doucet, J comme je, Paris, Seuil, janvier 2005.
Julie Doucet, « De Julie », dans M le Menu, édité par JAM éditeur, Paris, L’Association, janvier 2005, p. 45.
Julie Doucet, Sophie Punt, no 11, « La création de l’univers (variations) », Montréal, Atelier Graff, mars 2005.
Julie Doucet, Autrinisme de règlohnette : grandamme [1ère édition], Montréal, Atelier Graff, coll. « Tout plassoirer », mai 2005.
Julie Doucet, Chevalladar, Montréal, Atelier Graff, coll. « Tout plassoirer », septembre 2005.
2006
Julie Doucet, Poèmes d’amour, Montréal, Atelier Graff, 2006.
Julie Doucet, « [Sans titre] », dans 963, Montréal, Atelier Graff, avril 2006.
Julie Doucet, My Most Secret Desire, édition 10e anniversaire, Montréal, Drawn & Quarterly, juin 2006.
Julie Doucet et Anne‑Françoise Jacques, Je suis un K, Montréal, L’Oie de Cravan/Le son 666, octobre 2006.
Julie Doucet, Elle‑Humour, Brooklyn (NY)/Corte Madera (CA), Picture Box Inc./Gingko Press, décembre 2006.
2007
Julie Doucet, 365 Days: A Diary, Montréal, Drawn & Quarterly, 2007.
Julie Doucet, « [Illustrations sans titre] », dans Louisa May Alcott, Little Women, édité par Siobhan Kilfeather et Vinca Showalter, Londres, Penguin, coll. « Classics », 2007.
Julie Doucet, Le Pantalitaire, no 1, « Ouvrage technique et pratique », Montréal, SuperStudio, juin 2007.
Julie Doucet, Le Pantalitaire, no 2, Montréal, SuperStudio, juillet 2007.
Julie Doucet, Le Pantalitaire, no 3, Montréal, SuperStudio, août 2007.
Julie Doucet, Le Pantalitaire, no 4, Montréal, SuperStudio, septembre 2007.
Julie Doucet, À l’école de l’amour, Montréal, L’Oie de Cravan, automne 2007.
Julie Doucet, Le Pantalitaire, no 5, Montréal, SuperStudio, octobre 2007.
2008
Julie Doucet, Intermission, Montréal, autopublié, 2008.
Julie Doucet, « Le Pantalitaire », dans Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La Triennale québécoise 2008, édité par Josée Bélisle, Paulette Gagnon, Mark Lanctôt et Pierre Landry, Montréal, Musée d’art contemporain, hiver 2008, p. 98‑103.
Julie Doucet, « Montréal », The Walrus, vol. 5, « Cities Special Issue », janvier‑février 2008, p. 68‑71.
2010
Julie Doucet, Der Stein, no 1, Montréal, autoédité, mai 2010.
Julie Doucet, « You known I’m a very shy girl/Vous savez, je suis une fille très timide », dans XX/MMX, Paris, L’Association, juin 2010, p. 10‑11.
Julie Doucet, Der Stein, no 2, « Kurze Geschichten », Montréal, SuperStudio, juillet 2010.
Julie Doucet, Forecast, Montréal, SuperStudio, juillet 2010.
Julie Doucet, Der Stein, no 3, « Reise in die Schweiz », Montréal, SuperStudio, septembre 2010.
Julie Doucet, Der Stein, no 4, « Collagen », Montréal, SuperStudio, novembre 2010.
Julie Doucet et Michel Gondry, My New New York Diary, Brooklyn (NY), Picture Box Inc./Partizan films, novembre 2010.
2011
Julie Doucet, Scraps, Montréal, autoédité, [2011?].
Julie Doucet, Catalogue de boulons, Saint‑Lambert, Mille Putois, 2011.
Julie Doucet, Der Stein, no 5, « Rouyn‑Noranda », Montréal, autoédité, janvier 2011.
Julie Doucet,Der Stein, no 6, « Blick auf das Leben », Montréal, Atelier Graff, mars 2011.
Julie Doucet, Der Stein, no 7, « Mini », Montréal, Atelier Graff, juin 2011.
Julie Doucet, Der Stein, no 8, « Wahre Geschichten », Montréal, autoédité, septembre 2011.
Julie Doucet, Le révolution [1ère édition], Montréal, Atelier Graff, novembre 2011.
2012
Julie Doucet, yes? no? yes? no?, Ljubljana, Animateka, 2012.
Julie Doucet, Der Stein, no 9, « Die Suche nach Kunst », Montréal, Atelier Graff, mars 2012.
Julie Doucet, No Experience Needed, Montréal, Atelier Graff, mais 2012.
Julie Doucet, 99‑plus suicide projects [1ère édition], Montréal, Atelier Graff, septembre 2012.
Julie Doucet, J’aime [1ère édition], Montréal, Atelier Graff, septembre 2012.
Julie Doucet, rémi eurelec et les autres [1ère édition], Montréal, Atelier Graff, septembre 2012.
Julie Doucet, Mathieu Arseneault, Sara Fauteux, Isabelle Mandalian et David Ayotte, Aaargh, no 1, Montréal, Théâtre des Écuries, septembre 2012.
Julie Doucet, Sans titre [Soldats], Montréal, Atelier Graff, octobre 2012.
Julie Doucet, Autrinisme de règlohnette : grandamme [2e édition, augmentée], Montréal, Atelier Graff, coll. « Tout plassoirer », novembre 2012.
2013
Julie Doucet, Jeu de mémoire, Montréal, Le Pantalitaire, [2013?].
Julie Doucet, « [Sans titre] », dans L’Atlas sérigraphique de Montréal, Saint‑Lambert, Mille Putois, 2013, p. 57‑60.
Julie Doucet et Anne‑Françoise Jacques, Nouilles/Noodles. Courts films d’animation/Short Animation Films, Montréal, Le Pantalitaire, mai 2013.
Julie Doucet, Un, deux, trois, je ne suis plus là, Montréal, Le Pantalitaire, mai 2013.
Julie Doucet, 99‑plus suicide projects [2e édition], Montréal, Le Pantalitaire, septembre 2013.
Julie Doucet, Le révolution [2e édition], Montréal, Le Pantalitaire, septembre 2013.
Julie Doucet, Benoît Chaput et Isabelle Mandalian, Théâtre aux Écuries, tout tout, Montréal, Théâtre des Écuries, septembre 2013.
Julie Doucet, Fantastic plotte! B.D. de Julie Doucet’s comics, 1987‑1991, Montréal, L’Oie de Cravan, été 2013.
Julie Doucet, Skizzenbuch (Carnet de croquis), Montréal, Le Pantalitaire, automne 2013.
Julie Doucet, Expozine. La foire annuelle des petits éditeurs, bandes dessinées et fanzines! [affiche de l’événement], Montréal, novembre 2013.
Julie Doucet, Kevin Lo et Louis Rastelli, Expozine 2013 [livret de présentation], Montréal, Expozine, novembre 2013.
2014
Julie Doucet, rémi eurelec et les autres [2e édition], Montréal, Le Pantalitaire, 2014.
Julie Doucet, J’aime [2e édition], Montréal, Le Pantalitaire, hiver 2014.
Julie Doucet, La mémoire se mange, Montréal, Le Pantalitaire, printemps 2014.
Julie Doucet, The Adorable Little School of Art of Canada, Montréal, Le Pantalitaire, été 2014.
Julie Doucet, Maquette du livre J’aime, Montréal, Le Pantalitaire, août 2014.
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Š!, no 18 « Poetry », septembre 2014, Riga (Lettonie), Kuš.
Julie Doucet, Art Scrap Craft, Montréal, 2Dcloud, octobre 2014.
2015
Julie Doucet, Sauve‑qui‑peut!, Montréal, Le Pantalitaire, septembre 2015.
Julie Doucet, Going Somewhere?, Montréal, Le Pantalitaire, novembre 2015.
2016
Julie Doucet, Kpsake, Montréal, Le Pantalitaire, hiver 2016.
Julie Doucet, Carpet Sweeper Tales, Montréal, Drawn & Quarterly, mars 2016.
Julie Doucet, CÓMICS 1986‑1993, Oyón‑Oion (Araba/Álava), Fulgencio Pimentel S.L., avril 2016.
Julie Doucet, Dessins à main levée avec correcteur/Free‑hand drawings with correction fluid [2e édition], Montréal, Le Pantalitaire, août 2016.
2017
Julie Doucet, Poirette, no 1, Montréal, Le Pantalitaire, janvier 2017.
Julie Doucet, « Noms de famille », Mon Lapin Quotidien, no 1, février 2017, Paris, L’Association, p. 3.
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Mon Lapin Quotidien, no 2, mai 2017, Paris, L’Association.
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Mon Lapin Quotidien, no 3, août 2017, Paris, L’Association.
Julie Doucet, « Das Jahr 2050 », Le Monde Diplomatique Deutschland, août 2017.
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Mon Lapin Quotidien, no 4, novembre 2017, Paris, L’Association.
Julie Doucet, CÓMICS 1994‑2016, Oyón‑Oion (Araba/Álava), Fulgencio Pimentel S.L., novembre 2017.
2018
Julie Doucet, Poirette, no 2, Montréal, Le Pantalitaire, janvier 2018.
Julie Doucet, Poirette, no 3, Montréal, Le Pantalitaire, juillet 2018.
Julie Doucet, « Madame/Monsieur », Mon Lapin Quotidien, no 7, août 2018, Paris, L’Association, p. 1 et 4.
Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete Julie Doucet, édité par Dan Nadel, 2 vol., Montréal, Drawn & Quarterly, octobre 2018.
2019
Julie Doucet, Sans Titre [Elasti‑Chic], Montréal, autoédité, mai 2019.
2020
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Mon Lapin Quotidien, no 13, février 2020, Paris, L’Association.
Julie Doucet, Julie Doucets allerschönste Comic Strips, Berlin, Reprodukt, mars 2020.
2021
Julie Doucet, « [Titre inconnu] », Mon Lapin Quotidien, no 18, août 2021, Paris, L’Association.
Julie Doucet, Maxiplotte, Paris, L’Association, novembre 2021.
2022
Julie Doucet, Time Zone J, Montréal, Drawn & Quarterly, avril 2022.
2023
Julie Doucet, Suicide total, Paris, L’Association, janvier 2023.
Julie Doucet et Anne‑Françoise Jacques, La timidité vaincue, Lyon, Arbitraire, janvier 2023.
Notes biographiques
Izabeau Legendre est candidat au doctorat à l’Université Queen’s, à Kingston, en Ontario. Ses recherches portent sur les zines et le fanzinat. Il est l’auteur de La scène du zine de Montréal (2022). Il est également membre du comité éditorial de la revue Zines. An International Journal on Amateur and DIY Media. Ses recherches sont financées par une bourse d’étude supérieure du Canda Joseph‑Armand‑Bombardier - Doctorat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
Julien Lefort-Favreau est professeur agrégé au Département d’études françaises de l’Université Queen’s (Kingston, Canada). Ses principales publications sont : Henri Deluy, ici et ailleurs (avec Saskia Deluy), Le Temps des cerises, 2017; Politique de l’autobiographie. Engagements et subjectivités (avec Jean-François Hamel et Barbara Havercroft), Nota Bene, 2017; Pierre Guyotat politique, Lux éditeur, 2018; Le luxe de l'indépendance. Réflexions sur le monde du livre, Lux éditeur, 2021.
Notes
-
[1]
Frédéric Hojlo, « Julie Doucet Grand Prix d’Angoulême 2022 : une récompense pas si paradoxale », ActuaBD, 16 mars 2022, https://www.actuabd.com/Julie-Doucet-Grand-Prix-d-Angouleme-2022-une-recompense-pas-si-paradoxale.
-
[2]
Frédéric Potet, « Julie Doucet, un Grand Prix d’Angoulême “féministe jusqu’au bout des ongles” et underground », Le Monde, 16 mars 2022, https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/03/16/julie-doucet-un-grand-prix-d-angouleme-feministe-jusqu-au-bout-des-ongles-et-underground_6117814_3246.html.
-
[3]
François Rissel et Marlene Agius, « Angoulême 2023 – Exposition Julie Doucet : “Je pense qu’il est important de se faire les dents soi‑même” (Interview) », ActuaBD, 27 janvier 2022, https://www.actuabd.com/Angouleme-2023-Exposition-Julie-Doucet-Je-pense-qu-il-est-important-de-se-faire.
-
[4]
Michel Biron, L’absence du maître, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000, p. 13.
-
[5]
Michel Biron, L’absence du maître, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000, p. 15.
-
[6]
Anna Boschetti, Ismes. Du réalisme au postmodernisme, Paris, CNRS, 2014, p. 338.
-
[7]
Voir la section « Sources » de la bibliographie pour des précisions sur les références aux publications de Doucet.
-
[8]
Un exemple notable parmi plusieurs autres : Moore note, en 2018, que sur les 150 oeuvres de Doucet (chaque planche individuelle étant comptée comme une oeuvre) qu’elle a pu recenser, 15 ne sont pas des bandes dessinées au sens strict (pas dessinées, pas narratives, sans cases) (Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt: The Graphic Work of Julie Doucet, Minneapolis, Uncivilized Books, 2018, p. 21). En consultant la section « Sources » de la bibliographie, on peut observer qu’en 2018, la bande dessinée n’occupait alors depuis un bon moment qu’une partie, importante mais minoritaire, de l’ensemble de la production de Doucet, et ce, même si l’on accepte de compter chaque planche individuellement lorsqu’elles paraissent pourtant dans une même publication. Il est cependant à remarquer que Moore est bien au fait du problème, et qu’elle le déplore même, sans pourtant se donner les outils pour le régler. Elle relève ainsi que l’importante production de discours critiques entourant la publication de Carpet Sweeper Tales en 2016 s’est souvent limitée à une lamentation des nouvelles voies empruntées par Doucet : « the critical dialogue it inspired seems stuck mourning Doucet’s announced exit from comics 15 years prior, with little acknowledgement of the body of work completed during that time » (p. 162). Elle va même jusqu’à critiquer cette approche en y voyant le fruit d’un regard masculin, voire sexiste, sur l’oeuvre de Doucet : « The (male) writer seems put out by the mere thought of exenting such generosity [to include Doucet’s later work into the “comics” category], and questions not at all his right to police the borders of the form » (p. 163). S’il est vrai que Moore semble ouverte à l’idée d’inclure toute la production post‑1990 de Doucet dans la grande famille de la bande dessinée, elle ne se donne pas pour autant la peine de s’y engager sérieusement elle‑même.
-
[9]
Doucet est souvent comparée ou étudiée en parallèle d’autres bédéistes, le plus souvent des Américaines : Phoebe Gloeckner, Debbie Drechsle (Chase, 2013), Gabrielle Bell (Oksman, 2019), mais pas uniquement : Geneviève Castrée (Lamothe, 2011), Hergé (Stark, 2019). Notons avec sobriété notre étonnement de la voir comparée à Hergé!
-
[10]
Ann Miller et Murray Pratt, « Transgressive Bodies in the Work of Julie Doucet, Fabrice Neaud and Jean‑Christophe Menu: Towards a Theory of the “autobioBD” », Belphégor, vol. 4, no 1, 2004, p. 1‑18; Catriona MacLeod, « Sex and Death in Quebec: Female AutobioBD and Julie Doucet’s Changements d’adresses », European Comic Art, vol. 5, no 1, 2012, p. 57‑70.
-
[11]
Laurence Brogniez, « Féminin singulier : les desseins du moi. Julie Doucet, Dominique Goblet », Textyles, no 36‑37, juin 2010, p. 117‑138, par. 44.
-
[12]
Natalie Pendergast, « Julie Doucet’s “Monkey and the Living Dead” as Subliminal Autobiography », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 69.
-
[13]
Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt: The Graphic Work of Julie Doucet, Minneapolis, Uncivilized Books, 2018.
-
[14]
Voir notamment Jonas Engelmann, « “Picture This”: Disease and Autobiographic Narration in the Graphic Novels of David B and Julie Doucet », dans Jochen Ecke et Gideon Haberkorn (dir.), Comics as a Nexus of Cultures: Essays on the Interplay of Media, Disciplines and International Perspectives, Jefferson, McFarland, 2010; Ann Miller et Murray Pratt, « Transgressive Bodies in the Work of Julie Doucet, Fabrice Neaud and Jean‑Christophe Menu: Towards a Theory of the “autobioBD” », Belphégor, vol. 4, no 1, 2004, p. 1‑18; Sarah Richardson, « A Very Dirty Word. Cuteness as Affective Strategy in the Comics of Julie Doucet », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 97‑121; Julie Vincent, « Matérialité et transgression du corps obscène dans les oeuvres de Catherine Millet, Catherine Breillat et Julie Doucet », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2018; Kevin Thomas Ziegler, « “I Draw Myself so Ugly, I Am Going a Bit Too Far Here” (365 Days 05.11.02): Risk and Embodiment in Julie Doucet’s Graphic Narratives », dans « Drawing on the Margins of History : English‑Language Graphic Narratives in Canada », thèse de doctorat, Waterloo, University of Waterloo, p. 96‑151.
-
[15]
Julie Vincent, « Matérialité et transgression du corps obscène dans les oeuvres de Catherine Millet, Catherine Breillat et Julie Doucet », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2018.
-
[16]
Frederik Byrn Køhlert, « Female Grotesques: Carnivalesque Subversion in the Comics of Julie Doucet », Journal of Graphic Novels and Comics, vol. 3, no 1, 2012, p. 19‑38, https://doi.org/10.1080/21504857.2012.703883.
-
[17]
Voir notamment Kylie Cardell, « Drawn to Life: The Diary as Method and Politics in the Comics Art of Gabrielle Bell and Julie Doucet », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 122‑142; Margaret Galvan, « From Julie Doucet to Gabrielle Bell. Feminist Genealogies of Comics Anthologies », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 3‑22; Emma Tinker, « From Riot Grrrl to Fine Artist: Transformation in the Work of Julie Doucet », dans « Identity and Form in Alternative Comics, 1967‑2007 », thèse de doctorat, Londres, University College London, 2008, p. 136‑173.
-
[18]
Julie Vincent, « Matérialité et transgression du corps obscène dans les oeuvres de Catherine Millet, Catherine Breillat et Julie Doucet », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2018, p. 94.
-
[19]
Voir Emma Tinker, « From Riot Grrrl to Fine Artist: Transformation in the Work of Julie Doucet », dans « Identity and Form in Alternative Comics, 1967‑2007 », thèse de doctorat, Londres, University College London, 2008, p. 136‑173. On peut consulter, au sujet du mouvement Riot Grrrl, l’excellent travail de synthèse proposé par Labry (Manon Labry, Riot Grrrls. Chronique d’une révolution punk féministe, Paris, Zones, 2016; Manon Labry, Pussy Riot Grrrls, Donnemarie‑Dontilly, Éditions iXe, 2017). Le travail de Buchanan (Rebekah J. Buchanan, Writing a Riot: Riot Grrrl Zines and Feminist Rhetorics, New York, Peter Lang, 2018) sur la place du fanzinat dans le mouvement est également intéressant au regard du positionnement et du travail de Doucet.
-
[20]
Frederik Byrn Køhlert, « Female Grotesques: Carnivalesque Subversion in the Comics of Julie Doucet », Journal of Graphic Novels and Comics, vol. 3, no 1, 2012, p. 19‑38, https://doi.org/10.1080/21504857.2012.703883; Ann Miller et Murray Pratt, « Transgressive Bodies in the Work of Julie Doucet, Fabrice Neaud and Jean‑Christophe Menu: Towards a Theory of the “autobioBD” », Belphégor, vol. 4, no 1, 2004, p. 1‑18; Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt: The Graphic Work of Julie Doucet, Minneapolis, Uncivilized Books, 2018.
-
[21]
Annie Mok, « “The Starting Point”: An Interview with Julie Doucet », The Comics Journal, no 141, 25 avril 2016, https://www.tcj.com/the-starting-point-an-interview-with-julie-doucet/
-
[22]
François Rissel et Marlene Agius, « Angoulême 2023 – Exposition Julie Doucet : “Je pense qu’il est important de se faire les dents soi‑même” (Interview) », ActuaBD, 27 janvier 2022, https://www.actuabd.com/Angouleme-2023-Exposition-Julie-Doucet-Je-pense-qu-il-est-important-de-se-faire.
-
[23]
Andrea Juno, « Julie Doucet », Dangerous Drawings. Interviews with Comix & Graphix Artists, New York, Juno Books, 1997, p. 73.
-
[24]
Dans un entretien de 1999, Doucet cite comme sources d’inspiration autant des piliers de l’underground comix que des artistes de sa génération, connu.es et moins connu.es, qui s’en réclament comme elle : George Herriman, Art Spiegelman, Robert Crumb, Chester Brown, Dan Clowes, Charles Burns, Dori Seda, Debbie Drechsler, Jim Woodring, Brian Sendelbach, Krystine Kryttre, Michael Dougan, David Mazzucchelli, Carol Tyler, Phoebe Gloeckner, Mark Beyer, Kim Deitch, Joe Sacco, Brad Johnson, Basil Wolverton, Jayr Pulga, Jonathon Rosen (« Beyond the Grid: The Artists Talk Back », Comics Journal, no 210, 1999, p. 111‑112). Il est d’ailleurs intéressant de noter la place relativement faible qu’occupent les femmes dans cette liste.
-
[25]
Margaret Galvan, « From Julie Doucet to Gabrielle Bell. Feminist Genealogies of Comics Anthologies », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 6.
-
[26]
Hugo Santerre, « Dirty Plotte : les zines de Julie Doucet », dans « La bande dessinée féministe humoristique au cours des décennies 1970 et 1980 au Québec : l’humour visuel comme outil d’appropriation des représentations », thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2017, p. 92. Doucet raconte la même histoire dans un panel tenu à l’occasion de la publication de Dirty Plotte: The Complete par Drawn & Quarterly. Elle y mentionne par ailleurs ne pas avoir su se rapprocher d’Obom, pourtant la seule autre femme bédéiste qu’elle connaissait au début de sa carrière, et ce, paradoxalement, parce qu’elle la trouvait trop féministe! De la même manière, elle explique avoir été abonnée au magazine féministe La vie en rose et l’avoir lu avec attention, sans pour autant s’être sentie interpellée (SmallPressExpo, 2018, 5:20‑8:20).
-
[27]
Jean‑Christophe Menu, « Julie in France », dans Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete, Montréal, Drawn & Quarterly, 2018, p. 36.
-
[28]
Julie Doucet, Long Time Relationship, Montréal, Drawn & Quarterly, juillet 2001, p. 139.
-
[29]
Nous avons recensé 12 numéros de Sophie Punt, mais il pourrait y en avoir d’autres. Le site web de Doucet n’en recense que 10. La numérotation arbitraire, la grande variation des tirages d’un numéro à l’autre et la circulation, fracturée entre différents pays et différents publics (fanzinat, bande dessinée alternative, monde de l’art, etc.), compliquent la tâche d’un recensement exhaustif.
-
[30]
La référence au standard ISO est à titre indicatif seulement, le Canada et les États‑Unis comptant parmi les rares pays dans le monde à ne pas se conformer à ce standard international. Nous considérerons donc le format « lettre » (8½ x 11 pouces) comme équivalent du format A4, les autres formats étant ensuite déduits à partir de cette équivalence.
-
[31]
On compte, dans l’ordre : no 1 (octobre 2000), no 34 (décembre 2000), no 2 (janvier 2001), no 15 (mai 2001), no 3 (août/septembre 2001), no 4 (mai 2002), no 5 (2002), no 22 (août 2002), no 58 (novembre 2002), no 16 (mai 2003), no 11 (mars 2005). Doucet explique, à propos du no 34 – spécial biscuit de fortune (décembre 2000) : « I already had announced the astrology special as number two in S. P. no. 1, but felt like doing the fortune cookie book first. That’s why no. 34 came before no. 2. I was 34 at the time, that’s why it’s no. 34 » (Julie Doucet, Long Time Relationship, Montréal, Drawn & Quarterly, juillet 2001, p. 140).
-
[32]
Julie Doucet, Lady Pep, Montréal, Drawn & Quarterly, décembre 2004, p. 103‑104.
-
[33]
Voir la partie du mémoire de maîtrise de Catherine Cormier‑Larose consacrée à l’oeuvre de Doucet pour une description détaillée du dispositif : Catherine Cormier‑Larose, « Manquer de regard : enjeux intermédiatiques du texte et de l’image chez Julie Doucet et Ken Lum », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2009, p. 38‑71.
-
[34]
On retrouve notamment des poèmes d’amour dans l’ouvrage collectif français Viande de chevet, édité par Stéphane Blanquet (octobre 2010). Il est d’ailleurs intéressant de noter que ce sont bel et bien les textes des Poèmes d’amour qui sont réédités, et pas leur version retravaillée pour le livre avec L’Oie de Cravan.
-
[35]
Voir notamment Alison Piepmeier, « Why Zines Matter. Materiality and the Creation of Embodied Community », Girl Zines. Making Media, Doing Feminism, New York/Londres, New York University Press, 2009, p. 57‑86, et Geneviève Pagé, « L’art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique? », Recherches féministes, vol. 27, no 2, 2014, p. 191‑215.
-
[36]
« Der Stein [la roche] dit : ça suffit!!! Ensuite, Der Stein laisse l’art sur l’autoroute et ne revient jamais plus » (Julie Doucet, Der Stein, no 1, mai 2010, Montréal, autoédité, p. 10). Nous traduisons.
-
[37]
« L’art vous retourne l’estomac? Der Stein vous nettoie l’estomac » (Julie Doucet, Der Stein, no 8, septembre 2011, Montréal, autoédité, p. 22). Nous traduisons.
-
[38]
« À la recherche de l’art ». Nous traduisons.
-
[39]
« Der Stein est à la recherche de l’art / Est‑ce que Der Stein trouvera l’art? / Où est l’art? / L’art? / Où s’est‑il caché? / Où s’en est‑il allé? / Der Stein est complètement désespéré / Der Stein laisse tomber. / Il abandonne la recherche / Fin » (Julie Doucet, Der Stein, no 9, mars 2012, Montréal, Atelier Graff). Nous traduisons.
-
[40]
Julie Doucet, Le Pantalitaire, https://lepantalitaire.bigcartel.com/le-pantalitaire.
-
[41]
Doucet note avoir fait un burnout pendant la période où elle collaborait avec Gondry pour le film (voir l’interview avec Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt: The Graphic Work of Julie Doucet, Minneapolis, Uncivilized Books, 2018, p. 204‑205), ce qui transparaît dans notre bibliographie. Moore suggère que la collaboration avec Gondry peut expliquer cette interruption : « [Gondry] confesses that, to solicit her involvement, he “had to use inexcusable and manipulative means”. But the project – his re‑write of her autobiographical story – was necessary, he says, because his “concepts are like kidney stones to me: very painful to expel, but worse to hold in”. That Doucet would fall ill during the project (with mononucleosis) and be bedridden for months, after which she refused to draw for seven full years, does not enter his realm of concern at all » (p. 61).
-
[42]
Dan Nadel, « The Julies. An Introduction », dans Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete, vol. 2, « Everything Else », Montréal, Drawn & Quarterly, 2018, p. 33.
-
[43]
Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt: The Graphic Work of Julie Doucet, Minneapolis, Uncivilized Books, 2018, p. 133.
-
[44]
Julie Vincent, « Matérialité et transgression du corps obscène dans les oeuvres de Catherine Millet, Catherine Breillat et Julie Doucet », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2018, p. 101.
-
[45]
Voir Stephen Duncombe, Notes from Underground. Zines and the Politics of Alternative Culture, Londres/New York, Verso, 1997; Alison Piepmeier « Why Zines Matter. Materiality and the Creation of Embodied Community », Girl Zines. Making Media, Doing Feminism, New York/Londres, New York University Press, 2009, p. 57‑86; Izabeau Legendre, La scène du zine de Montréal. Montréal : AURA éditions, 2022.
-
[46]
Notamment Catriona MacLeod, « Sex and Death in Quebec: Female AutobioBD and Julie Doucet’s Changements d’adresses », European Comic Art, vol. 5, no 1, 2012, p. 57‑70, et Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt: The Graphic Work of Julie Doucet, Minneapolis, Uncivilized Books, 2018.
-
[47]
Andrea Juno, « Julie Doucet », Dangerous Drawings. Interviews with Comix & Graphix Artists, New York, Juno Books, 1997, p. 73.
-
[48]
Martine‑Emmanuelle Lapointe, « Hériter du bordel dans toute sa splendeur. Économies de l’héritage dans Va savoir de Réjean Ducharme », Études françaises, vol. 45, no 3, 2009, p. 85.
Bibliographie
- Mathieu Arsenault, « J’ai fait un fanzine avec Julie Doucet », Doctorak, GO! (blogue), 16 septembre 2012, https://doctorak-go.blogspot.com/2012/09/jai-fait-un-fanzine-avec-julie-doucet.html.
- Mathieu Arsenault, « Julie Doucet, 99-Plus Suicide Projects », Doctorak, GO! (blogue), 11 mars 2013, https://doctorak-go.blogspot.com/2013/03/julie-doucet-99-plus-suicide-projects.html.
- Association of English-language Publishers in Quebec, Episode 6: Helge Dascher, Katia Grubisic, Montréal, 2017, http://archive.org/details/podcast_inside-frozen-mammoth_episode-6-helge-dascher-kati_1000390683299.
- Marie Bardiaux-Vaïente, « Une douceur charnelle de l’abondance », Neuvième art 2.0, octobre 2022, https://www.citebd.org/neuvieme-art/une-douceur-charnelle-de-labondance.
- John Bell, « The Road to Palooka-Ville: New Directions, 1989-2006 », dans Invaders from the North: How Canada Conquered the Comic Book Universe, Toronto, Dundurn Press, 2006, p. 170-191.
- Rebecca Bengal, « A New Plot for Julie Doucet », EYE, no 23, 1999, Greensboro (NC), Lisa Crosby [fanzine autoédité], p. 8-11.
- « Beyond the Grid: The Artists Talk Back », Comics Journal, no 210, 1999, p. 109-113.
- Bibliothèque et Archives nationales du Québec, « Le livre comme espace de création », À rayons ouverts, no 93, 2013, p. 5-8.
- Stéphane Blanquet, Éric Heilmann et Lézard Fou, « Julie Doucet vous parle », dans Monkey and the living dead, Conflans, Chacal Puant, 1994, p. 2-12.
- Laurence Brogniez, « Féminin singulier : les desseins du moi. Julie Doucet, Dominique Goblet », Textyles, no 36-37, juin 2010, p. 117-138.
- brian Campbell, « The Original Dirty Plotte », Comic Book Daily (blogue), 8 mars 2021, https://www.comicbookdaily.com/columns/forgotten-silver/the-original-dirty-plotte/.
- Kylie Cardell, « Drawn to Life: The Diary as Method and Politics in the Comics Art of Gabrielle Bell and Julie Doucet », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 122-142.
- Alisia Chase, « You Must Look at the Personal Clutter: Diaristic Indulgence, Female Adolescence, and Feminist Autobiography », dans Drawing from Life, Jackson, University Press of Mississippi, 2013, p. 207-240.
- Hillary Chute, « Julie Doucet », Artforum, juillet 2014, https://www.artforum.com/print/201406/hillary-chute-46881.
- Hillary Chute, « Life or Something like It. Hilary Chute on Julie Doucet’s My New York Diary », Artforum, 25 juillet 2014, https://www.artforum.com/slant/hillary-chute-on-julie-doucet-s-my-new-york-diary-47566.
- Catherine Cormier-Larose, « Julie Doucet. Poésie projetée, petites passoires de peaux », Spirale, no 218, 2008, p. 9-10.
- Catherine Cormier-Larose, « Manquer de regard : enjeux intermédiatiques du texte et de l’image chez Julie Doucet et Ken Lum », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2009.
- Sophie Courval, « Julie Doucet : “Je suis davantage influencée par le dadaïsme que par la Beat generation” », Les Inrocks (blogue), août 2016, https://www.lesinrocks.com/livres/julie-doucet-suis-davantage-influencee-dadaisme-beat-generation-60747-10-08-2016/.
- Dans ta bulle!, « Épisode 241 : entrevue avec Julie Doucet », CHOQ FM, 4 décembre 2012, http://archive.org/details/podcast_dans-ta-bulle_emission-du-3-decembre-2013_1000370249295.
- Julie Doucet, « Julie Doucet’s Secretions. The Comics Journal Interview », dans Dirty Plotte: The Complete, Montréal, Drawn & Quarterly, 2018 [1991], p. 40-49.
- Julie Doucet, Le Pantalitaire, s. d., https://lepantalitaire.bigcartel.com/le-pantalitaire.
- Julie Doucet et Antoine Lefebvre, « Julie Doucet », Artzines, no 5 « Montréal », 2016, p. 20-21.
- Philippe Dumez et Julie Doucet, « L’année Julie », Jade, no 7, 1996, p. 51-54, https://www.pastis.org/jade/cgi-bin/reframe.pl?https://www.pastis.org/jade/nov01/juliedoucet.htm.
- Jonas Engelmann, « “Picture This”: Disease and Autobiographic Narration in the Graphic Novels of David B and Julie Doucet », dans Jochen Ecke et Gideon Haberkorn (dir.), Comics as a Nexus of Cultures: Essays on the Interplay of Media, Disciplines and International Perspectives, Jefferson, McFarland, 2010.
- Mira Falardeau, « Julie Doucet, between order and disorder », Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, no 89, août 2020, p. 29-45.
- Aubrey Gabel, « Julie Doucet: How a Zine Author Went Canonical », Los Angeles Review of Books, 23 juillet 2022, https://lareviewofbooks.org/article/julie-doucet-how-a-zine-author-went-canonical/.
- Sandrine Galand, « Fantastic Plotte, le corps en déterritoire/Fantastic Plotte, de Julie Doucet, L’Oie de cravan, 144 p. », Spirale, no 247, 2014, p. 56-57.
- Margaret Galvan, « From Julie Doucet to Gabrielle Bell. Feminist Genealogies of Comics Anthologies », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 3-22.
- Thierry Groensteen, « Réponses à huit questions sur l’autobiographie : Edmond Baudoin, Max Cabanes, Julie Doucet, Will Eisner, Jean-Christophe Menu, Fabrice Neaud, Joe Pinelli, Art Spiegelman et Lewis Trondheim », Neuvième Art, vol. 1, no 1, 1996, p. 70-82, https://www.citebd.org/neuvieme-art/reponses-huit-questions-sur-lautobiographie-edmond-baudoin-max-cabanes-julie-doucet.
- Lady Gunn, « Interview with Julie Doucet! », 8 avril 2010, https://drawnandquarterly.com/press/ladygunn-interviews-julie-doucet/.
- Charles Hatfield, Alternative Comics: An Emerging Literature, Jackson, University Press of Mississippi, 2009.
- Éric Heilmann, L’Étang Moderne, no 44 « Jules I c’est doux », La Capelle, L’Étang moderne, 1991.
- Andrea Juno, « Julie Doucet », Dangerous Drawings. Interviews with Comix & Graphix Artists, New York, Juno Books, 1997, p. 54-73.
- Frederik Byrn Køhlert, « Female Grotesques: Carnivalesque Subversion in the Comics of Julie Doucet », Journal of Graphic Novels and Comics, vol. 3, no 1, 2012, p. 19-38, https://doi.org/10.1080/21504857.2012.703883.
- Frederik Byrn Køhlert, « “At This Point I Become Real”: Experimental Autobiography in Julie Doucet and Michel Gondry’s Comics/Video Hybrid My New New York Diary », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 145-163.
- Frederik Byrn Køhlert, « Female Grotesques: The Unruly Comics of Julie Doucet », Serial Selves. Identity and Representation in Autobiographical Comics, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 2019, p. 23-53.
- Frederik Byrn Køhlert, « Self-Exposure: Two Retrospectives by Autobiographical Comics Pioneers Julie Doucet and Ariel Schrag », Los Angeles Review of Books, 19 juillet 2019, https://lareviewofbooks.org/article/self-exposure-two-retrospectives-by-autobiographical-comics-pioneers-julie-doucet-and-ariel-schrag/.
- Stéphanie Lamothe, « La vie extérieure de Julie Doucet et Geneviève Castrée », dans « Les modes d’expression du projet autobiographique dans la bande dessinée québécoise », mémoire de maîtrise, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2011, p. 98-125.
- Jacqueline Lealess, « Making a Spectacle: The Comics of Debbie Drechsler, Phoebe Gloeckner, Diane DiMassa, and Julie Doucet », mémoire de maîtrise, Peterborough, Trent University, 2006.
- Dominique Leblanc, « FANTASTIC PLOTTE! », Model-Peltex Artworks, février 2020, https://dominique-leblanc-artworks.mozello.fr/blog/params/post/2009452/.
- Izabeau Legendre, La scène du zine de Montréal. Montréal : AURA éditions, 2022.
- Izabeau Legendre, « Généalogie du zine contemporain au Québec : de la personnalisation de la politique à une politique de la mise en commun des intimités ». Analyses : revue de littératures franco-canadiennes et québécoise, vol. 16, n° 1, 2022, p. 71-86.
- Etelka Lehoczky, « Two Nostalgic, Fiercely Feminist Graphic Novels », The New York Times, 16 mai 2022, https://www.nytimes.com/2022/05/16/books/review/two-nostalgic-fiercely-feminist-graphic-novels.html.
- Sophie Létourneau, « Écriture du réel. On ne casera pas Julie Doucet », Lettres québécoises, no 175, 2019, p. 84-87.
- Catriona MacLeod, « Sex and Death in Quebec: Female AutobioBD and Julie Doucet’s Changements d’adresses », European Comic Art, vol. 5, no 1, 2012, p. 57-70.
- Ian McGillis, « Montreal’s Julie Doucet Revolutionized Comics – Then She Walked Away », Montreal Gazette, 14 décembre 2018, https://montrealgazette.com/entertainment/local-arts/montreals-julie-doucet-revolutionized-comics-then-she-walked-away.
- Jean-Christophe Menu, « Julie in France », dans Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete, vol. 2 « Everything Else », Montréal, Drawn & Quarterly, 2018, p. 36-37.
- Jean-Christophe Menu, « Introduction », dans Julie Doucet, Maxiplotte, Paris, L’Association, 2021, p. 5-12.
- Ann Miller et Murray Pratt, « Transgressive Bodies in the Work of Julie Doucet, Fabrice Neaud and Jean-Christophe Menu: Towards a Theory of the “autobioBD” », Belphégor, vol. 4, no 1, 2004, p. 1-18.
- Annie Mok, « “The Starting Point”: An Interview with Julie Doucet », The Comics Journal, no 141, 25 avril 2016, https://www.tcj.com/the-starting-point-an-interview-with-julie-doucet/.
- Anne Elizabeth Moore, « Julie Doucet », Punk Planet 73, Chicago, Self-Published, 2006, p. 48-52.
- Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt: The Graphic Work of Julie Doucet, Minneapolis, Uncivilized Books, 2018.
- David P. Moore, Hooked on Comix Vol. 1. Life on the Cutting Edge of an All-American Artform, d. p. works, 1994, https://www.youtube.com/watch?v=JjnHhBd0PTM.
- Dan Nadel, « A Good Life: The Julie Doucet Interview », 2007.
- Dan Nadel, « The Julies. An Introduction », dans Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete, vol. 2 « Everything Else », Montréal, Drawn & Quarterly, 2018, p. 8-33.
- Tahneer Oksman, « Reading Aloud with Julie Doucet », Los Angeles Review of Books, 24 juin 2016, https://lareviewofbooks.org/article/reading-aloud-julie-doucet/.
- Tahneer Oksman, « Introduction. A Shared Space », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell: A Place inside Yourself, Jackson, University Press of Mississippi, 2018, p. XI-LVI.
- Tahneer Oksman, « “I Really Had to Reinvent Myself”: An Interview with Julie Doucet », Los Angeles Review of Books, 19 janvier 2019, https://lareviewofbooks.org/article/i-really-had-to-reinvent-myself-an-interview-with-julie-doucet/.
- Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell: A Place inside Yourself, Jackson, University Press of Mississippi, 2018.
- Chris Oliveros, « Through Thick and Thin », dans Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete, vol. 2 « Everything Else », Montréal, Drawn & Quarterly, 2018, p. 23.
- Laura Paul, « Comics as Social Media: On Julie Doucet’s “Time Zone J” », Los Angeles Review of Books, 14 mai 2022, https://lareviewofbooks.org/article/comics-as-social-media-on-julie-doucets-time-zone-j/.
- Natalie Pendergast, « Julie Doucet’s “Monkey and the Living Dead” as Subliminal Autobiography », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 47-74.
- Antoine Peuchmaurd, « Chapu Gadget », La vie palpitante d’antoine p. (blogue), s. d., https://antoine-p.blogspot.com/2016/10/chapu-gadget.html.
- Joy Press, « Strip Teaser », The Village Voice, 4 décembre 2001, https://www.villagevoice.com/2001/12/04/strip-teaser/.
- Maël Rannou et Julie Doucet, « “j’ai trop besoin de toucher, de manipuler la matière, de remuer” – entretien », Neuvième art 2.0, octobre 2022, https://www.citebd.org/neuvieme-art/jai-trop-besoin-de-toucher-de-manipuler-la-matiere-de-remuer-entretien.
- Sarah Richardson, « A Very Dirty Word. Cuteness as Affective Strategy in the Comics of Julie Doucet », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 97-121.
- Nicole Rudick, « Carpet Sweeper Tales (Review) », The Comics Journal, juin 2016, https://www.tcj.com/reviews/carpet-sweeper-tales/.
- Nicole Rudick, « The Raunchy Brilliance of Julie Doucet », The New York Review of Books, 2018, https://www.nybooks.com/daily/2018/11/07/the-raunchy-brilliance-of-julie-doucet/.
- Hugo Santerre, « Dirty Plotte : les zines de Julie Doucet », dans « La bande dessinée féministe humoristique au cours des décennies 1970 et 1980 au Québec : l’humour visuel comme outil d’appropriation des représentations », thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2017, p. 76-94.
- Small Press Expo, Cutting Up: Julie Doucet’s Reinventions From Dirty Plotte to Carpet Sweeper Tales, Bethesda, MD, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=un8Mxey2oT4.
- Jessica Stark, « My Most Secret Boredom. (Dis)Affective Narrative in Julie Doucet’s “A Day in Julie Doucet’s Life” and Hergé’s “Adventures with Tintin: The Broken Ear” », dans Tahneer Oksman et Seamus O’Malley (dir.), The Comics of Julie Doucet and Gabrielle Bell, Jackson, University Press of Mississippi, 2019, p. 23-44.
- ThroatArt, Throatcast Episode 13: Julie Doucet, Brooklyn, 2011, http://archive.org/details/podcast_throatcast_throatcast-episode-13-julie-d_1000094535603.
- Emma Tinker, « From Riot Grrrl to Fine Artist: Transformation in the Work of Julie Doucet », dans « Identity and Form in Alternative Comics, 1967-2007 », thèse de doctorat, Londres, University College London, 2008, p. 136-173.
- Yevgeniya Traps, « It’s Julie Doucet’s World », The New York Times, 15 avril 2022, https://www.nytimes.com/2022/04/15/arts/design/julie-doucet-time-zone-j.html.
- Julie Vincent, « Matérialité et transgression du corps obscène dans les oeuvres de Catherine Millet, Catherine Breillat et Julie Doucet », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2018.
- Lorraine York, « “A Good Place Where to Be”: Un-Placing Mobilities in Julie Doucet’s My New York Diary », Inks, vol. 4, no 3, 2020, p. 309-26.
- Kevin Thomas Ziegler, « “I Draw Myself so Ugly, I Am Going a Bit Too Far Here” (365 Days 05.11.02): Risk and Embodiment in Julie Doucet’s Graphic Narratives », dans « Drawing on the Margins of History: English-Language Graphic Narratives in Canada », thèse de doctorat, Waterloo, University of Waterloo, p. 96-151.
- Michel Biron, L’absence du maître, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000.
- Anna Boschetti, Ismes. Du réalisme au postmodernisme, Paris, CNRS, 2014.
- Rebekah J. Buchanan, Writing a Riot: Riot Grrrl Zines and Feminist Rhetorics, New York, Peter Lang, 2018.
- Stephen Duncombe, Notes from Underground. Zines and the Politics of Alternative Culture, Londres/New York, Verso, 1997.
- Frédéric Hojlo, « Julie Doucet Grand Prix d’Angoulême 2022 : une récompense pas si paradoxale », ActuaBD, 16 mars 2022, https://www.actuabd.com/Julie-Doucet-Grand-Prix-d-Angouleme-2022-une-recompense-pas-si-paradoxale.
- Manon Labry, Riot Grrrls. Chronique d’une révolution punk féministe, Paris, Zones, 2016.
- Manon Labry, Pussy Riot Grrrls, Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, 2017.
- Jean-Dominique Leduc, « Retour aux sources », Le Journal de Montréal, 4 janvier 2014, https://www.journaldemontreal.com/2014/01/04/retour-aux-sources.
- Martine-Emmanuelle Lapointe, « Hériter du bordel dans toute sa splendeur. Économies de l’héritage dans Va savoir de Réjean Ducharme », Études françaises, vol. 45, no 3, 2009, p. 77-93.
- Geneviève Pagé, « L’art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique? », Recherches féministes, vol. 27, no 2, 2014, p. 191-215.
- Alison Piepmeier, « Why Zines Matter. Materiality and the Creation of Embodied Community », Girl Zines. Making Media, Doing Feminism, New York/Londres, New York University Press, 2009, p. 57-86.
- Frédéric Potet, « Julie Doucet, un Grand Prix d’Angoulême “féministe jusqu’au bout des ongles” et underground », Le Monde, 16 mars 2022, https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/03/16/julie-doucet-un-grand-prix-d-angouleme-feministe-jusqu-au-bout-des-ongles-et-underground_6117814_3246.html.
- François Rissel et Marlene Agius, « Angoulême 2023 – Exposition Julie Doucet : “Je pense qu’il est important de se faire les dents soi-même” (Interview) », ActuaBD, 27 janvier 2022, https://www.actuabd.com/Angouleme-2023-Exposition-Julie-Doucet-Je-pense-qu-il-est-important-de-se-faire.
- Kristen Schilt, « “I’ll Resist with Every Inch and Every Breath”: Girls and Zine Making as a Form of Resistance », Youth & Society, vol. 35, no 1, 2003, p. 71-97.

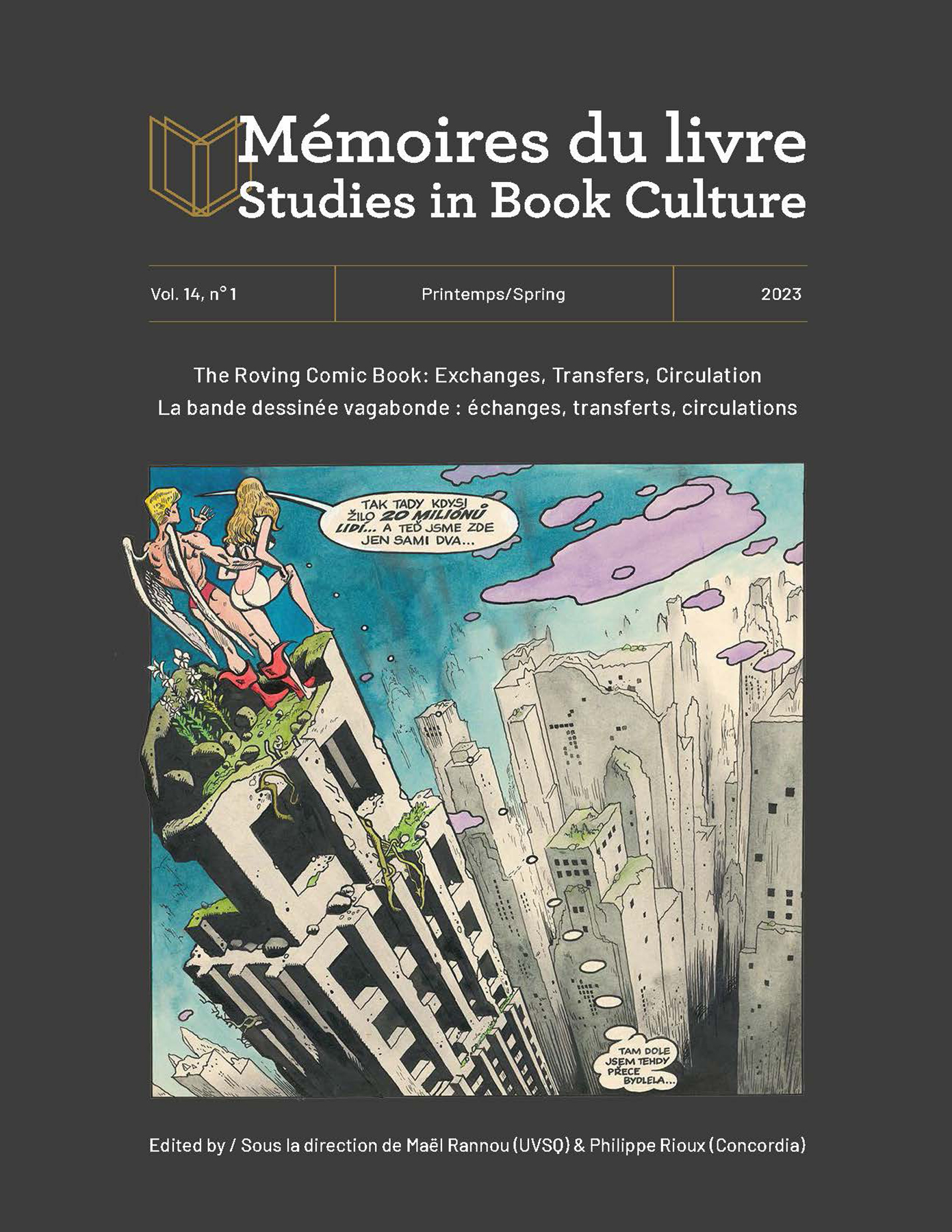

 10.7202/1088499ar
10.7202/1088499ar