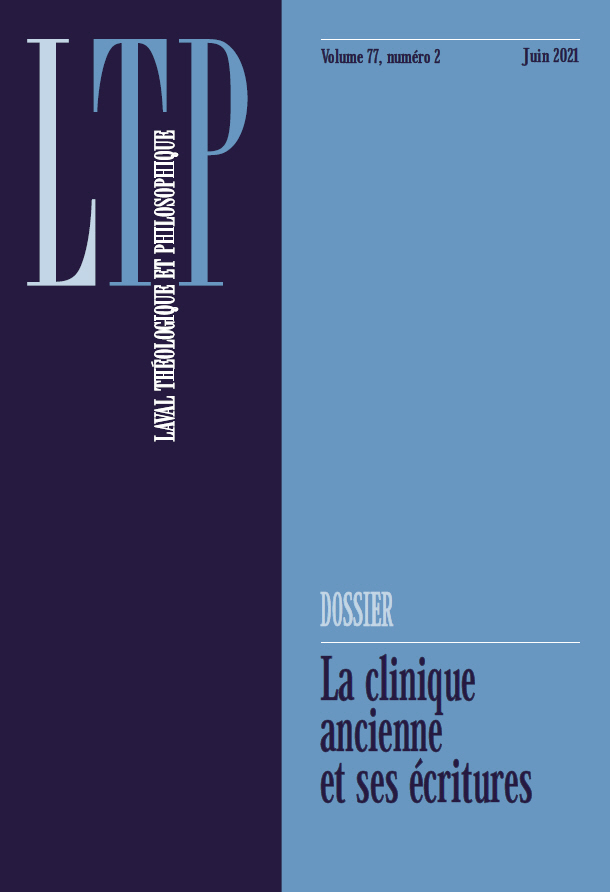Article body
Le terme « clinique » est aujourd’hui omniprésent dans le discours médical, revendiqué à tous les niveaux, au point qu’il semble constituer une norme, voire même l’idéal du « bon médecin ». Dans le même temps, on ne peut que constater une très grande polysémie du terme, qui rend flous ses contours et ses usages. Or les diverses conceptions et compréhension de la nature de la clinique, d’un fait, d’une pratique ou d’un cas cliniques, engagent des conséquences à la fois sur le statut épistémique de la médecine mais également des conséquences éthiques sur sa pratique.
Depuis 2015, dans le cadre du master « Philosophie : Soin, éthique et santé » de l’Université Bordeaux Montaigne, un colloque ou une journée d’étude réunit tous les ans des philosophes, des médecins, des professionnels du soin, des psychologues, des psychanalystes, auxquels s’ajoutent selon les années des historiens et des juristes, autour d’une question qui permet un abord renouvelé de la notion de clinique : « Parrhêsia (franc-parler) et médecine » (2015), « La honte, problématiques antiques et contemporaines » (2016), « Diagnostic : parrhêsia (franc-parler) et conflit des interprétations » (2017), « Extension du domaine de la clinique : un état des lieux » (2018), « Écritures de la clinique » (2019), « Ce que la Covid a fait à la clinique » (2021), « Clinique et transgression » (2022). La spécificité de ces rencontres pluridisciplinaires tient dans ce qu’une place importante est réservée à l’Antiquité — histoire et philosophie. Ce geste tend moins à annuler les distances historiques et les différences des problèmes qu’à favoriser ce qu’on pourrait appeler des phénomènes d’échos : les échos antiques dans les pratiques contemporaines peuvent permettre de lever des ambiguïtés au sujet de l’usage du terme (substantif ou adjectif) « clinique », tandis que les pratiques contemporaines et les interrogations qu’elles suscitent peuvent, en retour, fournir de nouvelles grilles d’analyses des textes antiques. Si le terme grec klinikos (littéralement : au lit du patient) est plus que rare dans la littérature ancienne, il n’en reste pas moins que la démarche, elle, est clairement avérée. Dans les occurrences anciennes comme modernes de la clinique, il s’agit bien d’articuler autour du corps du patient ou de son âme, observation, discours, traitement et souci éthique. Ce nouage implique une constante réévaluation de chaque élément par les autres, dans le respect des normes (légales, éthiques). Néanmoins, le statut épistémologique dont le discours s’autorise implique de profondes variations dans l’approche du fait clinique. Il s’agit de comprendre quel type de rationalité le terme « clinique » engage, rationalité qui mêle, hier comme aujourd’hui, observation de cas individuels, établissement de généralisations dans une recherche des causes, établissement d’un diagnostic, stratégie de soin, mais également, et depuis Hippocrate, souci éthique dans la relation entre soignant et patient.
Les cinq contributions qui suivent, et qui ont d’abord été des interventions prononcées lors d’un de ces colloques bordelais, voudraient témoigner de cette démarche. Les textes ne peuvent hélas rendre compte des discussions qu’ils ont alors suscitées — il ne s’agit en somme que d’un versant du pari interdisciplinaire que se joue chaque année, le versant antique. Mais chacun d’eux indique suffisamment de passerelles, de ces « échos » qui font la richesse et la complexité de la notion de clinique, pour donner un aperçu de la pertinence de la référence à l’Antiquité : pertinence pour la compréhension de ce qu’on appelle « clinique » en ne sachant pas toujours ce que recouvre le terme, mais également pertinence pour la compréhension de ce qui s’impose toujours comme une pratique prise dans une relation entre soignant et patient, pratique dont il convient de rendre compte par l’écriture. De fait, les cinq contributions s’interrogent toutes, d’une manière ou d’une autre, sur le fait d’écrire la clinique, et ce qu’il engage comme conséquences du point de vue de la recherche et de la transmission.
Ainsi, les textes de J. Giovacchini (« Comment décrire des cas sans maladies ? La recherche d’une écriture clinique dans les Épidémies ») et de J. Devinant (« La fabrique des prodiges. Théorie et stratégies du diagnostic chez Galien ») semblent opposer deux « écritures de la clinique » : celle, exotérique, d’un Galien usant volontiers d’une certaine rhétorique dans le souci de mettre en scène, en en écartant au besoin le patient (mais pas l’observation active des signes qu’il montre), la virtuosité de son diagnostic, contre ce que J. Giovacchini appelle « un schéma narratif de la maladie » que développent les Épidémies, « une démarche empirique tournée vers le singulier, dont la perspective n’est pas uniquement épistémique mais également éthique, à travers une narration orientée vers la thérapeutique ». On peut souligner combien ces deux approches de la pratique médicale partagent une méfiance commune : celle à l’encontre d’une connaissance qui ne serait que livresque, lorsque l’exercice de la médecine, dans la clinique, s’impose comme praxis. Il serait cependant illusoire de chercher à réduire leurs différences quant à la relation entre médecin et patient. Il est néanmoins nécessaire de leur donner un sens, à la fois épistémologique et pratique, un sens qui peut encore se révéler pertinent pour la clinique aujourd’hui.
En se situant résolument à une période charnière de l’histoire de la médecine, avec une recherche sur Laennec, médecin et philologue, F. Le Blay (« Laennec et Caelius : la philologie comme clinique ») montre que « l’exercice de lecture et de traduction des textes constitutifs d’une histoire de la clinique s’intègre dans la méthode de Laennec et contribue à fonder son épistémologie médicale, à une époque où les pratiques sont soumises à des redéfinitions majeures ». Cela lui permet de saisir le geste de la traduction des écrits de Caelius par Laennec comme fondamentalement clinique — là encore, l’accent est mis sur la pratique, plus que sur les théories qui peuvent diverger, sur l’observation « attentive et raisonnée des faits particuliers », d’hier et d’aujourd’hui.
M. Bourbon (« Jusqu’où peut-on rapprocher les thérapies cognitives de la thérapeutique sénéquienne ? La fonction psychothérapeutique du De la tranquillité de l’âme en question ») et V. Laurand (« Un “cas clinique” chez Épictète : l’obstination. Une lecture d’Entretiens 2, 15 ») se penchent plus précisément sur le stoïcisme (et plus spécifiquement sur deux pratiques romaines de celui-ci) comme « psychothérapie », en soulignant là encore à la fois la modalité d’écriture d’une clinique qui se voudrait tout autant enseignement que soin. Alors que les thérapies cognitives actuelles croient parfois trouver dans les échos de l’Antiquité de quoi se donner des racines lointaines, M. Bourbon montre au contraire que Sénèque souhaite moins à Sérénus, dans le De tranquillitate animi, une adaptation sociale qu’une appropriation à lui-même, comme sujet de sa volonté. C’est vers Épictète que se tourne V. Laurand pour montrer, dans ce qu’il considère comme l’exposé d’un cas clinique, comment l’enseignement du maître doit en passer par des gestes cliniques pour pouvoir prétendre prendre soin du disciple, en visant, lorsqu’il est possible, le traitement d’une souffrance.