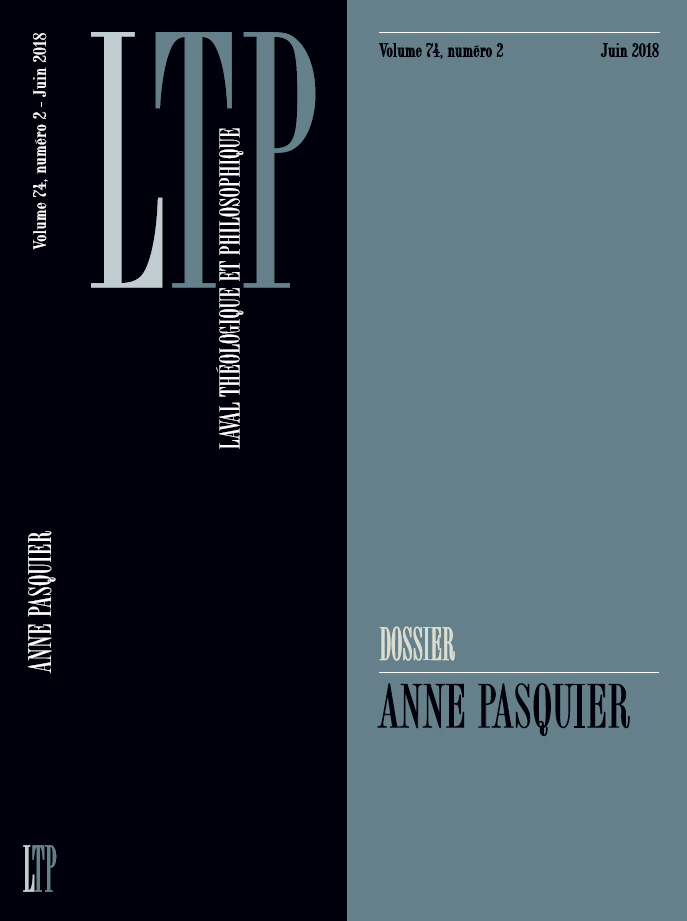Article body
Comme l’a déjà bien montré André Bareau[1], certains épisodes de la vie du Buddha ont depuis longtemps fait partie des premières collections de textes canoniques (Sūtra et Vinaya) avant de se trouver peu à peu réunis en biographies autonomes, mais partielles, en gros à partir du siècle qui a précédé l’ère chrétienne. Le Lalitavistara est l’une de ces biographies partielles qui s’est constituée en milieu mahāyāna, probablement au cours du iie siècle après J.-C. Ce livre s’est vraisemblablement inspiré des fragments de biographie contenus dans les textes canoniques ; on pense qu’il a dû également puiser dans les cycles d’épisodes liés à des lieux de pèlerinage spécifiques, comme Kapilavastu, le lieu de la naissance du Buddha, Bodhgayā, le lieu de son éveil, et Sārnāth, le lieu de son premier sermon. Ce sūtra, dont la première traduction complète à partir du texte tibétain a été réalisée par P.É. Foucaux en 1847-1848[2], a fait l’objet de diverses études ou essais d’interprétation. Le petit livre qui vient d’être publié par Guillaume Ducoeur est un commentaire basé sur le texte sanskrit et ses deux traductions chinoises anciennes (en 308 et 683 après J.-C.). Il est écrit dans une collection dont le format ne permet pas de longues discussions. Il aborde brièvement la question du genre littéraire de ce livre, celle de sa structure, de ses sources textuelles et mythologiques, et en étudie certains thèmes récurrents. Il s’agit d’un livre dans l’ensemble bien informé, facile à lire, et qui réunit une documentation souvent peu accessible. Pour comprendre la visée du Lalitavistara, on retiendra que cette biographie n’avait au point de départ aucune prétention historique : « La vie du fondateur telle qu’elle est narrée dans ce sūtra est une construction littéraire qui a pour objectif premier d’exposer les fondements de la doctrine » (p. 54). Le Buddha y devient un religieux archétypal qui est un modèle à suivre par tous les futurs moines bouddhistes. La doctrine qu’on y découvre coïncide avec celle qu’on trouve dans d’autres sūtra mahāyāna (voir p. 54-55, 66-72).
N’étant pas moi-même spécialiste du bouddhisme, je me contenterai de prendre le train en marche et de proposer sans prétention les remarques qui me viennent en tant que lecteur attentif du Harivaṃśa [HV], un complément à l’épopée du Mahābhārata [Mbh] datant probablement des iie-iiie siècles de notre ère, un livre parallèle hindou visant à présenter une biographie du dieu Kṛṣṇa répondant aux attentes des dévots de cette divinité et susceptible de répondre aux interrogations des lecteurs du Mbh. Ducoeur mentionne d’ailleurs explicitement l’intérêt scientifique qu’il peut y avoir à rapprocher le Buddha du mahāyāna du Kṛṣṇa de l’épopée, et indirectement le Lalitavistara du Harivaṃśa (voir en particulier p. 101-104). Il se fonde entre autres sur Émile Senart (1847-1928) qui, dans un célèbre essai sur la légende du Buddha, avait déjà noté que « la figure du Buddha du Lalitavistara empruntait à celles du Puruṣa-Viṣṇu et de Kṛṣṇa-Viṣṇu » (p. 103)[3]. Les suggestions qui suivent porteront tour à tour sur le contexte général de dévotion ou bhakti dans lequel ce livre évolue, la place des divinités dans ce contexte, la question de la « descente » du Bodhisattva dans le monde des humains et finalement le problème de la traduction du mot vyūha.
I. Un contexte général de bhakti
Une première remarque concerne le contexte général de bhakti, qui est celui du livre bouddhique autant que du livre hindou. Le personnage dépeint dans le Lalitavistara est un bodhisattva, c’est-à-dire un être destiné à l’éveil. On lui donne dès le premier chapitre le titre de « Bhagavant », laissé tel quel ou traduit conventionnellement par « Bienheureux ». Il est apparu dans ce monde par pure compassion pour libérer les humains de la douleur qui les assaille et reçoit régulièrement les hommages de ses dévots (upāsaka, voir p. 80-81). Ducoeur présente avec à-propos le contexte dévotionnel dans lequel ce livre évolue. Je me demande cependant s’il faut voir dans cette dévotion bouddhique une « influence du bhāgavatisme » (p. 78) hindou ?
Me fondant sur une enquête couvrant l’ensemble du Mbh et du HV[4], je suis arrivé à la conclusion qu’il fallait se méfier d’une certaine étymologie du mot bhakti à partir de la racine bhaj au sens de « partager » (Ducoeur fait allusion à cette étymologie en p. 79-80). La bhakti est plutôt l’expression du dévouement, ou de la « dévotion », de l’inférieur vis-à-vis de celui qui lui est immédiatement supérieur à l’intérieur d’un monde indien conçu comme naturellement hiérarchisé. C’est un sentiment de loyauté à un supérieur, mais qui ne peut exister que si ce supérieur est en mesure de répondre à la « dévotion » dont il est l’objet en se montrant généreux envers celui ou celle qui l’honore ainsi. Cette bhakti implique une relation d’interdépendance qui prend nécessairement un sens différent selon qu’il s’agit de l’un ou l’autre terme de la relation. Alors que, dans un cas, la dévotion s’exprime dans des gestes ou rites de soumission, dans l’autre cas, elle ne prend corps et sens que si le supérieur protège son dévot et déverse sur lui les dons de sa totale générosité. La bhakti s’inscrit en fait dans un ordre général qui s’appelle le dharma et qui englobe tant le donateur que celui qui reçoit le don, tant le supérieur que l’inférieur. Ce terme, qui exprime le lien asymétrique qui réunit la personne dévouée et l’autre personne ou entité qui fait l’objet de cette dévotion, s’emploie régulièrement dans l’épopée indienne pour évoquer le lien de confiance réciproque qui relie des personnes de statut différent, qu’il s’agisse des sujets et de leur roi, des protégés et de leur protecteur, des élèves et de leur gourou, d’une femme et de son mari, etc. L’univers de la bhakti apparaît donc comme un fait de culture typiquement indien, qui ne peut que s’exprimer à tous les niveaux de cette société.
En tant qu’expression d’un fait social typiquement indien, la bhakti est une réalité qui existe avant même que la religion ne s’empare de ce vocabulaire pour parler d’une divinité perçue comme un souverain universel qui déverse ses grâces sur ses dévots. « Bhagavant » est un titre de respect qui évoque un être « plein de bonne fortune », susceptible de répandre ses bénédictions sur tous ceux et celles qui se soumettent à lui en toute confiance. S’il est vrai que le vocabulaire de la bhakti est d’abord celui d’une société, on ne se surprendra pas qu’un certain bouddhisme, celui du mahāyāna, s’exprime avec le même vocabulaire quand il transforme le Buddha en un être de compassion susceptible d’apparaître dans le monde humain pour le supporter et l’enseigner.
Ducoeur a donc tout à fait raison d’attirer l’attention de ses lecteurs sur le fait que le Lalitavistara utilise le vocabulaire de la bhakti (voir p. 83) et que le Bhagavant du Lalitavistara se comporte tout à fait comme le Bhagavant des cultes hindous de dévotion : il vient sauver les êtres vivants et s’attend en retour à un culte dévotionnel qui s’accomplit dans ce cas par la vénération des caitya et des stūpa (p. 80-81). Je verrais cependant davantage la bhakti comme une « mode » panindienne[5], attestée davantage à l’intérieur de certains cultes hindous devenus très populaires, que d’y voir un phénomène typiquement hindou qui aurait par la suite influencé le bouddhisme et le jaïnisme.
II. La place des divinités en contexte de bhakti
Ducoeur a encore raison d’insister sur le fait que la naissance du Buddha emprunte à celle d’Indra (la naissance par le flanc) et que le combat livré contre Māra, le maître des désirs, reprend celui qu’Indra a jadis livré au démon Namuci (voir p. 75-77). On sait que pendant son enfance, lorsqu’il a soulevé le mont Govardhana, le Bienheureux Kṛṣṇa a également humilié Indra qui n’a eu d’autre choix que de se soumettre à lui. En fait, en contexte de bhakti, cette attitude des divinités n’est pas seulement celle d’Indra en tant que dieu des pluies, mais celle de toutes les autres divinités qui doivent nécessairement s’intégrer à un ordre nouveau qui les dépasse. Avant de présenter l’enfance de Kṛṣṇa, le HV commence par raconter en détail la victoire de Hari-Nārāyaṇa (une forme de Viṣṇu) sur Kālanemi, littéralement « la jante [de la roue] du temps », un démon qui incarne le temps de la mort. Au terme d’un légendaire combat où les fiers démons parviennent à vaincre successivement Indra et sa tāmasī māyā (c’est-à-dire ses sombres orages), Soma et Varuṇa (l’Astre lunaire, et le maître des océans, régent de l’Ouest), Agni et Vāyu (le Feu et le Vent), apparaît Kālanemi aux cent bras. Ce monstre suscite l’apparition de Hari Nārāyaṇa qui, de son disque, tranche d’un coup les multiples bras qui rendaient son adversaire invincible. Après être ainsi parvenu à évincer les divinités, Kālanemi se substitue littéralement à chacune d’elles et concentre en sa propre personne toutes les fonctions qu’elles occupaient jadis (HV 37,47-59). Comment réagit Hari-Nārāyaṇa ? En lui, nulle aspiration à imiter Kālanemi et à se substituer aux divinités. Après avoir soumis son gigantesque ennemi, il redonne immédiatement à chacune de ces divinités les fonctions qui étaient les leurs, à condition évidemment qu’elles reconnaissent sa souveraineté universelle. Il demande à Indra de poursuivre son travail pendant la mousson, à Varuṇa, à Yama, à Kubera, à la Lune et au Soleil, à Agni le feu, etc., de reprendre leurs fonctions respectives (HV 38,68-72). Il n’est jamais question d’éliminer les divinités, mais que chacune accepte de se soumettre à Viṣṇu tout en remplissant de son mieux la tâche qui lui revient.
Il se passe exactement la même chose dans le contexte du Lalitavistara. Ici également, dès le premier chapitre, le Bhagavant accepte d’enseigner à toutes les créatures y compris aux divinités. Au chapitre 3, il est dit que le Bodhisattva enseignait aux dieux Tuṣita. Au chapitre 6, les dieux s’interrogent sur ce que deviendra le Bodhisattva sur la terre des hommes, tandis que Brahmā et Indra veillent sur son entrée dans le sein d’une femme terrestre. Au chapitre 7, Indra et Brahmā reçoivent le nouveau-né dans leurs bras. Au chapitre 15, différents dieux ou troupes de dieux incitent même le Bodhisattva à quitter de nuit le palais de son père le roi Śuddhodana et à découvrir la voie qui lui permettra de vaincre l’ignorance et d’atteindre à la libération. Le chapitre 8 contient une scène fantastique qui résume en quelque sorte tout ce qui vient d’être dit : à peine le Bodhisattva vient-il de poser la plante de ses pieds dans un temple (devakula) que les images inanimées des dieux (acetanyo devapratimāḥ) — Śiva, Skanda, Nārāyaṇa, Kubera, Candra, Sūrya, Vaiśraṇava, Śakra (Indra), Brahmā, les gardiens du monde sont explicitement nommés — quittent tour à tour leur place et tombent aux pieds du Bodhisattva. Ce rapide survol montre que le Lalitavistara suppose une sorte de nouvelle complicité entre le Bodhisattva et les divinités qui s’inscrit parfaitement dans le monde de la bhakti qui vient d’être présenté et que l’on retrouve mutatis mutandis dans le HV[6].
III. À propos de la notion d’avatāra
La présente remarque porte sur la notion de descente de la divinité dans le monde des humains, encore ici au centre de l’univers de la bhakti. Il faut d’abord noter que l’expression garbhāvakrānti, « descente en embryon », est une formule répandue dans les milieux tant brahmaniques que bouddhiques pour désigner l’apparition du foetus dans le sein maternel[7]. C’est cette expression que l’on trouve utilisée à plusieurs reprises dans le Lalitavistara quand il est dit par exemple qu’après avoir quitté (cyutvā) sa demeure dans le ciel des Tuṣita, le Bodhisattva descendra dans le sein d’une mère[8]. Même si c’est le verbe « ava-kram », descendre (et ses dérivés), qui est utilisé, le composé garbhāvakrānti n’a vraisemblablement rien à voir avec la notion plus tardive d’avatāra, qui a aussi le sens premier de « descente » (opinion différente, p. 80-82). Dans un article de 2001[9], je faisais remarquer à la suite de Paul Hacker (1960) que le mot d’abord utilisé pour désigner les apparitions de Viṣṇu dans le monde des humains était prādurbhāva (ou le verbe correspondant), un mot qui désigne toute apparition ou manifestation de quelque chose ou de quelqu’un. C’est le terme utilisé par le HV lorsqu’il est question des « manifestations » de Viṣṇu (HV 31), tandis que le Viṣṇu-Purāṇa et le Bhāgavata-Purāṇa, plus tardifs, font plutôt usage du terme avatāra. Dans le même ordre d’idées, il a déjà été noté que la Bhagavad Gītā [BhG], datant probablement du iie s. après J.-C., n’utilise pas non plus le verbe avatṝ pour parler de la manifestation de Viṣṇu mais d’autres verbes plus ordinaires : « Bien que je ne sois pas assujetti à naître (puisque) mon essence est immuable, bien que je sois le Seigneur des êtres (venus à l’existence), en usant de la nature mienne, je viens à l’existence par mon pouvoir magique (prakṛtiṃ svām adhiṣṭhāya saṃbhavāmy ātmamāyayā). En effet, chaque fois que l’ordre (dharma) défaille, ô Bhâratide, et que le désordre (adharma) s’élève, c’est alors que moi, je me produis moi-même (tadātmānaṃ sṛjāmy aham) » (BhG 4,6-7, traduction Esnoul et Lacombe). Les verbes utilisées ici sont ceux qui servent à parler de la naissance (saṃbhū) ou encore de la production ou de l’émission d’une substance (sṛj). Autrement dit, selon la BhG, Viṣṇu prend appui (adhiṣṭhā) sur sa base matérielle (prakṛti) et naît (saṃbhū), ou encore se crée ou se produit (sṛj) lui-même en utilisant sa māyā, c’est-à-dire sa capacité de faire apparaître en une sorte de jeu des productions merveilleuses, des sortes de doubles de lui-même. En utilisant la notion de māyā qui remonte à l’époque védique, la BhG se situe dans le prolongement des créations magiques, caractéristiques des antiques divinités[10].
Mais l’article que je viens de citer ajoute que l’on commence à parler d’avatāra quand une métaphore spécifique s’impose pour parler de la manifestation d’une nouvelle forme de Viṣṇu : celle d’un acteur qui entre dans un monde alors comparé à une vaste scène. Le terme technique utilisé en sanskrit pour parler d’une « entrée en scène » est justement raṅgāvataraṇa, c’est-à-dire « descente sur une scène ». Le Kṛṣṇa du Viṣṇu-Purāṇa et du Bhāgavata-Purāṇa devient peu à peu un personnage qui entre sur la scène que constitue le campement de bouviers (vraja, ghoṣa, etc.) en revêtant un costume forestier et en se parant de divers ornements, tout en se mettant à rire, à danser et à jouer de la flûte. Le mot avataraṇa est connue du Mbh, et s’utilise pour tous les protagonistes de cette guerre dont on dit qu’ils sont « descendus » dans le monde pour y prendre part. Pour signifier que les guerriers entrent sur le champ de bataille du Kurukṣetra, il arrive même que le Mbh dise qu’ils y « descendent », comme si c’était une scène. Alors qu’on énumérait dans le HV les manifestations (prādurbhāva) de Viṣṇu, on se mettra peu à peu à parler de ses avatāra. Et pour comprendre comment le passage s’est opéré, il faut vraisemblablement prendre conscience que, lorsque le jeune Kṛṣṇa tue le méchant roi Kaṃsa à Mathurā en tant même que manifestation de Viṣṇu, c’est justement sur la scène d’un théâtre (raṅga) que celui-ci a fait construire pour de grandioses célébrations. L’expression n’est qu’indirectement utilisée à ce moment-là : on dit par exemple qu’après avoir tué l’éléphant Kuvalayāpīḍa, Kṛṣṇa est apparu devant les spectateurs, littéralement « est descendu (avatīrṇa) » dans cette assemblée qui avait l’apparence d’un océan (HV 74,39). C’est seulement quelques siècles plus tard qu’avec le Viṣṇu-Purāṇa, les hindous prendront l’habitude de parler des avatāra de Viṣṇu (littéralement de ses descentes), une expression qu’il serait alors beaucoup plus juste de traduire par ses « entrées en scène ».
Guillaume Ducoeur signale avec raison que l’auteur (ou les auteurs) du Lalitavistara qualifie de jeux les activités du Bodhisattva. Lalita doit d’abord être compris au sens de krīḍ, jouer, note-t-il. Il poursuit :
Lors de l’obtention de l’éveil, sont décrits les jeux innombrables du Bodhisattva par l’emploi récurrent de la formule « Ceci est encore un jeu du lion des hommes assis sur son trône » (iyam api narasiṃhasyāsanasthasya krīḍā, Lv 22.29-34). Cette idée de pouvoir librement se jouer du monde des désirs (kāmadhātu) et du monde des formes (rūpadhātu) et de s’en affranchir est propre, d’une part, au domaine de la quatrième concentration (dhyāna) à laquelle accèdent les moines (bhikṣu) pleinement accomplis (arhant), et, d’autre part, à la spécificité de la doctrine mahāyānique du véhicule des bodhisattva (bodhisattvayāna) » (p. 24).
On comprend alors que la traduction la plus exacte du titre de ce livre est « Développement des jeux » (du Bodhisattva). Le Lalitavistara constitue donc une longue présentation, perçue sur le mode du jeu, de ce qu’a réalisé le Bodhisattva. Le jeu est également au centre du HV où les actions de Kṛṣṇa se présentent justement comme des jeux d’enfance[11]. Le thème du jeu, présent aussi bien dans le HV que dans le Lalitavistara, sert en fait à évoquer la liberté souveraine autant de Kṛṣṇa que du Buddha. Les commentateurs de Brahma-Sūtra 2,1,33-34 ont depuis longtemps compris que le Brahman n’agissait pas pour atteindre un but autre que lui-même et que, par conséquent, on ne pouvait qualifier ses interventions d’actions (karman) au sens propre. Parce que de telles actions ne peuvent avoir d’autre but que le Brahman lui-même, on ne peut les comparer qu’au jeu (līlā, etc.), que ce soit les jeux amoureux d’un grand roi avec ses femmes, les jeux d’un enfant ou encore les jeux d’un acteur sur une scène[12]. Le même raisonnement s’applique aussi, me semble-t-il, dans le cas du Buddha.
IV. À propos de l’utilisation du mot vyūha
Une dernière remarque concerne le mot vyūha, qui est un terme technique qui désigne une méthode particulière d’intervention dans le monde des humains. Ducoeur rend ce mot par « manifestation » (p. 27, 53), une traduction qui semble apparentée à celle d’expansion ou d’émanation que l’on trouve dans les textes pāñcarātra ou qui s’en inspire, et cela malgré le fait que l’ancienne traduction de Foucaux traduisait déjà le mot vyūha par « arrangement[13] ». Cette traduction me semble insuffisante. En effet, Gonda[14] a déjà critiqué la traduction de vyūha par expansion ou émanation en insistant sur le fait que le verbe vy-ūh et le substantif correspondant faisaient partie du vocabulaire technique des spécialistes du rituel védique pour parler d’un ensemble dont il faut réorganiser les parties dans le but de le rendre plus efficace. Entre autres exemples, il cite celui d’un verset védique bien connu, la Gāyatrī (Ṛgveda-Saṃhitā 3,62,10) : si l’on place cinq syllabes en avant et trois en arrière, dit un commentaire, on obtient une disposition qui donne à cette formule plus d’efficacité et garantit la protection des dieux[15]. Le terme vyūha en serait venu par la suite à désigner toutes sortes de dispositifs faits d’éléments que l’on éloigne les uns des autres dans le but de leur conférer plus de force. À l’époque du Mahābhārata, le terme vyūha s’emploie régulièrement, en contexte guerrier, pour signifier une certaine disposition ou configuration des forces en présence, un certain ordre de bataille. Une des qualités d’un vyūha, peut-on y lire, est d’être solide, ferme (sthira) et impénétrable (abhedya, Mbh 6,21,2 ; 6,67,1, etc.), de façon à mieux résister aux forces adverses[16]. Sans utiliser explicitement le terme technique vyūha, le HV emploie une stratégie équivalente : pour combattre le démon Bāṇa et finalement réussir à délivrer Aniruddha, les trois combattants que sont Kṛṣṇa, son frère Saṃkarṣaṇa et Pradyumna adoptent une disposition de combat qui rend le groupe plus efficace (HV 110,47-49).
Dans le cas du Lalitavistara, il me semble que l’on est également dans un contexte où les forces du bien, celles du Bodhisattva, doivent utiliser des stratégies de protection. On dit qu’après sa conception, pour ne pas être souillé par le corps impur de sa mère Māyā, le Bodhisattva, qui avait alors la taille d’un enfant de six mois, descendit dans son sein, mais à l’intérieur d’une structure protectrice appelée ratnavyūha, un composé qui ne peut signifier à mon avis qu’« arrangement de joyaux » (voir p. 81). Il doit s’agir de joyaux disposés de façon à créer autour de l’enfant-foetus une enveloppe protectrice. On sait en effet que les gemmes, en Inde, en plus de servir d’antidote au venin des serpents et de guérir certaines maladies, protègent également contre l’influence néfaste des démons. On peut donc supposer que cette structure de gemmes a servi en quelque sorte de bouclier pour contrer les odeurs et autres influences néfastes liées au milieu dans lequel se produit normalement la gestation[17]. En suivant la même logique, je suggère de traduire lalitavyūha (chap. 19, p. 210, ligne 5) par un samādhi[18] portant le nom d’« arrangement de jeux », ce qui pourrait désigner une forme de méditation sur les jeux mondains du Bodhisattva disposés dans un ordre tel qu’ils permettent au méditant de triompher des forces du désir. Quant à l’alaṃkāravyūha-samādhi dont il est question au chapitre 1 (chap. 1, p. 2, ligne 16), ce pourrait être également une forme de méditation profonde (samādhi) portant le nom d’« arrangement d’ornements », mais sans qu’il soit possible d’en dire davantage[19].
S’il est vrai que la manifestation du Buddha ne peut se réaliser en contexte de bhakti sans que ce souverain universel impose sa domination sur les autres divinités, on peut également supposer que cette victoire ne peut s’obtenir sans une coordination des forces en présence, sans utilisation de dispositifs efficaces pour contrer les forces contraires. C’est exactement ce que les vyūha permettent de réaliser en contexte de bhakti.
Conclusion
Les considérations qui précèdent montrent à l’évidence que ce petit livre méritait d’être écrit, ne serait-ce que parce qu’il force la réflexion et oblige à découvrir de nouvelles avenues pour comprendre les débuts du mahāyāna. On a en effet souvent tendance à considérer chaque tradition religieuse comme des touts indépendants qui doivent être étudiés en vase clos. Ces quelques notes cherchent à faire comprendre qu’il est possible de rapprocher davantage le Lalitavistara de l’hindouisme ambiant que ne l’a fait Guillaume Ducoeur. L’Inde ancienne doit être considérée comme un monde fluide sillonné entre autres par des brahmanes, des moines bouddhistes, des maîtres jaina, qui parlent tous foncièrement un même langage[20]. À partir d’une certaine époque, sans doute quelques siècles avant l’ère chrétienne, apparaissent diverses religions, avec chacune une histoire et une théologie spécifique, centrées sur la dévotion (bhakti) à un Seigneur que l’on nomme Bhagavant, qui apparaît sur la terre par compassion (karuṇā, dayā, etc.) pour des humains aux prises avec la douleur et qui se plaît à séduire ses dévots par ses jeux (līlā, krīḍana, lalita, etc.), à les combler de ses attentions. Émile Senart a certes déjà amorcé certaines recherches en ce sens, mais qui doivent maintenant être ajustées aux progrès de l’indianisme contemporain. Il me paraît désormais impossible de comprendre les débuts du mahāyāna sans prendre conscience qu’on y parle un langage à plusieurs égards similaire à celui que l’on trouve dans les plus anciens textes concernant Kṛṣṇa. La venue du Bodhisattva dans le monde des humains me paraît tout à fait comparable à celle de Kṛṣṇa à Mathurā. Ces deux maîtres naissent sur le continent indien pour libérer les humains prisonniers d’un monde qu’ils comparent à une jungle impénétrable ou à un océan insondable (saṃsāra). Le Buddha et Kṛṣṇa sont tous les deux des êtres hautement spirituels dont les actions totalement désintéressées appartiennent au registre du jeu. Dans le bouddhisme comme dans l’hindouisme apparaissent de nouveaux textes parfois très longs, d’une part des sūtra qui racontent dans une sorte de prédication de dimensions épiques (p. 37-40) les faits et gestes d’un certain Bodhisattva tout en prodiguant à ses auditeurs/lecteurs un enseignement spécifique, et d’autre part des itihāsa, des textes épiques qui racontent les gigantesques combats que se livrent deux familles ennemies tout en y incorporant des réflexions qui transforment l’ancien ritualisme védique. Par-delà ces histoires, il y a la conviction que la sagesse ne réside plus uniquement dans les mains de quelques virtuoses : le nouveau bouddhisme sait désormais que tout un chacun possède en soi le germe de l’éveil, tandis que le nouvel hindouisme pense que cette libération passe essentiellement par le svadharma, devoir de caste de chacun, que celui-ci soit brahmane ou intouchable. Les moyens de salut se multiplient par le fait même de part et d’autre : du côté bouddhique, on parle d’un Buddha qui prêche l’habilité dans les moyens (upāyakauśalyā) ; du côté hindou, on mise sur des yoga qui sont des maîtrises dans le domaine de l’action (yogaḥ karmasu kauśalam, BhG 2,50). Et ce nouvel idéal est transmis d’un côté par des bodhisattva qui réapparaissent d’âge en âge et s’illustrent en tant que héros de compassion, et de l’autre par des manifestations (prādurbhāva) ou des descentes (avatāra) parmi les humains d’un certain Viṣṇu qui n’hésite pas à prendre les costumes les plus variés pour toucher le coeur de ses dévots.
Appendices
Notes
-
[1]
André Bareau, Recherches sur la biographie du Buddha dans les Sūtrapiṭaka et les Vinayapiṭaka anciens, t. I, De la quête de l’Éveil à la conversion de Śāriputra et de Maudgalyāyana, t. II, Les derniers mois, le Parinirvāṇa et les funérailles, t. III, Articles complémentaires, Paris, École française d’Extrême-Orient, respectivement 1963, 1970-1971, 1995.
-
[2]
Philippe Édouard Foucaux, Le Lalita Vistara, ou Développement des jeux, contenant l’histoire du Bouddha Çakya-Mouni depuis sa naissance jusqu’à sa prédication, traduit du sanscrit, 2 vol., Paris, Ernest Leroux (coll. « Annales du Musée Guimet », 6 et 19), 1884 et 1892 ; c’est cette seconde traduction (la première ayant été réalisée à partir du tibétain en 1847-1848) qui a été rééditée sous le titre : Le Lalitavistara. L’histoire traditionnelle de la vie du Bouddha Çakyamuni, traduit du sanscrit par P.E. de Foucaux (sic), Paris, Les Deux Océans (coll. « Les classiques du bouddhisme mahāyāna »), 1988.
-
[3]
Plus précisément, il est dit que la légende du Buddha « trouve ses analogies constantes dans le cycle unique de Purusha-Vishṇu, de Vishṇu-Kṛishṇa » (Émile Senart, Essai sur la légende du Buddha, son caractère et ses origines, seconde édition revue et suivie d’un index, Paris, E. Leroux, 1882, p. 440).
-
[4]
Publiée récemment sous le titre « Observations Concerning the Notion of Bhakti in the Mahābhārata », dans André Couture, Kṛṣṇa in the Harivaṃśa, vol. 2, The Greatest of All Sovereigns and Masters, Delhi, D.K. Printworld, 2017, p. 293-336.
-
[5]
Je reprends une expression d’Eliade à propos du tantrisme (voir Mircea Eliade, Le yoga, immortalité et liberté, Paris, Payot, 1954, p. 203).
-
[6]
Je développe les idées résumées ici dans « La place d’Indra dans l’épisode du soulèvement du mont Govardhana selon le Harivaṃśa : les présupposés d’une interprétation », Cahiers des études anciennes, 54 (2017), p. 127-156. Accessible sur https://journals.openedition.org/etudesanciennes/963.
-
[7]
Voir Arion Roşu, Les conceptions psychologiques dans les textes médicaux indiens, Paris, Institut de civilisation indienne (diffusion de Boccard), 1978, p. 163, également 272, pour la traduction de l’expression. Roşu explique en p. 272, n. 1, qu’il préfère cette traduction à la traduction « descente de l’embryon », attendu que « l’âme et son substrat subtil (liṅga) descendent dans le sein maternel lors de la conception (garbhāvakrānti) » (p. 163). Ces conceptions sont celles des médecins indiens, mais Roşu précise immédiatement que l’interprétation du bouddhisme est particulière : « Si les bouddhistes font usage du vocable garbhāvakrānti (pā. gabbhāvakkanti), leur interprétation est différente, puisqu’ils rejettent l’existence de l’ātman » (ibid.).
-
[8]
Voir les chap. 3-6. Les citations qui suivent proviennent de Lalita-vistara, éd. P.L. Vaidya (Darbhanga, The Mithila Institute, 1958). Les expressions utilisées varient (chap. 3, p. 11, ligne 8, bodhisattvo mātuḥ kukṣim avakramiṣyati ; p. 11, ligne 10 : yasyaiva(ṃ)rūpā garbhāvakrāntir bhavati ; p. 14, ligne 11, mātuḥ kukṣim avakrāmati ; chap. 5, p. 28, ligne 12 : kīdṛśenāham… rūpeṇa mātuḥ kukṣāv avakrāmeyam ; etc. On remarquera que le sujet de ces expressions c’est le Bodhisattva et non son ātman.
-
[9]
« From Viṣṇu’s Deeds to Viṣṇu’s Play, or Observations on the Word Avatāra As a Designation for the Manifestations of Viṣṇu », Journal of Indian Philosophy, 29, 3 (2001), p. 313-326 [repris dans Kṛṣṇa in the Harivaṃśa, vol. 2, p. 426-445].
-
[10]
« The word [māyā] has entered the English lexicon as a “mental fabrication,” primarily in the sense of the “appearing through fantasy” and thus of “illusion.” This is indeed the connotation of the word as it tends to be used in some Hindu philosophical schools of thought, particularly those traditions associated with the influential nondualist philosophy that has come to be known as the Advaita Vedānta […]. But this was not the word’s meaning in earlier, Vedic India. Here, māyā referred in general to the gods’ mysterious ability to construct objective forms where previously there were none. The gods’ māyā was associated particularly with the events and seeming marvels of nature, such as the appearance of the sun’s bright form at dawn from what previously had been a deep and encompassing darkness or the formation of thunderclouds in an otherwise empty sky. According to Vedic thought this is no ordinary process ; it reflected an unfathomable and even miraculous power of creativity and transformation. The deities are said to form those objects, first by conceiving them in their minds, second, by expressing or projecting those inward conceptions outward into time and space and, third, by dwelling in those forms they had thus created » (William K. Mahony, The Artful Universe. An Introduction to the Vedic Religious Imagination, Albany, SUNY Press, 1998, p. 6).
-
[11]
Voir André Couture, Kṛṣṇa in the Harivaṃśa, vol. 1, Delhi, D.K. Printworld, 2017, General Index, sous « Kṛṣṇa’s games and laughing ».
-
[12]
Voir Id., « Kubjā, la bossue redressée par Kṛṣṇa », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 155, 2 (avril-juin 2011), p. 1 013-1 051, en part. 1 043-1 044 ; traduction anglaise dans Kṛṣṇa in the Harivaṃśa, vol. 1, p. 214-259, en part. p. 254-255. Voir également William S. Sax, ed., The Gods at Play. Līlā in South Asia, New York, Oxford University Press, 1995, en part. les contributions de Norvin Hein et Clifford Hospital.
-
[13]
On se reportera aux pages 27 et 81 de son livre.
-
[14]
Jan Gonda, Viṣṇuism and Śivaism. A Comparison, London, The Athlone Press, University of London, 1970, p. 50-51.
-
[15]
Ibid. : « By pushing asunder the gāyatrī “five syllables in front and three behind”, the gods protected the sacrifice and the sacrificer » (p. 50), la référence étant « TS. 2,6,1,5, the verb used being vyauhan » (p. 165, n. 230). Concernant le bouddhisme, Gonda (ibid., p. 165, n. 222) cite Lilian Silburn, qui introduit le terme vyūha en discutant des saṃskāra, c’est-à-dire des tendances constructrices convergeant vers un but. Vyūha, ordinairement un arrangement des troupes en ordre de bataille, désigne plus généralement, dit-elle, « une coordination en vue d’une efficience » (Instant et cause, Paris, Vrin, 1955, p. 203).
-
[16]
Voir les références dans André Couture, « The Emergence of a Group of Four Characters (Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna, and Aniruddha) in the Harivaṃśa : Points for Consideration », Journal of Indian Philosophy, 34 (2006), p. 571-585, en part. p. 583-584. Le texte a été repris dans Kṛṣṇa in the Harivaṃśa, vol. 2, p. 196-214, en part. p. 212-213. On notera qu’un certain nombre de coquilles introduites systématiquement après la correction des épreuves ont été corrigées dans cette seconde version.
-
[17]
À propos de l’importance des bijoux et de leur signification en contexte indien, on pourra lire André Couture, « L’arrière-fond traditionnel indien de la thématique des bijoux dans Gaban », introduction à Premchand (1880-1936). Gaban. Détournement de fonds, traduction du hindi par Fernand Ouellet, avec la collaboration de Kiran Chaudhry, André Couture et Richard Giguère, Delhi, Langers, 2016, p. 5-10.
-
[18]
Une forme de méditation profonde bloquant les multiples transformations (vṛtti) engendrées par l’activité normale de connaissance.
-
[19]
Foucaux traduit par « arrangement des ornements du Bouddha » (Le Lalitavistara, p. 5).
-
[20]
Voir André Couture et Christine Chojnacki, Krishna et ses métamorphoses dans les traditions indiennes. Récits d’enfance autour du Harivamsha, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2014, en part. p. 17.