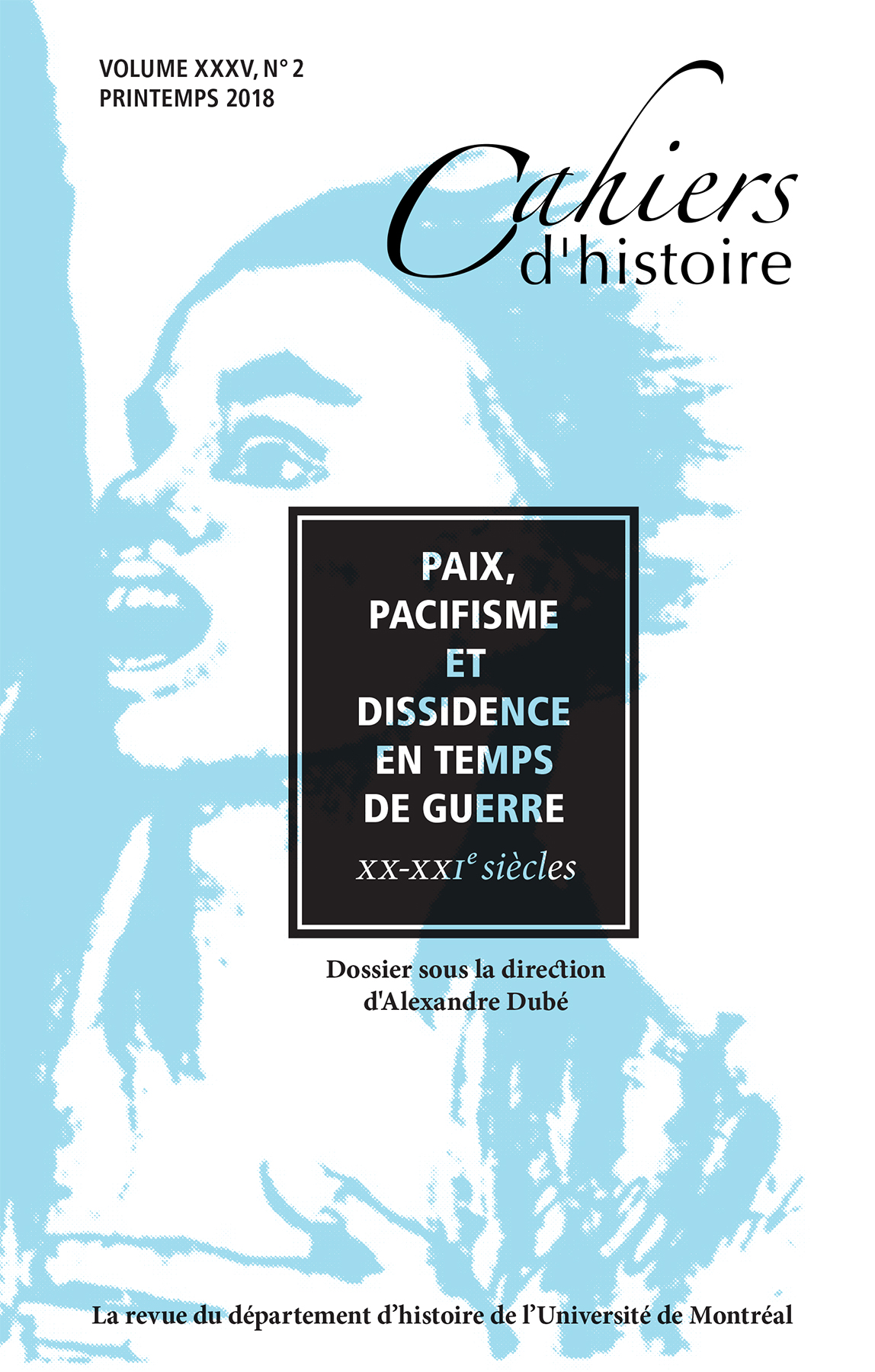Abstracts
Résumé
Cet article propose de réfléchir sur la façon dont s’articulent les états de guerre et de paix par le biais de la figure de l’otage, envisagée comme un espace de tensions et de négociations qui tantôt a apaisé, tantôt envenimé les conflits. Nous nous intéresserons à son évolution historique à partir de deux textes du 20e siècle dont le rapprochement s’est d’abord fait par les titres : une pièce de théâtre de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), et un essai de Jean Baudrillard, La guerre du Golfe n’a pas eu lieu (1991).
Article body
La guerre de Troie n’aura pas lieu : voilà le titre qu’avait donné Jean Giraudoux à sa pièce de théâtre, montée à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, en 1935, et qui voulait faire voir l’ironie d’une Histoire qui était à la veille de se répéter. Ce n’est pas un hasard si le dramaturge reprend le mythe grec de l’Iliade, un texte majeur d’Occident qui relate une des plus grandes batailles de l’Antiquité, puisque le mythe procède d’un temps cyclique, celui entre autres de la poésie sacrée. Ce n’est pas non plus par hasard qu’il situe l’action juste avant une déclaration de guerre, offrant ainsi un prélude à la fatalité de l’événement qui se prépare, et ce, malgré le non-sens dont le public est témoin. En 1991, juste avant le déclenchement des hostilités qui feront la guerre du Golfe, Jean Baudrillard publie dans le journal Libération un article qu’il avait d’abord intitulé La guerre du Golfe n’aura pas eu lieu, reconduisant l’ironie de Giraudoux pour médiatiser, cette fois, un non-lieu annoncé[1]. La théâtralité du titre avait de quoi plaire à Baudrillard qui s’apprêtait justement à traiter de la crise du Golfe persique comme d’une mise en scène douteuse où le public n’est plus témoin, mais désormais acteur. Son propos veut démontrer le passage d’une ère de la représentation (théâtrale) à une ère de la simulation (médiatique) où la distanciation critique fait place à la poursuite du réel qu’on cherche à capturer en images. Il écrit deux autres articles, l’un pendant, l’autre après le conflit—soit « La guerre du Golfe a-t-elle vraiment lieu ? » et « La guerre du Golfe n’a pas eu lieu », lesquels formeront un essai qu’on éditera sous le dernier titre de la triade.
L’ironie inférant un sens inverse à ce qui est énoncé, elle implique toujours un temps second, celui du décodage à rebours. Cet effet de différé ou de décalage temporel semble être mobilisé par les deux auteurs pour faire apparaître l’« ob-scène »—c’est-à-dire l’envers de la scène ou le hors champ—dans l’actualité en train de se jouer sous nos yeux. « Comprendre, c’est (donc) déjouer »[2], en l’occurrence ici ce qui articule les états de guerre et de paix.
Tandis que la temporalité de l’événement est problématisée dans les titres des oeuvres, avec l’inscription paradoxale dans une perspective historique qui se veut réversible, tandis que ces titres troublent l’horizon d’attente des lecteurs avec l’anachronisme, le lieu de l’événement, pour sa part, semble très bien arrêté, d’une part à Troie (aujourd’hui en Turquie), d’autre part dans le Golfe persique. Or, en lisant Giraudoux et Baudrillard, on réalise que la question du lieu et du non-lieu de la guerre est aussi problématique. En effet, les jeux de projection et de rétrospection qui agitent toute conscience collective, quand ils sont reproduits artistiquement, questionnent l’Histoire en tant que pratique interprétative entre la mémoire et l’anticipation, et où la réalité et la fiction coexistent, dans une certaine mesure, à travers la description des faits et l’organisation de ceux-ci en un récit narratif. Si l’historien veut rendre ce dernier le plus transparent possible, le littéraire en fait une problématique assumée. Ainsi, dans les deux textes à l’étude, c’est le temps qui semble déréaliser le lieu de l’événement, que ce soit par le détour du mythe de Troie pour aborder le conflit à venir entre la France et l’Allemagne, ou par celui de la « non-guerre » du Golfe pour parler du Nouvel ordre mondial venu d’Amérique.
C’est avec ces deux textes du 20e siècle que nous nous proposons de réfléchir sur la notion de paix, en traitant plutôt de son contraire, la guerre. C’est à travers la figure de l’otage qu’on analysera l’articulation des états de guerre et de paix, en envisageant l’otage d’abord comme un espace de négociations et de tensions, comme un champ de forces contraires qui tantôt a apaisé, tantôt a envenimé les conflits. Monnaie d’échange entre deux partis, objet d’une tractation de la dernière chance, « otage » a d’abord signifié « logement, demeure » (1160), puis, par l’intermédiaire d’expressions comme « laisser, prendre en ostage » dans le sens d’« abriter, loger » (1080), il a désigné l’hôte que l’on garde, la personne retenue comme garantie de l’exécution d’une promesse, d’un traité (1080). Par extension, le mot s’applique à toute personne dont on s’empare et que l’on utilise comme moyen de pression, de chantage : cette acception est d’époque révolutionnaire (1793). Le terme est quelque fois pris au figuré, notamment dans le discours politique, par exemple « être l’otage de qqn, de qqch »[3]. Un rapport édité en 2005 dans la Revue internationale de la Croix Rouge, intitulé « Une figure obsédante : l’otage à travers les siècles »[4], traite également de l’étymologie du terme « otage », qui a pour racine latine hospes, c’est-à-dire celui/celle qui offre l’hospitalité ou qui la reçoit, en d’autres termes l’« hôte » ; l’ancien latin utilisait quant à lui la variante hostis qui en viendra à signifier « ennemi ». La source du mot traduit déjà la réversibilité, et donc, l’ambiguïté du statut d’otage et annonce son évolution historique.
Un bref historique du statut de l’otage
Ce même rapport, fait par la Croix Rouge, relate qu’au départ, il s’agissait pour un pays de confier une personne notoire dotée d’un pouvoir politique, militaire ou autre, à l’autre parti le temps qu’une dette soit payée ou qu’un traité soit signé. L’otage, de façon générale, s’inscrivait dans un échange de bons procédés qui participait à désamorcer une situation conflictuelle, ou à la conclure. C’était là la pratique des otages donnés qui eut cours jusqu’au 18e siècle, alors que certains personnages historiques représentaient à eux seuls la souveraineté d’un pays. Ensuite ce sont des territoires qui ont été mis en gage, voire des populations entières : « …dans tous les cas, les populations résidentes sont vues et se perçoivent comme des otages à la merci des forces occupantes »[5]. Avec l’avènement de l’État-Nation, le principe de souveraineté est désormais représenté par un vaste ensemble de citoyens, si bien que tout un chacun peut servir d’otage. Probablement que c’est en raison de cette nouvelle interchangeabilité qu’on ne donne plus l’otage, dans un geste de réciprocité, mais qu’on le prend unilatéralement. C’est dire aussi que l’otage participe de plus en plus de l’escalade plutôt que de l’ajournement du conflit et qu’on exploitera la menace de sa mise à mort comme moyen de pression dans les négociations (chapitre « Entre hospes et obses »[6], soit entre l’hôte et l’ennemi). Le phénomène répété de guerre totale au 20e siècle voit les conquérants prendre des otages dans leur lieu d’origine, et généralement, ceux-ci servent d’exemple pour tout le reste de la communauté occupée. Puis, la dissolution du bloc soviétique et de l’organisation bipolaire du monde provoque l’apparition de nouveaux conflits, caractérisés par une forte asymétrie des forces en présence. En raison de quoi ce sera souvent hors du monopole de la violence détenu par les États que l’on verra des groupes s’attaquer de plus en plus à la population civile.
De fait, l’otage contemporain se trouve dans une posture différente de celle qui prévalait aux temps de la guerre totale, car il n’est plus pris à l’aveuglette, lors de razzias. Comme au Moyen Âge, il sert parfois de monnaie d’échange dans le but de toucher une rançon. La chose est courante dans des pays comme l’Irak ou la Colombie et touche généralement des ressortissants nationaux. Dans des cas plus rares, mais plus médiatisés, sa valeur serait moins pécuniaire que symbolique. En général, l’otage est alors envisagé comme un moyen de faire pression sur un « ennemi » externe[7].
En tous les cas, la réciprocité inhérente à l’hospes ou à l’hôte est moindre quand il y a une forte inégalité dans les combats ; l’otage n’a plus, aux yeux de ses ravisseurs, une valeur égale au gain qu’on tente d’en obtenir—si ce n’est celle que sa société d’appartenance lui confère. Tout l’enjeu est là. Aussi, l’otage n’appartient plus nécessairement au camp ennemi, mais plutôt à un tiers parti comme les ONG, les forces de l’ONU, etc. L’innocence ou la neutralité par rapport aux événements devient même un critère de sélection des victimes, car il accroit leur capital de sympathie populaire. Ainsi, parallèlement à l’imposition mondiale du modèle démocratique défendu par l’Occident vient une dissidence qui exploitera « les armes de l’ennemi », le plus souvent en les retournant contre un tiers, en s’attaquant à son individualité par exemple, une valeur occidentale de premier plan. Déshumanisé, traité en objet, le détenu créera l’émoi, et prendra de la valeur si et seulement si, paradoxalement, il est lui-même objectivé par les médias du « monde libre » (chapitre « de l’obses à l’objet », soit de l’ennemi à l’objet[8]).
Il semble que l’otage ait de moins en moins de valeur et qu’on en dispose maintenant comme d’une ressource renouvelable, vu l’importance du « vivier », et ce, dans le but de terroriser les populations visées. Ce n’est donc plus uniquement une rançon ou un levier de négociation qui justifie la prise d’otages, mais la terreur dont elle peut être l’instrument : « Ainsi, la dégradation du rôle d’otage est non seulement inversement proportionnelle mais consubstantielle à l’amélioration de son statut en tant qu’individu. C’est en raison de la dignité qu’il croit lui être due qu’on l’avilit »[9].
L’otage mythique et l’otage médiatique
Tout autre est la situation du premier otage mythique d’Occident. Il s’agit bien sûr d’Hélène, reine grecque et épouse du roi Ménélas enlevée par Pâris, prince de Troie, et qui passe à l’Histoire comme le casus belli d’une des plus importantes batailles de l’Antiquité. Mythe ou histoire, la guerre de Troie qui sert de propos à l’Iliade d’Homère met en présence deux peuples rivaux à forces quasi égales et qui se disputent, en la personne sublimée d’Hélène, un objet de désir obscur.
Les portes de la guerre s’ouvrent lentement. Elles découvrent Hélène qui embrasse Troïlus.
Ainsi se termine la pièce de Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu[10]. La cité d’Ilion s’apprête au siège des Grecs tandis que son enfant Troïlus succombe aux avances d’Hélène, dont le nom est « un destin pour les autres ». « Enlevée, c’est encore elle qui enlève », avance Nicole Loraux qui voit dans le personnage une représentation d’Éros[11]. Le titre paradoxal de la pièce témoigne d’une volonté de réécrire, voire de déjouer l’Histoire—laquelle semble déjà scellée par une sorte de fatalité, cette fois à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi l’auteur réfléchit sur la guerre, moins pour décrire l’actualité imminente, semble-t-il, que pour interroger l’absurdité d’une Histoire qui se répète.
Étant décrite par Giraudoux comme « l’heure qui précède une déclaration de guerre », la pièce imagine toutes les manoeuvres dont use Hector, chef militaire troyen, pour éviter la bataille et pour faire dérayer l’engrenage de la tragédie grecque. C’est à partir de cette pièce que nous poserons la question de l’otage, à savoir si Hélène est le gage d’une quelconque rétribution. Qu’investit-on symboliquement dans ce personnage « hybride », c’est-à-dire « tiers » nous le verrons, qui peut aussi bien concourir à la pacification qu’à l’escalade du conflit entre le camp grec et le camp troyen ?
Plus proche de nous, l’essai de Baudrillard écrit en 1991, La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu[12], décrit quant à lui la fatalité du spectacle médiatique d’une guerre qu’on met « à mort en direct » dans le souci d’en faire un événement présentable. L’asymétrie des forces en présence est alors telle que cette guerre s’est muée en chantage et en négociation d’otages, dit Baudrillard, de sorte que l’événement n’aura vraiment lieu qu’en mode virtuel, les médias pistant en continu le fantôme de la guerre, un peu comme les Antiques ont cherché à avoir la fuyante Hélène. Faire la paix serait devenu aussi difficile que faire la guerre aujourd’hui, la polarité des contraires étant peut-être menacée par des états d’urgence prolongés.
De la volonté de (non)puissance projetée dans le titre La Guerre de Troie n’aura pas lieu, on passe au constat d’impuissance dans La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu. À la machine infernale des dieux de la tragédie grecque se substitue la machination des stratèges, militaires aussi bien que médiatiques, d’une superpuissance qui se refuse à passer à l’acte. Celle-ci préfère prendre en otage les peuples comme spectateurs, dans le suspense du numen américain et de son manège militaire à la fine pointe de la technologie. Si l’amour d’Hélène et de Pâris, et surtout le passage à l’acte sexuel, était un simulacre qui fit naître une guerre, l’invasion du territoire du Koweit par Saddam fit naître le simulacre de la guerre vierge, c’est-à-dire « non-consommée ». L’envoyée des dieux qui vient, sur la scène de Giraudoux, livrer aux hommes un arbitrage on ne peut plus contradictoire semble s’être transformée, sur les écrans d’aujourd’hui, en dea ex machina (« déesse issue de la machine ») exempte de message, si ce n’est le spectacle de sa propre opérationnalité.
La guerre de Troie n’aura pas lieu
Diplomate féru de culture allemande, Giraudoux a bien senti l’imminence de la Seconde Guerre mondiale, ayant participé à la Première, deux décennies plus tôt. En écrivant le prélude de l’Iliade, le mythe fondateur de la guerre en Occident, il fait voir combien l’heure est critique, le tragique étant « cette forme accélérée du temps », dixit Cassandre. « Il est une espèce de consentement à la guerre que donnent seulement l’atmosphère, l’acoustique et l’humeur du monde. Il serait dément d’entreprendre une guerre sans l’avoir »[13], professe Ulysse dans ses pourparlers avec Hector. Est-ce là une vision d’esthète ?
« La Guerre de Troie n’aura pas lieu » : c’est ce que répètent comme un mantra les élites troyennes qui voient une part du peuple et de ses poètes s’attacher à l’inquiétante beauté d’Hélène. Or, à Andromaque, la prophétesse Cassandre demande dès la première scène : « Tu as vu le destin s’intéresser à des phrases négatives ? »[14]. La volonté politique de ne pas faire la guerre, partagée par le chef de Troie Hector et, en partie, par le chef de la Grèce Ulysse—cette volonté qui fait le titre de la pièce—, est dépassée par la charge symbolique d’Hélène. Mais quelle est-elle ? Ulysse voit en elle une créature qu’on a placée parmi les hommes pour en aliéner la conduite, ou comme un alibi à travers lequel se mesureront deux peuples qui semblent être « mûrs » pour s’affronter, mais toujours selon une volonté, voire une loi qui leur échappe. Comme s’il s’agissait de moissons à venir pour les Dieux. Selon les dires de l’orateur Isocrate :
Les uns avaient la possibilité, en rendant Hélène, de se débarrasser de leurs maux ; les autres, en se désintéressant de son sort, de vivre le restant de leurs jours dans la sécurité. Ni les uns ni les autres n’acceptèrent ces solutions ; les premiers voyaient sans émotion leurs villes détruites, leur territoire bouleversé, pourvu qu’ils ne fussent pas contraints d’abandonner Hélène aux Grecs ; les Grecs aimaient mieux vieillir en restant sur la terre étrangère et ne jamais revoir leur famille que de rentrer dans leur patrie en abandonnant Hélène[15].
À la fois au-delà et en-deçà de l’humain, Hélène est facteur de désordre dans la Cité, soit qu’elle appelle une hyper-morale répondant à son exception, soit qu’elle appelle au contraire une animalité foncière que tous porteraient en eux. L’hybris chez les Grecs désignait l’excès ou la démesure et en vint à être associé à la bâtardise, à l’hybridité des sangs mêlés. Sur ce point, Nicole Loraux fait voir le rôle des filiations mêlées d’Hélène dans la naissance violente de l’Histoire. Liée à Aphrodite, elle est l’amour fait corps, celui qui invite à la possession. Mais ce désir de conquête n’est jamais aussi important que lorsqu’il est interdit, ou entravé par la honte ou la pudeur, par exemple. C’est donc l’aspect douloureux du plaisir érotique qui fait se distancier Hélène, personnage pour qui le désir est toujours celui qu’elle suscite, non celui qu’elle éprouve. C’est aussi qu’elle est née du viol de Némésis, la justice divine en personne, par un Zeus transformé en cygne. Nul autre ne s’y serait risqué, mais celui-là va soumettre la puissance de sa vengeance pour la retourner contre les hommes, voire contre Némésis elle-même et le principe d’équité qu’elle figure (humiliée, la justice des dieux naît-elle de l’outrage?)
Ainsi, de l’Éros on passe à l’Éris, la discorde. « Moi, face de chienne », « moi, chienne lugubre » : c’est en ces termes que L’Iliade fait parler une Hélène clivée, parce qu’ayant intériorisé les insultes professées de toutes parts par rapport à sa lubricité. Ce qui nous mène aux origines, si chères aux Grecs, ou autrement dit à la sexualité :
En tant qu’Hélène est chose sexuelle, en elle s’affirme la paradoxale solidarité de deux modes de la procréation dont la Théogonie hésiodique se plaira à marquer l’antagonisme—l’un sous l’autorité d’Érôs et par conjonction des sexes, l’autre sous la loi de la division (Éris n’est pas loin) et par scissiparité. Car, il est temps de le rappeler, c’est d’un oeuf qu’Hélène est sortie[16].
Si l’on considère que le « destin » est, dans l’esprit grec, une question de partition, en ce qu’il concerne la juste part attribuée à chacun, il pose la question de la sexualité, de la reproduction, de la division et de la mort. Aussi, c’est en aimant plus d’un homme que l’Hélène antique devient double, à la fois déesse inatteignable et chienne érynie. Chez Giraudoux, sa sexualité est beaucoup plus assumée du fait qu’elle n’intériorise rien, qu’un vide lui fait mieux refléter le destin dont elle est le miroir. C’est alors à la guerre qu’on donnera deux visages :
Tandis qu’Hécube, plus loin, qu’on presse de dire à quoi ressemble la guerre, répond : « À un cul de singe. Quand la guenon est montée à l’arbre et nous montre un fondement rouge, tout squameux et glacé, ceint d’une perruque immonde, c’est exactement la guerre que l’on voit, c’est son visage.
DEMOKOS : avec celui d’Hélène, cela lui en fait deux »[17].
Grotesque, le rapprochement se fait encore sur le compte d’Hélène. C’est que le camp des pacifistes, formé principalement de femmes et avec à sa tête Hector, refuse de l’idéaliser et de faire la guerre au nom de l’amour. Pire encore, c’est qu’il ne voit pas de véritable amour entre elle et Pâris (d’où peut-être la confusion entre le derrière simiesque et le visage de la femme…qui imite ?). Jadis cause honorée par les deux peuples en présence, il appert qu’au début du 20e siècle, l’eidolon ou l’illusion hellénique est remise en cause par les pragmatiques, à savoir que la beauté, ici d’Hélène, signifie l’amour : « Nous autres poètes appelons cela le réalisme »[18].
Hector, rentrant lui-même d’une campagne et devant adresser un discours au nom de ceux tombés au combat, n’entend pas non plus glorifier les morts plus que les vivants, surtout que sa femme Andromaque attend un enfant. Il considère même tuer Hélène si elle refuse de repartir avec les Grecs qui s’amènent, et lirait bien dans les entrailles des prêtres, qui viennent eux-mêmes de lire dans celles des bêtes un oracle interdisant son renvoi.
Le camp belliciste de Troie est surtout formé des plus vieux, des poètes nationaux, de Pâris et de son équipage, avec à sa tête le roi Priam. Pour eux, Hélène est une muse et sa présence dans les murs de la cité leur apparait comme une protection d’Aphrodite : « Hélène n’est pas à toi seul, Pâris. Elle est à la ville. Elle est au pays »[19].
Quant à Hélène, elle est d’une neutralité et d’un détachement olympiens. À Hector qui la questionne sur ses sentiments envers son frère, elle répond qu’elle n’aime pas connaître les sentiments des autres—« c’est comme au jeu quand on voit dans le jeu de l’adversaire. On est sûr de perdre[20]»—pas plus que les siens propres. Hors de soi et de la relation à l’autre, elle est le médium d’une volonté supérieure, sûre d’elle-même. Les hommes qui l’ont possédée sont comparés à de grands savons que l’on frotte contre soi pour se laver, « on en est toute pure »[21]. En somme, Hélène n’est otage d’aucun peuple, si ce n’est des dieux. Son rapt, même annulé prochainement, reste irréversible et invite la némésis—némeïnn signifiant « répartir, distribuer ce qui est dû »—soit une injonction de mesure en contrepartie d’une démesure (hybris) :
HECTOR : Choisissez-vous le départ, oui ou non ?
HÉLÈNE : Ne me brusquez pas… Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis ceux qui ne sont pas pour moi des ombres. Je choisis ceux que je vois. (…)
HECTOR : Vous doutez-vous que votre album de chromos est la dérision du monde ? Alors que tous ici nous nous battons, nous nous sacrifions pour fabriquer une heure qui soit à nous, vous êtes là à feuilleter vos gravures prêtes de toute éternité !...Qu’avez-vous ? À laquelle vous arrêtez-vous avec ces yeux aveugles ? À celle sans doute où vous êtes sur ce même rempart, contemplant la bataille ? »[22].
Plus qu’à Hélène, c’est à la justice divine qu’Hector s’en prend, à qui il plaide aussi sa cause. La tragédie grecque est une forme d’art contemporaine de l’avènement du tribunal chez les Héllènes et pose le problème de la responsabilité humaine face à la fatalité. Aux yeux d’Hector, tous apparaissent irresponsables, même les dieux.
Le deuxième acte s’inscrit davantage dans le contexte du début du 20e siècle, entre autres en parodiant les débuts du droit international avec un juriste des peuples très versatile, capable de produire les arguments aussi bien en faveur de l’honneur blessé de la nation—auquel cas il faut riposter—, qu’en faveur de son honneur sauf. Sommé par le poète belliciste du pays d’interpréter l’avance des Grecs en eaux troyennes, il identifie certaines atteintes au code dont l’insignifiance est comique. Hector menace de l’enfermer pour toute la durée du conflit, arguant qu’on emprisonne bien le droit quand viennent les mesures de guerre. Ainsi parle le guerrier qui sait dans sa chair ce qu’il en coûte d’attiser les tensions pendant que le poète et le géomètre exaltent l’absolu personnifié en Hélène, l’un préparant les symboles du chant national, l’autre décrivant le paysage changé depuis l’arrivée de la dame. Giraudoux n’y va pas de main morte dans sa représentation du chantre courtois, prêt à mourir pour sa patrie en chantant la beauté sublime d’une étrangère. De plus, les femmes de la pièce objectent, au poète, qu’aucune d’entre elles ne souhaite être idéalisée au point de provoquer une guerre, pas même Hélène. Ce trait diffère assurément de l’Iliade, où l’Hélène d’Homère est le versant féminin d’un Achille soucieux de sa renommée, dans une société grecque où la gloire et la postérité seules sont capables de défaire la mort.
Les paradoxes se multiplient dans une logique scabreuse qui trouve probablement un terreau fertile dans l’avant-guerre. Par exemple, un juriste déclare que « l’anéantissement d’une nation ne modifie en rien l’avantage de sa position morale internationale », et que « c’est un manquement qui n’a pas été fait dans les formes ». Ce juriste sera contraint par Hector de composer un plaidoyer qui les sauve de la guerre, car « si le droit n’est pas l’armurier des innocents, à quoi sert-il ? »[23]. C’est tout l’enjeu de la légitimité qui devrait avoir préséance sur la légalité qu’il soulève là.
Avec l’arrivée d’Ulysse, l’envoyé des Grecs, tout se décide. Il est d’abord question de l’outrage qu’aurait subi ou non la reine, femme de Ménélas, et des représailles qui s’ensuivraient. Hélène dément tout rapport sexuel et la paix—personnifiée sur scène par une pâle mendiante qui en vient à se farder lourdement pour qu’on la remarque—semble sauvée. Jusqu’à ce qu’Ulysse lâche devant la foule : « Avouez, Hélène, que vous ne l’auriez pas suivi, si vous aviez su que les Troyens sont impuissants… ». La réplique ne se fait pas attendre : tel un seul homme, l’équipage de Pâris se met, en de multiples métaphores, à « faire l’amour au langage » pour évoquer les étreintes du couple, affirmant tous en choeur qu’ils y étaient, qu’ils ont tout vu. C’est l’honneur du Troyen qui est à défendre, et sur le champ, qu’importe ce qui s’est passé ou ce qui se passera après.
Sur ces entrefaites apparaît la messagère des dieux, avec cette mention : « En 1935, elle devait descendre des cintres, comme une dea ex machina, à l’aide d’un système de poulies appelé « gloire » ». Celle-ci livre aux mortels pas moins de trois messages, polythéisme oblige. D’abord celui d’Aphrodite, selon qui l’amour est la loi du monde. Puis celui de Pallas, qui veut que la raison soit la loi du monde. Enfin, on demande l’arbitrage de Zeus. Celui-ci fait dire que « tantôt il est bien de faire l’amour, et tantôt de ne pas le faire »[24]. Il commande donc de laisser le soin aux négociateurs, à Hector et à Ulysse, de trancher cette question.
Ainsi vient l’épisode de la pesée. La valeur et l’expérience des héros respectifs de Grèce et de Troie, soit Ulysse et Hector, sont mises dans la balance. Cet épisode est significatif en ce qu’il fait voir la congruité des forces en présence, le duel mettant face à face des adversaires à forces égales, ou presque. La balance penche en faveur d’Ulysse, désignant par-là la mort prochaine d’Hector que l’on sait, qu’Hélène sait. Leur entretien diplomatique, en aparté, fait allusion aux rencontres de Locarno (1925), de Stresa (1935), de Genève, siège de la Société des nations. La volonté d’Hector sera avertie par la sagesse d’Ulysse qui en sait davantage sur la fatalité de la guerre, mais le Troyen insiste : « L’univers peut se tromper. C’est à cela qu’on reconnaît l’erreur, elle est universelle ». Sur quoi, Ulysse parlera du « déchaînement de cette brutalité et de cette folie humaines qui seules rassurent les dieux. C’est de la petite politique, j’en conviens. Mais nous sommes chefs d’État, nous pouvons bien entre nous deux le dire : c’est couramment celle du Destin »[25]. Ulysse ajoute alors que « ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent (…) Ceux qui se battent, ce sont ceux que le sort a lustrés et préparés pour une même guerre : ce sont les adversaires ». Voyant que les dés des dieux sont jetés, Hector s’enquiert des autres Grecs, lesquels échappent peut-être à la déraison ambiante. Non, eux ne pensent qu’au fait que « Troie est riche » et « qu’ils sont à l’étroit sur du roc », énoncé qui rappelle la théorie allemande du Lebensraum inspirée du darwinisme social, et selon laquelle un peuple doit s’assurer un espace vital à la mesure de sa vitalité croissante, une théorie dévoyée plus tard par l’Allemagne nazie pour cautionner ses visées expansionnistes.
Comment une Troie humaniste attire à elle une telle injustice ? « Ce n’est pas par des crimes qu’un peuple se met en situation fausse avec son destin, mais par des fautes », répond Ulysse. Et les fautes dérisoires qu’il donne en exemple ironisent sur le cynisme des dieux. N’empêche qu’à ses yeux le cas d’Hélène est une exception : « C’est là la difficulté de la vie, de distinguer, entre les êtres et les objets, celui qui est l’otage du destin »[26]. Le Grec promet à son vis-à-vis d’employer sa ruse à conjurer le sort. Or, il est long, le chemin qui le sépare de son navire sur lequel emporter avec lui Hélène. L’espace à franchir est d’autant plus vaste qu’il est ouvert à tout attentat. De fait, une altercation éclate. Victime de l’affront, Hector fait taire son honneur, mais le poète Demokos s’apprête à lancer un chant de guerre. C’est alors son chef qui le tue de ses propres mains : « La guerre n’aura pas lieu, Andromaque ! [27] ».
Le rideau est sur le point de tomber, mais voilà qu’il se relève à la question d’un Troyen : « qui a tué Demokos?[28] ». Le temps que le poète mourant absolve son chef en accusant faussement un Grec... et la guerre de Troie aura lieu.
La guerre du Golfe n’a pas eu lieu
Même échangée, la figure de l’échange impossible qu’est Hélène est considérée comme en voie de disparition par Baudrillard en 1991. Aujourd’hui, notre incapacité à passer à l’acte, à faire l’événement nous maintiendrait dans une simulation entretenue en continu par les médias : « À la catastrophe du réel nous préférons l’exil du virtuel, dont la télévision est le miroir universel »[29]. Est-ce que ce sont les guerres totales et idéologiques du 20e siècle qui nous ont ainsi sortis de l’Histoire ? La question est de savoir si la paix se résume aujourd’hui en absence de guerre.
Si le destin se mirait dans l’oeil d’Hélène (et si Ronsard s’engageait ainsi pour elle : « Ton oeil vaut un combat de dix ans d’Ilion »), c’est aujourd’hui l’écran médiatique qui produit les images du désir et comporte les signes de notre avenir, voire de notre jugement dernier. Le nom d’Hélène, en tant que signe, parlait plus fort que son corps, car celui-ci étant pris, elle, elle continuait de prendre, le nom grec helein signifie bien « prendre ». Dans le même sens, la virtualité en vient à destituer le réel en ce que les signes priment désormais sur les phénomènes qu’ils désignent, de par leur nature spéculaire et spéculative :
La guerre et avec elle les faux guerriers, les guerriers présomptifs, généraux, experts, présentateurs de télé, que nous voyons spéculer sur elle à longueur de journée, la guerre se regarde dans un miroir : suis-je assez belle, suis-je assez opérationnelle, suis-je assez spectaculaire, suis-je assez sophistiquée pour entrer historiquement en scène ? [30]
La guerre du Golfe fut un nouveau modèle dans le genre, exploitant à fond sa dimension médiatique—la couverture des médias étant justement pour Baudrillard une couverture. Elle aboutit sur un conflit décorporalisé, où les guerriers relégués aux confins du désert ont laissé place aux otages, principaux figurants du nouveau spectacle qu’on donna de la guerre. Celle-ci sera désormais expérimentale, et se fera « in vitro », depuis le salon de tout un chacun :
La participation à l’action est un autre aspect déterminant de la propagande. L’entrée en guerre impliquait que le citoyen-téléspectateur soit associé à l’action. Il fallait pour remplir cette dimension créer l’unité entre le front et l’arrière, entre militaires sur le terrain et civils dans leurs foyers. Cette solidarité de situation dans la guerre allait être rendue possible grâce à la supériorité des moyens d’en rendre compte, et sous une stratégie de communication parfaitement maîtrisée. Le but, produire l’illusion aux yeux des civils, de maintenir le lien entre action militaire et maîtrise collective de l’action sur le terrain. Le mythe d’une « histoire en direct » allait ainsi prendre le pas sur la notion d’une information objective. Le téléspectateur fut alors invité à entrer de plain-pied dans la distribution de cette fiction, à tenir sa place dans « l’événement-image »[31].
Tandis que le poète de Troie Demokos voulait donner le visage d’Hélène à la guerre, en en faisant une beauté sublime, quasi d’outre-monde, les diffuseurs d’aujourd’hui misent plutôt sur le phénomène d’identification que sauront susciter les otages, augmentant par-là l’adhésion affective de l’auditoire :
La guerre fait appel à la persuasion des masses. Il y a un climat socio-affectif que crée la situation de guerre et que prend en charge la propagande. La conscience est prise facilement en otage par l’émotion. La propagande a souvent recours à la mise en jeu de l’émotion car elle annihile la capacité critique, met la conscience en retard sur l’événement. La montée en puissance de l’émotion fait prévaloir la justification de l’action sur la conscience de ses conséquences. La conscience, elle, fait intervenir la mémoire pour prévenir le risque de la reproduction d’une situation déjà évaluée comme mauvaise ou dangereuse. C’est cette capacité qui est particulièrement visée par la technique de la propagande. La propagande définit la norme informationnelle de la guerre pour tout simplement empêcher de penser autrement[32].
L’on voit ici apparaître un spectateur qui n’en démord pas, croyant se voir lui-même à l’écran, sous les traits de l’otage du jour et dont l’anonymat se prête à toutes les projections : « ce pourrait être vous, ce pourrait être moi ». Aussi, Baudrillard va jusqu’à présenter les otages comme des arguments de vente publicitaire :
L’otage est l’acteur fantôme, le figurant qui occupe l’espace impuissant de la guerre. Aujourd’hui, c’est l’otage sur site stratégique, demain l’otage comme cadeau de Noël, l’otage comme valeur d’échange et comme liquidité. Dégradation fantastique de ce qui était la figure même de l’échange impossible[33].
C’est dire que l’Autre irréductible, dans une ère mondialisée, est peut-être inconcevable. Tant érotique qu’antagonique, l’altérité semble avoir disparu dans un système total d’équivalences, où tout trouve son prix. Le président irakien Saddam Hussein étant vu par Baudrillard comme un mercenaire qui joue en bonne partie le jeu américain, la guerre est devenue selon ce dernier une « machine célibataire », sans plus de « partenaire » auquel se mesurer, et qui cherche peut-être à réfléchir ses pulsions désormais suicidaires, plutôt que meurtrières. La situation est aux antipodes de la guerre de Troie, ainsi que de l’épisode de la pesée des rivaux, lesquels entrevoient même une fraternité par-delà, ou en raison même, du futur conflit armé.
Si Hélène était une « otage » problématique, c’est qu’elle était une fin en soi plutôt qu’un moyen d’obtenir un quelconque gain pour ses hôtes. En vérité, l’unique échange à venir dont elle était garante était le duel programmé entre deux peuples égaux dans leur rivalité. Si elle représente une quelconque rétribution, c’est celle que les dieux exigent des mortels. À ce sublime antique, qui va de pair avec une horreur certaine, Giraudoux insuffle de la comédie, n’étant pas dupe d’une vision du monde où la beauté, pure et dure, est du parti guerrier tandis que la paix doit racoler pour qu’on la remarque :
La Paix reparaît, outrageusement fardée.
LA PAIX : Et comme cela ?
HÉLÈNE : Je te vois de moins en moins.
LA PAIX : Et comme cela ?
CASSANDRE : Hélène ne te voit pas davantage.
LA PAIX : Tu me vois, toi, puisque tu me parles !
CASSANDRE : C’est ma spécialité de parler à l’invisible.
LA PAIX : Que se passe-t-il donc ? Pourquoi les hommes dans la ville et sur la plage poussent-ils ces cris ?
CASSANDRE : Il paraît que leurs dieux entrent dans le jeu et aussi leur honneur.
LA PAIX : Leurs dieux ! Leur honneur !
CASSANDRE : Oui… Tu es malade ![34]
À l’opposé de l’absolu tragique, Baudrillard présente un Saddam Hussein abject de tout avoir vulgarisé : « le défi religieux en fausse guerre sainte, l’otage sacrificiel en otage commercial, la dénégation violente de l’Occident en magouille nationaliste, la guerre en comédie impossible. Mais nous l’y avons bien aidé »[35]. Ayant perdu de sa crédibilité, c’est maintenant à la guerre de racoler, et avec elle la volonté de puissance et la volonté de savoir en viennent à se résoudre dans la volonté persistante du spectacle. Inversement proportionnelle à l’événement, la médiatisation du conflit permet de mettre en scène l’écoulement d’un stock militaire en surplus, faute d’être utilisé, même partiellement. On a alors droit au théâtre de la fonctionnalité du deus ex machina. Ce dernier n’est plus porteur du message contradictoire des dieux, mais de celui d’une superpuissance qui entend faire valoir les droits des peuples et des personnes par une démonstration de sa force, qu’elle maintient néanmoins en suspens—le numen étant ce signe du puissant qui, tout en ayant le pouvoir d’anéantir son adversaire, l’épargne par magnanimité. Ainsi, le commandement américain expie l’iniquité foncière du combat.
Aussi, pour éviter la guerre, surtout dans le cas d’un combat très inégal, donne-t-on préséance aux signes de la bataille plutôt qu’à la bataille elle-même. Dans ce contexte, l’otage devient aussi le symbole d’un territoire, de par son corps, et celui d’une société, de par son appartenance à certaines valeurs. Mais pourquoi Baudrillard s’en prend-il aussi violemment à ce subterfuge ? Est-il belliciste ? C’est plutôt qu’il voit dans ce détournement une menace plus importante que la guerre :
La victoire du modèle est plus importante que celle sur le terrain. Le succès militaire consacre le triomphe des armes, mais le succès de la programmation consacre la défaite du temps. Le war-processing, la transparence du modèle dans le déroulement de la guerre, la stratégie d’exécution implacable d’un programme, l’électrocution de toute réaction, de toute initiative vivante, y compris les siennes propres, sont plus importants, du point de vue de la dissuasion générale (celle des amis comme celle des ennemis) que le résultat final sur le terrain. Guerre propre, guerre blanche, guerre programmatique—plus meurtrière que celle qui sacrifie des vies humaines »[36].
L’auteur fait-il référence au résultat nul par lequel se soldera le conflit (Saddam restera au pouvoir), et qui entraîne son prolongement indéfini sous d’autres formes ?
Hors d’une logique pacifique ou antagonique, la nouvelle guerre en est une de dissuasion qui permettrait de continuer la business as usual et qui prend des airs de liquidation de marché. Peut-être même que les pertes humaines aujourd’hui sont davantage imputables au marché qu’à la guerre, devenue le déchet techno de notre civilisation sur-productive. À l’aube du 21e siècle, le principe d’équité des forces, sur l’échiquier mondial, est si bien dépassé que la relation duelle est devenue caduque pour l’Occident. Il reste la stratégie de la prise d’otages pour les dissidents de l’empire. Ceux qui se refusent à marchander et à jouer le jeu des Américains seront quant à eux enclins, nous l’avons vu, à user de l’otage comme d’un symbole à dégrader, comme d’un instrument à terroriser.
L’otage est-il désormais vecteur de la terreur ? On croit voir revenir l’Hélène homérique, celle qui incarne le versant féminin d’Achille et dont la mênis (colère divine) rappelle la tradition généalogique qui fait descendre Hélène de Némésis (juste colère) ; à ceci près qu’à présent, la terreur n’est plus l’apanage des dieux et des puissants.
« Double et une, Hélène n’est jamais plus réelle qu’enlevée par Pâris. Si la guerre de Troie eut lieu pour une ombre, n’est-il rien de plus vrai que la guerre de Troie, rien de plus fantomatique qu’une Hélène restée chaste ? »[37]. Dans la version tragique d’Euripide, Hélène clivée se dédouble. Grecs et Troyens se sont battus « parce qu’ils croyaient que Pâris possédait Hélène, qu’il n’avait pas ». Fantôme « toujours déjà en allée », le simulacre aurait provoqué une des plus grandes batailles d’Occident. À Hélène qui affirme qu’il s’est battu pour l’ombre d’elle-même, Ménélas s’écrie : « L’immensité de mes épreuves là-bas seule me convainc, et non toi ». Laissé à lui-même, à l’erreur de ses sens et de son désir, Ménélas, tel Ronsard « embrassant pour le vray l’idole du mensonge » repartirait, abandonnant Hélène à son destin »[38]. Si la raison veut que l’illusion pâlisse devant le modèle, ceci afin de sauver la royauté du vrai, n’est-il pas plus vrai qu’au regard de la sexualité, la distinction du vrai et du faux n’a sans doute pas d’importance ? Par rapport au désir, au fantasme ? Dans ce domaine, soutient Nicole Loraux, « les fantômes sont vrais et le vrai fantomatique ».
Avec Baudrillard, c’est ce même désir du faux qui tue tout événement… celui de la guerre devenu simulation dans le Nouvel Ordre Mondial, la montée aux extrêmes ayant fait place au non-lieu de la programmation, où tout est décidé d’avance, et rien n’est mis en jeu :
La guerre électronique n’a plus exactement d’objectif politique, elle sert d’électrochoc préventif à tout conflit futur. De même que dans la communication moderne, il n’y a plus d’interlocuteur, de même dans cette guerre électrocutrice, il n’y a plus d’ennemi, il n’y a plus qu’un élément réfractaire qu’il faut neutraliser et consensualiser (…) le seul but (transpolitique), c’est d’aligner tout le monde sur le plus petit commun dénominateur mondial, le dénominateur démocratique (qui correspond de plus en plus, avec son extension, au degré zéro du politique). Le plus petit commun multiplicateur étant l’information sous toutes ses formes, qui correspond elle aussi de plus en plus, avec son extension à l’infini, au degré zéro de son contenu[39].
Alors que les Antiques, avec Aristote, croyaient que la virtualité prépare un passage à l’acte réel, l’essai de la Guerre du Golfe n’a pas eu lieu avertit que celle-ci ne reproduit la plupart du temps qu’elle-même, à l’infini. Sans l’événement qui crée une rupture dans le cours des choses, il n’y a ni début ni fin possibles—l’auteur parle d’ailleurs de l’extinction prochaine des « événements historiques », lesquels, implosés en temps réel, laisseront place à des « lieux d’effondrement ».
Si virtuellement, tout un chacun peut devenir un otage, il en va de même pour le potentiel terroriste; c’est le contrecoup de la disparition de l’Autre irréductible ou du flou dans lequel l’Occident maintient cet autre méconnu—ami ou ennemi, à la fois intérieur et extérieur—, c’est ce simulacre qui suscite une vigilance, voire une surveillance des citoyens, souvent avec l’assentiment de ces derniers :
C’est à la guérilla, mère du terrorisme, que l’on doit l’origine des prises d’otages idéologiques.
Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, la révolte des peuples opprimés bénéficia du soutien des médias et, pour une bonne part, de l’opinion publique prête à justifier toutes les actions menées dans le cadre de la décolonisation. Où que ce fût dans le monde, pourvu que la terreur restât cantonnée sur les territoires des anciens empires. Mais aussitôt que la violence eut franchi les mers pour perpétrer ses crimes à notre porte, il en fut tout autrement de notre perception des guerres d’idées. Nous en étions désormais le point de mire et nous nous défendions de toute justification à leur égard.
Mais le ver était dans le fruit. Avec sa litanie de sabotages, d’attentats à la bombe ou aux armes de poing, de détournements d’avions, de prises et de détentions d’otages, ce nouveau mal du siècle allait accompagner notre vie quotidienne[40].
« Le ver dans le fruit » aurait atteint « notre quotidien à tous », cette rhétorique traduit bien l’esprit inquiet d’une civilisation qui, en devenant otage de ses propres peurs, cherche à domestiquer tous les éléments d’une société à risque. Nos dispositifs technologiques seraient désormais rivés aux jeux d’ombres de l’anticipation, courant en temps réel après une menace diffuse et potentiellement constante. C’est le propos de Giorgio Agamben, qui publie dans le journal Le Monde un article intitulé « De l’État de droit à l’État de sécurité » à la suite du prolongement de l’état d’urgence en France, fin 2015 :
De même, la sécurité dont il est question aujourd’hui ne vise pas à prévenir les actes de terrorisme (ce qui est d’ailleurs extrêmement difficile, sinon impossible, puisque les mesures de sécurité ne sont efficaces qu’après coup, et que le terrorisme est, par définition, une série des premiers coups), mais à établir une nouvelle relation avec les hommes, qui est celle d’un contrôle généralisé et sans limites (…) [Cet état] fait le contraire de ce qu’il promet, puisque—si sécurité veut dire absence de souci (sine cura)—il entretient, en revanche, la peur[41].
La question est désormais de savoir si nous voulons être les acteurs d’un autre simulacre, celui d’une paix toujours en sursis, ou les acteurs qui oeuvreront à un état de paix durable.
Appendices
Notes
-
[1]
Mireia Aragay et Enric Monforte, Ethical Speculations in Contemporary British Theatre, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.
-
[2]
Vladimir Jankélévitch, L’Ironie, Paris, Flammarion, 1964, p. 27.
-
[3]
Alain Rey (sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2006.
-
[4]
Irène Herrmann et Daniel Palmieri, « Une figure obsédante : l’otage à travers les siècles », Revue internationale de la Croix Rouge, vol. 87, 2005.
-
[5]
Ibid., p. 80.
-
[6]
Ibid., p. 84.
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Ibid., p. 85.
-
[9]
Ibid., p. 87.
-
[10]
Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Paris, Grasset, 1935.
-
[11]
Nicole Loraux, « Le fantôme de la sexualité », Les expériences de Tirésias (le féminin et l’homme grec), Paris, Gallimard, 1989, p. 232-252.
-
[12]
Jean Baudrillard, La guerre du Golfe n’a pas eu lieu, Paris, Galilée, 1991.
-
[13]
Giraudoux, p. 157.
-
[14]
Ibid., p. 56.
-
[15]
Loraux, p. 237.
-
[16]
Ibid., p. 241.
-
[17]
Giraudoux, p. 125-126.
-
[18]
Ibid, p. 76.
-
[19]
Ibid., p. 85.
-
[20]
Ibid., p. 90.
-
[21]
Ibid., p. 91.
-
[22]
Ibid., p. 95.
-
[23]
Ibid., p. 121.
-
[24]
Ibid., p. 151.
-
[25]
Ibid., p. 155-156.
-
[26]
Ibid., p. 158.
-
[27]
Ibid., p. 162.
-
[28]
Ibid., p. 163.
-
[29]
Baudrillard, p. 16.
-
[30]
Ibid., p. 23.
-
[31]
Guylain Chevrier, « Guerre du Golfe et télévision : un mariage stratégique », Cahiers d’histoire, vol. 86, 2002, p. 63-84.
-
[32]
Ibid., p. 63-84.
-
[33]
Baudrillard, p. 11.
-
[34]
Giraudoux, p. 100.
-
[35]
Baudrillard, p. 12.
-
[36]
Baudrillard, p. 58.
-
[37]
Loraux, p. 252.
-
[38]
Ibid., p. 251.
-
[39]
Baudrillard, p. 97.
-
[40]
Gérard A. Jaeger, Prises d’otages : de l’enlèvement des Sabines à Ingrid Betancourt, Paris, Archipel, 2009, p. 48.
-
[41]
Giorgio Agamben, « De l’État de droit à l’État de sécurité », Journal Le Monde, 23 décembre 2015.