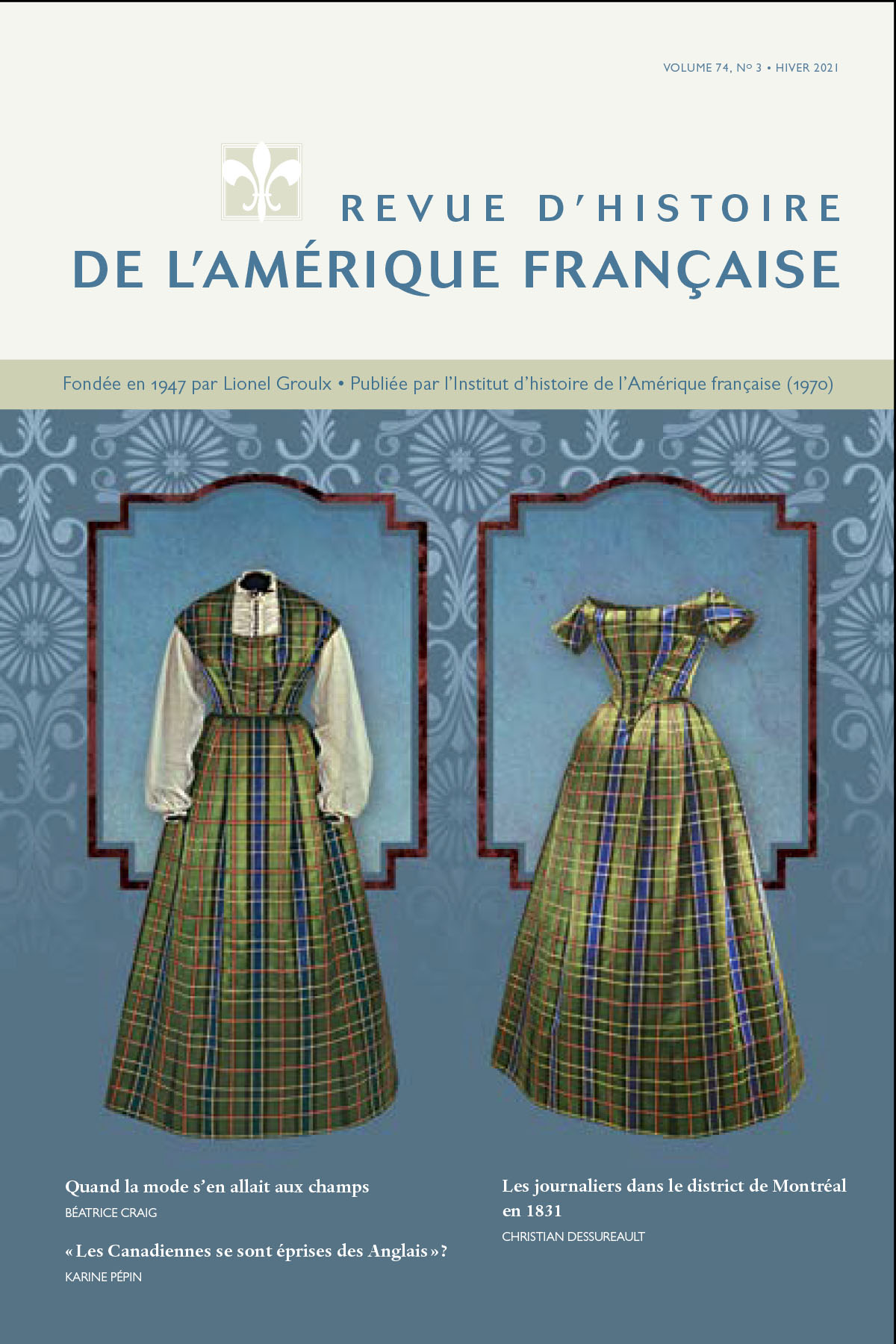Article body
Mai 68, Paris : Anne Hébert habite boulevard Saint-Germain. Les événements historiques ont lieu sous sa fenêtre, pour son plus grand malheur. Les cris des étudiants et des ouvriers, les voitures renversées, les commerces fermés, les gravats partout, les gaz lacrymogènes, tout cela l’effraie : « Anne Hébert, cinquante-deux ans, est terrorisée » (p. 350), écrit Marie-Andrée Lamontagne dans la première biographie digne de ce nom consacrée à l’auteure de Kamouraska. La scène qu’elle peint en dit long sur le rapport d’Anne Hébert au spectacle de la rue et au monde en général. À l’ère de l’engagement sartrien, la « petite Anne », comme on l’a longtemps appelée, n’aime pas les émois de la grande ville ni le désordre social. La violence, chez elle, ne s’autorise que des soubresauts intérieurs.
Toute son existence (1916-2000), Anne Hébert se sera ainsi tenue comme en marge de l’Histoire pour mieux s’abandonner à sa seule véritable passion, celle d’écrire. Vivre pour écrire : tel est le titre que Marie-Andrée Lamontagne a choisi pour cette biographie d’une érudition exemplaire. Un tel projet constituait un défi tant le personnage d’Anne Hébert est timide, discret, anti-romanesque. Au passage, la biographie défait quelques mythes tenaces, comme celui selon lequel Anne Hébert aurait choisi de publier ses romans en France parce que les éditeurs canadiens-français avaient refusé ses manuscrits, jugés trop violents. Marie-Andrée Lamontagne montre qu’Anne Hébert elle-même a entretenu ce mythe, comme si elle y trouvait une justification de son exil, ou poursuivait une tradition d’écrivains « empêchés », tel son père, le critique Maurice Hébert, dont on découvre ici les ambitions littéraires déçues, et surtout son cousin de Saint-Denys Garneau, qui fut son grand modèle et qu’elle défendra constamment.
L’événement le plus emblématique de cette biographie, celui qui déterminera toute la trajectoire d’Anne Hébert, est le « retour dans la chambre » (p. 93-103) auquel la contraint une tuberculose diagnostiquée (par erreur !) en 1939. Pendant les cinq années suivantes, alors qu’autour d’elle la guerre fait rage, elle ne sort pratiquement pas de la maison familiale, avenue du Parc à Québec. « Elle y restera jusqu’en 1944, et ces années seront l’incubateur de presque toute l’oeuvre de fiction à venir » (p. 96). De l’enfant « dépossédé du monde » dans Le torrent (1950) jusqu’à la Gaspésie terrifiante des Fous de Bassan (1982), l’imaginaire d’Anne Hébert se déploiera à partir de lieux isolés, autour de personnages reclus, privés de toute vie sociale et faussement dociles. Chacun de ses personnages semble porté par une révolte intérieure, comme s’il luttait silencieusement contre un enfermement qu’il cultive en même temps, prisonnier d’une sauvagerie curieusement désirée, porté par le courage de descendre là où personne n’ose aller, comme au fond du Tombeau des rois.
Cette étrange violence de son oeuvre contraste fortement avec la vie si rangée que mène Anne Hébert à Québec d’abord, puis à Paris ou dans le sud de la France, à Menton en particulier, où elle a ses habitudes, ses anges gardiens. Elle a l’art de se faire aimer partout où elle s’installe. Tous ceux qu’elle côtoie tombent sous son charme, son magnétisme « d’éternelle jeune fille » (p. 194). La première fois qu’elle visite Paris, en 1954, elle est accompagnée de son frère Pierre, qui se révèle une des figures les plus intéressantes de cette biographie, lui qui aura une carrière d’artiste à Québec et qui affirmera souvent tout haut ce que sa soeur dira tout bas. Il est le premier d’une série de chevaliers servants qui accompagneront Anne Hébert durant toute sa vie, notamment les trois « fées » féminines (p. 183) que seront la fascinante critique Jeanne Lapointe, la musicologue Andrée Desautels et la romancière Monique Bosco.
Comme toute biographie réussie, celle de Marie-Andrée Lamontagne ne propose pas seulement le récit d’une vie, mais aussi un portrait de groupe, notamment celui des écrivains catholiques réunis autour de la maison d’édition montréalaise HMH (Hurtubise-Mame-Hatier) ou de la revue française Esprit, publiée par le Seuil. C’est un monde amical, bienveillant, stimulant. Au Seuil, elle est accueillie avec un immense respect, mais aussi comme une écrivaine qui a encore des croûtes à manger. Paul Flamand et Jean Cayrol y sont ses amis, ses interlocuteurs, ses protecteurs quoique sans la moindre complaisance. Par exemple, malgré le succès de Kamouraska (1970), les remarques sur la première version des Enfants du sabbat (1975) sont dévastatrices : c’est un « brouillon d’amateur » (p. 400) ou encore, plus méchamment : « c’est Mlle Ouine [de Bernanos] chez Maria Chapdelaine » (p. 400).
La biographie insiste par ailleurs sur la figure de Roger Mame, le seul homme avec qui Anne Hébert ait développé une relation amoureuse, ou plutôt une « amitié amoureuse » (p. 296) pour reprendre les mots de Marie-Andrée Lamontagne. Du même âge qu’elle, il descend de la prestigieuse maison d’édition catholique Mame. Il vit à Amboise, au prieuré du Clos-Lucé (Léonard de Vinci y a passé les dernières années de son existence), où il reçoit diverses personnalités. Anne Hébert s’y rend souvent, non pour fréquenter la grande société, mais plutôt pour la tranquillité des lieux. Elle se trouve naturellement chez elle dans ce décor ancien, comme en marge du monde moderne, idéal pour écrire à l’abri des distractions.
Tout chez elle s’organise autour de l’écriture, d’où la vie routinière qu’elle mène, entourée de ses éternels chats. « En gros, ses journées suivaient l’ordre suivant : je me lève, je m’habille, je mange, j’écris, je me repose, je lis un livre, je corrige ce que j’ai écrit, je fais les courses, je vois des amis, je mange, je dors, je recommence. » (p. 521) La célébrité n’y changera rien : elle continuera de vivre pour écrire, fidèle au beau portrait que Marie-Andrée Lamontagne a réussi à dénicher dans les archives du Seuil, qui résume bien toute l’énigme d’une vie : « Très ouverte aux êtres, mais ne va pas vers eux. Très discrète. C’est une introvertie, une solitaire dont les capacités dynamiques trouvent difficilement application en dehors du spirituel. Cabrée, mais contre quoi ? » (p. 333)