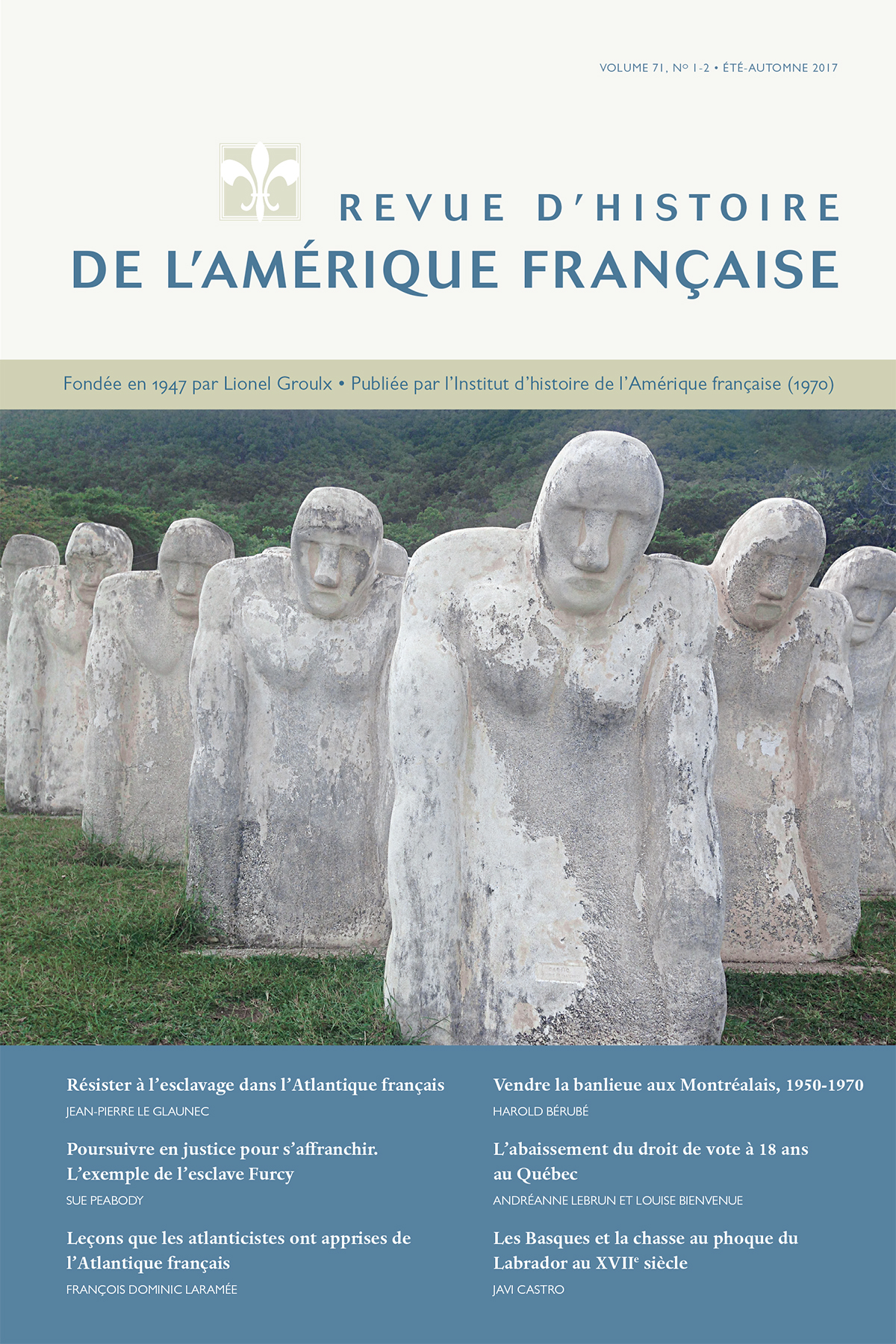Article body
Fais ce que dois clôture en quelque sorte le triptyque qu’Yvan Lamonde consacre à la pensée politique de Louis-Joseph Papineau, après Signé Papineau. La correspondance d’un exilé (PUM, 2009) et Papineau. Erreur sur la personne (Boréal, 2012) avec Jonathan Livernois. Ces trois opus suivaient de près la publication de la correspondance post-rébellionnaire de Papineau par Georges Aubin, envers qui Lamonde ne cache pas sa dette.
En 2009, la parution de Signé Papineau fut saluée comme une bouffée d’air frais : enfin le véritable Papineau ! Celui qu’on découvre par sa correspondance, celle avec son fils Amédée en particulier : républicain, annexionniste, mais aussi traversé par le doute. Mis bout à bout, les trois essais peuvent-ils pour autant faire office d’une véritable biographie intellectuelle de Papineau, celle qu’on attend plus depuis des décennies ? L’auteur lui-même s’en garderait, sans doute parce qu’il s’agit davantage dans chaque cas d’une enquête sur une absence : absence de projet politique clair chez Papineau dans Signé Papineau, absence de référence au gouvernement responsable dans Erreur sur la personne, absence d’une pensée nationaliste substantielle dans Fais ce que dois. Traquer Papineau sur l’idée de nation s’avère particulièrement difficile. L’auteur le concède d’emblée. Et le titre de l’essai lui-même exprime à la fois le caractère laborieux et fort délicat de l’opération, puisqu’il s’agit à terme de faire coïncider la pensée du grand Papineau avec les fondements même du nationalisme québécois actuel. Par conséquent, si Lamonde et Livernois pourfendent avec raison l’association entre Papineau et le principe de gouvernement responsable dans Erreur sur la personne, voilà que l’auteur est nettement plus prudent pour constater la minceur du sentiment national chez le grand homme.
L’idée de nation chez Papineau est abordée en trois tranches chronologiques, à l’aune des principaux écrits laissés au fil du temps par le chef patriote : avant 1830, de 1830 à 1839, puis de 1845 à 1867, quand Papineau livre son « Testament politique » devant les membres de l’Institut canadien.
Au moins jusqu’en 1830, la nationalité pour Papineau se confond avec la communauté politique et repose sur le respect des droits de la majorité : « [r]econnaitre que, dans l’ordre temporel et politique, il n’y a d’autorité légitime que celle qui a le consentement de la majorité au sein de la nation […] » (p. 175) La tutelle britannique est donc d’abord préjudiciable parce qu’un gouvernement canadien redevable devant Londres contrevient aux règles de la représentation et de la majorité : « ce droit imprescriptible de tout sujet anglais et qui devient la source de tous ses privilèges, celui de n’obéir qu’à la loi, et à la seule loi à laquelle il a lui-même consenti par ses Représentants ». (p. 32)
La nationalité devient plus substantielle durant les années 1830, en même temps que s’affirme chez Papineau son américanisme et son républicanisme. Lamonde nous ramène alors à l’aphorisme de Paine : « Une nation ne sut jamais en gouverner une autre. » L’incompatibilité « nationale » avec la métropole britannique continue cependant de reposer sur des motifs purement sociopolitiques, du fait du rôle néfaste qu’occupe l’aristocratie anglaise, en particulier par le biais d’un conseil législatif nommé. Au passage, Lamonde s’étonne (se désole ?) que nulle part Papineau ne fasse allusion à l’éveil des nationalités des années 1830, en particulier à l’expérience grecque, polonaise ou latino-américaine.
Il y a donc usage, chez Papineau du mot « nationalité » dans la double limite du refus des « distinctions nationales », faites par les Britanniques de la colonie, et d’un non-appel au principe de nationalité, trop identifié à l’Europe, alors que l’Amérique a appris, à sa façon, que « nulle nation n’en peut commander une autre ». (p. 78)
Puisque l’indépendance apparaît inéluctable, Papineau l’attend comme un fruit mûr, lors d’une « séparation consentie », suivant le mot du curé Chartier, tandis que bon nombre de patriotes se disent prêts à forcer la séparation politique, rajoutant aux dissensions du mouvement patriote.
La rébellion de 1837-1838 précipite les événements au point de devoir devancer l’accession à l’indépendance. Papineau écrit alors à un député anglais : « Vos ministres n’en peuvent plus douter, ils ont fait naître un sentiment qui n’existait pas avant 1837. La séparation, alors personne voulait l’amener forcément et bien vite. » (p. 123)
Le Papineau troisième manière, désormais isolé et sans doute choqué par le régime raciste de l’Union de 1840, ose alors avancer que la « première cause des nationalités de chaque peuple, c’est la langue maternelle ». (p. 139) Il n’ira pas plus loin. Du même souffle, il rappelle que jamais ce trait ne doit permettre d’engendrer des « distinctions nationales ». Sur tout le reste, il ne déroge pas : « Tout ce que j’ai demandé en 1836 avec une si vaste majorité de mes collègues, appuyés que nous étions par une égale proportion dans la masse du peuple, je le redemande en 1847 […] » (p. 138) Tant que les Canadiens formeront une majorité démographique, ils seront une majorité démocratique et c’est à cette seule loi qu’ils doivent et devront obéissance : « Papineau voit l’émancipation à l’horizon, sur un horizon démocratique. » Sa conception d’une nation canadienne s’effondre donc quand s’évanouit la majorité francophone au sein du Canada-Uni à compter de 1850. Ses écrits empruntent dès lors des accents défaitistes et dramatiques, ne voyant plus de salut que dans l’annexion à une « république colombienne » pan-américaine qu’il oppose désormais à cette « petite nationalité néo-canadienne » (p. 165), quitte à engendrer l’assimilation linguistique pourtant décrite plus haut comme l’attribut premier de la nation. Manifestement, la pensée nationale du tribun vacille : « À propos de cette assimilation linguistique, il est symptomatique que Papineau n’ait pas parlé de la Louisiane et du destin de sa culture et de sa langue. […] Papineau a choisi d’être indépendant dans une république anglophone plutôt que d’être dépendant dans une monarchie anglophone. » (p. 170)
Lamonde évoque bien au passage l’émergence, à la même époque, d’un autre type de nationalisme, « essentiellement culturel, qui revendique la conservation de la langue, de la religion, des moeurs ». (p. 193) L’auteur aurait pu développer bien davantage sur cette dualité, se contentant de souligner que Papineau n’a rien à y voir. Il écorche plutôt au passage un certain courant historiographique qui fit de Papineau l’agitateur du principe de nationalité au seul service de son ambition : « La loi qui prévaut est celle de la majorité et la voie démocratique n’est pas qu’un levier “national” comme a eu tendance à la présenter l’historien Fernand Ouellet, mais un moyen de résister à une politique de colonialisme qui, précisément, crée des “distinctions nationales” [….] ». (p. 180)
Papineau put donc être souverainiste en son temps, sans être nationaliste. Une certaine gauche multiculturaliste aurait sans doute trouvé un glorieux précurseur chez ce dernier, n’eût été de son américanisme candide.