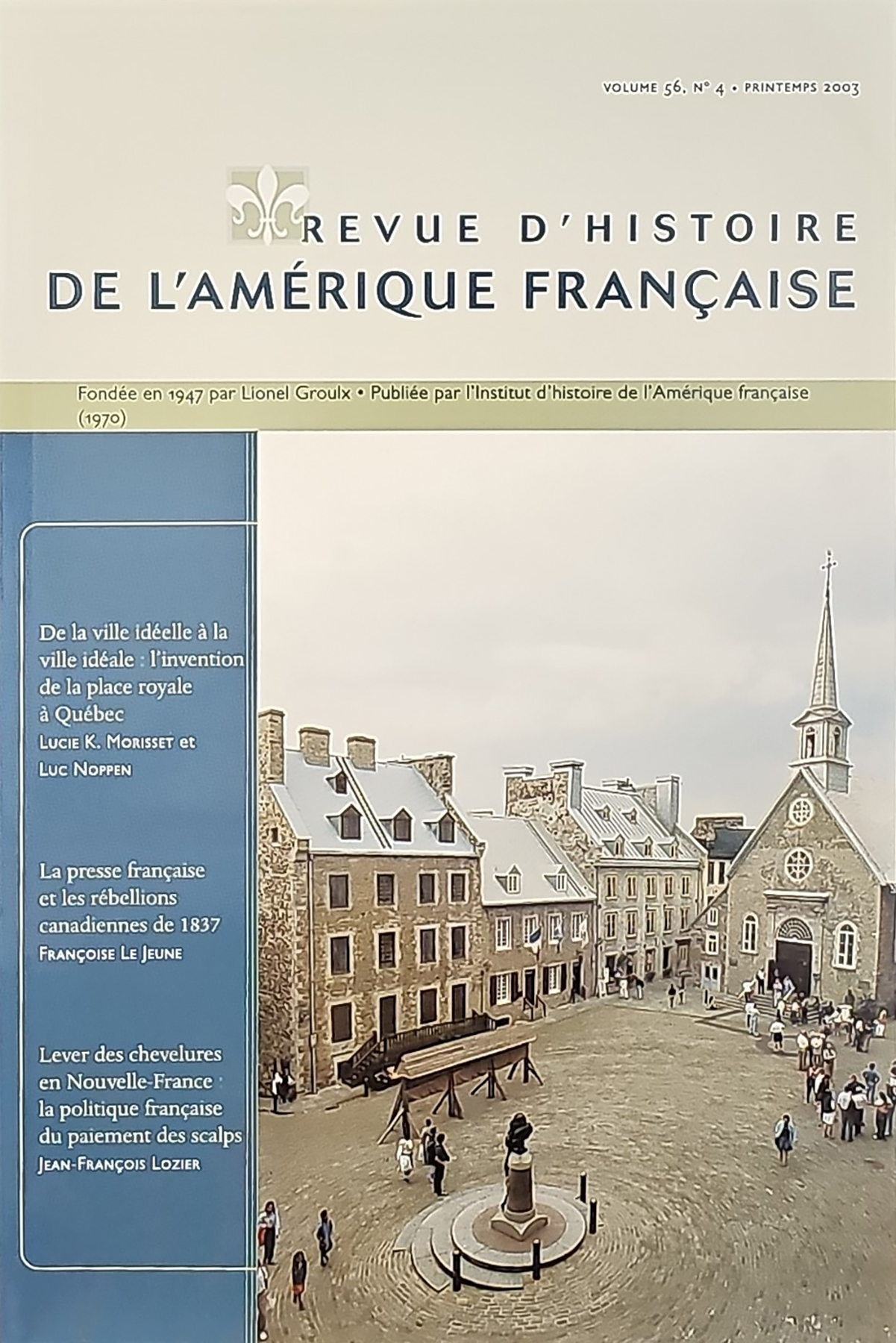Article body
Par sécularisation, il faut entendre la perte de pertinence sociale du religieux dans la société moderne, à savoir les aspects culturels et psychosociaux du « désenchantement du monde ». La laïcisation est un processus différent. Elle concerne « l’aménagement politique, puis la traduction juridique, de la place de la religion dans la société civile et dans les institutions publiques » (p. 34). Oeuvre du politique, ce processus ne se réduit pas à la victoire de l’Étatdans sa lutte de pouvoir contre l’Église, mais implique au premier chef leur « autonomisation réciproque » et la reconnaissance du droit à la liberté de conscience. L’État laïque est « neutre à l’égard des différentes conceptions de la vie bonne » : « il ne peut favoriser ni gêner aucune religion » (p. 35). En France, le principe de laïcité a été érigé en doctrine explicite, qui a toutefois suscité d’âpres conflits historiques contre l’Église — aujourd’hui contre les sectes dangereuses et contre la « dérive communautariste », symbolisée par le port du voile islamique. Car la laïcité forte à la française entend aussi préserver la liberté de penser contre les empiètements de la liberté de conscience.
Dans le sillage des travaux de Jean Baubérot, qui signe la préface, Micheline Milot soutient ici que les rapports Église-État au Québec se sont fondés sur une « neutralité tacite » et que le processus de laïcisation s’est amorcé dès la Conquête. Elle entend ainsi relativiser les représentations convenues sur l’ancienne société canadienne-française, « qualifiée de confessionnelle, de cléricale, de théocratique » (p. 15). Ce qui situe son travail dans le paradigme de la « modernité radicale », à cette variante près que cette société depuis toujours « américaine » est présentée ici comme plus « française » qu’on ne croyait.
Entre deux chapitres théoriques sur la laïcité, au titre d’« impensé de l’histoire de la société québécoise » et comme problème d’« aménagement du pluralisme », Milot nous offre une relecture de l’histoire politique du Québec, pour les périodes 1760-1840 et 1840-1960, sous l’angle des rapports Église-État. Quant à la période contemporaine, elle fait surtout l’objet d’une analyse juridique des droits de la personne, l’ensemble étant centré sur la question scolaire. Basés sur quelques classiques, les deux chapitres proprement historiques n’apportent guère de nouveau. Pour la période pré 1960, l’étude passe sous silence les conflits sur la non-confessionnalité des coopératives et des syndicats, qui se sont soldés par le triomphe du père Lévesque et le limogeage de Mgr Charbonneau. Admettons qu’il n’y avait pas lieu de s’y attarder, vu qu’il s’agit d’institutions civiques et non proprement « publiques » ; il aurait tout de même fallu les situer en fond de scène. Il aurait aussi fallu traiter de la laïcisation des services d’assistance et de santé, amorcée en 1921. Et prendre la peine de discuter les thèses que contredit implicitement l’ouvrage. Dans sa Genèse de la société québécoise, par exemple, Fernand Dumont endossait Marcel Trudel à propos de « la “servitude” de l’Église sous le Régime anglais » ; Milot parle plutôt de « différenciation des pouvoirs, avec des alliances objectives » (p. 67). « Par son insertion dans les structures du pouvoir civil, l’Église québécoise est aussi une puissance politique », posait Jean Hamelin pour le début du xxe siècle ; Milot la relègue au statut de « groupe de pression bien organisé » (p. 110). Faute d’expertise assurée sur le xixe siècle, je ne peux que la soupçonner d’anachronisme semblable lorsqu’elle impute aux libéraux ou « laïques francophones » le souci d’« égalité des chances » (p. 64) et de « préservation de la langue française » (p. 63) dans leur combat pour l’instruction publique.
Milot ne s’encombre pas non plus de précision historique. Elle n’indique qu’occasionnellement les références à l’appui de son propos. Elle ramène trop facilement les personnages à des catégories. Et ses inexactitudes factuelles dépassent le seuil de tolérance. Mgr Briand est présenté comme « évêque de Québec reconnu par le nouveau gouverneur » (p. 42), alors qu’il avait été choisi par celui-ci comme « surintendant de l’Église romaine au Canada ». Les Juifs « fondent » une commission scolaire (p. 108) — créée par le gouvernement Taschereau, qui a veillé à y nommer une majorité d’opposants à cette nouvelle structure, restée alors lettre morte. « Le gouvernement n’adoptera qu’en 1946 [1943] la loi rendant obligatoire la fréquentation scolaire » (p. 107). Le père Lévesque a créé, « dans les années 50, l’Institut des sciences sociales » (p. 114) — l’École des sciences sociales, en 1938. J’en passe. Convenons donc que Milot s’est donné un méritoire arrière-plan historique et qu’elle a cru devoir le conserver au bénéfice (risqué) de son lectorat français. Et que là n’est pas le principal intérêt de son travail.
Outre les clarifications conceptuelles et états de la question aux chapitres théoriques, l’ouvrage comporte un dossier instructif sur le processus accéléré de laïcisation à partir de 1960 : mouvements laïques de 1961 et de 1981, chartes des droits et libertés du Québec et du Canada, déconfessionnalisation des structures scolaires et débat sur la place de la religion à l’école. Milot s’arrête sur le dispositif juridique découlant du libellé des chartes, notamment sur l’obligation d’« accommodement raisonnable » en cas de « discrimination indirecte », qu’elle illustre de plusieurs exemples. Il ressort de son analyse que la jurisprudence dans l’interprétation des chartes offre une très large protection aux convictions personnelles, comparativement à la France.
Malgré l’amendement constitutionnel de 1997 autorisant le remplacement des structures scolaires confessionnelles par des structures linguistiques, la laïcisation de l’école n’est pas achevée puisque le débat subséquent sur l’enseignement religieux a débouché sur une demi-mesure, préservant partiellement le privilège des religions catholique et protestantes. Milot avait participé au groupe de travail ministériel qui a proposé de remplacer l’enseignement confessionnel ou moral par un enseignement culturel commun. Fernand Ouellet a publié un gros dossier sur ce débat (CRP, 2000), dont il ressort que le projet des experts était contestable, ramenant la culture religieuse à une éducation civique à la tolérance. Milot n’a pas touché à ce dossier. Elle insiste plutôt sur l’opposition entre la conception individualiste de la citoyenneté et la conception communautaire, qui valorise le droit des parents et la médiation des héritages religieux et culturels particuliers. Elle met aussi en évidence la marginalisation de l’Église, devenue un intervenant parmi d’autres dans le débat de 1997.