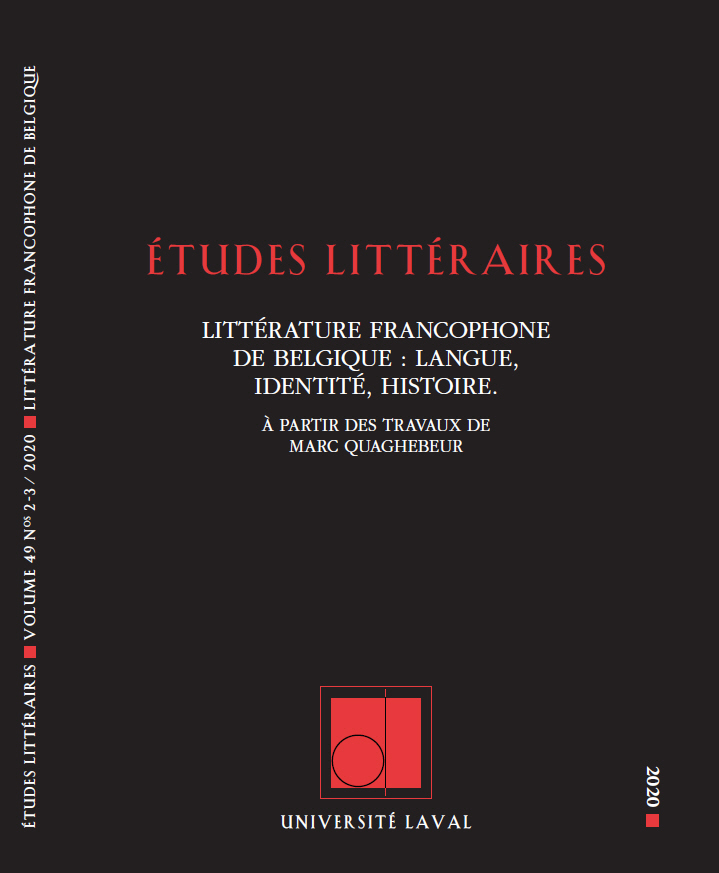Abstracts
Résumé
L’oeuvre de Maeterlinck (1862-1949) se heurte à la notion d’irréversible tant dans son premier que dans son second théâtre. S’intéressant à ce paradoxe existentiel, tel que défini par Jankélévitch, cet article propose de se pencher sur ce concept et d’analyser quelles résistances lui oppose le théâtre du dramaturge gantois. Passant d’un théâtre de la perte à un théâtre de la délivrance, l’oeuvre de Maeterlinck cherche constamment à trouver une réponse à cette fatalité qui impose à l’homme d’être « tout entier irréversibilité ».
Abstract
The work of Maeterlinck (1862-1949) clashes with the notion of irreversibility in both his first and second theatres. This article looks at this existential paradox, as defined by Jankélévitch, and analyses the resistance against this concept in the Ghent playwright’s theatre. Shifting from a theatre of loss to a theatre of deliverance, the work of Maeterlinck constantly seeks to find an answer to this fatality that requires man to be “entirely irreversible”.
Article body
Le devenir est à la fois une marche à la mort et un progrès créateur.
– Vladimir Jankélévitch[1]
La critique maeterlinckienne a fait consensus autour de l’idée que l’oeuvre du poète gantois se scinde vers 1895, se répartissant en un premier et un second théâtre. Cette date marque le début d’une période mouvementée pour Maurice Maeterlinck (1862-1949), qui a quitté le château familial d’Oostakker dans une forme de « dérive [qui] l’écarte toujours plus de l’espace natal[2] ». Ce bouleversement dans la vie du dramaturge entraîne un changement de paradigme non négligeable dans son oeuvre théâtrale. Je postule que ce dernier s’inscrit dans la conception de l’irréversible, tel que défini par Jankélévitch. Dans L’Irréversible et la Nostalgie, le philosophe écrit :
L’homme est tout entier devenir, et n’est que cela ; et comme le devenir lui-même est toute irréversibilité, il s’ensuit que l’homme entier est tout entier [sic] irréversibilité : […] l’homme est un irréversible incarné : tout son « être » consiste à devenir (c’est-à-dire à être en n’étant pas)[3].
L’oeuvre de Maeterlinck bute constamment sur ce paradoxe existentiel et l’évolution de son premier à son second théâtre trahit un changement dans la résistance offerte par ses drames au concept d’irréversible. Cet article s’interrogera ainsi sur les réponses données par Maeterlinck à cette question[4].
Le théâtre de la perte
Le premier théâtre[5] se caractérise par un enracinement spatial : la frontière y demeure omniprésente, les protagonistes se barricadent à l’intérieur d’un lieu confiné, réduit à l’espace scénique. L’oeuvre du dramaturge gantois correspond alors, ainsi que le note Anne Ducrey[6], à un théâtre du seuil et, dans cet espace sensoriel minuscule, des héros innocents se retrouvent isolés. Les Sept Princesses[7] (1891) est symptomatique de ce désir de se cloîtrer et de former un abri autour des personnages. La pièce débute par deux monarques en pleine contemplation de jeunes princesses endormies ; les souverains commencent à s’inquiéter de ce sommeil prolongé :
LE ROI : Je vais frapper doucement à la porte.
LA REINE : Non, non ! Jamais ! Jamais !… Oh ! Non, pas vous ! pas vous ! Vous frapperiez trop fort… Prenez garde ! Oh prenez garde ! Elles ont peur de tout.
LSP, p. 353
Tous les personnages du premier théâtre se barricadent progressivement dans des espaces confinés (d’où la présence régulière de grottes dans le théâtre de Maeterlinck). Le dramaturge précise cette idée dans son agenda en février 1891 :
Exprimer surtout cette sensation d’emprisonnés, d’étouffés, de haletants en sueur qui veulent se séparer, s’en aller, s’écarter, fuir, ouvrir, et qui ne peuvent pas bouger. Et l’angoisse de cette destinée contre laquelle ils se heurtent la tête comme contre [sic] un mur et qui les serre de plus en plus étroitement l’un contre l’autre[8].
Les protagonistes et les lieux s’unissent dès lors pour créer un « univers fusionnel[9] ». Phénomène particulièrement visible dans Les Aveugles (1890), où les personnages ne sont pas nommés, ces derniers finissant par se confondre dans une masse indistincte : « Serrons-nous les uns contre les autres ! » (LA, p. 323), s’écrie le Premier Aveugle-Né dans les dernières lignes de cette pièce. D’ailleurs, l’espace maeterlinckien lui-même évoque la fusion. Ainsi, Antoine Vitez, metteur en scène de l’opéra Pelléas et Mélisande (1892), affirme « qu’il fallait être Belge pour inventer un décor mythique qui accolât la forêt d’Ardenne à la mer du Nord[10] ». De plus, la temporalité elle-même devient imprécise : « Je ne sais jamais si je me promène à midi ou à minuit » (LA, p. 297). Les protagonistes vivent dans un flottement et dépendent entièrement des mots des autres. Ils ne peuvent néanmoins se fier à la parole d’autrui : aucun personnage ne réussit à nommer l’espace qu’il cherche pourtant si frénétiquement. L’aïeul dans L’Intruse (1890) et Le Roi dans La Princesse Maleine (1889) s’écrient tous deux : « Je voudrais être ailleurs » (LI, p. 278 ; LPM, p. 152). Le lieu indéterminé est donc plébiscité et l’aïeul, dans L’Intruse, de renchérir :
La Fille : – Où voudriez-vous aller, grand-père ?
L’Aïeul : – Je ne sais pas où — dans une autre chambre, n’importe où ! n’importe où !
L’espace se perd ainsi dans une faille amenée par la parole. Les personnages souhaitent un endroit innommable qu’ils ne peuvent qu’esquisser en ayant recours à des formes pronominales indéterminées. En effet, de nombreux déictiques spatiaux traversent les textes de Maeterlinck : ces éléments font que l’oeuvre ne repose que sur elle-même puisque la scène demeure « exempte de véritables points d’ancrage descriptifs, elle n’offre plus de repères précis en ce qui concerne le temps et l’espace[11] ». L’obsession du vide de Maeterlinck entraîne les paroles avec elles, celles-ci s’enfonçant dès lors dans un gouffre où les mots se répercutent sous forme d’écho (phénomène analysé par Gérard Dessons[12]). Ces nombreuses répétitions annihilent toute forme de communication (« On ne dit jamais ce qu’il faudrait dire » [LI, p. 273]). Maeterlinck, ainsi, « [l]utte avec le Verbe dont il est contraint de se servir pour dire les entrevisions du vide, qui l’obsèdent[13] ». Ses textes sont hantés par cette faille, cet irréversible final qu’est la mort.
Les personnages se cloîtrent et leur refus de traverser les frontières s’avère symptomatique d’un désir de se couper du monde extérieur et de se focaliser sur leur malheur. Dans son texte Deuil et mélancolie, Freud caractérise la mélancolie à la fois comme « une dépression profondément douloureuse », mais également comme « une suspension de l’intérêt pour le monde extérieur[14] ». Les protagonistes maeterlinckiens sont prostrés par ce sentiment mélancolique. En effet, ils se barricadent derrière ce seuil, créent une frontière entre le « Je » et « l’Autre ». Ils sont enfermés dans un îlot, lieu de la faille, et dans un présent statique. Telle Mélisande, dont on ne sait « ni son âge, ni qui elle est, ni d’où elle vient » (P&M, p. 379), les héros vivent, pour le dire avec Jankélévitch, dans cette « impuissance absolue à remonter, fût-ce d’un instant infinitésimal, vers le passé [qui] engendre une certaine sorte de mélancolie pneumatique [15] ». Innerve tout le premier théâtre de Maeterlinck cette mélancolie que le dictionnaire définit comme un « [é]tat morbide caractérisé par un abattement physique et moral complet, une profonde tristesse, un pessimisme généralisé, accompagné d’idées délirantes d’autoaccusation et de suicide[16] ». Mélisande explique ainsi à Golaud : « Je ne suis pas heureuse ici » (P&M, p. 392). Les personnages, plongés dans des évènements statiques, où le passé est inconnu et le futur indéterminé, s’enfoncent dans un état mélancolique duquel il semble impossible de s’extraire. Le premier théâtre de Maeterlinck baigne dans ce « sentiment » qui est, selon Jankélévitch, « échec de l’action[17] ». Les personnages sont condamnés à ne rien faire et à s’adonner à des actions « oisives » : « Pleurer, souffrir, chanter, rêver…[18] », la poésie et la musique étant « filles de [la] mélancolie[19] ».
Les nombreux chants qui jalonnent les textes du premier théâtre témoignent de cette plongée dans « les profondeurs de la rêverie ». Il n’y a « rien à faire, et rien non plus à dire : car cet impossible est également indicible, ou du moins à peine dicible[20] » : les textes de Maeterlinck, ponctués de points de suspension, reflètent une telle incapacité. Le discours mélancolique ne doit pas être développé, car ce malheur est universellement compris. Ainsi, les servantes du château dans Pelléas et Mélisande, qui ne doivent pas parler, tombent simplement à genoux comprenant, pour reprendre l’analyse de Jankélévitch, « d’un seul coup tout ce qu’il y avait à comprendre[21] ». Ce langage mélancolique a recours à un langage « autocentré » qui ne s’adresse pas à autrui, les dialogues se singularisent par un refus de la conversation. Les protagonistes s’enfoncent dans leur « moi » intérieur alors que les échanges dialogiques sont laissés en suspens. Proches du babil enfantin, ils sont une expression du « processus interne et représente[nt] un type de communication non-intentionnelle[22] ». Comme l’affirme Peter Szondi : « La répartition en plusieurs “répliques” ne correspond pas à une conversation comme dans le véritable drame, elle reflète seulement le chatoiement nerveux de l’incertitude[23]. »
Cette incertitude et cette plongée intérieure, caractéristiques de la mélancolie, sont visibles également dans le paysage qui se dévoile grâce à la parole des personnages. La vision est indéfinie et le spectateur ne perçoit les décors que par l’entremise de leur discours :
LA NOURRICE : Mais ne voyez-vous rien ?
MALEINE : Pas encore ; si ! si ! le ciel est tout bleu. Et la forêt ! Oh ! toute la forêt !
LA NOURRICE : Laissez-moi voir !
MALEINE : Attends ! Je commence à voir !
LA NOURRICE : Voyez-vous la ville ?
MALEINE : Non.
LA NOURRICE : Et le château ?
MALEINE : Non.
LA NOURRICE : C’est qu’il est de l’autre côté.
MALEINE : Mais cependant… je vois la mer.
LA NOURRICE : Vous voyez la mer ?
MALEINE : Oui, oui, c’est la mer ! Elle est verte !
LA NOURRICE : Mais alors, vous devez voir la ville. Laissez-moi regarder.
MALEINE : Je vois le phare !
LA NOURRICE : Vous voyez le phare ?
MALEINE : Oui. Je crois que c’est le phare…
LA NOURRICE : Mais alors, vous devez voir la ville.
LPM, p. 102
Dans cet extrait, Maleine et sa nourrice, enfermées dans une tour, font naître le paysage par leurs paroles, celui-ci perdant ainsi de son importance, n’étant qu’une projection de leur intériorité. D’autant plus que les protagonistes, notamment la nourrice dans l’extrait précédent, remettent en doute les paroles des autres, questionnant ainsi l’espace. Le monde se trouve réduit à nouveau puisqu’il ne saurait exister que par les mots, présentés plus avant comme lieux de la faille. Ciselées, les figurations des décors sont attribuées à l’imagination des personnages. Ils les donnent à voir par leurs échanges, bien que la présence d’aveugles rende le procès quelque peu paradoxal. Ces derniers « dévalorisent, sur le mode ironique, l’importance du réel extérieur, qui va du néant à l’action banale et contingente, en faveur d’un réalisme des “essences”, le seul susceptible d’exprimer la réalité du moi profond[24] ». De plus, en s’exclamant « mais il n’y a rien à voir au dehors » (LA, p. 294), ces aveugles confirment cet enracinement intérieur qui s’apparente à un repli sur soi. Pour leur part, les spectateurs sont plongés dans un paysage lugubre, similaire à ces marais dans lesquels s’enfoncent les personnages et qui représentent leur intériorité décrépie. Les décors marécageux reflètent dès lors le marasme dans lequel s’enferment ces derniers. Le peuple devient le miroir de ce mal-être généralisé, la population subissant des famines, des pestes et la fièvre des marais. La mélancolie structure ainsi l’espace : projection d’un moi mélancolique qui dessine la scène et la pièce. L’espace se réduit au néant dans lequel baigne l’intériorité des personnages. Cette annihilation de l’environnement est exacerbée par le besoin d’introspection qui, chez Maleine, l’amène à ignorer le paysage et l’horizon. Elle s’interroge d’ailleurs à plusieurs reprises : « Où est mon miroir ? » (LPM, p. 100). Cette question lancinante trahit le caractère disproportionné du « moi » dans cette oeuvre, le miroir étant l’expérience narcissique par excellence. Les personnages finissent par se désagréger, à tendre vers l’inorganique et chutent dès lors dans l’abîme qu’ils ont créé autour d’eux. La fin de Mélisande, racontée par la vieille servante, souligne cet état de fait :
Une toute petite blessure sous son petit sein gauche… Une petite blessure qui ne ferait pas mourir un pigeon. Est-ce que c’est naturel ? […] Elle a accouché sur son lit de mort ; est-ce que ce n’est pas un grand signe ? – Et quel enfant ! L’avez-vous vu ? – Une toute petite fille qu’un pauvre ne voudrait pas mettre au monde…
P&M, p. 440
Mélisande est condamnée à se déliter, ce qui renvoie à l’inévitable conclusion de cet enlisement intérieur : la putréfaction des racines. Cet ancrage, vu comme sécuritaire par les personnages, les conduit à leur perte. À ce sujet, Paul Aron écrit très justement qu’il y a une forme d’impuissance, voire d’abandon chez les matriarches et les patriarches dans l’oeuvre de Maeterlinck[25]. Personnification des racines pour les héros, les parents sont incapables de les aider et peuvent même causer leur perte (le roi Hjalmar dans La Princesse Maleine). Reprenant à Jankélévitch ses réflexions sur la perte et le néant, on peut avancer que les personnages maeterlinckiens s’effacent peu à peu dans l’inexistence :
[L]orsque les possibles, entièrement consommés, ne se renouvèlent plus, lorsque nos chances enfin se réduisent à zéro ; alors, ayant atteint le Bas absolu qui est le terme de la chute et la limite métempirique où s’annule toute énergie potentielle, l’homme touche le fond du désespoir et s’annihile dans la mort. Le devenir ne devient plus rien ! […] le moribond est acculé sur place au néant[26].
Un enlisement trop profond entraîne donc la faille, et la connaissance de cette dernière fait naître la mélancolie qui caractérise tout le premier théâtre. Maeterlinck propose un lieu où l’on ne saurait concevoir « l’Autre », l’extérieur n’étant qu’une projection de la mélancolie des personnages. Fondamentalement dans une pensée unitaire, ce qui est autre devient inénarrable et plonge dans la faille. Le monde créé par Maeterlinck impose d’ignorer que le devenir est entrouvert, « [o]uvert du côté de l’avenir, fermé du côté des choses révolues […]. [Si le monde apparaît] clos de toutes parts, comme dans le monde des portes fermées de Maeterlinck, il nous plong[e] dans les ténèbres de l’enfer[27] ». En enfermant ses personnages sur scène, Maeterlinck n’offre que la mélancolie et la mort comme horizon.
Le théâtre de la délivrance
Dans son second théâtre, le questionnement de l’auteur face à l’irréversible demeure, son imaginaire reste habité par cette notion. Cependant, Maeterlinck y cherche de nouvelles réponses, distinctes de l’enracinement et de la mélancolie caractéristiques du premier théâtre. Tout d’abord, c’est un théâtre qui n’est plus un théâtre statique. Ensuite, ce second théâtre fait entrer sur scène le passé et l’avenir. Finalement, c’est un théâtre qui met en exergue l’importance de la fiction, lieu de la création. La pièce Monna Vanna[28] (1902) définit parfaitement les intentions de Maeterlinck dans ce second théâtre à travers un personnage qui affirme : « Vous avez su détruire, il faut réédifier » (MV, p. 154). Un changement de paradigme est dès lors perceptible au tournant du siècle. D’un théâtre centré sur la fin, sur l’inévitable gouffre, Maeterlinck propose un théâtre qui parvient finalement à franchir ce seuil. Dans Le Trésor des humbles (1896), le dramaturge déclare que c’est « à l’endroit où l’homme semble sur le point de finir que probablement il commence ». Le regard n’est plus rivé sur le gouffre, mais passe au-delà. Le second théâtre se caractérise par ce « déplacement de point de vue […]. Les héros vont voir ailleurs […] de façon à pouvoir ensuite réviser leur jugement[29] ». Opposé au statisme du premier théâtre, le deuxième joue sur le mouvement et sur l’idée de progrès. Dans Le Temple enseveli, Maeterlinck affirme :
D’un certain point de vue, tout le progrès de la pensée humaine se réduit à deux ou trois changements de ce genre ; à avoir délogé deux ou trois mystères d’un lieu où ils faisaient du mal, pour les transporter dans un autre où ils deviennent inoffensifs, où ils peuvent faire du bien.
Ce transport des mystères vers un lieu où ils perdent leur aspect néfaste a de nombreuses conséquences : la mélancolie est notamment abandonnée au profit d’un climat proche du merveilleux. Le dramaturge, à propos de Ariane et Barbe-Bleue (1896), affirme : « J’ai en ce moment achevé une sorte d’opéra légendaire ou féérique[30]. » Ce climat légendaire s’appuie sur la mémoire et s’attache notamment à son passé littéraire. Nancy Delay rappelle :
L’irruption de tant de sources et d’influences nous apparaît personnellement comme un autre symbole capital du changement de régime de l’imaginaire. L’autarcie menaçait peu à peu de porter à la ruine et seule l’instauration d’un système harmonieux de LIBRE-ECHANGE entre esprits éclairés de tous bords, de tous âges et de toutes nationalités pouvait faire oublier les pertes en amenant de nouvelles richesses[31].
D’un théâtre de la perte, tendant vers l’inorganique, on passe à un théâtre dans lequel de nombreux effets d’intertextualité viennent nourrir le texte. Les références à des contes célèbres sont nombreuses et explicites : Barbe-Bleue, Le Petit Poucet, etc. Maeterlinck va d’ailleurs jusqu’à s’autoréférencer, un dialogue se crée donc entre les personnages du premier théâtre et du second. Dès lors, Ariane dans Ariane et Barbe-Bleue termine la pièce par un déplacement « loin d’ici » (A&BB, p. 43) après avoir demandé aux princesses, nommées d’après les héroïnes du premier théâtre : « Pourquoi voulez-vous qu’on vous délivre si vous adorez vos ténèbres ? » (A&BB, p. 27). Les personnages du second théâtre ne comprennent pas les choix des héroïnes du premier et Ariane ne peut que conclure par ce dernier message : « Adieu, soyez heureuses… » (A&BB, p. 43). L’auteur « entreprend une véritable descente dans les Enfers de son premier théâtre pour y récupérer toutes ses victimes et les initier à la quête du Bonheur[32] ». On y lit une volonté de se libérer, de s’ouvrir et de dépasser la mélancolie figurée dans le premier théâtre, cause d’un sentiment d’enfermement. Ariane et Barbe-Bleue « est comme un chant de délivrance, inconcevable sans la longue souffrance préalable de l’emprisonnement[33] ». Le second théâtre devient celui de la libération et est, paradoxalement, inséparable de la première phase du théâtre. La mort, appréhendée comme un absolu irréversible, est de cette façon perçue comme « rien d’autre qu’un simple passage, un transfert intérieur de l’âme du monde[34] ».
Il faut néanmoins noter que malgré cette libération, les textes du second théâtre ne sont dépourvus ni de tiraillements ni de paradoxes. Une forme évidente de résistance à l’irréversible est perceptible ; de même qu’un désir de retour en arrière, de réhabilitation. Les héroïnes du premier théâtre ne ressuscitent-elles pas dans Ariane et Barbe-Bleue ? Cette résurrection, « véritable mutation de contradictoire à contradictoire[35] », affirme Jankélévitch, est « censée ramener le défunt de l’au-delà à l’en deçà ; enjambant à rebours le seuil de la mort, c’est-à-dire l’irréversible par excellence[36] ». Véritable guerre faite à l’irrévocable, la résurrection des princesses montre le désir de Maeterlinck de le confronter dans ce nouveau théâtre. De même, le discours tente vainement de retarder l’inéluctable – « Ah ! tenez, je me perds ; j’entrelace des phrases, j’accumule des mots pour reculer un peu le moment qui décide… » (MV, p. 96) – et obtient ainsi un rôle bien plus conséquent que dans le premier théâtre. Cela est souligné par cette phrase tirée de Monna Vanna :
Je n’ai rien entendu qu’un écho attardé… C’est un silence vierge que tu vas déchirer. Vois, tout le monde écoute ; personne ne sait rien et tu dois encore dire la première parole… […] Dis celle que j’attends et qui doit être dite, pour soutenir enfin tout ce qui croule en moi !…
MV, p. 108
Les paroles des personnages sont capables de « déchirer » le silence et prouvent la force qu’elles avaient perdue dans le premier théâtre.
Paradoxalement, ce discours tente, dans Monna Vanna, d’en effacer un autre et annule dès lors la force du premier. Ces pièces présentent, en effet, de nombreux paradoxes et conflits intérieurs profonds. La figure de soeur Béatrice se trouve ainsi tiraillée au début de la pièce éponyme (1901) entre un monde céleste et terrestre. Cette même lutte entre le gouffre et la raison apparaît dans Monna Vanna :
Je vous l’ai dit : Prinzivalle parait sage ; il est raisonnable et humain… Mais quel est l’homme sage qui n’ait pas sa folie ; et quel est l’homme bon qui n’ait jamais nourri une idée monstrueuse ?… À droite est la raison, la pitié, la justice ; à gauche, c’est autre chose, le désir, la passion, que sais-je ? la démence où nous tombons sans cesse… J’y suis tombé moi-même, vous y tomberez peut-être et j’y retomberai… Car l’homme est ainsi fait…
MV, p. 95
D’autres démons viennent régulièrement harceler les héros sous la forme de regrets (« Fallait-il venir sans regrets ? » [MV, p. 125]) ou d’obsessions par rapport à la question du pardon. Ce phénomène permet de cerner les éléments qui distinguent les deux périodes. En effet, dans le premier théâtre, se perçoit une tentative de nihiliser l’avoir-été. Le passé est abandonné, les personnages ne peuvent dès lors être pardonnés. Dans ces premières pièces, aucune conclusion ne peut être tirée des évènements et les choses sont condamnées à se succéder sans distinction. Ainsi, dans la dernière scène de Pelléas et Mélisande, le dialogue entre Arkel, Golaud et Mélisande mourante montre cette incapacité :
Mélisande : Que faut-il pardonner ? […] Non, non ; nous n’avons pas été coupables. […] Arkel : Veux-tu voir ton enfant ? Mélisande : Quel enfant ? […] Arkel : Il [l’enfant] faut qu’il vive maintenant à sa place… C’est au tour de la pauvre petite…
P&M, p. 445-451
Quant au deuxième théâtre, rongé par le passé, il bute régulièrement sur cette idée du pardon et du regret : « Ah ! Comme le temps qui passe efface des merveilles ! … Mais ces merveilles-là, je les avais vues seul… Au fait, c’est mieux peut-être qu’elles soient oubliées… Je n’aurai plus d’espoir, j’aurai moins de regrets… » (MV, p. 129). Ainsi, ce changement de paradigme, bien que positif, car il sort les personnages de leur torpeur, entraine également un tiraillement intérieur.
Pour parvenir à dépasser ce combat intérieur, l’oeuvre de Maeterlinck découvre le « pouvoir essentiel de la Fiction […] pour révéler, en le recréant, le mystère du monde caché[37] ». Les héros jouent des rôles, s’inventent des récits imaginaires et le dramaturge confie à ces récits fictionnels le rôle de réinventer l’Histoire, de libérer les personnages du fardeau du passé. Dans Soeur Béatrice, la jeune femme est réhabilitée, malgré une vie de débauche, après avoir accepté le rôle qu’on lui offrait : celui d’être « l’âme élue qui […] revient du ciel… » (SB, p. 73). Les images de la Vierge et de la soeur dévoyée se confondent. Son oeuvre devient ainsi le lieu de la recréation et celui où la fiction – en l’occurrence, le dialogue théâtral – peut prendre ses droits. Il devient donc envisageable de réparer l’irréversible, et ce, notamment grâce au souvenir où l’on peut restaurer ce qui a été brisé. La scène de la perte de l’anneau dans Pelléas et Mélisande est revécue dans les souvenirs de Monna Vanna, le geste, qui avait été ébauché, peut être finalisé :
Alors, je vous trouvai sous un bosquet de myrtes, près d’un bassin de marbre… Une mince bague d’or était tombée dans l’eau… Vous pleuriez près du bord… J’entrai dans le bassin. – Je faillis me noyer ; mais je saisis la bague et vous la mis au doigt… – Vous m’avez embrassé et vous étiez heureuse…
MV, p. 129
Maeterlinck s’autoréférentialise, modifie son regard pour pouvoir juger différemment[38] et laisse aux personnages la possibilité d’être heureux dans leurs souvenirs. Cette compensation appliquée par le dramaturge est une forme de « justice réparative [qui] restaure la situation qui prévalait en deçà de l’empiètement : tout se passe comme s’il n’était rien arrivé au cours du devenir[39] ». Ce changement de perspective permet de voir d’une manière bénéfique un passé difficile. Le départ qui caractérise nombre de personnages du second théâtre (fuite de Béatrice vers le monde extérieur, celui de Vanna, le départ des enfants dans L’Oiseau bleu [1909]) oblige à considérer certains lieux comme appartenant au passé et à les percevoir ainsi autrement. Ce retour en arrière devient rédempteur, s’apparente à une forme de justice « qui postule la très relative et très approximative réversion de l’irréversible[40] », et fait entrer la question du temps au centre de son oeuvre. Ce phénomène atteindra son apogée dans Bulles bleues. Souvenirs heureux (1949).
Les pièces du deuxième théâtre se caractérisent donc par le retour du temps. Le temps
devient lui aussi un refuge : il enlève [au] Barbe Bleue du XVIIe siècle son aspect épouvantable ; dans Soeur Béatrice, il transforme la pècheresse du Moyen-Âge en une sainte ; il sauve Prinzivalle du supplice que le personnage historique dont il s’inspire (Paolo Vitelli) dut affronter pendant la Renaissance ; enfin, il rend à la femme-enfant (Joyzelle), à l’enfant (dans L’Oiseau) et à l’homme (Jésus dans Marie-Magdeleine) la force de volonté qu’il leur déniait dans ses premières oeuvres[41].
L’auteur y précise « le laps de temps qui s’écoule entre un acte et un autre[42] ». Il faut, en effet, qu’une période de temps se soit écoulée pour pouvoir porter un regard neuf sur la situation. Cependant, ce « passé n’a pas la vitalité du présent en chair et en os, et pourtant le passé est tout le contraire d’un spectre irréel ; le souvenir n’a pas la réalité active et concrète de la perception, et pourtant le souvenir est bien loin de ressembler à un fantôme… [Ces fantasmes et reflets] sont, pour employer le langage de saint Jean, le “chemin vers” la vérité[43] ». Forme d’illusion, le passé entre de plain-pied dans le théâtre de Maeterlinck.
L’importance grandissante qui est accordée au monde révolu a plusieurs répercussions au sens de Jankélévitch : « [A]u fur et à mesure que la conscience s’enfonce dans l’infiniment petit de son regret, les souvenirs oubliés remontent à la surface : ce sont mille détails oiseux, refoulés par les exigences de la pratique utilitaire et du sérieux le plus prosaïque, qui reparaissent inépuisablement dans leur dérisoire et pittoresque anachronisme ; et plus ils sont démodés, inactuels, surannés plus ils nous touchent[44]. » À l’austérité des premières pièces, il est nécessaire de comparer l’opulence des énumérations dans le second théâtre, et ce, dès Ariane et Barbe-Bleue. Mais c’est principalement dans L’Oiseau bleu que cela se ressent. Alors que Myltyl et Tyltyl sont dans le pays des souvenirs et revoient leur famille disparue, chaque personnage renaît à travers une foison de détails :
TYLTYL : Voilà Kiki dont j’ai coupé la queue avec les ciseaux de Pauline… Il n’a pas changé non plus… […] Et Pauline a toujours son bouton sur le nez !…
LOB, p. 284
L’Oiseau bleu fait culminer cette nostalgie, notamment grâce au rôle prépondérant de la figure maternelle dans cette pièce. Elle y possède, en effet, une fonction essentielle qu’elle n’avait jamais eue jusqu’alors chez Maeterlinck[45]. Dans sa préface à L’Oiseau bleu, Marc Quaghebeur avait noté que Maeterlinck semblait y résoudre les contradictions qui le tiraillaient auparavant[46] et il apparaît, en effet, que L’Oiseau bleu cherche à présenter une forme de synthèse entre l’être et le savoir. Si les vieillards, dans le premier théâtre de Maeterlinck, sont dépositaires d’un savoir, c’est parce qu’ils ont, pour citer Jankélévitch, « de la vérité une notion plus complète que la conscience naïve, il[s] envisage[nt] volontiers les problèmes dans toutes leurs dimensions[47] ». Ce gérontisme de Maeterlinck est exacerbé par l’abolition du passé chez les jeunes protagonistes qui s’enlisent dans un présent, n’ayant pas la possibilité d’accumuler de l’expérience. Face aux patriarches capables d’« être et avoir été[48] », les jeunes chez Maeterlinck sont condamnés à stagner dans l’« être ». Les vieillards et les jeunes protagonistes du premier théâtre se trouvent devant le constat suivant : « Jamais le même ne peut être et savoir en même temps[49] ! » Et Jankélévitch d’ajouter : « Être sans savoir ou savoir sans être – telles sont les deux moitiés de notre destin, et elles nous sont imparties successivement. L’innocence est la rançon de la jeunesse, comme la vieillesse est la rançon de la conscience[50]. » Dans les premières pièces du second théâtre, se perçoit dès lors un tiraillement : l’arrivée du passé entraîne l’impossibilité de demeurer innocent, d’où l’arrivée des thèmes du regret et du pardon dans ce théâtre. Des subterfuges sont donc mis en place : une illusion, par exemple, permet à la figure de soeur Béatrice de conserver sa pureté, malgré son expérience malheureuse.
En ce qui concerne L’Oiseau bleu, il parvient à répondre différemment à l’opposition entre être et savoir, notamment par l’usage du dédoublement[51] de la temporalité. Le monde psychique et le monde physique se scindent pour permettre aux personnages d’être tout en ayant été. Le voyage fictif devient ainsi la solution idéale permettant de « rester physiquement au sein du refuge tout en voyageant dans l’imaginaire. L’Oiseau bleu est, sous cet angle, le moment d’une harmonisation parfaite entre des sentiments qui restent ancrés dans le refuge intérieur et des désirs qui peuvent être projetés sur le monde extérieur[52] ». Cependant, bien que l’oeuvre soit capable de répondre aux contradictions, on doit noter que cette réponse se fait à nouveau sous le signe de l’imaginaire, et ce, par le recours au rêve. S’opposant au premier théâtre qui se morfond dans une forme de stagnation, le second théâtre joue avec le temps et résiste à l’irréversible. Il tente de rattraper le passé, poursuit la mémoire. D’ailleurs, comment ne pas voir dans cette définition du souvenir selon Jankélévitch, l’image de l’oiseau bleu :
Quelque chose nous est rendu, un souvenir, une ombre, un écho du passé — mais ce quelque chose n’est rien ; ou inversement : il ne manque rien, et pourtant il manque quelque chose… Il ne manque que l’essentiel ! Il manque la présence charnelle de l’effectivité. […] Le quelque chose auquel tout manque, et qui n’est pourtant pas rien, a échangé la vérité incontestable de la présence contre le charme de l’ineffable et impalpable de la passéité. Appelons ce presque-rien, le je-ne-sais-quoi, pour mieux marquer sa nature évasive et son incomplétude : le désir nostalgique de revenir en arrière vers un passé qui jamais ne nous sera rendu se confond ici avec l’aspiration à un avenir infiniment lointain et qui jamais ne reviendra[53].
Force est de constater, au réveil : l’oiseau bleu fuit constamment et l’on ne peut qu’être soulagé d’avoir-été en possession de ce dernier. Ce qui est tout de même infiniment plus que rien : « [E]ntre le zéro de l’inexistence absolue et l’avoir-été la distance est certes infiniment infinie[54] ! » Les héros se voient dès lors contraints de briser le quatrième mur et de transférer, dans un ultime mouvement, la quête de la Fée Berylune aux spectateurs :
TYLTYL : S’avançant sur le devant de la scène et s’adressant au public. Si quelqu’un le retrouve, voudrait-il nous le rendre ?… Nous en avons besoin pour être heureux plus tard…
LOB, p. 398
Telle l’héroïne éponyme de Monna Vanna, les spectateurs ne doivent qu’avoir foi en l’avenir : « C’était un mauvais rêve… Le beau va commencer… Le beau va commencer… » (MV, p. 161) et en la force réconfortante de l’illusion. Tyltyl et Myltyl, après qu’ils se sont réveillés dans leur petite maison, se révèlent comblés par ce voyage intérieur ; le personnage du père, incapable de comprendre, affirme alors : « Laisse donc, t’inquiète pas… Ils jouent à être heureux… » (LOB, p. 395). Maeterlinck, dans son second théâtre, semble avoir foi dans les bienfaits de la fiction et lui confère un pouvoir libérateur. La force de l’illusion est telle, car « [t]oute idée est relative [et] liée à un certain point de vue. C’est l’image vraie ou fausse que l’on se représente qui conditionne nos pensées et nos actions[55] ». Les personnages acceptent la possibilité du miracle et préfèrent « [s]’enivre[r] un instant d’une illusion trop douce » (MV, p. 136). Les personnages du second théâtre se caractérisent, en effet, par leur croyance dans le pouvoir de la fiction. Prenant appui sur le passé et sur d’autres textes, les nouvelles pièces tendent vers une projection en laquelle tous les espoirs des protagonistes reposent.
Appendices
Note biographique
Doctorante à l’Université Laval, Stéphanie Crêteur est également agente de liaison académique et culturelle pour Wallonie-Bruxelles International en charge des pays baltes. Sa thèse porte sur la « Perte de l’objet » dans les oeuvres de trois écrivains belges : Paul Willems, Dominique Rolin et Henry Bauchau.
Notes
-
[1]
Vladimir Jankélévitch, L’Irréversible et la Nostalgie, Paris, Flammarion, 2010, p. 230.
-
[2]
Marc Quaghebeur, « Préface », dans Maurice Maeterlinck, L’Oiseau bleu, Arles / Bruxelles, Actes Sud / Labor, 1989, p. 7.
-
[3]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 8.
-
[4]
Dans cet article, les pièces du premier théâtre ayant été analysées sont : La Princesse Maleine (abrégé LPM dans la suite de cet article), Les Aveugles (LA), Les Sept Princesses (LSP) et Pelléas et Mélisande (P&M). Celles du second théâtre sont Ariane et Barbe-Bleue (A&BB), Soeur Béatrice (SB), Monna Vanna (MV) et L’Oiseau bleu (LOB). Les pièces des troisième et quatrième théâtres ne font pas partie du corpus. Il serait sans doute intéressant d’étendre cette analyse aux dernières oeuvres de Maeterlinck.
-
[5]
Le premier théâtre comprend les pièces allant de La Princesse Maleine jusqu’à Aglavaine et Sélysette. Ariane et Barbe-Bleu marque l’entrée dans le second théâtre.
-
[6]
Anne Ducrey, « Dramaturgie du seuil », Textyles, vol. 41 (2012), p. 31-44.
-
[7]
Les citations des oeuvres du premier théâtre sont reprises de Maurice Maeterlinck, Oeuvres II. T. 1 : Théâtre […], édition présentée et commentée par Paul Gorceix, Bruxelles, Éditions Complexe (Bibliothèque Complexe), 1999.
-
[8]
Maurice Maeterlinck, Oeuvres I. Le Réveil de l’âme : poésie et essai, Bruxelles, édition établie et commentée par Paul Gorceix, Éditions Complexe (Bibliothèque Complexe), 1999, p. 38.
-
[9]
Nancy Delay, « Structure et symboles de l’“imaginaire nocturne” dans le second théâtre de Maurice Maeterlinck », dans Marc Quaghebeur (dir.), Présence/absence de Maurice Maeterlinck, Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (2-9 septembre 2000), Bruxelles, Archives et Musée de la littérature (Archives du futur), 2002, p. 221.
-
[10]
Marc Quaghebeur, « Il était le théâtre français », Forum Modernes Theater, vol. 6, no 1 (1991), p. 84.
-
[11]
Maria de Jesus Cabral, « Mallarmé, Maeterlinck. D’une idée de la dramaturgie à une dramaturgie de l’Idée », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 107.
-
[12]
Gérard Dessons, Maeterlinck, le théâtre du poème, Paris, L. Teper, 2005.
-
[13]
Maurice Maeterlinck, Oeuvres I, op. cit., p. 26.
-
[14]
Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie. Extrait de Métapsychologie », Sociétés, vol. 86, no 4 (2004), p. 8.
-
[15]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 184.
-
[16]
« Mélancolie » [en ligne], dans Trésor de la langue française informatisé [http://atilf.atilf.fr/].
-
[17]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 184.
-
[18]
Ibid., p. 185.
-
[19]
Ibid., p. 186.
-
[20]
Ibid., p. 189-190.
-
[21]
Ibid., p. 191.
-
[22]
Id.
-
[23]
Peter Szondi, cité dans Georges Dessons, op. cit., p. 104.
-
[24]
Maria de Jesus Cabral, « Mallarmé, Maeterlinck. D’une idée de la dramaturgie à une dramaturgie de l’Idée », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 108.
-
[25]
Paul Aron, « La mort, les légendes et le conflit des générations chez Maurice Maeterlinck : une lecture politique du symbolisme belge », The French Review, vol. 68, no 1 (1994), p. 32-43.
-
[26]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 196-197.
-
[27]
Ibid., p. 159.
-
[28]
Les citations des pièces du second théâtre sont reprises de Maurice Maeterlinck, Oeuvres III. T. 2 : Théâtre […], édition présentée et commentée par Paul Gorceix, Bruxelles, Éditions Complexe (Bibliothèque Complexe), 1999.
-
[29]
Nancy Delay, « Structure et symboles de l’“imaginaire nocturne” dans le second théâtre de Maurice Maeterlinck », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 227.
-
[30]
Maeterlinck, cité dans Maurice Maeterlinck, Oeuvres III. T. 2: Théâtre […], op. cit., p. 8.
-
[31]
Nancy Delay, « Structure et symboles de l’“imaginaire nocturne” dans le second théâtre de Maurice Maeterlinck », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 228 ; dans la citation, l’utilisation des majuscules est de l’auteure.
-
[32]
Ibid., p. 203.
-
[33]
Pierre-Aimé Touchard, cité dans Maurice Maeterlinck, L’Oiseau bleu, préface de Marc Quaghebeur, lecture de Michel Otten, Arles / Bruxelles, Actes Sud / Labor, 1989, p. 135.
-
[34]
Ibid., p. 141.
-
[35]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 90.
-
[36]
Id.
-
[37]
Maria de Jesus Cabral, « Mallarmé, Maeterlinck. D’une idée de la dramaturgie à une dramaturgie de l’Idée », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 115.
-
[38]
La justice est également un thème majeur de pièces du second théâtre, notamment Monna Vanna.
-
[39]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 243.
-
[40]
Id.
-
[41]
Nancy Delay, « Structure et symboles de l’“imaginaire nocturne” dans le second théâtre de Maurice Maeterlinck », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 215.
-
[42]
Ibid., p. 232.
-
[43]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 204.
-
[44]
Ibid., p. 213.
-
[45]
Elles sont absentes, en train de mourir hors scène (L’Intruse) ou meurent dès qu’elles deviennent mères (Pelléas et Mélisande). Le rôle de la mère paraît d’autant plus important que Maeterlinck avait pris comme premier nom de plume « M. Mater » dans La Jeune Belgique.
-
[46]
Marc Quaghebeur, « Préface », dans Maurice Maeterlinck, L’Oiseau bleu, op. cit.
-
[47]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 208.
-
[48]
Ibid., p. 209.
-
[49]
Id.
-
[50]
Id.
-
[51]
Ce dédoublement est déjà visible dans Ariane et Barbe-Bleue (entre Ariane et les princesses), dans Soeur Béatrice, entre la Vierge et Béatrice.
-
[52]
Nancy Delay, « Structure et symboles de l’“imaginaire nocturne” dans le second théâtre de Maurice Maeterlinck », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 221.
-
[53]
Vladimir Jankélévitch, op. cit., p. 223.
-
[54]
Ibid., 205.
-
[55]
Nancy Delay, « Structure et symboles de l’“imaginaire nocturne” dans le second théâtre de Maurice Maeterlinck », dans Marc Quaghebeur (dir.), op. cit., p. 227.
Références
- Aron, Paul, « La mort, les légendes et le conflit des générations chez Maurice Maeterlinck : une lecture politique du symbolisme belge », The French Review, vol. 68, no 1 (1994), p. 32-43.
- Cabral, Maria de Jesus, « Mallarmé, Maeterlinck. D’une idée de la dramaturgie à une dramaturgie de l’Idée », dans Marc Quaghebeur (dir.), Présence/absence de Maurice Maeterlinck, Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (2-9 septembre 2000), Bruxelles, Archives et Musée de la littérature (Archives du futur), 2002, p. 89-123.
- Delay, Nancy, « Structure et symboles de l’“imaginaire nocturne” dans le second théâtre de Maurice Maeterlinck », dans Marc Quaghebeur (dir.), Présence/absence de Maurice Maeterlinck, Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (2-9 septembre 2000), Bruxelles, Archives et Musée de la littérature (Archives du futur), 2002, p. 198-239.
- Dessons, Gérard, Maeterlinck, le théâtre du poème, Paris, L. Teper, 2005.
- Ducrey, Anne, « Dramaturgie du seuil », Textyles, vol. 41 (2012), p. 31-44.
- Freud, Sigmund, « Deuil et mélancolie. Extrait de Métapsychologie », Sociétés, vol. 86, no 4 (2004), p. 7-19.
- Jankélévitch, Vladimir, L’Irréversible et la Nostalgie, Paris, Flammarion, 2010.
- Maeterlinck, Maurice, Oeuvres I. Le Réveil de l’âme : poésie et essai, Bruxelles, édition établie et commentée par Paul Gorceix, Éditions Complexe (Bibliothèque Complexe), 1999.
- Maeterlinck, Maurice, Oeuvres II. T. 1 : Théâtre […], édition présentée et commentée par Paul Gorceix, Bruxelles, Éditions Complexe (Bibliothèque Complexe), 1999.
- Maeterlinck, Maurice, Oeuvres III. T. 2 : Théâtre […], édition présentée et commentée par Paul Gorceix, Bruxelles, Éditions Complexe (Bibliothèque Complexe), 1999.
- Maeterlinck, Maurice, L’Oiseau bleu, préface de Marc Quaghebeur, lecture de Michel Otten, Arles / Bruxelles, Actes Sud / Labor, 1989.
- Quaghebeur, Marc, « Il était le théâtre français », Forum Modernes Theater, vol. 6, no 1 (1991), p. 84-86.
- Quaghebeur, Marc, « Préface », dans Maurice Maeterlinck,L’Oiseau bleu, Arles / Bruxelles, Actes Sud / Labor, 1989, p. 4-10.