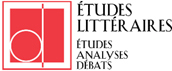Abstracts
Résumé
Depuis une rencontre inaugurale à Lausanne en 1984, Anca Visdei a entretenu avec Jean Anouilh, et ce, jusqu’à sa mort en 1987, une relation suivie faite d’appels, de conversations de vive voix et d’une correspondance dont sont ici publiés de larges extraits. Il en ressort un visage peu connu du dramaturge qui se fait lecteur attentif, conseiller amical et quasi paternel.
Abstract
From their first meeting in Lausanne back in 1984 until Anouilh’s passing in 1987, he and Anca Visdei enjoyed a sustained relationship peppered with telephone calls, face-to-face conversations and letters, many excerpts of which are published here. Through them, one discovers a little known side of the playwright: an involved reader, a friendly advisor, and a quasi father figure.
Article body
Lettre imaginaire
Cher Jean Anouilh,
Je vous ai gardé dans mon coeur, même après votre mort, « mourir la belle affaire ! » Comme un signet dans le livre de ma vie, un père spirituel à mettre sur toutes les blessures, toutes les douleurs… mon père spirituel, vous ne m’avez jamais abandonnée. Merci. Dont acte.
Dans Lettre à une jeune fille qui veut faire du théâtre vous écriviez :
Mademoiselle, j’ai bien cherché. Votre lettre est récente, mais il ne faut pas croire que cette qualité, comme en géologie, garantit une place aux couches supérieures des papiers qui encombrent ma table.
Moi, je n’ai pas eu à chercher. Vos lettres sont anciennes, mais il ne faut pas croire que cette qualité, comme en géologie, les condamne à une place aux couches inférieures des papiers qui encombrent ma table…
Vos lettres, vos pièces, vos mots m’aident à vivre chaque jour. Je vous entends, Monsieur. Comme si c’était hier. Six pieds sous terre, Monsieur, vous n’êtes pas mort. Je vous évoque souvent, avant les choix difficiles, lorsque les doutes m’assaillent, lors des moments de découragement. Vous êtes toujours là.
Je me rappelle votre grain de voix, votre sourire, presque tous vos mots, votre veston de bon vieux tweed, votre panama clair et votre canne qui, posée à côté de vous, faisait davantage penser à une coquetterie de jeune homme qu’à une servitude de l’âge. Je ne peux pas vous garder pour moi, Monsieur.
Bien sûr, il y a votre oeuvre, reprise dans les manuels de littérature, savez-vous que nous voisinons sur la même page de « Langue et littérature française pour les 3e » chez Hachette ? Vous étiez au moins aussi élégant, aussi plein d’humour et de lucidité que vos pièces. Dans un monde d’ego hypertrophiés, une réelle modestie, une réserve prudente et pudique vous ont aidé à rester un inconnu célèbre.
Puisque vous avez commis l’imprudence (et la terrible trahison amicale, je vous en voudrai toujours) de mourir, permettez-moi de vous dresser un modeste tombeau dans l’acception du Grand Siècle français, cette époque que vous aimiez tant : un monument de mots pour vous honorer.
Mon souvenir de vous n’est pas objectif, je n’y ai vu que du bon. Je dirai ce bien que je vous ai vu faire, ce vrai que je vous ai entendu dire, ce sourire lucide qui ne vous quittait pas, votre absolu besoin de porter secours à tout être en détresse. La raison pour laquelle je veux vous remercier ici est la même qui justifie l’admiration d’Albert Cohen pour Churchill d’Angleterre, lettre d’amicale et fraternelle affection, au mot près la raison pour laquelle vous êtes reconnaissant à Molière d’avoir été un homme. Cohen a-t-il rencontré Churchill ? Moi, je vous ai rencontré, le roi n’est donc pas mon cousin. Merci, Monsieur.
La rencontre improbable
Un jour de juin, sur les hauteurs verdoyantes de Lausanne, je faisais la connaissance de Jean Anouilh, rencontre parfaite comme une scène bien écrite. L’anecdote qui la précède, je crois l’avoir aussi racontée, par bribes et à doses homéopathiques à Jean Anouilh.
La scène se situe à Paris rue Jean-Goujon. En 1984. J’écrivais des pièces de théâtre et je travaillais comme critique dramatique dans un magazine tout neuf tout beau. Nous avions tout : le grand hall carrelé de marbre où l’on dressait l’arbre de Noël du personnel, l’escalier d’apparat somptueux, épousant des murs très hauts et laissant un grand puits de lumière.
Je venais de connaître mon premier succès d’auteur au théâtre (je m’en suis, à quelques rares exceptions, abstenue depuis), grâce surtout à deux de mes interprètes, stars dont les amateurs du XXe siècle doivent avoir conservé le souvenir. Je viens de retrouver le nom de ma protagoniste, Blanchette Brunoy, dans la distribution du Voyageur sans bagage, film réalisé par Jean Anouilh avant la guerre. Mais cela, je l’ignorais en 1984. À cette époque je ne vivais que pour écrire du théâtre. Anouilh était un grand auteur, le dernier géant d’une race disparue car il savait bâtir une pièce, en faire la mise en scène en trouvant la bonne distribution et même gagner de l’argent puisque le public le suivait presque toujours. La critique chic boudait, j’ai même lu sous une plume fielleuse « Anouilh, cet auteur qui ne fait rire que le public », mais cela attirait les spectateurs et n’empêchait nullement la « boutique » de tourner. Anouilh représentait un modèle pour l’auteur débutant que j’étais. En attendant, j’allais sagement, tous les soirs, et le dimanche en matinée (parfois deux fois) au théâtre pour livrer au journal mes chroniques dramatiques. J’avais remarqué que l’un ou l’autre de mes collègues de la culturelle avait fait la « une » du journal, ce titre en première page qui annonce fièrement les sujets que l’on souligne pour appâter le lecteur. Je n’avais jamais eu de une. Je suis donc allée chez D. , mon rédacteur en chef, pour lui demander justice. Je n’osais pas avouer que je voulais la « une » surtout pour que ma famille restée en Suisse constatât à quel point, au bout de deux exils, le vilain petit canard s’en sortait. Je contournai la difficulté en demandant à D. si la « une » était mieux payée que le reste des articles. Comme je l’espérais, il me répondit affirmativement ; je couvris mon orgueil de ce bouclier de fortune et prétendis que je manquais d’argent. Les gens aiment entendre que vous n’avez pas d’argent. D. me regarda avec condescendance (il acceptait déjà tous mes sujets les plus farfelus, ce qui nous a permis d’ailleurs de ne pas rater quelques carrières naissantes de gloires aujourd’hui confirmées) et m’expliqua patiemment comment se méritait une « une ». Le sujet devait être de grand intérêt, à la fois moderne, important, visible et fleurer bon son originalité.
Il conclut que dans le théâtre, ma foi, surtout au moins de juin, de tels sujets en or, il n’y en avait pas. À moins de scoop…
— C’est quoi un scoop au théâtre ?
Du ton dont on dit les énormités, D. me donna un exemple :
— Un scoop serait « Anouilh s’exprimant sur le Festival d’Avignon ».
Qu’à cela ne tienne, folle jeunesse ! Je posai la question dans la rédaction : « Qui a le numéro de téléphone d’Anouilh ? »
— Ben… Anouilh, il ne vit plus en France, il est en Suisse.
Sur le ton dont on dirait le Pôle Nord.
— Où en Suisse ?
— À Lausanne. Mais cela ne sert à rien, il ne donne jamais d’interview, il déteste les journalistes. Nous avons essayé plusieurs fois de le rencontrer, il a toujours refusé.
Anouilh était réputé misanthrope.
Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre… J’appelai. Ce fut lui qui répondit. Voix grave, décidée, j’avais intérêt à me dépêcher si je voulais l’entendre encore. Ses monosyllabes me faisaient très bien sentir qu’il était interlocuteur à vous condamner d’un « Non-merci-au-revoir » sans vous laisser le temps d’en placer une.
Une lettre adressée à Pierre Fresnay (BNF) dans les années trente m’est apparue comme la métaphore anticipée de ma propre rencontre.
Mon cher ami
Nous avons eu P. P. et moi le dialogue suivant :
— Madame Paulette Pax ?
— Oui.
— C’est Jean Anouilh, madame.
— Oui.
— Je serai heureux de pouvoir vous voir.
— (encombré) Voulez-vous lundi 7h ?
— Si vous voulez. J’ai besoin de vous voir assez rapidement à cause de Fresnay.
— Hé bien lundi 7h si cela vous est possible. Entendu au revoir etc.
Tout lui est théâtre. Il rédige la conversation comme une scène.
Nous avons eu J. A. et moi le dialogue suivant :
— Monsieur Jean Anouilh ?
— Oui.
— C’est Anca Visdei, Monsieur. — (encombré) Vous pouvez répéter ?
—Vis dei : force de dieu. En latin.
—Mhmhm.
—Je suis journaliste.
— Mhmhm.
—Je serai heureuse de pouvoir vous rencontrer. Mon journal serait honoré…
— (coupant ma phrase)… Je ne reçois pas les journalistes. On ne dit jamais que des sottises. J’ai tout dit dans mes pièces.
— Je sais Monsieur, je les ai lues.
— Bon alors…
—C’est que, Monsieur… je suis… (cherchant quelque chose à dire, vite, sinon il raccroche !) je ne suis pas (être ou ne pas être, là est la question) une journaliste (ouf, visitée enfin par le démon de l’improvisation) comme les autres.
— … Hmm ?
— Moi, je vous admire depuis… la Roumanie.
J’avais perdu toute dignité ! Moi, la réfugiée politique qui n’évoquait jamais ses origines, j’en étais arrivée à me cacher derrière la Roumanie. Pour faire exotique ? pour faire pitié ? j’étais tombée bien bas.
— Je ne voyage plus, pour me rencontrer vous devriez venir en Suisse.
— Mais bien sûr, Monsieur, mes parents y habitent, j’y vais tout le temps.
— Ils habitent dans quelle ville, vos parents ?
— À Lausanne, Monsieur.
— Quand vous viendrez les voir, vous me passez un coup de fil et nous conviendrons d’un rendez-vous.
— Oui, Monsieur, convenons de la date !
— Mais… (encombrement, il pense : « C’est une dingue, une emmerdeuse, une kidnappeuse » ; la fille de Frédéric Dard et le cercueil de Charlie Chaplin avaient été enlevés à l’époque dans la région.) Quand venez-vous voir vos parents ?
— Tout de suite, Monsieur (je regarde ma montre). Ce soir, il y a encore un train.
— … Hé hé hmm (rire sous cape). C’est un peu précipité. Voulez-vous le… 9 ? Le 9 juin, vous pouvez venir pour le thé.
La conversation avait duré trois minutes tout au plus ; elle me laissait épuisée. Il fallait foncer acheter les billets, préparer des articles en avance pour la durée de l’absence, mériter cet entretien. À cet instant précis, la peur de ne pas le décrocher m’avait quittée pour laisser la place à l’angoisse de ne pas être à la hauteur.
⁂
Extérieur jour. Le 9 juin 1984. Décor : le Lavaux, cette rive du lac Léman, célébrée par Ramuz et Cingria, ces vignes du Seigneur chantées par Gilles et Urfer, ce pays paradisiaque où l’on appelle le soleil Jean Rosset et où l’on fête l’arrivée du printemps par les étincelles du carnaval des Brandons. Une côte ensoleillée du canton de Vaud que choisissent comme dernier port tant de voyageurs venus d’ailleurs : Nabokov, Chaplin, Audrey Hepburn, Frédéric Dard, Madame de Staël. Un endroit où, plus tard, dans le cimetière de Pully, le seul cimetière, à ma connaissance, à posséder un petit bassin avec des poissons rouges, Anouilh reposera en compagnie de C. F. Ramuz.
Dès notre première rencontre, Anouilh m’avoua que si je m’étais simplement présentée comme auteur de théâtre, il m’aurait lue tout de suite et, très probablement, vu la qualité, etc., reçue ensuite. En riant, il confessa que l’argument que j’avais choisi pour le convaincre de me recevoir, était le pire de tous. Dans son lever de rideau Épisode de la vie d’un auteur, il avait placé, croquée d’après nature probablement, une journaliste roumaine, Madame Bessarabo, qui bombarde inlassablement l’auteur, pris dans le broyeur de scènes de ménage, d’un redressement fiscal et de sollicitations de parasites divers, de cette antienne existentielle : « — Maître, maître, je ne peux plus attendre. L’intelligentsia roumaine est anxieuse de savoir ce que vous pensez de l’amour… ».
C’était peut-être la raison pour laquelle, en me voyant pénétrer dans son jardin, à la place de Madame Bessarabo, Anouilh m’a dit avec un soupir de soulagement :
— C’était bien vous.
Ce souvenir est devenu mon « fond d’écran » intérieur. Quand il fait trop gris et froid dans ma vie, je ressors aussitôt cette image : je monte le chemin vers Jean Anouilh, un soleil de jeune été nous éclaire, le ciel est transparent, le décor si neuf qu’il semble la toile peinte d’une scène de théâtre. Anouilh m’accueille et sourit. « C’était bien vous ». C’est bien moi.
Un taxi m’avait déposée devant la grille blanche qui était ouverte, je montais le jardin en pente. Les nappes de gazon étaient dressées sur les vagues douces d’une colline dominée par une grande maison blanche, compacte, solide, sur le modèle des fermes cossues du canton de Vaud. De grands chiens viennent à ma rencontre. Debout, devant la maison, surveillant peut-être qu’ils ne me mettent pas en pièces : Jean Anouilh. J’eus un grand sourire, pour répondre au sien. Le soleil brillait, il s’était coiffé d’un panama clair. Je portais une robe marin blanche, à parements bleu marine, trouvée chez Laura Ashley. J’arborais les couleurs de la marine à dessein. Comme un premier salut à mon auteur. Une convention 1900 à laquelle je le savais attaché. Une réminiscence des enfants de ses pièces, les Toto et Marie-Christine qu’il costumait en jeunes mousses. Plus tard, il allait me confesser dans l’une de ses lettres, avec cette merveilleuse tendresse bourrue qui était toute de pudeur et d’empathie :
Pour l’interview vous avez été honnête, j’ai dit tout ça, mais vous m’avez fait plus méchant et plus aigri que je ne suis. Mais c’est la loi du genre… je ne me laisserai plus prendre au piège d’un sourire, de regards noyés (vous vous êtes vendue dans votre pièce), d’une robe blanche à col marin, qui, moi, ne m’a rappelé que mes dix ans. J’avais une petite amie habillée comme ça.
Courage, vous avez des dons et on rejoueraLes jaloux, j’en suis sûr.
Je vous embrasse.
Cachet de la poste de Lausanne 16/06/1984
Les jaloux était ma première pièce jouée à Paris au Théâtre de Plaisance. Un beau spectacle qui s’arrêta net en raison de la disparition de l’un de nos comédiens vedettes. À la fin de ma visite, Anouilh m’avait demandé de lui envoyer le texte, ce que j’ai fait aussitôt arrivée à Paris. Quelques jours après, sa réponse me parvenait.
Voilà, j’ai lu les oeuvres complètes. J’ai ici pendant une courte absence de ma femme, mon ami Pietri qui est venu « me garder » et qui collabore avec moi depuis quarante ans et qui a le meilleur jugement de théâtre que je connaisse…
Le petit divertissement Louis XV l’a beaucoup amusé, comme moi — je vais essayer le Tamin — Les jaloux m’ont épaté et lui aussi. Vous avez des dons merveilleux de dialogue et d’humour… et de méchanceté ? Là il y a quelque chose à faire, même si cela a été joué dans « l’indifférence » comme vous dites. Écrivez où, quand, par qui, et quels articles il y a eu. On peut peut-être la replacer — Je pense à Mauclair[1] qui la jouerait merveilleusement dans son petit théâtre pour rire. J’ai d’ailleurs tout le temps pensé à la [sic] lisant aux Chaises et surtout à la Leçon. On peut avoir de plus mauvaises références.
La vive voix et l’épistolaire
J’ai gardé la cassette recevant les messages de mon répondeur de l’époque. Il y a un message d’Anouilh. Que je n’effacerai jamais. « C’était rien. C’était Anouilh qui venait prendre de vos nouvelles. »
Anouilh était un conteur doué, joyeux. Sa conversation était pleine de charme et d’humour. Quand il racontait une anecdote drôle, il riait juste là où il fallait, pas au début de l’histoire ! cela aurait grillé l’effet, ni à la fin, là il s’offrait le plaisir d’entendre rire les autres, non : il riait au milieu, très exactement là où, dans une pièce classique on plaçait la grande scène du deux, là où il y a un creux à remplir, un pont pour ne pas se mouiller les pieds dans l’ennui. Un rire discret mais présent, comme le velours d’un rideau de théâtre qui glisse sans bruit, un rire de feutrine insolente.
Il racontait les blagues avec le même art qui lui servait à construire ses pièces : une charpente solide, stable, recouverte d’un tissu à fleurs, il passait la main par-dessus pour chasser les plis. Son père avait été coupeur-tailleur, il avait hérité du geste sûr, du respect de l’étoffe. Une anecdote n’est que du tissu au mètre, c’est le savoir-faire du coupeur qui en fera un rideau, une jupe à volants, un couvre-lit.
Prudent, goguenard, Anouilh se renseignait auprès de votre auditoire :
— Ah, mais vous avez dû l’entendre cent fois, cette histoire !
On riait :
— Chaque fois elle nous fait rire.
Une histoire racontée par lui acquérait à chaque fois une saveur nouvelle.
Anouilh ne pouvait raconter, fût-ce une petite anecdote de théâtre, sans qu’elle soit pourvue d’un prologue, d’un point culminant, ou plusieurs, d’une chute. Sa langue parlée était belle, précise, émaillée ici et là d’un mot familier, faisant contrepoint avec un mot rare (jamais précieux !), histoire de donner du tonus et du piment à la phrase.
Il lisait merveilleusement ses pièces. À ses débuts, il ne donnait pas le manuscrit au directeur du théâtre, il lui faisait la lecture à haute voix, jouant tous les personnages.
Anouilh était un Monsieur d’apparence classique qui avait la maîtrise de ses émotions et savait exactement ce qu’il voulait livrer (« un vrai homme avec un vrai riflard de luxe, pas de temps à perdre », écrivait Marcel Aymé), tout en restant, comme tout vrai homme, un petit garçon prêt à enfourcher le premier fou rire. Il ne se permettait jamais un mot vulgaire ou déplacé. Tout en avertissant d’emblée qu’il aimait les plaisanteries de garçon de bain.
En écoutant le Siegfried de Giraudoux, Anouilh avait eu la révélation de ce style, à la fois poétique et quotidien, dont il avait toujours rêvé. À la fin de sa vie, il confessait ne plus savoir pour quel public il écrivait. Aujourd’hui, contemplant la vie du théâtre, à part quelques heureuses exceptions, c’est la description par Chateaubriand de Talleyrand arrivant avec Fouché, dans Les mémoires d’outre-tombe, qui me vient à l’esprit : « Le Vice s’appuyant sur le bras du Crime ». Plus exactement l’Imposture s’appuyant sur le bras de la Calomnie. L’art perd chaque jour un peu plus de son caractère sacré dans un marigot où le produit commercial voisine avec la prétentieuse pose artistique nombriliste, aussi loin de son vrai propos que l’est une perspective Potemkine[2] d’une avenue bordée de bâtiments réels.
Notre correspondance s’est poursuivie pendant des années, émaillées par des visites en Suisse. Jusqu’à sa mort.
L’année passée [2008], une fois par semaine, j’avais rendez-vous avec lui, rue de Richelieu, dans cette vaste salle de lecture du Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque Nationale qui lui aurait plu : bibliothèque à l’anglaise, avec cour de lumière intérieure, passerelles, belles lampes aux globes en opaline qui s’allument au crépuscule et tomes anciens reliés de vieux cuir bordeaux. Bordeaux… Lire la correspondance de Jean Anouilh (presque toujours manuscrite) revient pour qui l’a connu à l’entendre parler. La magie opère. Il ouvre des parenthèses sans les fermer, d’ailleurs la plupart du temps, il oublie le point final des phrases. Souvent, il trace le début du mot, sa seconde moitié se perdant dans une arabesque incertaine. Il en va de ses idées comme des conversations téléphoniques avec des gens que l’on connaît bien, le début est affirmé, martelé parfois et on ne peut que deviner la suite.
Aujourd’hui j’ai déposé au Département des Arts du Spectacle les lettres que j’ai reçues, amicales, enlevées et si drôles. J’en ai même conservé les enveloppes. Sur les timbres suisses, on voit le cachet de la poste. Et la date. Car il ne datait presque jamais ses lettres. Pour les rendre éternelles ? En quatre ans, ses lettres m’ont suivie de déménagement en déménagement où j’ai tant perdu, des bijoux, des amis, des illusions, des déclarations d’impôt. Jamais ses lettres.
Je m’en sépare aujourd’hui. Avec joie. Je ne peux pas les garder pour moi. Par la fenêtre du bureau où l’échange a lieu, je vois le square Louvois avec ses quatre belles cariatides soutenant la vasque de la fontaine. Le conservateur en chef a beaucoup d’humour, mais je n’ose pas lui dire qu’Anouilh vient de me faire signe. Le square Louvois rappelle aussitôt à ma mémoire les vers dont Tristan Bernard a fait don à Anouilh :
Comme disait Colbert à Monsieur de Louvois
Que n’ai-je baisé plus, quand baiser je pouvois.
Jean Anouilh lisait sans délai les textes que je lui adressais, donnait son avis avec franchise, sans détour, ajoutant toujours comme une espièglerie qu’il pouvait se tromper. Il n’aimait pas tout et ses avis étaient tranchés.
Nous arrivons à Dona Juana. Je n’aime pas et dans sa forme, je suis sûr qu’elle ne sera pas jouée. Il y en a trop : c’est trop long et complaisant. C’est un fatras, avec un peu de psychanalyse (?) en plus ce qui est une faute rarement pardonnable… Et puis, pourquoi Dona Juana, grosse couseuse de gros fils blancs ? Appelez la Elvira ou n’importe quel nom sans références si vous tenez à l’Espagne et laissez le symbolisme enfantin des Perceval, Siegfried et compagnie… Les symboles décidemment vous poursuivent… Je la relirai dans quelque temps pour des conseils plus précis, mais croyez en ma vieille sagesse, ne la faites pas monter, même si on vous le propose dans son état actuel… Vous gâchez de merveilleux dons, et un éreintement d’une première pièce est dur à remonter.
Cachet de la poste de Lausanne 16/06/1984
Une autre volée de bois vert m’attendait, lors de la sortie de mon roman, L’éternelle amoureuse. Mais comme toujours chez lui, dans le fagot il y a aussi des fleurs. Comme si, constamment, un dialogue intérieur faisait alterner en lui l’avocat et le procureur, autour de textes qu’il analysait toujours avec passion.
Ma chère Anka
Le best-seller se porte gras, en ce moment. Je suis lapidé. Que dire du vôtre ? Le seul dont je vous parlerai = […] agacement (je pense que vous vous en doutiez de la part d’un vieil ermite râleur et à demi infirme) et émerveillement devant certaines scènes… je vous en ferai la liste et là, votre talent m’a sidéré.
Mais que de foutre, pour écrire comme vous et ce n’est pas parce qu’on met bite et couilles toutes les trois lignes qu’on a de la force ? C’est un défaut de collégienne… et avec votre talent ce n’était vraiment pas la peine… Si vous aviez fait votre service militaire dans une chambrée en France, cela vous épaterait moins… Mais inondation de foutre mise à part, qui est monotone (peut-être parce que je suis un homme) mais il y aura sûrement des dames Genevoises ou Lausannoises à la ménopause douloureuse qui vont se précipiter dessus — si elles osent l’acheter…
La mort du père, la clinique et le Suisse économe, la bibliothèque, l’accident de la rue, et le mouton devenu tigre, l’hôtel de Beaulieu ce Noël fantomatique Venise aussi et toute l’histoire du sculpteur sont des scènes extraordinaires… Vive le théâtre qui vous aurait obligée à faire court !
Je vous supplie d’écrire un livre de 250 pages condensées sans complaisance nombrilesque (c’est finalement la cavité la plus profonde du corps humain plus que le vagin et le rectum pour les fantaisistes…).
Et puis votre livre est de ceux que les belles Dames du XVIIIe appelaient drôlement un livre « à lire de la main gauche ». Et pour cet usage, il est beaucoup trop lourd…
Je vous embrasse et vous avez beaucoup de talent. Je suis épaté.
Bien amicalement,
Cachet de la poste suisse (Pully) du 18/12/1984
Il n’avait pas tort, des années après j’ai donné une nouvelle version, restreinte, du roman et elle est infiniment meilleure. Le théâtre était son monde, sauf quand, me disait-il, « n’ayant plus la force de porter des personnages », il écrivit ses souvenirs. Des mois après la lettre précédente, il me réécrivait, pour me recentrer sur le genre dramatique :
Faites-moi une pièce avec des bonnes scènes de votre livre
La mort du père — La librairie — la fureur du faible — Venise et le sculpteur.
Là vous aurez les pieds sur terre. Sur votre terre.
Lettre postée à Pully le 03/03/1986
Son amitié était de grande qualité. Quand il aimait un texte, il me l’écrivait. Mais auparavant il l’avait déjà envoyé à quelques directeurs de théâtre, avec une lettre de recommandation chaleureuse. Il actionnait spontanément son réseau, il remuait ciel et terre pour aider, revenait à la charge, n’abandonnait jamais. Des années après sa mort, j’ai croisé Guy Descaux qui m’a raconté qu’Anouilh lui laissait souvent des messages sur son répondeur au Théâtre des Champs-Élysées : « Pourquoi vous ne jouez pas les pièces d’Anca… ? ». Anouilh ne me l’avait jamais dit.
C’était un ami doublé d’un vrai artisan du théâtre pour lequel apprécier une pièce allait de pair avec sa présentation dans le bon écrin et par les meilleures interprètes (?).
Votre visite m’a fait plaisir, chère Anca parce que vous êtes charmante et que vous ne m’avez pas posé une seule question sotte sur le théâtre. Vous avez l’air de très bien savoir ce que c’est. C’est peut-être parce que c’est ce que je pense moi-même que cela m’a paru si bien… Vous pouvez être une excellente journaliste de théâtre.
Je vais essayer de parler de vous à quelqu’un du métier qui pourra peut-être vous être utile… un gros « peut-être » car les gens ne sont pas des terre-neuve et ce n’est qu’une « connaissance » au Figaro.
Quant à la pièce je l’ai lue et relue ravi par deux choses : vous avez un excellent dialogue vif et drôle et de plus, ce qui est rare, vous avez un style. Le sujet est sans doute un peu académique. Un peu un sujet de devoir pour Éditions Bordas, « Imaginez Don Juan vieilli que le ciel punit en lui envoyant une petite coquette, qui n’est peut-être que le diable et qui va le désespérer à son tour. » « Tracez un portrait aussi peu conventionnel que possible de Leporello. Comparez ce rôle au rôle de Sganarelle dans la pièce de Molière » etc., etc.
Je ne me moque pas de vous… et c’est tout de même d’une qualité rare.
Je suis à peu près sûr que vous êtes un auteur dramatique — il n’y en a pas beaucoup en jupons. Écrivez une pièce moderne de préférence avec ces qualités-là et « faisant le spectacle ». C’est très important : pas si courte que ce Don Juan…
Je vais voir, sans trop d’espoir, si quelqu’un s’y intéresserait et envisagerait de le monter dans un lieu où l’on joue des pièces en un acte… Connaissez-vous Tamin[3], il avait monté un Crébillon fils dans ce ton à l’Odéon et il est un de ceux à qui j’ai fait un papier qui a renversé la situation à ses débuts avec « Arlequin serviteur de deux maîtres ».
Il m’a toujours dit qu’il ne l’oublierait jamais… qui sait ?
Tâchez d’avoir son adresse je vais essayer de mon côté et je lui enverrai la pièce. En attendant « bravo », et c’est sincère.
Je vous embrasse Jean Anouilh
Non daté [Été 1984]
J’ai rarement rencontré une personne qui fasse autant attention aux autres. Du désir de m’aider à trouver une place dans un journal, à l’attention émouvante qu’il portait aux enfants, le mien par exemple, au fait qu’il ne pouvait pas ne pas offrir son aide dès que vous aviez un souci. Hospitalisée, j’avais reçu à l’Hôpital Saint-Antoine, le plus beau bouquet de ma vie : il était plus grand que moi. Et il donnait envie de guérir. La délicatesse de son attention était celle des pères qui vous entourent de leur protection attentive, sans vous peser, qui vous surveillent de loin, discrètement, sans en tirer la moindre gloire.
Sa critique était précise, rigoureuse.
Chère Anca,
Je ne lis jamais sans angoisse la pièce de quelqu’un que j’aime bien surtout lorsqu’elle commence brillamment comme la vôtre. Et page, par page (il manque la page 73) je me dis comme la mère de Napoléon « Pourvu que ça doure ! » Et bien ça doure presque jusqu’à la fin. Ça se gâte avec le Klimski. Il faudrait trouver un gag — une pirouette pour en finir avec cet homme sans ce dénouement tristement Hollywoodien. La scène de l’huissier est bonne et le coup du Président, mais pas le coup de foudre et le happy end à la guimauve. Il faudrait savoir pourquoi il est venu pourquoi il reste et comment ça se termine sur un gag (le coup du bébé qui a fait pipi sur le pantalon du Monsieur est bien vieux). Ce bébé il n’a pas douze ans c’est une poupée de chiffon faite avec polochon aussi fausse que possible. Comme dans les Poissons rouges tous ses cris sont faits des coulisses par une fille. Les deux téléphonistes doivent être dans les avant-scènes — ou du moins sur les côtés de la scène — éclairés puis éteints.
Je vous le répète tout est très bon jusqu’au Klimski. Il y a sûrement quelque chose à trouver de plus drôle et de moins conventionnel que coup de foudre réciproque… Mais quoi ?
En tout cas vous avez un vrai talent cocasse, un merveilleux dialogue cocasse et vous m’avez ravi presque jusqu’à la fin.
Je vous embrasse
⁂
Double vue, intuition, connaissance des hommes ? il sentait les choses à naître.
Un exemple révélateur. Dans une lettre conservée au Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque Nationale, Anouilh supplie Barrault, sur l’honneur, de ne pas présenter à la censure de Malraux l’une de ses pièces :
Je ne te donne pas de manuscrit.
Je ne m’engage à rien et d’ailleurs je ne bouge pas jusqu’au 18 juin. Symbole !
Ton ministre, ta subvention, ton gouvernement autorisant ou n’autorisant pas, ta pièce de Brecht m’emmerdent.
Mouvement d’humeur ? Prémonition.
Au sujet de Malraux qui l’emmer…, une fois de plus, Anouilh anticipait : ce ministre, au demeurant un très grand homme, s’est débarrassé comme on congédie un laquais justement de Barrault qui voulait faire passer Anouilh par ses ministérielles fourches caudines. Au premier geste perso’ qui lui avait été dicté davantage par son tempérament d’histrion (sens littéral) que par une réelle conviction politique, le courtisan zélé s’est fait mettre à la porte de l’Odéon.
L’auteur de Becket, vieux renard, vieux crabe, il se définissait toujours auprès de ses proches comme un vieil animal, peut-être pour cacher qu’il était resté, toute sa vie, un petit garçon, Anouilh avait vu venir. Passionnément attaché à son indépendance, Anouilh n’a jamais couru les honneurs, n’oubliant jamais que le Capitole est proche de la roche Tarpéienne. Aimant les anachronismes, il en jouait comme souvent les passionnés d’histoire. Certains ne le lui ont pas pardonné, couronnant la générale de Pauvre Bitos par une bataille émaillée de cris vengeurs.
Jean Anouilh était fier de sa célèbre lettre qui commençait par « Et puis d’abord, je vous emmerde ». C’était le maximum qu’il s’était accordé parce qu’il avait gros sur le coeur. Par réserve naturelle, par pudeur, il se refusait aux insultes faciles.
Dès qu’Anouilh employait un mot un peu leste, une tournure trop familière, il l’assortissait in fine d’une soupape : comme dirait Anca. Il m’écrivait :
[C]’est devenu ma plaisanterie favorite quand je me risque (c’est mon péché mignon)… à des plaisanteries graveleuses — c’est tout ce qui me reste — j’ajoute toujours « comme disait Anca » et nous rions quand même.
Cachet de la poste suisse du 13/05/1985
Le jour où Jean Anouilh s’en est allé
Le jour où j’ai appris son départ, je n’ai trouvé qu’un moyen de me consoler : regarder le ciel. Ce jour-là, à Paris le ciel était bleu clair comme ses yeux.
Je me suis dit : tant que je suis encore dans ce monde temporel, pour toutes les années qui me séparent encore de ma mort, je regarderai le ciel à dessein, quelques secondes de plus, je regarderai le ciel pour Jean Anouilh. Je ne sais pas trop bien ce que nous réserve l’au-delà, peut-être juste une nuit sans rêves, mais si par mes yeux il était possible qu’il voie encore une fois notre monde, je veux bien lui servir d’antenne.
Quand mon fils était très jeune et que des circonstances que j’ai oubliées ont fait qu’il a été informé de notre fin terrestre, pour le consoler, je me suis empressée de lui promettre : « Quand je serai partie, si c’est possible, je te ferai signe, s’il y a un moyen je le trouverai ». Anouilh disait souvent : « Si après ma mort, vous dites des choses qui ne me plaisent pas sur moi, je viendrai vous chatouiller les pieds. » Une promesse ? une menace ?
Le lendemain de la mort de Jean Anouilh, je publiais « Il a fait semblant de mourir » dans le Quotidien de Paris. J’ai écrit bien des articles, mais celui-là fut le plus difficile de toute ma carrière. Je l’ai dicté car c’était urgent. Nous étions le dimanche 4 octobre, il fallait qu’un texte sur Anouilh paraisse dans le numéro du lendemain.
Puis je suis sortie. C’était dimanche, j’avais mon fiston, tout rond, tout joli dans la fraîcheur de ses deux ans pour me consoler un peu. Je l’ai amené au manège de la Place de la Nation faire des tours. Un manège. Le monde, la vie. Ses joyeux rires ponctuaient la ronde. J’étais sur le quai, Lavicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique à la main. Je n’arrivais pas à pleurer. Anouilh me faisait trop rire. Et quand je tentais de refermer le livre, je retombais sur la dédicace de la page de titre : « Pour David qui lira les aventures de ce jeune homme quand il l’aura rattrapé… avec ma profonde amitié pour sa maman. Jean Anouilh Mai 87 ».
Comme les dictons populaires, Anouilh dit parfois une chose et son contraire. C’est sa manière d’être dialectique : les deux sont vraies.
« Mais enfin, le bonheur est une éthique de midinette ! » s’écrie Bernard dans Le nombril. « Je hais le bonheur ! Quelle pâtée de chien ! » déclare Électre dans Tu étais si gentil quand tu étais petit ! « La vie ce n’est peut-être tout de même que le bonheur ! » leur répond Créon dans Antigone.
Les gens, comme les peuples heureux, n’ayant pas d’histoire, ce que raconte le théâtre d’Anouilh est le malheur, les rencontres ratées, l’incommunicabilité qui fait le lit sépulcral de la solitude.
La jeune fille sourde d’Humulusle muet n’entend pas la déclaration d’amour, les lettres d’adieu n’arrivent pas à leur destinataire. Ni celle d’Antigone adressée à Hémon et confiée au garde, ni celle d’Eurydice, qui échoue, suite à la mort de l’héroïne, dans un commissariat.
De la même manière, certaines pièces d’Anouilh n’ont pas atteint leur public. Déprimé, il écrivait à Pitoëff : « [I]l me semblait qu’ils ne voulaient pas de cette histoire ».
Anouilh adresse des lettres d’amour à ses spectateurs. S’ils rient, s’ils sont touchés, Anouilh se sent aimé. Besoin vital d’un artiste. Il paraît que les premiers mots que Mozart adressait à tous ceux qu’il rencontrait étaient : « M’aimez-vous ? »
Le bonheur, ce n’est peut-être tout de même que d’entendre répondre : « Oui ».
Appendices
Note biographique
Anca Visdei
Née en Roumanie, réfugiée politique en Suisse, après des études de droit et de criminologie à Lausanne, Anca Visdei s’établit à Paris. Elle mène longtemps une carrière de journaliste (La Gazette de Lausanne, L’avant-scène théâtre, Les Nouvelles littéraires), axée sur la critique dramatique et les grands entretiens (García Márquez, Kundera, Cioran, Anouilh, Ionesco, Dürrenmatt) parallèlement à celle d’écrivain : un roman, trois recueils de nouvelles (Les petits contes cruels, Paris, Club Zéro, 2000), et une trentaine de pièces de théâtre diffusées par France Culture, éditées aux Éditions l’Avant-Scène, Quatre-Vents, Art et Comédie (Paris), La Traverse (Nice), Crater (Marseille), Lansman (Carnières / Morlanwelz) et aux Éditions La Femme Pressée (Montreuil-sous-Bois), et jouées à Paris, New York, Munich, Istanbul, etc. Actuellement, Anca Visdei se consacre entièrement à l’écriture et à la mise en scène, notamment à travers sa compagnie « La Femme pressée ». Deux de ses pièces (Toujours ensemble et Puck en Roumanie) ont été à l’affiche de la rentrée parisienne 2009. Ses deux derniers livres sont : Mademoiselle Chanel (Paris, Éditions L’oeil du Prince, 2005) et Madame Shakespeare (Montreuil-sous-bois, Éditions La Femme Pressée, 2006). Site Internet : www.ancavisdei.com.
Notes
-
[1]
Jacques Mauclair (1919-2001), comédien et auteur dramatique, a fait partie de la troupe de Jouvet, dirigé le Théâtre de l’Alliance française et créé le Théâtre du Marais où il a monté du Ionesco.
-
[2]
La perspective Potemkine était un système d’échafaudages et de toiles peintes dont le ministre Potemkine habillait les masures misérables de Russie sur le trajet des visites de l’Impératrice Catherine II. De la sorte, au lieu de voir la réalité, celle-ci voyait une Russie rutilante. On utilise aussi l’expression villages Potemkine.
-
[3]
Jean-Louis Thamin.