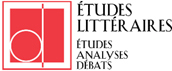Abstracts
Résumé
Travaillant au renouveau de l’idée de poésie après la Seconde Guerre mondiale, Louis Aragon propose dans les Chroniques du bel canto, en 1946, de lire la poésie « comme le journal ». Envisagé surtout comme mode communicationnel et support engageant une lecture différente du livre, le « journal » sert au poète-chroniqueur de modèle pour repenser la communication poétique et conduire ses contemporains à une nouvelle sensibilité littéraire. C’est aussi une notion stratégique par laquelle Aragon prend position dans les débats de son temps et reconfigure l’histoire de la poésie de façon inédite, à partir d’une idée de la réception en poésie.
Abstract
In the wake of World War II, poet and chronicler Louis Aragon sought to reinvent the concept of poetry. In his 1946 Chroniques du bel canto, he suggested that poems should be read “just as you would the newspaper”. He viewed the daily paper as a communications medium requiring a different reading approach from books, one that could redefine poetic communication and instil in its readers a new literary sensibility. This strategic notion also helped Aragon position himself in the debates of his times, all the while resulting in an innovative take on the history of poetry, based on its awareness.
Article body
La question des rapports entre poésie et journalisme est devenue un lieu commun depuis le milieu du XIXe siècle, soit que les poètes vitupèrent contre la « littérature industrielle » des journaux ou fassent de l’écriture journalistique le contre-exemple absolu de ce que devrait être le langage de la « poésie pure » (de Baudelaire à Valéry), soit qu’ils revendiquent au contraire l’apport du journal dans l’écriture poétique moderne, par le biais des innovations typographiques, de la publicité ou encore de l’imaginaire du quotidien (par exemple chez Apollinaire, Cendrars ou Desnos). Alors que la question du rapport entre poésie et journal s’est jusque-là surtout posée en termes de création poétique, Aragon, dans ses importantes Chroniques du bel canto, adopte une tout autre perspective. En effet, dans ces chroniques publiées dans la revue Europe tout au long de l’année 1946, où Aragon s’attache, au gré des parutions poétiques, à redéfinir la nature et les valeurs de la poésie, le « journal » apparaît non plus seulement comme le parangon d’un type de langage et d’écriture, mais comme celui d’un mode de lecture. En fait, c’est une véritable pensée des media qui s’élabore dans ces textes et, par bien des aspects, celle-ci prolonge, quoique en adoptant un point de vue presque radicalement opposé, la réflexion de Mallarmé sur le livre et le journal, dont ce dernier tirait des conséquences tant poétiques que philosophiques. La référence au « journal » cristallise également bon nombre d’éléments permettant de mieux cerner la position complexe qu’adopte Aragon dans les débats de l’après-guerre sur la poésie ainsi que les stratégies argumentatives auxquelles il recourt pour construire sa place dans l’histoire littéraire. La question qui se pose est de savoir si la référence au « journal », à première vue essentiellement convoqué en tant que support éditorial impliquant un mode de communication différent de celui du livre ou de la plaquette de poèmes, et drainant avec lui un ensemble de représentations littéraires et sociales, vaut également comme référence esthétique et modèle de création. Aragon défend-il une poésie de journal, ou use-t-il seulement de ce terme pour fonder stratégiquement le renouveau poétique de l’après-guerre ? L’examen des principales occurrences du terme « journal » dans les Chroniques du bel canto nous permettra dans un premier temps de cerner les différents principes que propose Aragon pour son art de la lecture poétique, destiné à forger une nouvelle sensibilité poétique chez ses lecteurs. Les ambiguïtés de la référence au « journal » nous conduiront ensuite à analyser celle-ci, conjointement à deux autres notions clefs, celle de « chant » et celle de « réalité », comme argument stratégique pour légitimer non seulement une esthétique, mais encore la construction en acte de l’histoire du genre poétique.
Lire la poésie « comme le journal » : pour une autre figure de la lecture poétique
Les occurrences du terme de « journal » sont peu nombreuses dans les Chroniques du bel canto, mais chaque fois très frappantes. La première, la plus importante, survient à la fin de la troisième chronique, datée de mars 1946, consacrée d’une part à la nouvelle traduction que René Nelli propose de poèmes d’amour du poète catalan Jordi de Sant Jordi, d’autre part au dernier livre de Paul Éluard, Poésie ininterrompue. Après quelques pages semées de citations où Aragon s’emploie à « résumer » le poème (en fait il se livre plutôt à un commentaire buissonnier suivant grosso modo les grandes parties du texte), le chroniqueur élève soudain le ton, accompagnant ainsi la courbe graduée et ascensionnelle du poème d’Éluard (« Si nous montions d’un degré », « Et nous montons ») :
Je vous en prie, comprenez tout ceci comme si c’était écrit sur le journal. La guerre est, dit-on, terminée, mais les victimes sanglantes empuantissent encore l’univers, moins que les criminels déjà oubliés. Lisez ceci aux grandes heures de Nuremberg, et quand déjà ces messieurs du Figaro sont excédés que l’on continue à se souvenir du crime français… Éluard ne parle pas dans la lune, et tout ceci est bien la terre où nous souhaitons que comprendre juge l’erreur selon l’erreur, Pétain selon la loi de Pétain, Brasillach ou Goering suivant Brasillach ou Goering, mais : Si nous montions d’un degré[1] ?
Paradoxalement et de façon provocatrice au regard des idées reçues de l’époque concernant la poésie, selon lesquelles tout poète est idéaliste, obscur, « dans la lune[2] », cette prise de hauteur par rapport au poème ne rapporte pas ce dernier à une envolée philosophique ou mystique, mais l’arrime au contraire fermement à un « lieu commun » : l’actualité. De plus, ce qui est remarquable, c’est le travail d’explicitation et d’interprétation mené par Aragon : dans le poème d’Éluard, on ne lit nulle référence précise et datée à l’événement (la Seconde Guerre mondiale, la Libération, le procès de Nuremberg). C’est Aragon qui attire l’attention du lecteur sur les liens qui peuvent et doivent se tisser entre le contenu textuel du poème et la « réalité », bref qui fait de Poésie ininterrompue, explicitement, un « poème de circonstance ». La référence au « journal » sert donc ici à définir le premier principe de l’art de la lecture poétique selon Aragon : lire, c’est lier le mot à l’événement, rapporter le poème à son actualité qu’Aragon nomme « circonstance ». En outre, en mettant sur un pied d’égalité le poème d’Éluard et les opinions des journalistes du Figaro (sans pour autant aliéner le poème au genre de l’article), le chroniqueur définit la fonction de la poésie en termes politiques, comme témoignage et pensée engagée de l’événement. En même temps, la notion d’« actualité » dépasse largement le seul cadre politique pour Aragon. En effet, autre point tout aussi important que la reconnaissance du contexte politique dans le poème, le chroniqueur enseigne également aux lecteurs à lire ce poème non pas à la lumière des conceptions anciennes et idéalistes de l’amour (l’amour platonicien du poète catalan idéaliste traduit par Nelli par exemple), mais à l’aune de ses représentations contemporaines, relevant notamment pour le lecteur l’introduction dans le poème de la « nouveauté » du « couple », « haute expression de l’amour de ce temps[3] ». Et il recommencera la leçon, pour d’autres poètes, au fil de ses chroniques, inlassablement.
Dans ce premier appel à lire la poésie « comme si c’était écrit sur le journal », un élément surprend : c’est que le format du poème d’Éluard, sur lequel Aragon insiste d’ailleurs largement (« un poème de près de sept cents vers »), ne correspond nullement à celui d’un poème de journal, d’ordinaire caractérisé par une certaine brevitas[4]. Ce paradoxe d’un long poème appelé à être lu comme le journal tendrait à prouver que cette analogie n’implique pas un type d’écriture propre au medium journalistique. Aragon ne semble pas viser un changement effectif de support. La seconde occurrence du terme de « journal » dans les chroniques va permettre d’élucider encore ce paradoxe.
Cette instante prière qu’Aragon adresse à ses lecteurs pour qu’ils changent leur façon de lire la poésie est réitérée deux fois encore dans cette même chronique :
Lisez cela comme le journal, je vous en prie, aux grandes heures de Nuremberg. La poésie se lit comme le journal, et pas qu’aux heures de Nuremberg, aux grandes heures de tout un monde…
[…] Lisez cela comme le journal. La poésie, notre poésie, se lit comme le journal. Le journal du monde qui va venir[5].
Ces variations litaniques font osciller la portée de l’analogie entre cas particuliers et cas généraux, circonstances et universalité (« aux grandes heures de Nuremberg » — « et pas qu’aux heures de Nuremberg » ; « notre poésie » — « la poésie »). En dégageant ainsi son propos du seul contexte immédiat (Nuremberg), Aragon, qui se livre ici à une véritable leçon de lecture poétique, laisse entendre que le contenu du poème relève d’une actualité non seulement collective et historique, mais encore toute personnelle, renvoyant à l’expérience de chacun — nous y reviendrons. Par ailleurs, Aragon indique ici que le « journal » n’est un modèle de lecture pertinent que dans des circonstances historiques bien particulières, celles qui suscitent, comme il l’explique dans « Les poissons noirs ou de la réalité en poésie », la renaissance à la fois du « sens national » et du « sens épique[6] », auquel fait ici écho le syntagme « grandes heures ». Ainsi, sans que soit prononcé le mot « épique » dans cette troisième chronique, le paradoxe du format de Poésie ininterrompue, apparemment inapproprié au support journalistique, se dénoue dans la référence au genre épique rattaché par le poète à la « poésie de circonstance ». Notons que cette dernière expression, pourtant sous-jacente elle aussi, n’est pas mentionnée en tant que telle dans cette chronique. C’est que le terme de « journal », apparemment plus neutre, sert ici à subsumer les deux notions, celle d’« épopée », qui aurait fait intervenir l’ancienne triade des genres poétiques (d’Aristote au romantisme), peu adéquate avec l’idée de poésie exposée ici par Aragon (la poésie comme « bel canto »), et celle de « poésie de circonstance », trop galvaudée[7]. La notion de « journal » apparaît dès lors comme une tentative inédite pour caractériser une certaine tendance de la poésie.
La dernière expression, « le journal du monde qui va venir », modifie quant à elle considérablement, en l’élargissant, l’acception du terme de « journal » qui dès lors réfère à la notation non plus seulement de l’actualité, du présent, mais aussi de l’avenir. Il ne s’agit donc pas d’un journal « réaliste » au sens premier du terme ; à moins de considérer que ce terme de « journal » ne permette en fait à Aragon de définir sa propre conception du réalisme. Nous y reviendrons.
La treizième et dernière chronique répète à nouveau, à propos du « Dormeur du val » de Rimbaud, l’appel à lire la poésie « comme le journal », ce type de lecture apparaissant cette fois comme une simple méthode complémentaire de ce que serait un mode de lecture plus ordinaire (non précisé ici) de ce genre :
S’il est vrai qu’il faut savoir lire la poésie autrement que le journal, il faut savoir aussi la lire comme le journal, et alors Le Dormeur du val sera certainement à la fois plus accessible au lecteur, et plus conforme au sentiment rimbaldien, que cette exégèse arbitraire[8].
Le modèle de lecture que représente le journal, s’opposant ici à celui de l’« exégèse », fait apparaître, avec l’exemple de Rimbaud, un second principe de lecture, indépendant du rapport à l’actualité ou aux circonstances. Lire la poésie « comme le journal » signifie ici adopter une lecture naïve, dégagée des « idées reçues » ainsi que des références culturelles et littéraires. C’est l’idéal d’une communication poétique transparente. Dès la première chronique, Aragon déplore en effet le poids des étiquettes qui empêchent de « lire les choses comme elles sont dites, écrites directement » : il songe alors à la poésie de Reverdy, « écrasée sous une étiquette », celle de « poésie cubiste[9] ». Dans une autre chronique, il dénonce en passant, dans une parenthèse à propos de Baudelaire, le poids des stéréotypes, transmis sans doute par la culture scolaire, qui eux aussi dressent des barrières entre le poète et ses lecteurs : « […] (l’aura-t-on assez écrasé, celui-ci, sous les oripeaux de son moderne à lui, de ses divans profonds, de sa Charogne et de tout le décor Rops) […][10] ».
Lire la poésie « comme le journal », c’est donc ici se mettre dans une disposition de lecture non poétique ou, plus largement, non littéraire. Jean Paulhan, dans Clef de la poésie, ce petit livre si important dans les débats de l’après-guerre sur la poésie, exprimait l’idée selon laquelle le fameux « mystère » poétique relève en fait du seul état d’esprit du lecteur au moment de lire le poème : « Il y suffit de lire un poème. Il y suffit de s’attendre à lire un poème. Il y suffit, si je puis dire, d’être en disposition de poème[11]. »
Cet « horizon d’attente » que pointe ici Paulhan bien avant Jauss, c’est celui qu’Aragon prie le lecteur de modifier, en lui demandant d’imaginer lire un journal plutôt qu’un livre, selon l’idée très juste que le support conditionne un certain mode de lecture. À travers le modèle médiatique du « journal », ce sont donc les représentations littéraires qui sont en jeu : se figurer lire dans le journal, c’est changer sa conception de la poésie et accéder à une nouvelle sensibilité poétique.
Cette réflexion proprement médiatique à laquelle se livre ici le chroniqueur reprend en fait le point de vue mallarméen sur le « journal » exposé principalement dans la VIe « Variation sur un sujet », « Le Livre, instrument spirituel » (1895). Si l’on résume Mallarmé, le « journal » est cette forme dépliée donnant à lire le texte par grandes étendues, sans « mystère », au contraire du « livre », caractérisé par le pli des feuilles que le « couteau », comme en un rite sacrificiel désignant en soi le caractère sacré du texte, doit trancher pour permettre à l’initié de lire et d’espérer ainsi accéder au sens. Loin de cette conception-là du « mystère dans les lettres », Aragon défend au contraire une lecture du poème aussi fluide et « dépliée » que possible. C’est là le troisième principe de son art de la lecture. D’où, par exemple, son goût pour les notes explicatives en bas de page, discrètes et efficaces, qui n’interrompent pas la lecture du poème, mais permettent d’en éclairer les « circonstances », ainsi qu’il l’explique par exemple au début de la huitième chronique ; d’où également le désir, dans les Chroniques du bel canto, de citer parfois un poème d’un bout à l’autre, « d’une haleine[12] », comme il le dit pour l’assez long poème d’Henry Bataille recopié intégralement à la fin de la même chronique. Aucun exemple ne sera cependant plus clair que ce passage de la neuvième chronique où, renvoyant dos à dos deux lectures d’un sonnet de Mallarmé (précisément !), deux interprétations reposant sur l’« idée commune » d’une obscurité essentielle de ces vers à décrypter, Aragon en propose à son tour une lecture fluide et non heurtée, « d’un trait » :
Si pourtant, j’oublie, c’est mon droit que ce sonnet est de Mallarmé, et que d’un trait aujourd’hui je vais le lire :
Ô si chère de loin et proche et blanche, si
Délicieusement toi, Méry, que je songe
À quelque baume rare émané par mensonge
Sur aucun bouquetier de cristal obscurci.
Le sais-tu, oui ! pour moi voici des ans, voici
Toujours que ton sourire éblouissant prolonge
La même rose avec son bel été qui plonge
Dans autrefois et puis dans le futur aussi.
Mon coeur qui dans les nuits parfois cherche à s’entendre
Ou de quel dernier mot t’appeler le plus tendre
S’exalte en celui rien que chuchoté de soeur
N’était, très grand trésor et tête si petite,
Que tu m’enseignes bien toute une autre douceur
Tout bas par le baiser seul dans tes cheveux dite.
si d’un trait donc j’arrive à la fin, sans buter sur ce bouquetier, dont l’obscurité me semble à vrai dire purement syntaxique, il s’agit d’un sonnet très clair […][13].
C’est bien le mode de lecture du journal qu’adopte ici Aragon et qu’il fait adopter à ses lecteurs du seul fait que ces citations intégrales de poèmes soient elles-mêmes prises dans une chronique d’Europe.
Aragon, conformément aux politiques culturelles de la gauche d’après-guerre, se situe résolument du côté de « l’art pour tous », tendance que Mallarmé qualifiait pour sa part, dans un article de jeunesse (1862), d’« hérésie ». Dans ce texte, Mallarmé, sans parler encore du « journal » en tant que tel, dénonçait les choix typographiques et maquettes vulgaires qui ne distinguent pas la poésie d’art de la prose ou des mauvais vers, ainsi que les « éditions à bon marché » qui brisent la dernière « barrière » entre la « foule » profanatrice, qui « achète » mais ne comprend pas, et les poètes, ces prêtres d’une nouvelle religion. Aragon partage en fait les mêmes inquiétudes quant à la compréhension de la poésie par le grand public et sa vulgarisation, d’autant plus que, selon un constat sévère, même les poètes, ou ceux qui se disent tels, n’ont pas la culture littéraire suffisante pour écrire :
Je ne sais ce que ressent un jeune homme d’aujourd’hui, lisant Anciennetés, par exemple. Je sais qu’à mes yeux la culture poétique d’un esprit qui négligerait le fait que cette poésie constitue serait fâcheusement lacunaire. Je me dis que les auteurs des vingt-trois plaquettes que j’ai lues ces jours-ci doivent ignorer Anciennetés. Et d’autres expériences de notre langage, de notre poésie, de notre histoire. La pauvreté poétique est certainement liée à l’insuffisance de la culture. Si on pouvait leur demander, à ces poètes qu’on édite, ce qu’ils ont lu — fort reconnaissable dans leur mauvais miroir où se marient le verlainisme et le surréalisme — si on pouvait soupeser ce qui leur est tombé dans les mains, la pauvre bibliothèque de ces somnambules, il n’y aurait pas à chercher midi à quatorze heures pour comprendre ce qui leur manque, quelles vitamines, quelles hormones[14].
On retrouve également chez lui la même méfiance lucide envers l’enseignement de la poésie, l’institution scolaire figeant les poètes dans des stéréotypes, ou encore envers les phénomènes de mode mettant en valeur tel ou tel artiste, bientôt délaissé au profit d’un autre. Mais contrairement à Mallarmé, Aragon veut croire dans les facultés du grand public à lire, relire et « comprendre » la poésie, même si cela reste un horizon idéal non encore atteint. « Un jour, tout le monde pourra la lire[15] », écrit-il ainsi dans la première chronique à propos de la poésie de Reverdy. Aragon, loin de « la peur ou [du]dégoût des masses » qu’il dénonce chez André Frénaud ou Patrice de la Tour du Pin comme une « maladie[16] », se veut au contraire médiateur patient entre les poèmes et le public. Le « journal », expérience de lecture connue de tous, est de ce point de vue l’un des moyens pédagogiques trouvés dans ces chroniques pour transmettre son approche de la poésie.
En même temps, comme certaines occurrences étudiées plus haut le montrent, le modèle du « journal » semble laisser échapper une partie de la nature poétique telle que la conçoit Aragon. Le « journal » ne tient pas compte, en effet, du « mystère » qui, pour le poète-chroniqueur, sous le nom de « chant » demeure : « Le chant. Ce mystérieux pouvoir d’écho qui fait vibrer les verres sur la table, frissonner les insensibles[17]. »
Il y a un mot par lequel Aragon rassemble, de façon extrêmement ingénieuse, l’exigence de compréhension du poème et le maintien du mystère au coeur même de la compréhension : c’est le verbe « entendre ». Les occurrences où se mêlent et se juxtaposent les sens intellectuel et sensible de ce terme sont extrêmement nombreuses. Ainsi de ce passage de la cinquième chronique qui place côte à côte les deux acceptions d’ « entendre », la deuxième occurrence, employée avec un complément d’objet indirect, ne pouvant avoir que le sens de « comprendre » :
Le bel canto… pauvres malheureux sourds qui ne l’entendez pas, qu’entendez-vous à la poésie ? Il est la poésie, quand elle se met vraiment à chanter[18]…
De façon paradoxale, le modèle de communication journalistique qu’Aragon rattache à la fois à un contenu (sujet d’actualité), à une conduite de lecture (lecture non littéraire, allant « directement » au sens) et à une physique de la lecture (lecture fluide, non heurtée) a donc en fait partie liée au « mystère » poétique puisqu’il permet de faire tomber toutes les barrières entre signifiant et signifié pour ne plus laisser que le « chant », c’est-à-dire l’émotion poétique.
La reconfiguration de l’histoire littéraire à travers la notion de « journal »
Devant cette persistance étonnante du « mystère » poétique pour un poète matérialiste et réaliste, devant également la réappropriation d’un terme clef du postsymbolisme et des tenants de la poésie pure comme celui de « chant », il est temps d’examiner plus avant le type d’esthétique que propose Aragon et la façon dont il construit son inscription, par-delà les débats littéraires de l’après-guerre (nous avons montré plus haut comment la notion de « journal » venait suppléer stratégiquement à celle de « poésie de circonstance »), dans l’histoire littéraire. Nous examinerons pour ce faire deux notions, celle de « chant » et celle de « réalité », en montrant comment la référence au « journal » permet à Aragon d’échapper aux esthétiques qui leur sont d’ordinaire attachées.
Revenons d’abord brièvement sur l’idée de « chant » telle que la développe Aragon dans ses chroniques. Comme il l’indique lui-même non sans malice dans la cinquième chronique, celle où il explique l’emploi qu’il fait de la notion de belcanto, cette conception de la poésie fondée sur le « chant » pourrait faire croire à un « retour à la “poésie pure” » (« Voici que m’écoutant, quelqu’un s’étonne et murmure. Ah, dit-il avec espoir, le bel canto, vous, mais, mais… c’est un retour à la “poésie pure”[19] ! »), ce que le chroniqueur dément bien sûr immédiatement avec vigueur. En effet, le « beau chant » que loue et recherche Aragon rompt avec le modèle harmonique et opératique des symbolistes. De façon cohérente avec le désir de fluidité et de linéarité exprimé à travers l’idée du « journal », son modèle musical est la « mélodie ». Laissons de côté ici les considérations nationalistes qui lui font opposer la musique allemande, avec le modèle wagnérien, et la musique italienne, avec le bel canto de Rossini : plus intéressante est l’opposition très nette qui se dessine entre une conception d’un côté artistocratique de l’art (Wagner, Mallarmé, « l’harmonie[20] ») et de l’autre populaire, ou tout au moins d’un art accessible au grand public (Rossini, Aragon, bel canto). Par cette notion de bel canto qui popularise celle de « chant » symboliste, et par la reprise de la réflexion mallarméenne sur le « journal », Aragon cherche moins à rompre avec le symbolisme qu’à le démocratiser. C’est ainsi que peut s’expliquer l’éloge de Pierre Emmanuel dans la septième chronique, puisque sa poésie, « qui oscille entre le journal et Mallarmé », ne semble garder du symbolisme qu’une certaine diction pour aboutir malgré cela à un ton populaire :
Si je considère les poètes comme des événements de l’histoire, il n’y a peut-être pas dans la poésie contemporaine un cas plus saisissant que celui de l’éclosion d’Emmanuel, dont l’oeuvre déjà considérable de 1938 à 1946, s’est avec soudaineté située, élevée, développée. Prise à une espèce de charnière de la méditation poétique : où l’éloquence est par le cri niée, le langage au départ du symbolisme même, avec ses flexions syntaxiques particulières, aboutissant à une poésie réaliste, et je dis ce dernier mot presque au sens qu’il a quand il s’agit d’une chanteuse[21].
Si la notion de « poésie réaliste » renvoie ici clairement, employée dans son sens musical, à une conception de l’art à la fois engagé et populaire, il est intéressant de voir que dans les Chroniques du bel canto, la notion récurrente de « réalité » convoque en fait, de façon complexe, plusieurs esthétiques fort différentes. Or, le modèle communicationnel du « journal » tend à unifier la compréhension que nous pouvons en avoir.
La notion de « réalité », d’emblée, semble rattacher Aragon à l’esthétique revendiquée et jamais démentie depuis 1935[22] du « réalisme socialiste ». Pourtant, cette épithète n’apparaît à aucun moment des Chroniques du bel canto. Certes, en plusieurs passages, on pourrait parler d’une reformulation des théories réalistes socialistes telles qu’Aragon les avait développées dans les années 1930. Par exemple, à la fin de la troisième chronique, l’expression de la réalité va de pair avec un optimisme marxiste (« la dénonciation du monde tel qu’il est, du monde noir, s’achève par l’appel d’un monde différent, par la négation du pessimisme originel[23] »), faisant du poème un « instrument pour la transformation du monde[24] » comme le préconisait Aragon dans sa conférence du 5 octobre 1937, « Réalisme socialiste et réalisme français » : c’est donc sans doute dans la perspective du réalisme socialiste qu’il faut dès lors entendre l’expression de « journal du monde qui va venir ». Mais la plupart du temps, la notion de « réalité » ou celle de « démarche réaliste », toujours valorisées par Aragon, servent en fait à définir la poésie « moderne ». Ainsi, la façon dont Aragon résume la trajectoire de Rimbaud dans l’histoire littéraire, tout en l’ « annexant » à son tour au réalisme, est particulièrement révélatrice de la démarche intéressée de ce penseur de l’histoire littéraire :
L’explication symboliste de Rimbaud, celle de la génération « fin de siècle », celle de ceux qui, mettant l’accent sur Le Bateau ivre et les premiers poèmes, comme sur le sonnet des Voyelles, voyaient en Rimbaud la suite du romantisme, voire un prolongement de Baudelaire, a depuis longtemps fait long feu. Il a fallu que cette conception soit brisée pour que Rimbaud prît dans l’histoire de la poésie la place hors pair qu’il occupe, et que consacrèrent les hommes de ma génération, ceux qui avaient vingt ans pendant l’autre guerre. Aussi bien, la démarche proprement réaliste dans la poésie qui oppose à tous ses contemporains, fût-ce au prétendu réaliste Coppée, Arthur Rimbaud, la façon qu’il a d’appeler chaque chose par son nom, d’introduire dans la poésie les mots qui n’y ont pas droit de cité […], voilà qui suffirait à faire justice de l’annexion littéraire au symbolisme d’un homme qui l’a précisément fui au Harrar[25].
De même que l’« explication symboliste » de Rimbaud se trouve recouverte par l’explication « réaliste » qu’en donne Aragon, de même Henry Bataille est « annexé » à la poésie « moderne », au sens historique du terme, du seul fait d’être placé aux côtés d’Apollinaire comme un défenseur de la « réalité » en poésie :
Le modernisme de Bataille, si vous voulez bien le replacer dans son temps, est précisément ce que tous les tenants de la poésie intemporelle, ont combattu et combattent encore. C’est la réalité dans les vers. Grave et puissante conspiration du goût. Il lui faut cinquante ans et bien des opérations pour lui rendre pudique, comme les statues qu’on habille, pour lui faire avaler Rimbaud. Les gens de cette conjuration oublient dans Apollinaire ce qui les y dérange. Et c’est toujours la réalité, cette salade à l’anchois que quelque part se mange un territorial… ou Le lundi rue Christine. (J’aimerais mieux me couper le parfaitement.)[26]
Une histoire de la poésie se reconstitue donc à travers l’idée de « réalité ». Cette annexion des « modernes », au sens historique du terme, tels Reverdy ou Apollinaire, au « réalisme » aragonien doit certes être comprise comme une stratégie par laquelle le chroniqueur se défend devant ceux qui l’accusent d’être un poète réactionnaire[27] (à cause notamment de sa théorie de la rime et de sa défense de la « poésie de circonstance »). Mais de même que le « réalisme » d’Aragon n’a que peu à voir avec le courant ainsi nommé par l’histoire littéraire (le « prétendu réaliste Coppée »), de même la « modernité » dont parle Aragon n’a pas de lien authentique avec le courant historique du début du siècle. C’est que « modernité » et « réalité » sont avant tout des valeurs, et des valeurs qui, dans cette stratégie de légitimation de la « poésie de circonstance », vont pour Aragon de pair. Dans les Chroniques du bel canto, ces valeurs, attachées au modèle du « journal », doivent être considérées comme des effets de réception, liées à la conscience des « circonstances » du poème. C’est ainsi qu’Aragon oppose chez André Frénaud d’un côté « la tranche de vie : cette description arbitraire, exacte et puis après ? », relevant d’un critiquable « naturalisme » (déjà critiqué comme faux réalisme dans la conférence d’octobre 1937), de l’autre, la « large communication de la réalité » atteinte dans des poèmes écrits par le poète prisonnier[28].
Ce que désigne Aragon par le terme de « réalité » dans les Chroniques du bel canto a donc tout à voir avec le modèle communicationnel du « journal » dont nous avons déterminé plus haut les principes. Car la « réalité en poésie », ce sont en fait les éléments par lesquels le lecteur se sent partie prenante de ce qu’il lit : cela peut passer par une prise de conscience des « circonstances » du poème si la réalité décrite dans le poème est trop éloignée de lui, ou bien alors par la référence qu’il tisse, même de façon anachronique, à une expérience vécue soit individuellement, soit collectivement. Ainsi de cette leçon de lecture anachronique dans la troisième chronique où Aragon appelle à lire les poèmes de Jordi de Sant Jordi à la lumière de la « poésie prisonnière de ces temps derniers[29] » ; ainsi également de cette lecture de Reverdy, dont Aragon nous dit que le « frémissement[30] » poétique toujours renouvelé que les vers de Plupart du temps suscitent en lui tient sans doute au fait qu’il les lisait à vingt ans et que toute une atmosphère les accompagne encore. Si la notion de « réalité » correspond ainsi à un art de la lecture – qui devient aussi art de la rêverie et de la divagation, et par là même puissance d’invention poétique — l’art d’établir des liens entre les mots et le monde, combien sommes-nous alors éloignés des caractéristiques esthétiques et idéologiques de la poésie moderniste, dont Aragon se place pourtant en héritier, laquelle réclame l’absence de toute « référence » au monde pour recréer une réalité nouvelle, celle de l’oeuvre en soi ?
Dans les Chroniques du bel canto, Aragon parle davantage du point de vue du lecteur de poésie que de celui du poète. Le « journal » lui sert de modèle communicationnel de référence pour faire accéder les lecteurs à une autre sensibilité poétique que celle véhiculée par les critiques d’après-guerre ou par les stéréotypes académiques. C’est aussi pour lui un moyen original et provocateur de répondre aux débats concernant la poésie de circonstance, la poésie engagée et la poésie pure, tout en s’inscrivant dans une histoire de la poésie reconfigurée. D’autre part, si l’idée du « journal » apparaît comme le moyen paradoxal de faire surgir le mystère poétique, le chant, jamais Aragon ne légitime ce medium comme un support de création poétique en soi. Aragon en reste finalement à l’analogie : la mutation médiatique du poème reste ici imaginaire. Mais cet imaginaire est lourd de sens à une époque où bon nombre d’écrivains commencent à ne plus se satisfaire du livre ou des revues spécialisées comme moyens d’édition : l’essor de nouveaux médias de masse, en particulier la radio, ouvrent en effet des horizons nouveaux non seulement en termes de démocratisation de la culture, mais aussi en termes d’expression artistique. Des écrivains aussi différents que Sartre et Artaud appellent ainsi, après la guerre, à sortir du livre. On sait combien Aragon lui-même s’intéressera de près à l’enregistrement parlé de ses poèmes sur disques. L’appel à lire la poésie « comme le journal », dans les Chroniques du bel canto de 1946, est l’un des signes de cette mutation médiatique en cours.
Appendices
Note biographique
Céline Pardo
Agrégée de Lettres classiques, Céline Pardo termine actuellement une thèse à Paris IV-Sorbonne intitulée La poésie hors du Livre en France de 1945 à la fin des années 1960. Il s’agit notamment de penser les nouvelles pratiques et formes poétiques émergeant à cette époque, liées au développement de médias tels que la radio, le disque, le cinéma et la télévision. Elle mène une réflexion sur Éluard (« Paul Éluard, Les chemins et les routes de la poésie : le poète au micro et l’utopie poétique », Études littéraires, « La lecture littéraire et l’utopie d’une vie commune », Frédérik Detue et Christine Servais (dir.), à paraître) et sur Ponge (« Francis Ponge et la mise en livre du Savon », Poésie et médias au XXe siècle, actes du colloque des 30 et 31 octobre 2008, Maison de la recherche, Paris, Nouveau Monde Éditions, à paraître en 2010).
Notes
-
[1]
Louis Aragon, « Chronique n° 3 », mars 1946, Chroniques du bel canto, 1979, p. 38.
-
[2]
Dans un texte contemporain des Chroniques du bel canto servant de préface à la réédition du Musée Grévin en 1946, « Les poissons noirs ou de la réalité en poésie », Aragon écrit également : « cette étrange conception lunaire que la poésie n’est pas de circonstance quoi qu’en ait dit Goethe ; que plus on comprend un poème et moins il est poétique. Que la poésie à être expliquée perd son caractère poétique. Et caetera. Ce qui est, contre le poète, le triomphe du jongleur, de celui qui confond, qui répète à son idée, interprète, et ne comprend pas » (Oeuvres poétiques complètes, 2007, t. 1, p. 927). Autant d’« idées reçues » que reprendront pour s’y opposer les Chroniques du bel canto. Notons que cette lutte contre ces préjugés n’est pas le propre d’Aragon mais correspond à une tendance forte pour réévaluer auprès du grand public l’image de la poésie. En témoigne par exemple cet extrait d’article d’Anne Manson présentant justement la prochaine mise en ondes de Poésie ininterrompue d’Éluard : « Non, Paul Éluard n’est pas un obscur. Le poète qui écrivit : “À celle dont ils rêvent” […] ne s’enferme jamais dans une tour d’ivoire ; il est parmi nous, il est aussi réellement notre frère que l’ami torturé à mort par les Allemands » (Radio 46, no 72 (10 mars 1946), p. 7).
-
[3]
Louis Aragon, « Chronique n° 3 », op. cit., p. 34.
-
[4]
Pour un exposé des caractéristiques du « poème de journal », l’on pourra se référer par exemple à l’article d’Alain Vaillant, « Le vers à l’épreuve du journal », Recherches & travaux, n° 65 (2004) : « Poésie et journalisme au XIXe siècle en France et en Italie », p. 11-27.
-
[5]
Louis Aragon, « Chronique n° 3 », op. cit., p. 39-40.
-
[6]
Louis Aragon, « Les poissons noirs ou de la réalité en poésie », op. cit., p. 917.
-
[7]
Ce travail sur les étiquettes est caractéristique des écrits théoriques et critiques d’Aragon, conscient qu’il est du poids idéologique, et partant stratégique, de toute expression. Dans Le fou d’Elsa, Aragon revient, dans un très beau passage métalittéraire, intitulé la « Parabole du montreur de ballets », sur la difficulté à trouver le bon mot pour définir sa position poétique : « Et qui pourrait prétendre que j’ai fermé les yeux devant les jours présents / Moi qui me tins hâssib au carrefour […] / J’ai dit hâssib il n’y a point de mot en français / Et ce n’est tout à fait ni poète de circonstance ni / Chroniqueur hâssib quoi ni journaliste / Une sorte à peu près de pommier de plein vent » (Louis Aragon, Oeuvres poétiques complètes, 2007, t. 2, p. 664). En 1963 donc, le modèle du « journal » a rejoint la chronique et la poésie de circonstance dans le grenier de l’histoire littéraire. Seul un mot étranger, l’arabe hâssib, qui signifie « conteur des rues », ou une périphrase métaphorique, « pommier de plein vent », semblent désormais convenir au poète, comme s’il manifestait par là le désir de s’éloigner des prises de position idéologiques et nationalistes.
-
[8]
Louis Aragon, « Chronique n° 13 », janvier 1947, op. cit., p. 151.
-
[9]
Louis Aragon, « Chronique n° 1 », janvier 1946, op. cit., p. 16-17.
-
[10]
Louis Aragon, « Chronique n° 8 », août 1946, op. cit., p. 82.
-
[11]
Jean Paulhan, Clef de la poésie, 1944, p. 20-21.
-
[12]
Louis Aragon, « Chronique n° 8 », op. cit., p. 83.
-
[13]
Louis Aragon, « Chronique n° 9 », septembre 1946, op. cit., p. 88-89.
-
[14]
Louis Aragon, « Chronique n° 4 », avril 1946, op. cit., p. 46.
-
[15]
Louis Aragon, « Chronique n° 1 », op. cit., p. 19.
-
[16]
Louis Aragon, « Chronique n° 12 », décembre 1946, op. cit., p. 139 (en italique dans le texte).
-
[17]
Louis Aragon, « Chronique n° 1 », op. cit., p. 10.
-
[18]
Louis Aragon, « Chronique n° 5 », mai 1946, op. cit., p. 57.
-
[19]
Id., p. 57
-
[20]
Comme le dit Stendhal, écrivain-relais cité par Aragon dans la cinquième chronique : « En musique, on ne se rappelle bien que les choses que l’on peut répéter ; or un homme seul se retirant chez lui le soir, ne peut pas répéter de l’harmonie avec sa voix seule » (ibid., p. 55).
-
[21]
Louis Aragon, « Chronique n° 7 », juillet 1946, op. cit., p. 67.
-
[22]
Louis Aragon, Pour un réalisme socialiste, Paris, Denoël et Steele, 1935.
-
[23]
Louis Aragon, « Chronique n° 3 », op. cit., p. 39.
-
[24]
Louis Aragon, « Réalisme socialiste et réalisme français », 1938, p. 303.
-
[25]
Louis Aragon, « Chronique n° 11 », novembre 1946, op. cit., p. 117-118.
-
[26]
Louis Aragon, « Chronique n° 8 », op. cit., p. 81.
-
[27]
« Et de nos jours, malgré l’extraordinaire sursaut de la poésie française à l’heure du danger national, nous traînons encore les préjugés des circonstances pacifiques, le bonnet de coton de la poésie pure, la coiffure de papier du surréalisme. La masse de la gent qui écrit, la cour des miracles de ceux qui se croient poètes un instant ébranlée revient à ses hochets de délire et de rêve, méprise à nouveau la poésie de circonstance. Elle est ce qu’on appelle dans le langage politique la réaction : les faits pour elle n’ont pas le dernier mot, elle revient sur leur leçon d’évidence » (« Les poissons noirs ou de la réalité en poésie », op. cit., p. 918).
-
[28]
Louis Aragon, « Chronique n° 12 », op. cit., p. 134.
-
[29]
Louis Aragon, « Chronique n° 3 », op. cit., p. 30.
-
[30]
Louis Aragon, « Chronique n° 1 », op. cit., p. 13.
Références
- Aragon, Louis, Chroniques du bel canto suivi de Chroniques de la pluie et du beau temps, Paris, Les éditeurs français réunis, 1979.
- Aragon, Louis, Le Fou d’Elsa, Oeuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2007, t. 2 (éd. Olivier Barbarant), p. 489-938.
- Aragon, Louis, « Les poissons noirs ou de la réalité en poésie », Oeuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2007, t. 1 (éd. Olivier Barbarant), p. 913-940.
- Aragon, Louis, « Réalisme socialiste et réalisme français », Europe, no 183 (janvier-avril 1938), p. 289-303.
- Manson, Anne, « Paul Éluard ou la poésie ininterrompue », Radio 46, no 72 (10 mars 1946), p. 7.
- Paulhan, Jean, Clef de la poésie, Paris, Gallimard, 1944.