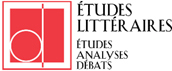Abstracts
Résumé
L’article classique de Georg Lukàcs sur Illusions perdues (1935) a fixé l’image d’un critique littéraire « exploité prostitué » par force de la marchandisation capitaliste de la littérature. Lukàcs reconnaît par là l’appartenance du critique à la chaîne de production du livre et donc son rôle de médiateur de l’oeuvre littéraire. Mais il méconnaît une partie essentielle de la relation critique telle qu’elle apparaît autour de 1830 : les louanges se donnent aussi souvent qu’elles se vendent, soit dans l’espoir plus ou moins conscient d’un échange de bons procédés entre écrivains-journalistes, soit par esprit de « camaraderie littéraire ». Cet article se penche sur l’ambivalence, à l’époque romantique, des représentations du critique littéraire, que l’on voit verser tantôt du côté de la vénalité, tantôt du côté du don de soi et de son texte.
Abstract
Georg Lukàcs’ classic utterance on Lost Illusions (1935) forever cast literary critics as “prostitutes exploited” by the capitalist merchandising of literature. In so doing, and while acknowledging both the critic’s place in the production cycle of books and his role as mediator of a given literary oeuvre, Lukàcs nonetheless failed to grasp a key component of a critic’s role in the 1830s. Back then, laudatory comments were freely bestowed just as easily as they could be bought, whether as an expression of literary camaraderie or as part of a more or less implied exchange of favours between journalist-writers. This article will look at the romantic era’s ambivalence in the depiction of literary critics, sometimes venal, sometimes selfless.
Article body
Et l’Ange, me montrant ces hommes, me dit encore :
— Ce sont des gens de lettres. Celui qui marche le premier est celui-là même qui, ce soir, était en communion de passion et de poésie avec le peuple et qui en a reçu des acclamations et des couronnes. Quelques-uns parmi ceux que tu vois autour de lui les ont obtenues avant lui et les obtiendront encore après. D’autres que tu vois encore n’entrent jamais dans cet état de communication directe et intime avec le peuple : ceux-ci sont les juges des autres, et ont pour mission d’expliquer leurs oeuvres et de les rapprocher des meilleures oeuvres des temps précédents pour en contrôler la valeur. Et, à l’opposé de ce qui se passe dans votre monde, où les écrivains que vous appelez critiques sont ordinairement honnis et récusés par leurs confrères, ceux-ci sont au contraire honorés et chéris par nos poètes ; car ils les reconnaissent comme les historiens et les explicateurs de leurs pensées, et aussi, à cause de leur savoir, comme des moniteurs et des censeurs auprès desquels ils peuvent toujours s’assurer s’ils sont égaux à eux-mêmes ou inférieurs.
Charles Asselineau[1]
Modèles imaginaires
S’intéresser à la critique littéraire du XIXe siècle revient souvent à se faire l’observateur d’une galerie de portraits[2]. De physiologies en typologies, d’articles en préfaces, quelques silhouettes se dessinent : le feuilletoniste pressé, l’habitué des parterres, l’éreinteur envieux, l’historien poussiéreux, chaque figure renvoyant à un répertoire peu étendu de patronymes : Jules Janin, Villemain, Nisard, Gustave Planche, Sainte-Beuve, Jules Lemaitre, Francisque Sarcey, Brunetière, etc. Les imaginaires de la critique mobilisent toujours des imaginaires du critique. À bien y regarder, quatre modèles, quatre « patterns » imaginaires[3] peuvent sans doute être discernés en autant de sections de cette galerie de portraits : 1) La critique « professée », produit de cours privés — celui notamment de Villemain dans les années 1820 — ou de cours publics, à la Sorbonne ou au Collège de France. Nisard et Gustave Lanson représentent cette critique littéraire des professeurs en chaire. 2) La critique « de synthèse », surplombante, enfermée en apparence dans les grandes revues. Proche de la précédente mais s’en distinguant par son inscription dans le champ journalistique, « la Sainte Critique » rêvée par le Cénacle d’Illusions perdues, la critique qui s’extirpe du commentaire des nouveautés de librairie et de parterre pour embrasser les grands mouvements de pensée ou pour réécrire l’histoire de la littérature. Cette critique-là — « cette grande chose de mesure et de poids, de principe et de certitude[4] », écrit Barbey d’Aurevilly — a à coeur de dorer son blason, de se hisser en se définissant hors de la masse des feuilletonistes, d’élever en somme le journal au livre. Ainsi, sous la monarchie de Juillet, nombreux sont ceux qui se sont essayés à fournir une épithète définitive, censée détrôner la précédente et caractériser au mieux ce à quoi la critique littéraire devrait tendre : « avant-courrière » pour Sainte-Beuve, « conjecturale » pour Villemain, « prospective » puis « indépendante » pour Planche, « d’initiation » pour Chaudesaigues, etc. Dans tous les cas, elle s’assigne pour double mission d’exposer au lecteur les voies ouvertes à la littérature contemporaine et de l’aider à faire un tri entre les novateurs et les imitateurs, les bâtisseurs et les démolisseurs.
Ces deux premiers modèles, largement identifiables tout au long du XIXe siècle, s’accordent sur la représentation d’un critique isolé et ne tiennent pas compte du fait que, comme l’écrit Alain Vaillant, le critique est lui-même dans la plupart des cas un écrivain professionnel et qu’il entretient donc « une relation complice et dialogique avec l’ensemble des gens de lettres ». Le critique se trouve en fait au croisement de deux logiques communicationnelles parfois difficilement compatibles : celle qui fait de lui un « maître d’école du public » et l’autre qui le classe « en camarade et en confrère de l’écrivain[5] », c’est-à-dire, tendanciellement, en homme de lettres professionnel tenu pour survivre de vendre le produit de son travail aux éditeurs et aux journaux. 3) C’est pourquoi le critique est souvent peint sous un jour beaucoup moins flatteur : la critique « prostituée » domine en fait, sur le plan des imaginaires de la presse, le XIXe siècle. Le critique souffre de la marchandisation de la pensée à l’oeuvre dans l’économie capitaliste qui régit la littérature. Prostitué volontaire, comme l’écrivait Lukàcs à la lecture d’Illusions perdues[6], il livre sa plume soit contre rémunération, soit, et cette distinction se révélera cruciale pour mon propos, dans l’espoir d’un échange de bons procédés. Parmi les historiens de la presse et du monde littéraire, c’est l’aspect qui a été, à raison, le plus souvent remarqué. Qu’il éreinte ou qu’il loue, qu’il invective ou qu’il « poffe », pour reprendre le terme de Stendhal — qu’il définit comme « vanter à toute outrance, prôner dans les journaux avec effronterie[7] » —, qu’il se fasse enjôleur ou acrimonieux ou même qu’il alterne ces deux postures à l’image de Lucien de Rubempré qui, sur les conseils de Lousteau, éreinte et encense tour à tour le même livre, le critique nage dans l’insincérité et le dévoiement parce qu’il se met non pas au service de la Littérature mais des instances hétéronomes qui tendent à la régir : les éditeurs et les directeurs de journaux. La mise en place à la fin des années 1820 d’un système d’annonces payées dans les journaux[8] a joué pour beaucoup dans l’endogamie entre la presse et l’édition et par conséquent dans la dévalorisation de la « fonction critique ». Placés au milieu d’annonces pour toutes sortes de marchandises, les livres ont trouvé là une source de publicité d’autant plus efficace que les lecteurs viennent consulter les journaux dans les cabinets de lecture, c’est-à-dire à l’endroit même où ils louent leurs livres. Les éditeurs y consacraient un important budget et engageaient même les rédacteurs de ces petites réclames dont pouvait dépendre le succès d’un livre.
On eut beau vouloir séparer dans le journal ce qui restait consciencieux et libre, de ce qui devenait public et vénal, écrit Sainte-Beuve dans son grand article « De la littérature industrielle » : la limite du filet fut bientôt franchie. La réclame servit de pont. Comment condamner à deux doigts de distance, qualifier détestable et funeste ce qui se proclamait et s’affichait deux doigts plus bas comme la merveille de l’époque ? L’attraction des majuscules croissantes de l’annonce l’emporta : ce fut une montagne d’aimant qui fit mentir la boussole. Afin d’avoir en caisse le profit de l’annonce, on eut de la complaisance pour les livres annoncés ; la critique y perdit son crédit[9].
Le cercle devenait vicieux : le système de l’annonce s’élargit à une profusion de petites feuilles, souvent éphémères, qui profitent de l’inexistence d’un « copyright » sur les textes de journaux pour se piller les unes les autres. Dans la mesure où l’immense majorité des écrivains n’avaient d’autre choix pour continuer à vivre de leur plume que de se faire journalistes et de rédiger des critiques d’oeuvres écrites, elles aussi, par des écrivains devenus journalistes par nécessité, l’endogamie entre la presse et la littérature ne pouvait que s’auto-alimenter tout en engendrant une polémique sans fin sur la malhonnêteté de cet ensemble de pratiques. Ces phénomènes seraient trop longs à traiter dans le cadre de cet article ; je renvoie aux travaux de Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, Patrick Berthier, Marie-Ève Thérenty et autres[10] pour ce qui concerne les formes et les transformations — des cénacles romantiques à la bohème des brasseries — de la contestation de l’ordre médiatico-critique au XIXe siècle, avec ses « machines à gloire » et ses charlatanismes dénoncés sur les modes satiriques, épigrammatiques ou encore polémiques. 4) S’il n’échappe jamais, on comprendra pourquoi, à l’atmosphère de suspicion pesant sur la critique prostituée, un dernier modèle, moins souvent repéré, est également agissant tout au long du siècle. Il s’agit là d’une critique non plus prostituée mais « donnée » sans espoir de retour, préoccupée de dégager les qualités de l’oeuvre commentée et, par un glissement qu’il faudra étudier, de défendre l’oeuvre et son auteur non par appât du gain mais par affinité élective. C’est à cette critique toujours suspecte de virer malhonnête, à cette critique d’admiration, souvent partisane, sincèrement quoique stratégiquement admirative, que s’intéressera cet article.
La théorie romantique de la critique
La critique d’admiration a été précocement théorisée. Elle s’ancre en effet dans la théorie esthétique « symphilosophique » des romantiques allemands, dont l’idée maîtresse était de rendre la critique responsable d’une « intensification de conscience dans l’oeuvre » : son rôle consiste à découvrir les dispositions cachées de l’oeuvre même, à exécuter ses intentions secrètes, pour la dépasser, la compléter et la rendre absolue : « Pour les romantiques la critique est moins le jugement d’une oeuvre que la méthode de son achèvement[11] », écrit Walter Benjamin dans la thèse de doctorat qu’il a consacrée au sujet. Se saisissant de l’oeuvre, le critique devient lui-même créateur. On voit à quel point cette ambition élevée entre en contradiction avec le métier fondé sur l’urgence toujours renouvelée qu’est celui du journaliste. Pour Schlegel, dans l’Atheneäum, il ne saurait d’ailleurs être question d’une critique professionnelle, pas plus que d’une critique enfoncée dans la négativité, car le travail d’universalisation de l’oeuvre qu’elle doit s’assigner ne peut appartenir qu’à un poète, seul digne de pénétrer et d’interpréter l’oeuvre d’un autre poète : « La poésie ne peut être critiquée que par la poésie. Un jugement sur l’art qui n’est pas lui-même une oeuvre d’art […] n’a pas droit de cité au royaume de l’art[12]. »
Par l’intermédiaire du groupe de Coppet, certains écrivains français se sont saisis de cette conception de la fonction critique, moins médiatrice que créatrice, et ont tâché, sous l’Empire et la Restauration, de la ramener aux nécessités et aux dimensions de l’écriture périodique. L’essentiel, pour les cosmopolites de Coppet et leurs héritiers, est de rompre avec les habitudes de critique agressive qui avait prévalu au siècle du persiflage[13], tant parmi les philosophes que les anti-philosophes. A alors émergé, chez certains littérateurs qui se piquent de critique, la conception d’une critique compréhensive, qui sauvegarderait le plaisir de la lecture : « On glace tout, on anéantit la poésie par les raisonnements froids d’une métaphysique partiale et maligne, lit-on en 1817 dans le Cours analytique de littérature de Népomucène Lemercier. On se débat contre les talents, on flétrit les jouissances qu’ils donnent, on tue l’inspiration, on se rend incapable de la sentir. » Et de conseiller : « notre goût se formera mieux aujourd’hui en apprenant à discerner le beau et à l’admirer, qu’en nous exerçant à censurer sans relâche[14]. » Deux ans plus tard, Chateaubriand donne au nom du Conservateur la formulation définitive de ce que sera la théorie romantique de la critique :
Il était utile, sans doute, au sortir du siècle de la fausse philosophie, de traiter rigoureusement des livres et des hommes qui nous ont fait tant de mal, de réduire à leur juste valeur tant de réputations usurpées, de faire descendre de leur piédestal tant d’idoles qui reçurent notre encens en attendant nos pleurs. Mais ne serait-il pas à craindre que cette sévérité continuelle de nos jugements ne nous fît contracter une habitude d’humeur dont il deviendrait malaisé de nous dépouiller ensuite ? Le seul moyen d’empêcher que cette humeur prenne sur nous trop d’empire, serait peut-être d’abandonner la petite et facile critique des défauts, pour la grande et difficile critique des beautés[15].
La génération romantique de 1820, élevée au lait des paroles du « grand sachem », s’est alors emparée de cette théorie et a tenté de la systématiser, de la propager et, exercice qui va s’avérer périlleux, de la mettre en pratique. Victor Hugo en particulier développera sans cesse, depuis la préface de Cromwell jusqu’à William Shakespeare, l’idée de son grand-père spirituel et en fera même la réponse du génie orgueilleux à l’âge envieux : « Admirer. Être enthousiaste. Il m’a paru que dans notre siècle cet exemple de bêtise était bon à donner. […] Quant à moi, qui parle ici, j’admire tout comme une brute[16]. » Plus profondément, il y a là une tentative du mage romantique pour accorder à la critique un statut aussi enviable que celui de la poésie ou du drame : à peuple nouveau, littérature nouvelle, et à littérature nouvelle, critique nouvelle, aurait pu écrire Hugo en paraphrasant son propre credo révolutionnaire. La préface de Cromwell, au milieu de vifs reproches à la critique telle qu’elle se fait, prophétise ainsi l’avènement d’un art critique — « une critique franche, savante, une critique du siècle[17] » digne des principes de l’art poétique énoncés tout au long de la préface. Appelant Chateaubriand à son secours, Hugo assène : « Il est temps que tous les bons esprits saisissent le fil qui lie fréquemment ce que, selon notre caprice particulier, nous appelons défaut à ce que nous appelons beauté. » Puis il conclut : « Nous touchons donc au moment de voir la critique nouvelle prévaloir, assise, elle aussi, sur une base large, solide et profonde[18] ».
La critique de cénacle
Ce sont bien là les principes d’une critique qui délaisse le jugement aisé et renonce à « questionner le poète sur sa fantaisie[19] » en vue de la lui reprocher. Cette critique-là, au contraire, privilégie l’interprétation initiée et initiante de l’oeuvre que le critique, idéalement, a vu naître[20]. C’est là que réside le point nodal par lequel on peut sans doute expliquer à la fois la persistance des déclarations d’intentions et la difficulté de mise en oeuvre d’une telle critique. D’un côté, pour être à même de comprendre et d’interpréter en profondeur l’oeuvre commentée, le critique a tout bénéfice à connaître les intentions de l’auteur, à avoir assisté, voire contribué, à la naissance de l’oeuvre. De l’autre côté, le statut médiateur de la critique devient crucial dans le cadre de l’émergence de mouvements littéraires soucieux de transmettre des éléments de doctrine. Pour toucher, comme y aspirent les cénacles, à la consécration collective par l’accumulation de consécrations individuelles, pour multiplier le capital symbolique de chaque cénaclier dans un capital symbolique collectif[21], la critique d’admiration constitue une activité stratégique de premier plan[22]. Ce caractère stratégique s’affirme d’autant plus que le compte rendu — sous-entendu élogieux — se demande couramment comme un service, un gage d’amitié : « Ladvocat me promet encore de votre part un article signé Ch. Nodier dans La quotidienne, écrit le jeune Victor Hugo. Est-ce que je dois croire à tant de bonté ? Est-ce que l’aigle consentira à juger le vol du moineau franc[23] ? » Sur un tout autre ton, Albert Glatigny écrit à Eugène Vermersch lors de la réédition de ses recueils de poèmes chez Lemerre :
Je pourrais [te] demander un tome à la louange de ces poésies merveilleuses, et l’in-folio serait de rigueur. Que dis-je ! ce serait laisser encore trop peu de champ à ta légitime admiration !... donc, je te rends ta liberté. Toutefois, aussitôt que Lemerre aura remis ès mains de ta flagornerie le susdit chef-d’oeuvre, […] tu t’empresseras de chanter en mon nom un Te Deum, faible signe de ta joie, dans tous les journaux ridicules où tu peines[24].
La sollicitation brise la logique du don dans le cadre privé mais renforce la logique stratégique. Et voilà justement ce qui rend la critique de cénacle impraticable, dans la mesure où la fonction sociale même du critique s’y abolit pour préparer celles de l’exégète, de l’interprète, du médiateur. Dans le climat d’auto-ethnographie polémique de la vie littéraire qui caractérise le XIXe siècle français, le soupçon de complaisance pèsera sans cesse sur la critique d’admiration et engendrera parmi ses tenants une mauvaise conscience bien souvent insurmontable. Quelle frontière tracer en effet entre la solidarité cénaculaire, l’échange de capital symbolique sous sa forme minimale de l’échange de bon procédé, et la rétention pure et simple du jugement ? Comment une pratique périodique de la critique peut-elle se rendre digne de la théorie qui la sous-tend et comment distinguer dans la pratique entre critique d’admiration et critique de complaisance ? Autant de dilemmes insolubles qui expliquent sans doute, à l’heure où il était le critique attitré de Hugo, les réticences de Sainte-Beuve à fonder un journal du cénacle romantique : « si nous avions un journal, confiait-il à Juste Olivier, l’amitié, le bon goût nous engageraient à louer les ouvrages de ceux qui partagent nos opinions, sans que nous n’y comprenions rien[25] ». Sainte-Beuve, on le sait, se reprochera toute sa vie d’avoir ainsi cédé à l’enthousiasme cénaculaire :
En général, écrira-t-il dans ses Cahiers, dans cette école dont j’ai été depuis la fin de 1827 jusqu’à juillet 1830, ils n’avaient de jugement personne, ni Hugo, ni Vigny, ni Nodier, ni les Deschamps ; je fis un peu comme eux durant ce temps ; je mis mon jugement dans ma poche et me livrai à la fantaisie. […] Je m’efforçais cependant, sous forme indirecte (la seule qui fût admise en ce cercle chatouilleux) d’éclairer, de rectifier la marche, d’y apporter des enseignements critiques, et dans la manière dont je présentais mes amis poètes au public, je tâchais de leur insinuer le vrai sens où ils devaient se prendre eux-mêmes, se diriger pour assurer à leurs talents le plein succès.[26]
L’embarras gagne également les critiques littéraires plus occasionnels quand il s’agit de reconnaître que la ligne de partage entre amitié — c’est-à-dire, en contexte, solidarité cénaculaire — admiration et critique s’efface. Déjà au temps de La Muse française, Émile Deschamps fait amende honorable devant ceux qui accusent les romantiques
de nous aimer entre nous et d’en faire confidence à tout le monde […] ; je passe condamnation. Je ne puis cacher que nous nous aimons, et que nous aimons la poésie comme si nous n’avions pas fait un vers de notre vie. Ce n’est pas la moins bizarre de nos innovations littéraires[27].
Six ans plus tard, on peut lire dans La tribune romantique, éphémère revue issue des rangs du cénacle hugolien :
« Les écrivains de l’école nouvelle s’admirent et se flattent mutuellement les uns les autres, parce qu’ils s’aiment. » — Voilà un grand mal en effet ; mais ne serait-ce pas plutôt le contraire, et ne se sont-ils pas aimés, parce qu’ils s’admiraient ? N’est-ce pas le rapport de leurs talents qui a entraîné la sympathie de leurs affections[28] ?
Puis, lors de la renaissance parnassienne de l’institution cénaculaire, Catulle Mendès justifie à son tour la camaraderie critique :
On a dit aussi : ils s’admirent les uns les autres. Cela est vrai, ils le confessent naïvement ; et le contraire seul pourrait donner lieu à quelque surprise, puisque leur amitié a pris source dans une ardente estime réciproque. Admirer un poète parce qu’il est votre ami, est absurde ; mais ne pas oser l’admirer, parce qu’il est devenu votre ami, serait coupable[29].
Déclarations faussement assurées et aveux gênés témoignent qu’entre la critique stimulée par l’admiration et la critique entachée par la camaraderie, il n’y a que la mince frontière d’une sincérité indécidable.
Persistance d’une illusion perdue
Quoiqu’il en soit des éventuelles dérives cénaculaires, Chateaubriand et Hugo ont, du haut de leur autorité, établi le principe d’une critique littéraire visant à l’autonomisation du champ littéraire. La critique qu’ils préconisent se met en effet au service non plus d’un public à instruire et à guider ou d’un champ journalistique pourvu ou dépourvu de sa déontologie propre, mais d’une littérature, ou plutôt du fantasme d’une littérature, avec laquelle elle a partie liée, qu’elle intègre pleinement. Pierre Bourdieu remarque que
les progrès du champ de production restreinte vers l’autonomie se marquent par la tendance de la critique (qui se recrute pour une part importante dans le corps même des producteurs) à se donner pour tâche non plus de produire les instruments d’appropriation toujours plus impérativement exigés par l’oeuvre à mesure qu’elle s’éloigne du public, mais de fournir une interprétation « créatrice » à l’usage des « créateurs »[30].
La critique des beautés apparaît bien alors comme la première expression de cette critique créatrice pour créateurs, en tout point opposée à la critique de journalistes pour consommateurs de livres. Du moins dans son principe, parce qu’elle ne parviendra jamais, à l’inverse des autres modèles imaginaires énumérés plus haut, à prendre consistance. Les défections successives de Nodier, Planche, Sainte-Beuve et de tous ceux qui ont oeuvré par la critique pour la cause romantique montrent que la critique, qui devait être la forme de solidarité la plus efficiente au sein du mouvement romantique, en a été la moins contrôlable.
La formulation, plusieurs fois réitérée au cours du XIXe siècle, de cet idéal de la critique donnée mais non aliénée, se fera donc généralement sous forme déceptive. Ainsi en 1836 Gustave Planche, d’abord hugolâtre fanatique, devenu impitoyable hugophobe, imagine dans son article « Les amitiés littéraires » une quasi-fiction à clés mettant en scène un poète novateur en marche vers la gloire (Victor Hugo) et un critique, son confident, son interprète, qui le conseille et l’oriente. Planche affirme d’abord l’intérêt pour les deux intervenants de cette fréquentation intime : le poète d’un côté,
[f]orcé de s’expliquer à celui qui reçoit les premières confidences de son génie, amené sans effort et sans contrainte à dérouler devant lui tous les mystères de sa volonté, […] arrive à se mieux comprendre lui-même[31] ;
le critique, de l’autre côté,
[e]n le voyant à l’oeuvre, en assistant chaque jour aux progrès de la pensée qui est née sous ses yeux, en surveillant avec une attention assidue l’épanouissement et la floraison du germe déposé dans le sol fécond de la réflexion, […] acquiert fatalement une subtilité d’interrogation, une précision de curiosité qu’il n’aurait jamais pu atteindre, s’il n’avait eu devant lui l’expérience vivante de la poésie, le spectacle intérieur d’une intelligence aux prises avec l’inspiration[32].
Planche avance ensuite une manière de profession de foi :
Il est donc vrai que le poète et le critique, en vivant dans une intime familiarité, s’instruisent mutuellement et agrandissent chaque jour le champ de leur pensée. Il est donc vrai que l’inspiration, surveillée par la réflexion, et la réflexion, fécondée par le spectacle permanent de l’inspiration, se doivent une mutuelle reconnaissance[33].
Hélas, le temps joue contre les amitiés littéraires, et à mesure que le poète passe de l’obscurité à la gloire et de la gloire à l’apothéose, il supporte moins l’aiguillon amical mais honnête, la médiation attentive de son ancien ami. Ainsi s’expliquent selon Planche, premier grand critique littéraire du XIXe siècle à n’être pas écrivain-journaliste, les reproches dont souffre la profession de critique. Le contre-mythe du journaliste véhiculé dans le discours littéraire, notamment dans la toute récente préface de Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, est selon Planche attribuable, par un étrange renversement, à la seule ingratitude des écrivains :
C’est pour avoir méconnu cette vérité incontestable que les poètes d’aujourd’hui ont proféré contre leurs juges des reproches si amers et si injustes ; c’est pour avoir nié comme imaginaire cette fraternité intellectuelle, qu’ils ont prononcé le mot si singulier d’ingratitude[34].
Quarante ans plus tard, dans son article « La critique contemporaine », Émile Zola s’exprime à son tour sur cette alliance subjective entre l’écrivain et le critique. Pour Zola, écrivain-journaliste et chef de file d’une école littéraire en pleine légitimation, l’interaction entre ces deux rôles sociaux ne se pense pas cependant, comme chez Planche, de façon égalitaire. Elle s’inscrit aussi dans le cadre plus large de la « génération » d’écrivains :
Chaque génération, chaque groupe d’écrivains a besoin d’avoir son critique qui le comprenne et le vulgarise. […] Les écoles littéraires demandent des combattants d’avant-garde, des trompettes qui annoncent et qui fassent ranger la foule, pour leur ouvrir un large passage. […] Il est, en un mot, un des soldats du groupe qui a dans le cerveau plus de compréhension que d’invention, et qui se résigne au rôle de porter le drapeau, pendant que les autres se battent[35].
Mais là encore le voeu de rapprochement entre critique et littérature s’accompagne de l’aveu de son échec, et Zola doit reconnaître que ce porte-drapeau, le naturalisme ne l’a pas encore trouvé et qu’il ne le trouvera sans doute jamais.
C’est sur le mode du regret de la camaraderie, vice si souvent relevé et condamné autour de 1830, que l’idéal de la critique donnée se maintiendra principalement. Dès 1844, lors de la reprise de la comédie de Scribe La camaraderie ou la courte échelle, Théophile Gautier s’exclame :
Hélas ! si la camaraderie existait, ce serait, non pas une satire, mais un dithyrambe qu’elle mériterait. Nous croyons peu, pour notre part, à ces assurances mutuelles de succès ; on est trop inquiet et trop jaloux, dans ce temps, pour se prêter, même à charge de revanche, à la réussite d’un autre. On aurait trop peur que, parvenu au faîte, il ne renversât sur vous l’échelle que vous lui teniez. […] Il n’y a plus, d’ailleurs, ni camarades ni ennemis, on n’a plus la force ni d’aimer ni de haïr[36].
Jules Claretie écrit à son tour en 1881 :
Nos aînés étaient plus heureux. Ils se montraient moins solitaires. Ils s’aimaient. Ils s’entr’aidaient. La camaraderie, dont on a trop médit, la camaraderie, — suprême ressource des médiocres, mais qui après tout est une forme de l’amitié comme le chauvinisme est une des variétés du patriotisme, — la camaraderie n’existe plus. Nos aînés, peintres ou poètes, se partageaient la renommée comme on le ferait d’un manteau de pourpre. Nous nous disputons un peu de gloire comme des chiens s’arracheraient un os[37].
Bassesse, hypocrisie, veulerie, telles sont les travers relevés par les écrivains désormais établis qui se souviennent de leur jeunesse — ou qui rêvent celle des autres — et qui regrettent en tous les cas le temps glorieux des combats acharnés et des amitiés admiratives qui survivaient à la profession de critique. Il ne s’agit plus alors, comme en 1830, de défendre la camaraderie littéraire ou de s’en défendre, mais de signifier son acte de décès : puisque la jalousie, l’hypocrisie, la prostitution de la pensée, forment désormais la norme, la camaraderie critique, impraticable au présent, presque irreprésentable, devient l’exception à préserver et le symbole d’un âge d’or révolu, directement opposable à la décadence présente.
Appendices
Note biographique
Anthony Glinoer
Anthony Glinoer est professeur adjoint à l’Université de Toronto. Il a publié Naissance de l’éditeur. L’édition à l’âge romantique (en collaboration avec Pascal Durand, Bruxelles, Impressions Nouvelles, 2008) et La querelle de la camaraderie littéraire. Les romantiques face à leurs contemporains (Genève, Droz, 2008). On lui doit également des travaux consacrés à Sainte-Beuve : des éditions critiques de Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (en collaboration avec Jean-Pierre Bertrand, Paris, Bartillat, 2004) et de sa Correspondance avec Victor Hugo (Paris, Honoré Champion, 2004) ainsi que le volume collectif Sainte-Beuve : le sens du moderne (en collaboration avec Jean-Pierre Bertrand, Toronto, Centre d’études du XIXe siècle français Joseph Sablé, 2008).
Notes
-
[1]
Charles Asselineau, Le paradis des gens de lettres selon ce qui a été vu et entendu (1861), Paris, Poulet-Malassis, 1862, p. 27-28.
-
[2]
La recherche présentée dans cet article a bénéficié d’une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines.
-
[3]
Voir José-Luis Diaz, L’écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Honoré Champion (Romantisme et modernités), 2007.
-
[4]
Jules Barbey d’Aurevilly, « Sainte-Beuve », 1887, p. 60.
-
[5]
Alain Vaillant, « Avant-propos » du dossier « La littérature fin-de-siècle au crible de la presse quotidienne », Romantisme, 2003, p. 4.
-
[6]
Voir la pénétrante analyse de Georg Lukàcs dans Balzac et le réalisme français, Paris, La Découverte, 1999 [1935] (trad. P. Laveau).
-
[7]
Stendhal, « Lettre au rédacteur du Globe » [6 décembre 1825], 1967, p. 75.
-
[8]
On lit par exemple sous la plume d’Edmond Rochefort : « Charles Nodier s’est arrangé avec Ladvocat pour annoncer les ouvrages que publie ce libraire et faire des articles de journaux. Il a pour cela 500 francs par mois » (cité dans Victor Hugo, Correspondance croisée de Victor Hugo & Charles Nodier, 1987, p. 26, note 3).
-
[9]
Sainte-Beuve, « De la littérature industrielle », 1992 [1839], p. 207-208.
-
[10]
Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, L’écrivain-journaliste au XIXe siècle : un mutant des lettres, Saint-Étienne, Éditions des Cahiers Intempestifs (Lieux littéraires), 2003 ; Patrick Berthier, La presse littéraire et dramatique au début de la Monarchie de Juillet (1830-1836), Lille, Éditions Universitaires du Septentrion, 1997, 4 vol. ; Marie-Ève Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, Honoré Champion (Romantisme et modernités), 2003 ; voir aussi Anthony Glinoer, La querelle de la camaraderie littéraire. Les romantiques face à leurs contemporains, 2008 ; Jean Marie Goulemot et Daniel Oster, Gens de lettres, écrivains et bohèmes, Paris, Minerve, 1992.
-
[11]
Walter Benjamin, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, 1986 [1920], p. 113.
-
[12]
Ibid., p. 112.
-
[13]
Voir Élisabeth Bourquinat, Le siècle du persiflage, Paris, Presses Universitaires de France (Perspectives littéraires), 1998.
-
[14]
Népomucène Lemercier, Cours analytique de littérature, 1817, cité dans Raphaël Molho, La critique littéraire en France au XIXe siècle, 1963, p. 53.
-
[15]
François-René de Chateaubriand, « Sur les Annales littéraires, ou De la littérature avant et après la Restauration ; ouvrage de M. Dussault », Le Conservateur, 19e livraison (1819), p. 247-248. En 1831, dans une « Lettre au directeur de L’Artiste », Achille Devéria tient le même discours : « Il faut croire que la découverte du côté ridicule en tout a quelque chose de bien séduisant, puisque tant de gens ont préféré le plaisir de montrer leur esprit satirique à la tâche moins facile, mais infiniment plus honorable, de faire comprendre et de développer les qualités qui se trouvent dans les oeuvres remarquables » (Achille Devéria, « Au directeur de L’Artiste », L’Artiste, 27 mars 1831, p. 97).
-
[16]
Victor Hugo, William Shakespeare (1864), Oeuvres complètes : critique, 2002, p. 381.
-
[17]
Victor Hugo, Préface de Cromwell (1827), Oeuvres complètes : critique, 2002, p. 37.
-
[18]
Ibid., p. 37-38.
-
[19]
Victor Hugo, Préface des Orientales (1829), Oeuvres complètes : poésies, 1985, p. 411.
-
[20]
Raphaël Molho a proposé une interprétation stimulante de l’avènement de cette nouvelle tendance de la critique en l’attribuant à l’attrait du romantisme pour la diversité, pour la nature incessamment changeante du beau en rupture avec l’esthétique classique de la beauté immuable : « L’oeuvre d’art devenant l’expression d’une humanité toujours changeante, et toujours diverse, les critiques vont se charger de mettre au jour le degré d’originalité de chaque oeuvre et sa beauté », beauté spécifique à un lieu et un temps, « moderne » au sens de Stendhal et indépendante de tout modèle invariant. La fonction des critiques s’en trouve transformée : « ils comprennent, ils expliquent, ils admirent : ils ne jugent plus, ou du moins, ils ne jugent chacun qu’en fonction de lui-même. » Dans la lignée immédiate de l’idéalisme allemand, « la critique devient une conscience de l’art, une conscience que l’artiste doit interroger sans cesse avec inquiétude pour se comprendre lui-même et pour comprendre le temps en vue duquel il écrit » (La critique littéraire en France au XIXe siècle, op. cit., p. 10-11). Cette analyse d’ensemble colle de très près à la métaphore d’une critique insinuante et mobile dont Sainte-Beuve se fait le chantre dans Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme, Paris, Bartillat, 2004 [1829] (éd. J.-P. Bertrand et A. Glinoer).
-
[21]
Sur cette question, voir mon article « De la solidarité et du don. Les stratégies cénaculaires d’écriture à l’époque romantique », dans D. Ribard et N. Schapira (dir.), Stratégies sociales et gestes d’écriture, Paris, Presses universitaires de France, à paraître en 2010.
-
[22]
« Un noeud plus étroit qu’on ne pense rattache aux oeuvres poétiques de M. Victor Hugo les recherches de critique et d’histoire de M. Sainte-Beuve. L’un est en effet le critique de l’école dont l’autre est le chef », écrit par exemple Charles de Rémusat dans son compte rendu du Tableau de la poésie française publié dans la Revue française, n° 8 (janvier 1829), p. 54.
-
[23]
Lettre de Victor Hugo à Charles Nodier, 8 mars 1824. Voir Victor Hugo, Correspondance croisée de Victor Hugo & Charles Nodier, op. cit., p. 26.
-
[24]
Cité par Job-Lazare, Albert Glatigny, Paris, Bécus, 1906, p. 166-167.
-
[25]
Juste Olivier, Paris en 1830. Journal, 1941, p. 207.
-
[26]
Charles-Augustin Sainte-Beuve, Les cahiers, 1876, p. 40-41.
-
[27]
Émile Deschamps, « La guerre en temps de paix », La Muse Française, 1909 [1824], p. 274.
-
[28]
Anonyme, « “Les Consolations” (Poésies) », La tribune romantique, 1830, p. 205, repris dans Anthony Glinoer, La querelle de la camaraderie littéraire, op. cit., p. 105-107.
-
[29]
Catulle Mendès, « La Poésie », L’Artiste, 1er janvier 1868, cité par Yann Mortelette, Le Parnasse, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (Mémoire de la critique), 2006, p. 99-100.
-
[30]
Pierre Bourdieu, « Le marché des biens symboliques », 1972, p. 56-57.
-
[31]
Gustave Planche, « Les amitiés littéraires », 1836, repris dans Anthony Glinoer, op. cit., p. 167.
-
[32]
Id.
-
[33]
Ibid., p. 168.
-
[34]
Ibid., p. 170-171.
-
[35]
Émile Zola, « La critique contemporaine », repris dans Documents littéraires, 1926, p. 333-335.
-
[36]
Théophile Gautier, « Théâtre-Français. Reprise de La camaraderie », 1844, p. 231 (je souligne). Il écrivait déjà lors de la reprise d’Hernani : « une chose encore distingue cette époque : c’est l’absence d’envie et de jalousie littéraires ; l’on s’aimait et l’on s’admirait franchement » (article de La Presse du 15 juin 1841, repris dans Théophile Gauthier, Victor Hugo / Théophile Gauthier, 2000, p. 107).
-
[37]
Jules Claretie, La vie à Paris, 1881, p. 440-441. Ou encore sous la plume des Goncourt : « Causerie sur 1830. Pour nous donner l’idée et le goût du courant de pensées, de la confraternité, des folies enfantines et généreuses, de l’atmosphère des choses ridicules et grandes, de la fièvre, hélas ! qui circulait alors et poussait tous les coeurs, de Belloy raconte cette anecdote. » L’anecdote concerne la représentation d’Hernani. (Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, 1989, p. 334, note du 14 mars 1858).
Références
- Asselineau, Charles, Le paradis des gens de lettres selon ce qui a été vu et entendu, Paris, Poulet-Malassis, 1862.
- Barbey d’Aurevilly, Jules, « Sainte-Beuve », Les oeuvres et les hommes, t. 6 : Les critiques, ou Les juges jugés, Paris, Finzine et Cie, 1887, 1re série, p. 43-79.
- Benjamin, Walter, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, Paris, Flammarion (Champs), 1986 [1920].
- Bourdieu, Pierre, « Le marché des biens symboliques », L’année sociologique, vol. 22 (1972), p. 49-126.
- Chateaubriand, François-René de, « Sur les Annales littéraires, ou De la littérature avant et après la Restauration ; ouvrage de M. Dussault », Le Conservateur, 19e livraison, t. 2, 1819, p. 241-252.
- Claretie, Jules, La vie à Paris, Paris, Havard, 1881.
- Devéria, Achille, « Au directeur de L’Artiste », L’Artiste, 27 mars 1831, p. 97-98.
- Deschamps, Émile, « La guerre en temps de paix », La Muse française, 11e livraison (mai 1824), Paris, Cornély, 1909, t. 2 (éd. J. Marsan), p. 274.
- Gautier, Théophile, « Théâtre-Français. Reprise de La camaraderie », La Presse, 15 juillet 1844.
- Gautier, Théophile, Victor Hugo / Théophile Gauthier, Paris, Honoré Champion (Textes de littérature moderne et contemporaine), 2000 (éd. Françoise Court-Pérez).
- Glinoer, Anthony, La querelle de la camaraderie littéraire. Les romantiques face à leurs contemporains, Genève, Droz (Histoire des idées et critique littéraire), 2008.
- Goncourt, Edmond et Jules de, Journal. Mémoires de la vie littéraire, Paris, Robert Laffont (Bouquins), 1989, t. 1.
- Hugo, Victor, Correspondance croisée de Victor Hugo & Charles Nodier, Châteauneuf-sur-Charente, Plein Chant (L’atelier furtif), 1987 (éd. J.-R. Dahan, Bassac).
- Hugo, Victor, Préface de Cromwell (1827), Oeuvres complètes : critique, Paris, Laffont (Bouquins), 2002 (éd. Jean-Pierre Reynaud), p. 3-44.
- Hugo, Victor, Préface des Orientales (1829), Oeuvres complètes : poésies, Paris, Laffont (Bouquins), 1985, t. 1 (éd. Guy Schoeller), p. 411-414.
- Hugo, Victor, William Shakespeare (1864), Oeuvres complètes : critique, Paris, Laffont (Bouquins), 2002 (éd. Jean-Pierre Reynaud), p. 245-463.
- Job-Lazare (pseudonyme d’Émile Kuhn), Albert Glatigny, Paris, Bécus, 1906.
- Olivier, Juste, Paris en 1830. Journal, Paris, Mercure de France, 1941 (éd. A. Delattre et M. Denkinger).
- Molho, Raphaël, La critique littéraire en France au XIXe siècle, Paris, Buchet / Chastel (Le vrai savoir), 1963.
- Mortelette, Yann, Le Parnasse, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (Mémoire de la critique), 2006, p. 99-100.
- Rémusat, Charles de, «Tableau de la poésie française par M. Sainte-Beuve », Revue française, n° 8 (janvier 1829) , p. 54.
- Sainte-Beuve, Charles-Augustin, Les cahiers, Paris, Lemerre, 1876.
- Sainte-Beuve, Charles-Augustin, « De la littérature industrielle », Pour la critique, Paris, Gallimard (Folio /Essais), 1992 [1839], (éd. A. Prassoloff et J.-L. Diaz), p. 197-222.
- Stendhal, « Lettre au rédacteur du Globe » [6 décembre 1825], Correspondance, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1967, t. 2 (éd. V. Del Litto et H. Martineau), p. 74-75.
- Vaillant, Alain, « Avant-propos » du dossier « La littérature fin-de-siècle au crible de la presse quotidienne », Romantisme, n° 121 (2003), p. 3-8.
- Zola, Émile, « La critique contemporaine », repris dans Documents littéraires, Paris, Fasquelle, 1926, p. 35-359.