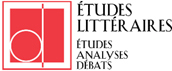Abstracts
Résumé
À partir de la figure exemplaire de Louis Sébastien Mercier (1740-1814), cet article se propose de présenter ce qui, dans la double fonction d’homme de lettres et de journaliste, crée un malaise entre un discours contre le journalisme et une pratique bien réelle du périodique. Le passage chez l’auteur d’une écriture littéraire à une écriture journalistique nous est d’abord présenté comme allant de soi, tant par la mission sociale que le polygraphe s’est donnée que par sa pratique scripturale qui participe déjà d’une réflexion sur la représentation du quotidien. Le résultat de ce passage est toutefois inconfortable puisqu’il y a une réelle incompatibilité entre les critiques que formule Mercier à l’égard des journalistes et une participation de plus en plus nourrie aux journaux de l’époque. Se dessine ainsi un écartèlement qui obligera l’auteur à créer un équilibre entre ces deux postures inconciliables, et ce, par la justification qu’il fera de son utilisation de la presse.
Abstract
In this article, the example of writer-cum-journalist Louis Sébastien Mercier (1740-1814) illustrates the uncomfortable dichotomy between criticising journalistic writing and contributing to it. Mercier’s switching from literary to journalistic writing is at first considered only natural, given this versatile scribe’s social mission and his established written ability to depict everyday life. However, such a switch is an awkward one given the documented opposition between Mercier’s criticism of journalists and his growing collaboration with their milieu. As well, being torn thusly will force Mercier to reach some balance point between these two irreconcilable extremes, in the form of a self-justification of his recourse to printed periodicals.
Article body
Dès ses premiers balbutiements, la double fonction d’écrivain et de journaliste a contraint les auteurs à se mouvoir dans un espace où ils étaient pris entre, d’une part, un discours idéalisé sur l’homme de lettres et un mépris unanime à l’égard des journalistes et, d’autre part, une écriture qui participe de ces deux métiers tout en les donnant à voir comme bien distincts : l’un considéré comme noble ; l’autre, roturier. Si le XIXe siècle voit davantage se préciser la figure de l’écrivain-journaliste — qu’il s’agisse de Balzac, Nerval ou Gaston Leroux —, il n’en demeure pas moins que ces auteurs doivent vivre avec un double statut qui génère fort souvent, et encore de nos jours, bon nombre de commentaires négatifs. Afin de présenter le malaise que suscite chez les auteurs la pratique de ces deux activités difficilement conciliables, nous nous intéresserons aux écrits de Louis Sébastien Mercier, polygraphe exemplaire de cet écartèlement nécessaire mais périlleux entre l’homme de lettres prononçant un discours continu contre le journalisme et sa participation pourtant bien réelle aux périodiques de l’époque.
La question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante : si le double emploi d’écrivain et de journaliste crée des tiraillements, pourquoi tant d’auteurs s’y adonnent-ils ? En ce qui concerne plus précisément Mercier, trois facteurs principaux expliquent le déplacement d’une pratique littéraire à une pratique journalistique : sa définition de l’homme de lettres, sa pratique scripturale et son inscription au sein de la bohème littéraire.
Nous présenterons brièvement la définition que donne l’auteur de sa mission, pour nous attarder ensuite à la nature de sa pratique scripturale qui se trouve fortement imprégnée du rôle que doit jouer, selon lui, tout bon homme de lettres. Si ces deux premiers éléments ne paraissent pas, d’emblée, très convaincants pour opérer un glissement de la fonction de littérateur à celle de journaliste, en ce qui concerne Mercier, ils contribuent fortement à l’inscription de ses textes au sein des périodiques. Également, le choix de l’auteur d’utiliser le support du journal, avec tous les préjugés qui en découlent, n’est sûrement pas étranger au fait qu’il n’a pas obtenu de rente ou de pension[1], ce qui l’a obligé à utiliser sa plume comme moyen de subsistance[2]. L’auteur fait indubitablement partie, qu’il le veuille ou non, de cette cohorte d’écrivains qui doivent trouver quotidiennement, à partir de leurs écrits, la matière qui leur permettra de survivre.
Définition d’une mission, pratique scripturale et statut social sont donc étroitement liés pour donner à voir un auteur pris entre ses préjugés contre les « folliculaires » et la paternité de ses écrits journalistiques, choix de vie qui le force à marcher, tel un funambule, sur la mince ligne qui sépare un discours d’une pratique. À notre avis, c’est dans cette marche d’équilibriste que se trouve tout l’intérêt de la question du journalisme dans l’oeuvre de Mercier, c’est-à-dire tant par la forte parenté qui existe entre sa pratique journalistique et littéraire que par le propos qui entoure — et surtout qui justifie — ce double emploi. Cet aspect constituera d’ailleurs notre dernier point de réflexion.
Mission sociale et pratique scripturale
Mercier, qui exerça abondamment sa plume de 1763 à 1814, fait véritablement office de pont entre deux siècles, puisqu’il fait siennes à la fois une définition traditionnelle de l’homme de lettres et une vision très moderne de la liberté stylistique, cette dernière étant présentée comme ne pouvant se vivre qu’en dehors de tout dogme académique ou de toute autre appartenance à un corps littéraire. Dans la mesure où, selon lui, la question poétique est personnelle[3], l’homme de lettres sera essentiellement défini en fonction de la mission morale et sociale qu’il doit accomplir. Ce faisant, l’aspect esthétique ne sera effleuré que pour préciser qu’il s’agit du domaine exclusif de l’imagination et de l’invention et qu’aucune loi ne peut prétendre le régir : « Vous êtes auteurs puisque vous pensez [;] écrivez, n’ayez ni maîtres, ni modèles[4]. »
Du discours sur Le bonheur des gens de lettres (1763) jusqu’à la Néologie (1801), en passant par un texte phare comme De la littérature et des littérateurs (1778), la définition d’un bon écrivain que donne Mercier demeure la même, malgré les grands bouleversements de l’Histoire qu’il connaîtra durant les vingt-cinq dernières années de sa vie. Pour la définir brièvement, la mission de l’homme de lettres qu’il propose consiste à rendre le monde meilleur grâce à la dénonciation des injustices et des abus dont sont victimes ses contemporains, qu’il s’agira de diffuser à intervalles courts et de mettre dans le plus grand nombre de mains. Véritable « Dieu tutélaire qui s’est chargé des intérêts de la patrie, […] qui défend la cause honorable de l’humanité [et qui] rejette le cri insensé de l’opinion pour faire parler la voix immortelle de la raison[5] », un auteur digne de ce nom a un devoir envers ses contemporains qui va bien au-delà d’une simple distraction fictionnelle. Aussi n’est-il pas surprenant de constater que la volonté de Mercier de fournir le plus souvent possible de l’information influente pour le mieux-être de l’humanité contribue fortement à la tentation de la feuille périodique apparue très tôt dans sa vie. Et quelle meilleure façon de « voiturer [s]es idées[6] » que par leur impression désormais quotidienne grâce, notamment, au Journal de Paris. Ce n’est certes pas un hasard si le premier quotidien de France compte Mercier au rang de ses fidèles collaborateurs[7].
Voilà donc notre écrivain « pla[çant] la récompense de [ses] travaux dans l’amélioration des projets pour le bien public » et qui se targue d’écrire en ayant « toujours devant les yeux, la Patrie & l’Humanité[8] ». Que lui importe d’écrire sur les anciens Grecs, Romains ou Égyptiens ! Il s’est « occupé de la génération actuelle et de la physionomie de [s]on siècle, parce qu’il est bien plus intéressant pour [lui][9] ». Ce souci constant de rendre compte du présent, de l’ici et du maintenant le pousse à définir tout bon auteur comme un énonciateur-dénonciateur des tares actuelles et, ce faisant, il annonce d’emblée son implication dans les journaux de la période révolutionnaire, quand tout appellera une participation quotidienne à la diffusion d’informations.
Bien établir sa mission d’homme de lettres et s’y tenir sa vie durant est une chose, mais parallèlement à cette tâche, il importe d’avoir — ou de développer — une poétique qui saura la servir au mieux. Dans le cas de Mercier, les deux se complètent à la perfection puisque sa pratique d’écriture participe déjà d’une représentation du quotidien liée davantage au témoignage, au reportage, à l’enseignement moral et à un profond souci anthropologique qu’à une réelle intention de fiction[10]. En ce sens, l’auteur ne pouvait mieux faire coïncider poétique et mission : quasi-concomitantes dans les premiers écrits, l’une et l’autre sont complémentaires.
L’intérêt flagrant de Mercier pour l’écriture brève influencera aussi sa participation aux journaux de l’époque. Dès ses premiers écrits, on perçoit un amour certain pour le fragment qui ne se démentira guère durant toute sa carrière de littérateur. Bien qu’il aime à écrire des ouvrages volumineux, ils ne sont pour la plupart qu’un rassemblement d’opuscules[11], c’est-à-dire un assemblage de courts chapitres, souvent exempts de véritables liens, qui ne contiennent parfois qu’une seule page, voire un seul paragraphe[12]. L’intérêt du court extrait coïncide également avec une constatation de l’auteur : « [i]l faut être court et précis, si l’on veut être lu aujourd’hui », puisque « bientôt nous ne lirons plus que sur des écrans[13] ». Qu’il s’agisse d’articles parus dans les journaux ou encore de notes de travail conservées dans le Fonds Mercier, la supériorité des brochures et des « pages » sur les livres est toujours flagrante :
Qu’est-ce qu’une bibliothèque pressée, serrée, brillante et dorée ? un véritable Mausolée. […] Vieilles idées c’est la reliure superbe qui vous couvre ; et vous jeunes idées vous appartenez à la brochure. […] [Le livre] est lourd dans la poche, il pèse dans la main. Ah ! qu’un livre soit toujours un souffle et non une brique[14].
On voit souvent revenir l’idée, sous diverses formes, que « plus le livre s’éloigne de la matière, plus il est livre[15] », car plus il est près de la page, plus l’accent est mis sur le contenu et non sur le contenant[16]. À la lecture de ces commentaires, il n’est guère surprenant de voir le littérateur privilégier la forme commode du journalisme : elle se transporte partout, elle est légère et passe aisément de main en main. En ce sens, la pratique scripturale de Mercier, courte, fragmentée, vive, ancrée dans le hic et nunc avec une préférence marquée pour les brochures et les feuillets détenait déjà les qualités nécessaires à la parution périodique. Et dans la mesure où les journaux sont accessibles à tous, voilà la mission de notre écrivain qui vient de trouver son véhicule idéal.
Du préjugé à la pratique
Le passage d’une fonction à l’autre est pourtant difficile. C’est que le polygraphe, tout à fait de son temps, dénigre le métier de journaliste comme étant un dérivé honteux de la posture plus noble d’homme de lettres. De ce point de vue, et comme le précise Philippe Roger, il est « représentatif d’une foncière méfiance de “l’homme de lettres” à l’encontre de ces journalistes dont le nom même sonne comme une insulte[17] ». Si Mercier a en horreur la satire et les querelles contenues dans les journaux, sa haine à l’égard des « feuillistes » vise surtout deux types d’écrits : les journaux littéraires et, durant la période révolutionnaire, les journaux politiques.
L’hostilité de Mercier va surtout à ceux qui parlent d’un sujet sans le connaître, qui jugent un livre sans l’avoir lu ou qui se servent des périodiques comme outil de propagande auprès de la multitude. Près d’une centaine de feuillets contenus dans ses notes de travail vilipendent d’ailleurs ces « faiseurs d’extraits », ces « feuillistes, folliculaires et apprentis satiriques » qui, aux dires de l’auteur, osent juger alors qu’ils ne savent même pas lire[18]. Pour lui, ces hommes sont devenus journalistes par défaut, simplement parce que, malgré leurs efforts, ils n’ont pas su accéder au digne titre d’écrivain[19]. À ce sujet, il ne se gêne pas de préciser : « Passer sa vie à décrier les talens d’autrui, n’est-ce pas avertir hautement le Public, qu’on voudroit cacher de cette manière ceux dont on manque[20] ». De même, la définition qu’il donne du journalisme dans De la littérature et des littérateurs n’a rien de flatteur : « celui-là avoit bien raison, qui a dit le premier, qu’une bonne injure est toujours mieux reçue & retenue, qu’un bon raisonnement ; voilà la Théorie du Journalisme tracée en deux mots[21]. »
Si l’auteur n’est guère tendre à l’égard de la plupart de ces « folliculaires », certains réussiront tout de même à obtenir quelques commentaires positifs. Véronique Costa précise d’ailleurs que « [l]es seuls périodiques dignes d’éloges sont des journaux affranchis des principes rigides et de la paralysante vénération du passé, accordant suprématie au jugement final du liseur[22]. » Ce parti pris s’explique fort bien par les nombreuses déclarations de Mercier selon lesquelles « c’est le lecteur qui fait le livre[23] », et qu’à partir du moment où l’on accepte ce précepte, « la plume du critique [se trouve] à jamais brisée[24] ». Les seuls qui obtiennent son suffrage sont donc justement ceux qui jugent l’oeuvre en fonction de leur lecture ; il s’agit de leur impression, de leur sensibilité, et non de jugements esthétiques marqués par des poétiques convenues.
Malgré ces rares moments de clémence, il n’en demeure pas moins que Mercier participe tout à fait de son époque, tant par ses commentaires généralement négatifs à l’endroit des feuilles périodiques et de leurs collaborateurs que par sa position sociale au sein de la bohème littéraire. Qu’est-ce à dire ? Simplement que l’auteur est pris entre la conviction d’être véritablement un digne homme de lettres — plusieurs commentaires disséminés dans son oeuvre en font foi — et la réalité de sa situation sociale qui fait de lui un être exclu des cercles prestigieux et associé à la foule des auteurs excentriques et marginaux. Populaire quant au nombre d’ouvrages vendus, il demeure non reconnu par la plupart des institutions littéraires. Ainsi, malgré ses propos désobligeants à l’égard de la fonction journalistique, le littérateur doit malgré tout y participer afin de subvenir à ses besoins, mais aussi — sinon surtout — de se faire connaître[25].
Car les écrivains ne bénéficiant pas de tribunes comme l’Académie ou les Salons les plus illustres se servent des feuilles volantes comme outil de promotion : par la simple publication dans les périodiques de textes inédits ou par la publicité obtenue par les journalistes qui jugent leurs extraits ou leurs livres. Le choix ne va pas sans inconvénient ; n’ayant guère de pouvoir sur lesdites critiques, la publicité souhaitée ne sera pas toujours à leur avantage :
mais combien de fois n’arrive-t-il pas [que le critique] a prononcé contre un livre avant de l’avoir lu, parce qu’il est d’un auteur qui lui déplaît, ou parce que le libraire qui le débite n’est pas de ses amis. Alors le malheureux auteur a tort avant qu’on l’ait entendu ; & la critique amere qu’on va faire de son ouvrage, en empêchera la vente sur laquelle il comptoit, peut-être, hélas ! pour subsister[26].
Contrairement à d’autres auteurs, Mercier a tout de même le net avantage d’être populaire : son An 2440, son Tableau de Paris et ses drames sont autant d’ouvrages à avoir été traduits et vendus dans plusieurs pays européens et, en cela, il a pu effectivement « entretenir décemment[27] » lui-même et les siens. Toutefois, sa posture sociale et son caractère singulier — d’aucuns diront bizarre — font en sorte qu’il vit entre deux mondes : « [i]l est à la fois connu et non reconnu[28] ». Et voilà la triste réalité à laquelle se trouvent confrontés les minores que sont les Mercier, Rétif de la Bretonne, Linguet et autres auteurs à la fois populaires et dédaignés[29]. Ce qui est frustrant pour ces plumes prolifiques de la fin des Lumières, c’est de constater que « [p]endant que les mandarins s’engraiss[ent] grâce à leurs pensions, la plupart [d’entre eux] tomb[ent] dans une sorte de prolétariat de la littérature[30]. » Dans leur vie d’écrivain, l’écriture prend ainsi la place d’un véritable métier : ils doivent produire et ne peuvent guère prendre de longues pauses afin de peaufiner leurs écrits. D’où, à la lecture de certains de ces textes, l’impression parfois d’un état d’urgence : le style est souvent court, vif, on peut presque sentir la plume courir sur le papier pour rendre, telles quelles et sans fard, leurs idées, leurs opinions, leurs descriptions.
Participant des deux mondes, à cheval entre l’anonymat du scribe et la gloire littéraire, « [l]’écrivain est souvent placé entre ces contrastes frappants […] Orateur du plus grand nombre, et conséquemment des infortunés, il doit défendre leur cause ; mais la défend-on quand on n’a pas senti le malheur d’autrui, c’est-à-dire, quand on ne l’a point partagé[31] ? » Ainsi, du moins si on garde à l’esprit la mission que s’est donnée l’auteur, les seuls bons hommes de lettres sont justement ceux qui sont indigents, puisque c’est de ce point de vue qu’ils sont à même de bien observer et de rendre compte des abus et des injustices dont souffrent leurs compatriotes. Mercier présentera la pauvreté ou, du moins, la simplicité, comme le seul état digne d’un véritable écrivain, tâchant ainsi de concilier les deux statuts extrêmes que sont la « noblesse » d’homme de lettres et celui, dédaigné, d’ouvrier littéraire, mettant l’accent sur la liberté du dire de ce dernier : sans les devoirs obligés à un quelconque mécène, l’écrivain n’a pour tout directeur de pensée que sa propre conscience.
Malgré ces timides tentatives de conciliation entre deux modèles, la double fonction d’écrivain et de journaliste vécue par Mercier demeure tout de même difficile à légitimer. Comme l’indique fort à propos Shelley Charles, le journal est à la fois « un objet d’aversion et de fréquentation privilégié[32] » : objet d’aversion, car le fait d’y écrire dévoile, en quelque sorte, son statut de littérateur marginal, mais également objet de fréquentation privilégié car, comme nous le disions, il s’agit du véhicule idéal pour répandre ses écrits selon la mission qu’il s’est fixée. Il va sans dire que la période durant laquelle l’auteur évolue influence aussi son choix puisque la Révolution voit naître journellement de nouveaux quotidiens : véritable envahissement de feuilles, tant distribuées que placardées sur les murs de la capitale, comme autant de tentations d’y participer, surtout pour les auteurs comme Mercier qui désirent voir leurs écrits répandus entre toutes les mains, dans tous les coins de la ville. Là où le bât blesse, c’est que le polygraphe ne délaissera jamais ses commentaires négatifs à l’endroit des journalistes, tout en publiant, année après année, de plus en plus d’articles dans les journaux. Dans cet inévitable écartèlement, comment parvenir à trouver un équilibre — aussi précaire soit-il — entre un discours et une pratique qui s’affrontent sans cesse ?
La recherche d’un équilibre : la presse comme lieu d’essai
Le problème qui se pose pour Mercier est le suivant : en sa qualité d’homme de lettres, il se doit de dénigrer les écrits des « feuillistes ». Or, comment continuer à produire un tel discours dès lors qu’il collabore davantage aux journaux à mesure que le siècle avance ? À la lecture des textes de Mercier concernant ses écrits journalistiques, le lecteur est nécessairement frappé par l’attitude défensive de son discours : l’auteur est sans cesse en train de se justifier, d’excuser une telle pratique, voire de traiter ses articles avec une apparente désinvolture. Ne les taxe-t-il pas ouvertement de « peccadiles[33] » ? Certes, Mercier possède déjà un discours de désintéressement à l’égard de tous ses ouvrages — que l’on pense notamment à plusieurs notes manuscrites[34] ou encore au dernier paragraphe de ses Entretiens du Palais-Royal[35] — mais jamais la paternité de ses oeuvres littéraires ne semble le faire autant souffrir que la légitimité de ses écrits parsemés ici et là dans les divers journaux.
Afin de ne pas avoir à renier tous ses articles, Mercier explique sa pratique journalistique par l’argument suivant : « Qu’est-ce qu’une imprimerie ? C’est mon écritoire[36] ». C’est d’ailleurs, comme nous le disions précédemment, la tribune idéale pour les auteurs qui cherchent à vivre de leur plume, puisqu’à l’époque, « le périodique leur est ouvert comme un espace intermédiaire entre leur cabinet de travail et la boutique du libraire, entre leur solitude, ou le petit cercle familier, et le large public auquel ils prétendent accéder[37]. » Ainsi, le journal, en se donnant comme intermédiaire entre les écrits manuscrits des littérateurs et leur publication sous forme de livres, permet non seulement d’en faire la promotion, mais aussi de les tester en fonction de l’appréciation des lecteurs. À ce sujet, Robert Favre ajoute : « des gens de lettres obtiennent du périodique le droit de se faire un nom, d’accéder au livre, utilisent le périodique comme le conservatoire et le lieu d’exposition des pièces dont ils pourront constituer un “Recueil”[38] ». C’est en ce sens surtout que Mercier semble utiliser le périodique, à savoir comme un lieu d’écriture recueillant divers textes en devenir qui seront éventuellement rejetés ou récupérés pour faire partie d’un grand tout. Le recours à la presse comme « écritoire » est vérifié par la reprise, dans certains ouvrages de l’auteur, d’articles préalablement publiés dans les périodiques.
L’unique façon pour le polygraphe de trouver un équilibre entre son activité journalistique et littéraire consiste donc à reprendre ses textes parus dans les journaux pour les insérer au coeur d’autres oeuvres[39]. À ce sujet, le Tableau de Paris, dont la publication s’échelonne de 1781 à 1789, est exemplaire : plusieurs chapitres de l’ouvrage avaient été préalablement publiés dans le Journal des dames durant l’été 1775. Ce qui frappe d’emblée à la lecture parallèle des articles des journaux et des chapitres du Tableau de Paris est la quasi-absence de changements entre les deux versions ; ce qu’on trouve dans le Tableau, c’est, à quelques mots, voire à quelques virgules près, ce qu’on retrouve dans les articles publiés précédemment. À titre d’exemple, le texte intitulé « Civilité », paru dans le Journal des dames en juillet 1775, se retrouve sous le même titre dans le Tableau de Paris, dont l’unique variante consiste en une réécriture de la première phrase ; là où l’article inscrivait « La civilité produit une infinité de bons effets dans la société », le Tableau, lui, débute comme suit : « Et la civilité n’en règne pas moins : elle est répandue dans presque toutes les classes. C’est qu’on a vu qu’elle produisait une infinité de bons effets dans la société […][40] », modification infime qui sert à lier le texte au chapitre précédent.
Ce que ces parutions au coeur du Journal des dames nous apprennent, c’est que le style de l’écrivain pour la description de la ville de Paris et de ses habitants était déjà bien affirmé au moins cinq ans avant la première publication du Tableau de Paris. Même si les articles disséminés dans le Journal n’ont pas encore pris la forme d’un ouvrage dans la tête de l’auteur, leur particularité stylistique est bien présente dès 1775. En ce sens, même si presque aucun changement notoire n’existe entre les articles parus dans Le Journal des dames et le Tableau de Paris, on peut effectivement considérer ces articles comme « l’écritoire » de Mercier, sorte de chantier qui finira par donner naissance au Tableau de Paris.
Contrairement aux articles publiés dans le Journal des dames, les publications dans Le vieux tribun et sa bouche de fer semblent davantage un moyen de publiciser l’ouvrage à paraître qu’un lieu d’essai. Ici, le texte ne fait pas office d’oeuvre en devenir ; il est simplement l’extrait d’une oeuvre déjà achevée. Les textes donnés au Vieux tribun et sa bouche de fer offrent un modèle parfait du dévoilement d’inédits au sein des feuilles périodiques : pas une seule virgule ne diffère entre le texte paru en son sein et la version définitive de l’ouvrage. Il s’agit véritablement d’une publication du manuscrit officiel et il est d’ailleurs présenté comme tel : « C’est un chapitre détaché de l’Ouvrage intitulé : Le Nouveau Paris, par Mercier et encore manuscrit[41]. » Avec l’écriture du Nouveau Paris — à laquelle nous pourrions ajouter la réédition de L’an 2440 —, l’auteur espère séduire à nouveau son public qui avait été conquis par son Tableau de Paris et par la première version de L’An 2440, textes à l’origine de sa renommée littéraire, comme l’indique fort à propos Frédéric Bassani : « Malmené par les journalistes, malmené par le peuple, Mercier qui s’est classé politiquement sous la Révolution française, a en effet besoin de se réaffirmer en tant qu’écrivain[42]. » Il doit cependant passer par le lieu dénigré du journal pour appâter, par des chapitres inédits, l’ancien et le nouveau lectorat. La distance entre une pratique et un discours laisse paraître la figure de l’auteur-journaliste qui doit vivre de sa plume et, conséquemment, s’assurer d’une visibilité accrue afin de rassembler un maximum de lecteurs ; on ne se procure pas les ouvrages d’un écrivain dont le monde ne parle point.
À la lumière de ces différentes publications donnant à lire en parallèle des articles de journaux et des oeuvres, il semble important de préciser qu’aucune réelle distinction n’est percevable chez Mercier entre sa poétique littéraire et journalistique. Cela n’est guère surprenant d’ailleurs puisque, pour reprendre les mots de Jean Sgard, « [l]a poétique du journal est née de la poétique du récit ; elle est sa complice, elle peut à tout moment lui emprunter, comme elle peut lui rendre son bien[43] ». Qu’il s’agisse d’un article écrit dans le but d’être publié au sein d’un journal ou d’un chapitre qu’il souhaite incorporer à un ouvrage, Mercier ne change rien à la singularité de sa plume. Son style vif, concis, qui cherche à capter et à retenir l’attention de son lecteur, à le surprendre, à l’émouvoir, n’est pas sans rappeler, comme le souligne Frédéric Bassani[44], nos éditorialistes modernes, d’autant plus que, comme nous le disions, l’auteur situe son discours davantage du côté du témoignage que de la fiction. De plus, à la lecture de l’oeuvre, le style du polygraphe donne l’impression que son rapide coup d’oeil sur un objet est immédiatement retranscrit en mots par la plume, créant conséquemment des écrits courts, sorte « d’instantanés » que Rivarol qualifiera de textes « pensé[s] dans la rue et écrit[s] sur la borne[45] ». Ce style, toujours égal à lui-même, entraîne une absence de distinction entre l’écriture journalistique et littéraire qui est d’autant plus apparente lorsqu’on considère plus précisément son Tableau de Paris et son Nouveau Paris : les articles du Tableau de Paris sont d’abord parus dans le Journal des dames avant d’être mis dans un tout, alors que le Nouveau Paris a été pensé en entier avant d’être fragmenté pour être inséré au coeur d’un journal. Également, notons que certains textes publiés uniquement dans les journaux à l’époque[46] auraient pu être placés dans ces deux ouvrages sans créer de problème d’homogénéité. Mercier a un style : animé, allant droit au but, dénonçant, grondant, riant, utilisant l’impératif et l’exclamation, style de celui qui a un lecteur, qui le sait et qu’il interpelle quotidiennement.
Conclusion
Pourrait-on voir dans le passage quasi sans transformation du journal au livre chez Mercier une volonté de montrer que son journalisme n’en est pas vraiment un et, ce faisant, de conserver la distinction marquée qui existe entre ces deux supports ? Sans doute. Et si on considère également l’ampleur de ses textes justificatifs concernant son utilisation de la presse et la façon désinvolte avec laquelle il traite ses écrits journalistiques, force est d’admettre la présence étouffante et persistante d’un malaise entre deux statuts inconciliables. Il se proclame homme de lettres durant toute sa vie et se défend bien d’être un journaliste : il n’a fait que s’amuser à écrire dans les périodiques ou, comme il le dit : « J’ai pris quelque plaisir à jeter dans plusieurs Journaux et de tous côtés de petites lettres sur divers sujets, des peccadiles. J’appelois celà devant mes amis prendre mon chocolat du matin[47]. » Ainsi, en un constant effet de balancement, les écrits de l’auteur mettent l’accent sur l’aspect anodin, voire ludique de sa participation aux journaux, et sur le sérieux de sa pratique littéraire.
La légèreté avec laquelle Mercier traite ses écrits journalistiques peut d’ailleurs surprendre, d’autant plus que la plupart d’entre eux participent de la mission qu’il s’est donnée en tant qu’écrivain de travailler au mieux-être des hommes par la dénonciation des abus par un discours davantage social et politique que fictionnel. Lorsqu’on observe l’ensemble de ses écrits parus dans les journaux, il est en effet assez révélateur de constater que, mis à part quelques textes de fiction placés dans l’Iris de Guienne en 1763, la part repérable de son oeuvre journalistique est résolument tournée vers l’étude de ses contemporains et, surtout, constitue une tribune pour donner son opinion, ses impressions et ses propositions de solutions sur divers sujets et problèmes[48], tout en profitant également de l’espace dialogique d’échange entre lecteurs que permet l’envoi de lettres aux journaux, notamment au sein du Journal de Paris. Aussi Frédéric Bassani a tout à fait raison à notre avis d’associer Mercier à nos éditorialistes modernes[49], l’auteur ne se situant résolument pas du côté de la fiction lorsqu’il s’agit de sa participation aux journaux.
Il n’en demeure pas moins que la figure du polygraphe qu’est Louis Sébastien Mercier dessine d’ores et déjà l’écartèlement que vivront ses successeurs qui tâcheront sans cesse de justifier leurs choix d’écriture ; on peut se proclamer homme de lettres sans conséquences fâcheuses, mais il vaut toujours mieux taire son emploi de « feuilliste » si l’on ne veut pas être à jamais éclipsé de la reconnaissance des hautes sphères littéraires. Perdure ainsi un véritable clivage entre la posture noble du littérateur et celle roturière du journaliste. Le préjugé d’un gouffre infranchissable entre l’objet littéraire reconnu et la dénigrée « feuille de chou » se perpétuera, durant les siècles suivants, répétant, comme en écho, sans jamais oser répondre clairement par l’affirmative à la question de Mercier : « Je le demande les journaux sont-ils des livres ? leurs auteurs sont-ils des écrivains[50] ? »
Appendices
Note biographique
Annie Cloutier
Annie Cloutier est étudiante au doctorat à l’Université Laval. Elle consacre sa thèse à l’étude de l’oeuvre de Louis Sébastien Mercier (1740-1814). Elle est l’auteure de plusieurs articles sur Mercier parus dans des revues et dans des actes de colloques. Elle fait partie du groupe de recherche du Cercle interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres (CIERL) depuis sa fondation en 1999. En plus de consacrer une bonne part de son temps à l’enseignement du français en formation professionnelle, elle s’occupe du travail éditorial pour la collection « République des Lettres » aux Presses de l’Université Laval (monographie, actes de colloques) et pour la revue Diderot Studies.
Notes
-
[1]
À ce sujet, Robert Darnton précise : « Quelques excentriques, comme Delisle de Salles, Mercier et Carra, osèrent demander des pensions, mais n’obtinrent rien […] La racaille littéraire tendait la main, mais le gouvernement réservait ses aumônes aux écrivains bien placés dans le “monde” » (Bohème littéraire et Révolution, 1983, p. 13).
-
[2]
« Je n’ai que cette plume pour subsister ; elle m’a déjà gagné cent-quarante mille livres, et m’a mis en état d’entretenir décemment moi, et les miens. Je souhaiterais qu’une rente médiocre me mît, comme vous en état de mûrir mes productions ; mais je suis en telle situation, qu’il m’importe beaucoup plus d’écrire vîte, que de bien écrire » (« Communication de M. Antoine Lasalle, “savant traducteur de Bacon”, à Varot d’Amiens », dans Varot d’Amiens, Mémoires sur la vie et les ouvrages de L. S. Mercier, 1825, p. 31-32).
-
[3]
« les hommes voient differemment les mêmes objets. […] Pardonnons donc à chacun la poëtique qu’il se fait à lui-même ; car on est toujours plus sûr de sa pensée que de celle d’autrui. » (Louis Sébastien Mercier, « […] les hommes voient différemment les mêmes objets […] », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d.], fº 336rº).
-
[4]
Louis Sébastien Mercier, « Mais il y a des règles du goût […] », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d.], fº 419rº.
-
[5]
Louis Sébastien Mercier, Mon bonnet de nuit, 1999, p. 1025.
-
[6]
Louis Sébastien Mercier, « Vous êtes des rabacheurs et ne sortirez jamais du même refrein […] », Notes de travail et fragments divers, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15082 (1.2) [n.d.], f° 246r°.
-
[7]
Si sa présence est plutôt discrète dans les premières années du Journal de Paris, les années 1797 à 1800 verront paraître près de soixante-dix articles de Mercier au sein de ce quotidien, soit, à quelques articles près, le même nombre que ceux fournis au Bien informé pour la même période. S’ajoutent à cela sa quarantaine d’articles parus dans Le censeur des journaux et dans La clef du cabinet des souverains, toujours de 1797 à 1800. Mercier a donc produit près de deux cents articles en quatre ans, en comptant uniquement quatre journaux et les articles qui y sont dûment signés ou, à tout le moins, ceux dont la paternité n’est pas mise en doute. Pour une liste détaillée des articles publiés par Mercier, voir l’ouvrage d’Enrico Rufi, Louis Sébastien Mercier, Paris / Roma, Éditions Memini (Bibliographie des écrivains français ; 2), 1996, p. 34-52.
-
[8]
Louis Sébastien Mercier, De la littérature et des littérateurs, 1970 [1778], p. 3-4.
-
[9]
Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, 1994, t. 1, p. 17.
-
[10]
Bien que Mercier soit l’auteur de nombreux ouvrages de fiction, ses textes sont, pour la plupart, davantage liés à un souci d’information qu’à un réel souci d’illusion. En effet, certains de ses écrits se trouvent tantôt envahis de notes de bas de pages informatives — anecdotes, commentaires, comparaisons, etc. —, tantôt ont pour objet même d’informer ses contemporains de leurs manies, de leurs vices, de leurs vertus. Par la nature de ses oeuvres, Mercier est résolument reporter, même s’il s’agit pour lui d’une insulte suprême. À ce sujet, Geneviève Bollème précise que Jules Lemaître, qui considérait l’oeuvre entière de Mercier comme un « déchet », « met fin et comble à ses injures en le traitant de reporter » (« Préface », 1978, p. 13-14).
-
[11]
Il s’agit ici de sa propre expression concernant Mon bonnet de nuit (Louis Sébastien Mercier, Mon bonnet de nuit, op. cit., p. 9).
-
[12]
L’intérêt pour l’écriture d’une simple page se retrouve, entre autres, dans un passage consacré à Diderot : « Il ne se vantoit pas de savoir faire un livre, mais bien d’écrire des pages ; il disoit : […] J’ai fait une page qu’il faut que je vous lise, et il vous lisoit sa page sans savoir où il la placeroit ; il l’oublioit, ou il la donnoit au premier venu » (Louis Sébastien Mercier, De Jean-Jacques Rousseau, 1791, t. 2, p. 137, note 1. Mercier souligne).
-
[13]
Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, op. cit., t. 1, p. 350. Il est important de préciser que l’écran auquel Mercier réfère est ce qui servait de pare-feu, lequel était souvent orné « de diverses histoires ou images », comme le souligne Paul-Édouard Levayer, l’un des annotateurs du texte (ibid., p. 1590, note 5).
-
[14]
Louis Sébastien Mercier, « Une brocheuse », Notes de travail et fragments divers, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15082(1.2) [n.d.], f° 398vº-399r°.
-
[15]
Ibid., f° 397vº.
-
[16]
Une anecdote contenue dans Les entretiens du Palais-Royal est fort parlante à ce sujet : une élégante « fait couper en huit parties ses in-folio, pour avoir une bibliothèque à la mode, & maintenant qu’ils sont reliés en verd-pomme, en bleu céleste, en nacarat, ce sont de charmants in-12. » Dès lors, le contenu de ses beaux livres devient tout à fait inaccessible… (Louis Sébastien Mercier, Les entretiens du Palais-Royal, 1786, p. 198-199. Mercier souligne).
-
[17]
Philippe Roger, « Repentirs de plume », 1990, p. 592.
-
[18]
Louis Sébastien Mercier, « […] sans parler de goût, sans dire, j’ai du goût […] », Oeuvres poétiques. Fragments, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(2.1) [n.d.], fº 217rº.
-
[19]
Louis Sébastien Mercier, Discours sur la lecture, 1764, p. 12.
-
[20]
Louis Sébastien Mercier, De la littérature et des littérateurs, op. cit., p. 62, note 28.
-
[21]
Ibid., p. 67. Mercier souligne.
-
[22]
Véronique Costa, « Le procès des journalistes du Parnasse par Mercier », 1995, p. 91-92.
-
[23]
Louis Sébastien Mercier, « Je brûle sous le nez de Boileau toutes les ordonnances littéraires [...] », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [après 1795], fº 356vº.
-
[24]
Louis Sébastien Mercier, « Suite du scepticisme littéraire », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2), fº 346vº.
-
[25]
« Sans doute, il y a des auteurs qui se plaignent des feuilles périodiques ; mais combien d’autres dont les livres & les noms seroient ignorés, si un journal n’avoit informé le public de leurs productions, bonnes ou mauvaises ? » (Louis Sébastien Mercier, Les entretiens du Jardin des Thuileries, 1788, p. 164).
-
[26]
Ibid., p. 25.
-
[27]
« Communication de M. Antoine Lasalle, “savant traducteur de Bacon”, à Varot d’Amiens », loc. cit., p. 31-32.
-
[28]
Geneviève Bollème, « Préface », op. cit., p. 11.
-
[29]
Nous empruntons cette expression de « dédaignés » à l’ouvrage de Charles Monselet (Oubliés et dédaignés, Linguet, Fréron, Rétif de la Bretonne, Mercier, Cubières, Paris, Bachelin-Deflorenne, 1885) dans lequel l’auteur s’intéresse justement aux laissés-pour-compte que sont les Mercier, Rétif, Cubières, etc.
-
[30]
Robert Darnton, Bohème littéraire et Révolution, op. cit., p. 18.
-
[31]
Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, op. cit., t. 1, p. 31.
-
[32]
Shelley Charles, « L’écrivain journaliste », 1995, p. 92.
-
[33]
Louis Sébastien Mercier, « Mercier, membre de l’Institut aux rédacteurs », Lettres de Mercier, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15078(2), 1813, fº 41rº.
-
[34]
« Je couve les écrits qui ne sont pas encore éclos ; je leur donne tous mes soins et mon amour. Je les couve, je les échauffe ; je me complais à voir pousser leurs aîles. Une fois envolés je ne suis plus maître de leur destin et je les oublie ». (Louis Sébastien Mercier, « Pardon, citoyens, si je reviens sur cette nomenclature considérable de mes oeuvres […] », Littérature et critique. Fragments, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d.], fº 380vº). Il est assez difficile de dater les notes à ce sujet puisque cette idée paraît chez Mercier dès son Discours sur la lecture en 1764, pour être aussi publiée dans le Journal de Paris le 20 mai 1784.
-
[35]
« Mais, adieu mon livre, je vous laisse. Tirez-vous de presse comme il vous plaira. Pour moi, maître de mon imagination & de mes volontés, je vous ai déjà oublié » (Louis Sébastien Mercier, Les entretiens du Palais-Royal, op. cit., p. 204).
-
[36]
Louis Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris, 1994, p. 689.
-
[37]
Robert Favre, « Une fonction du périodique : du manuscrit au livre », 1982, p. 258.
-
[38]
Ibid., p. 259-260.
-
[39]
Mercier a une forte tendance à omettre volontairement de signer une bonne part de ses articles parce qu’il compte sur ses fidèles lecteurs pour reconnaître sa griffe, véritable casse-tête pour les chercheurs actuels. Au sujet de la difficulté liée à l’étude des textes journalistiques de Mercier, voir l’article de Shelley Charles, « L’écrivain journaliste », op. cit., p. 83-120.
-
[40]
Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, op. cit., t. 1, p. 1565 et 242. Pour l’ensemble des légères variantes contenues entre le Journal des dames et le Tableau de Paris, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à l’excellent appareil de notes contenu dans les deux tomes du Tableau de Paris.
-
[41]
Le vieux tribun et sa bouche de fer, An V [1796], p. 81, note 1. En tout, quatre chapitres du Nouveau Paris seront publiés en avant-première dans ce journal, entre 1796 et 1797.
-
[42]
Frédéric Bassani, « Louis Sébastien Mercier journaliste », 1995, p. 72, note 16.
-
[43]
Jean Sgard, « L’écriture du fait divers », 2008, p. 53.
-
[44]
Frédéric Bassani, op. cit., p. 68.
-
[45]
Rivarol, cité par Geneviève Bollème, « Préface », op. cit., p. 9-10.
-
[46]
À la toute fin de l’édition du Nouveau Paris effectuée sous la direction de Jean-Claude Bonnet, une section intitulée « Musées, jardins et fêtes de Paris » donne à voir un choix d’articles publiés par Mercier entre 1797 et 1800, textes non insérés dans l’ouvrage de Mercier et qui sont décrits comme « la matière d’un autre Nouveau Paris ». Voir Louis Sébastien Mercier, Nouveau Paris, op. cit., p. 937-1047.
-
[47]
Louis Sébastien Mercier, « Mercier, membre de l’Institut aux rédacteurs », Lettres de Mercier, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15078(2), 1813, fº 41rº. Mercier souligne.
-
[48]
Mercier écrira des textes sur la mode, sur le rire, sur les voitures, sur la propriété littéraire, sur l’astronomie, etc.
-
[49]
Voir note 44.
-
[50]
Louis Sébastien Mercier, « […] L’art d’écrire est le premier de tous […] », Politique, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15085(1) [n.d.], fº 238vº.
Références
- Le vieux tribun et sa bouche de fer, Paris, Imprimerie-Librairie du Cercle social, An V [1796].
- Amiens, Varot d’, Mémoires sur la vie et les ouvrages de L. S. Mercier, auteur de L’an 2440, du Tableau de Paris, etc., Paris, Bibliothèque Nationale de France, nouv. acq. franç. 10260, 1825.
- Bassani, Frédéric, « Louis Sébastien Mercier journaliste : un témoin de son temps », Recherches & travaux, no 9, vol. 48 (1995), p. 67-79.
- Bollème, Geneviève, « Préface. L’écriture, cet art inconnu », dans Louis Sébastien Mercier, Dictionnaire d’un polygraphe, Paris, Union Générale d’Éditions (10 / 18 ; 1233), 1978, p. 7-83 (éd. Geneviève Bollème).
- Charles, Shelley, « L’écrivain journaliste », dans Jean-Claude Bonnet (dir.), Louis Sébastien Mercier (1740-1814). Un hérétique en littérature, Paris, Mercure de France (Ivoire), 1995, p. 83-120.
- Costa, Véronique, « Le procès des journalistes du Parnasse par Mercier », Recherches & travaux, no 9, vol. 48 (1995), p. 81-93.
- Darnton, Robert, Bohème littéraire et Révolution. Le monde des livres au XVIIIe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1983.
- Favre, Robert, « Une fonction du périodique : du manuscrit au livre », dans Pierre Rétat (dir.), Le journalisme d’Ancien Régime. Questions et propositions, Table ronde CNRS, 12-13 juin 1981, Lyon, Presses Universitaires de Lyon (Centre d’études du XVIIIe siècle de l’Université de Lyon II), 1982, p. 257-269.
- Mercier, Louis Sébastien, L’An 2440. Rêve s’il en fut jamais suivi de L’homme de fer, songe, Genève, Slatkine Reprints (Bibliothèque des voyages aux pays de nulle part), 1979 [1799] (éd. Raymond Trousson).
- Mercier, Louis Sébastien, « […] L’art d’écrire est le premier de tous […] », Politique, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15085(1) [n.d.], fº 238r°-241vº.
- Mercier, Louis Sébastien, De Jean-Jacques Rousseau considéré comme l’un des premiers auteurs de la révolution, Paris, chez Buisson, 1791, 2 t.
- Mercier, Louis Sébastien, De la littérature et des littérateurs suivi d’un Nouvel examen sur la tragédie françoise, Genève, Slatkine Reprints, 1970 [Yverdon, 1778].
- Mercier, Louis Sébastien, Les entretiens du Jardin des Thuileries de Paris, Paris, Chez Buisson, 1788.
- Mercier, Louis Sébastien, Les entretiens du Palais-Royal de Paris, Paris, Chez Buisson, 1786.
- Mercier, Louis Sébastien, « Je brûle sous le nez de Boileau toutes les ordonnances littéraires [...] », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d., mais après 1795], fº 356rº-357rº.
- Mercier, Louis Sébastien, « […] les hommes voient différemment les mêmes objets […] », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d.], fº 336rº-337rº.
- Mercier, Louis Sébastien, « Mais il y a des règles du goût […] », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d.], fº 419rº.
- Mercier, Louis Sébastien, « Mercier, membre de l’Institut aux rédacteurs », Lettres de Mercier, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15078(2), 1813, fº 41rº.
- Mercier, Louis Sébastien, Mon bonnet de nuit suivi de Du théâtre, Paris, Mercure de France, 1999 [1784 et 1773] (éd. Jean-Claude Bonnet).
- Mercier, Louis Sébastien, Le Nouveau Paris, Paris, Mercure de France, 1994 [1798] (éd. Jean-Claude Bonnet).
- Mercier, Louis Sébastien, « Pardon, citoyens, si je reviens sur cette nomenclature considérable de mes oeuvres […] », Littérature et critique. Fragments, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d.], fº 379rº-380vº.
- Mercier, Louis Sébastien, « […] sans parler de goût, sans dire, j’ai du goût […] », Oeuvres poétiques. Fragments, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(2.1) [n.d.], fº 217rº.
- Mercier, Louis Sébastien, « Suite du scepticisme littéraire », Protestations contre les dogmes littéraires, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15081(1.2) [n.d.], fº 346rº-348rº.
- Mercier, Louis Sébastien, Tableau de Paris, Paris, Mercure de France, 1994 [1781] (éd. Jean-Claude Bonnet et al.).
- Mercier, Louis Sébastien, « Une brocheuse », Notes de travail et fragments divers, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15082(1.2) [n.d.], f° 397rº-399r°.
- Mercier, Louis Sébastien, « Vous êtes des rabacheurs et ne sortirez jamais du même refrein […] », Notes de travail et fragments divers, Paris, Fonds Mercier, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 15082(1.1) [n.d.], fº 246r°.
- Roger, Philippe, « Repentirs de plume : l’échec du journalisme révolutionnaire selon Mercier et Louvet », Revue d’histoire littéraire de la France, no 90, vol. 4-5 (juillet-octobre 1990), p. 589-598.
- Sgard, Jean, « L’écriture du fait divers », Orages. Littérature et culture 1760-1830, vol. 7 (mai 2008), p. 53-66.