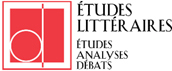Article body
Assis au pied de la statue de Samuel de Champlain, je regarde la grande gueule du fleuve avaler la brume matinale. Le calepin que je tiens dans ma main bave son surplus de mots entre les planches de la terrasse Dufferin et je ne fais rien pour les retenir, emporté par les rêveries qui m’ont maintenu réveillé toute la nuit. Hier, au moment où j’écrivais la dernière lettre du dernier mot du dernier paragraphe du dernier chapitre du roman qui me garde en vie depuis plus d’un an, elle m’est apparue furtivement, évanescente dans sa robe fleurie. Ma fille morte. Elle ne s’était pas manifestée depuis le jour où j’ai brûlé tout ce qui lui a appartenu, poupées et déguisements, photos et vêtements, dans un grand feu de peine sur la grève de Saint-Jean, à l’Île d’Orléans. L’île de sa mère aux yeux bleus et au coeur rouge comme le rocher en lamelles qui protège le cimetière. L’île-luette de notre pays mort-né. L’île que je cherche maintenant du regard dans le brouillard que le soleil teinte d’un rose enveloppant.
Debout autour de moi, mes personnages me protègent de la brise et du vide où me laisse la fin de mon histoire. Nadine Pilon serre contre sa poitrine la cassette vidéo rose qu’elle est allée cueillir dans la maison de son père biologique, trésor d’images-pépites où elle apparaît d’abord toute petite dans la poussette de sa mère adoptive, puis gamine amusée par ses premiers hivers, puis à la rentrée des classes dans la cour asphaltée de son école primaire, puis au parc dans une balançoire, puis à la porte de sa polyvalente, puis soulevée par les autres membres de sa troupe de danse, puis dans la rue avec son premier amour… Des images illégitimes, volées par son géniteur, toujours tapi derrière quelque chose, un arbre, une voiture, sa souffrance ou sa culpabilité. Des images refuges qu’elle fait rouler en boucles dans son cerveau pour se rappeler son histoire. Une histoire avec laquelle je n’ai jamais eu rien à voir, même si elle est née d’un élan de mon inconscient. Parce qu’il me faudra bien des années avant de saisir ce qui brillait pourtant d’évidence. Cette Nadine, avec ses images-matraques, s’est nourrie de la souffrance et du manque et du vide et de tout ce qui ne peut pas se dire quand une partie de soi nous est enlevée, quand un boulet de plomb nous traverse le corps et l’esprit, emportant avec lui une part de lumière et de légèreté que nous mettrons des années à retrouver, toujours déçus que ce ne soit pas tout à fait ça malgré le soleil qui pisse de partout pour nous combler de ses offrandes. Il n’y a pas de salut au pays des endeuillés, et le bleu du ciel qui s’ouvre au-dessus de ma tête pendant que Nadine se lève pour aller s’appuyer contre le garde-fou de la terrasse Dufferin ne me dit rien d’autre que ce que la solitude me répète depuis que j’ai jeté mes derniers regrets dans le grand feu de peine que j’ai allumé sur la grève de Saint-Jean, Île d’Orléans.
Je me lève à mon tour et marche dans la ville qui s’éveille lentement, mes personnages en procession dans mon dos. Il ne leur manque que des lampions pour que nous nous retrouvions à la Fête-Dieu, que Gilles Carle a reconstituée pour le cinéma là même où nous posons les pieds. C’était au début des années 1980, après que René Lévesque a chanté à ceux qui venaient de dire non à son projet de souveraineté en tendant sa joue gauche : Gens du pays, c’est votre tour de vous laisser parler d’amour…
Nous descendons la rue Sainte-Famille vers la côte de la Canoterie. Un peu plus loin, je retrouve mon quartier natal, tel qu’en lui-même, engoncé dans sa petite misère malgré les retouches des urbanistes. Rémi Belleau et Harold Lubie sortent du troupeau pour me rejoindre. Ils me parlent de leur jeunesse, qui ressemble à la mienne, une enfance de courses de bicyclettes et de hockey bottines dans les rues étroites de Saint-Sauveur, une enfance de gangs de rue avant la lettre, guerre de paroisses avec chaînes et couteaux en guise de saintes espèces, une enfance de morve au nez qu’on essuie sur sa manche avant de se lancer dans la bataille à son tour.
Belleau et Lubie se sont rencontrés dans mon premier roman, mais ils se perdront de vue assez rapidement. Quand il s’agit de raconter leurs coups les plus réussis, ils sont intarissables, mais je sens bien que derrière leur fougue et leur superbe se cachent quelques remords. Et je me dis que si la vie ne m’avait pas indiqué les voies qui ont été celles que j’ai empruntées malgré moi – et malgré ce qui s’annonçait dans l’appartement de la rue Fleury où ma mère m’a donné naissance –, peut-être aurais-je fini par les fréquenter dans un petit bar miteux de la rue Saint-Joseph pour y planifier avec eux le coup fumant qui nous aurait rendus riches.
Quand je déambule ainsi avec mes personnages et les entends se plaindre de leurs déconvenues ou se vanter de leurs prouesses passées, j’ai l’impression de replonger dans l’état où me confine l’écriture, sorte de cocon ouateux propice au mouvement de repli nécessaire à la mise en forme de ce qui sera projeté dans le cosmos par le langage, là où flotte ma fille morte – avec laquelle je ne peux communiquer que par la pensée tellement mes mots ne sont pas assez puissants pour se rendre jusqu’à elle.
Parce que j’en ai assez de les entendre se raconter leurs magouilles de petits truands, je renvoie Belleau et Lubie en queue de peloton et demande à Véronique de s’approcher. La belle Véronique… Elle se libère de Charles et de Victor, ses deux amoureux – qui ne la quittent plus depuis qu’ils ont su comment leur histoire allait se terminer – et vient vers moi, toujours sur ses gardes quand je l’oblige à m’aborder. C’est qu’elle ne sait pas comment me prendre, et je conçois qu’elle puisse m’en vouloir de la destiner à mourir si jeune. Si elle savait comme j’aimerais qu’elle puisse survivre au-delà de ses dix-huit ans. Mais tout la condamne, ses amoureux et le voyage qu’ils lui feront faire dans une clinique de Montréal, ses rêves dont personne ne veut à part elle, son père catholique et conservateur, à jamais prisonnier d’une époque révolue… Si je le pouvais, je lui parlerais de ma fille morte, qui lui ressemble quand je vois son reflet dans le miroir du télescope Hubble avec ses joues rondes rougies par le froid sidéral et son sourire d’enfant sage que la vie n’a pas gâché. Je prendrais sa main et la poserais sur mon front pour qu’elle y sente la fièvre qui me gagne chaque fois que je l’imagine tomber du toit du bureau de poste de la rue Buade, deux jours avant la grande kermesse politique de mai 1980, après avoir fait la fête avec ses amoureux. Je la bercerais comme on berce une enfant que le tonnerre apeure, lui offrirais des sucreries comme un dernier sursis, lui donnerais la clé de mes mots égarés pour qu’elle les libère avec elle quand elle plongera dans le trou sans fond de mon histoire pour rejoindre ma fille morte. Mais je me contente de lui sourire et de lui tendre la main, en route pour le cimetière Belmont où son corps se mêlera à la terre en emportant avec lui les lumières de ses deux amants, condamnés à errer avec l’espoir de la retrouver dans toutes les femmes qu’ils croiseront par la suite.
Nous gravissons la côte de la Pente douce après avoir salué de loin le buste de Roger Lemelin dans la rue de l’Aqueduc. Mon alter ego, Samy Martel, s’est arrêté devant l’écrivain et j’ai cru un moment qu’il allait lui cracher au visage. Je sais qu’il ne l’aime pas, surtout à cause de ce que Lemelin est devenu par la suite, c’est-à-dire après que les mots se sont moqués de lui parce qu’il croyait pouvoir les contrôler. Je me suis approché de Samy et lui ai pris le bras pour le ramener dans le rang. Un jour, il comprendra qu’il arrive que l’homme, quand on lui dit trop souvent qu’il a du talent, phagocyte l’écrivain, mais que cela n’enlève rien à la valeur de ce qui s’est écrit avant que l’orgueil et la vanité viennent à bout du génie qui, jadis, avait su s’exprimer.
Au moment où nous allons passer de la basse ville à la haute ville, j’entends des cris derrière moi. Ce sont ceux de Bruno qui, en nage, veut que tout le monde s’arrête. Bruno me fait peur, parce qu’il porte en lui une plaie qui nous menace tous et toutes, celle de la folie ravageuse, exterminatrice, petit point dans le cerveau capable de faire le vide autour de lui en disséminant dans un rayon de plusieurs mètres un champ de radiation destructeur et pratiquement imparable. Quand il est là, tout le monde est en danger. Mes autres personnages le savent, et c’est pourquoi ils se tassent derrière moi en espérant que je saurai désamorcer la bombe.
Je m’approche de Bruno et lui demande ce qui ne va pas. Rien ne va, répond-il, parce que quitter son quartier lui fait peur. Il n’a jamais mis les pieds à la haute ville depuis le jour où sa mère méchante l’a abandonné dans un orphelinat de la rue Bourlamaque, à l’âge de huit ans, avant de le récupérer neuf mois plus tard sans savoir tout le mal qu’elle lui avait fait, en le laissant ainsi entre les mains de ses bourreaux. Il garde sur ses doigts les marques du grillage de la cour extérieure ; il le serrait si fort quand son père venait à passer dans la rue pour lui lancer des bonbons par-dessus la clôture que sa peau en est restée bleuie.
Tout le monde sait que Bruno ne fera jamais rien de bon, parce qu’on lui a enlevé une partie de sa raison dans le dortoir de sa prison pour enfants. Et quand je m’approche davantage pour le serrer contre moi, son corps d’homme se raidit, prêt à se défendre même si rien ne le menace. Je me contente de déposer ma main sur son épaule et, par ce geste, j’entre dans ses pensées. Le soleil tombe aussitôt derrière les Laurentides et je m’enfonce dans une nuit d’encre, secoué de spasmes qui me désorientent. Je me cherche une ligne pour y suspendre mes mots, mais me voilà sans parole devant l’absence qui, tout autour, s’impose. J’appelle à l’aide mes personnages qui ne me répondent pas. Je les ai échappés dans une fissure en voulant fuir le désert de glace où Bruno m’entraîne. Je lui crie de me lâcher, que je ne peux rien pour lui, que de nous forcer à participer à son délire ne le guérira pas. Mais il a choisi son camp, et il lui importe peu que je plonge avec lui dans les méandres de sa folie avec le risque de ne jamais en revenir. Il ne m’en veut pas, mais il tient à me montrer ce qui se cache sous la surface d’un personnage comme le sien, toujours seul, humilié, sans femme à caresser sinon sur le papier ciré d’un magazine. Il le fait pour moi, semble-t-il, pour que je comprenne d’où il vient et par où il est passé avant de devenir ce qu’il est. Et je ne mets pas de temps à saisir que l’orphelinat n’était qu’un hors-d’oeuvre, qu’il y a eu pire avant, dans la pénombre de sa chambre, les bonbons de son père dans la main de sa mère méchante en guise d’hosties pour une communion macabre avec les anges du démon. Je me cherche une craque pour m’enfuir, un jet de lumière pour m’y décomposer, mais il n’y a pas d’échappatoire possible lorsque tout t’est montré malgré tes yeux fermés. Je m’accroche à ce que je peux, aux éléments du décor, la commode laquée rose et blanche, la porte du placard et son poster d’ACDC, la lumière black-lite du plafond, le matelas défraîchi, le plancher qui se lamente sous le mouvement du sommier, et les cris de Bruno qu’il étouffe dans ses larmes, la bouche pleine des bonbons du père que lui offre sa mère méchante. Recroquevillé dans un coin de la chambre, j’implore Bruno de me laisser partir, mais il m’en veut de l’avoir mis au monde, m’accuse de jouer avec la vie des gens. J’essaie de me défendre, en lui répétant que ce ne sont que des mots, et il me parle des broches à tricoter de sa mère méchante, et je ne veux pas savoir pourquoi il me parle des broches à tricoter de sa mère méchante parce que je devine qu’elle ne s’en servait pas que pour confectionner des vêtements de bébés.
Au moment où je vais m’évanouir, trop impressionné par la scène à laquelle je suis en train d’assister, les murs de la pièce tombent un après l’autre et le soleil entre à plein dans la maison. Ébloui, je me lève d’un bond pendant que Bruno salue sa libération en criant que ses parents sont des porcs prêts à être embrochés pour le grand méchoui final. Merci Seigneur-Dieu, roi du ciel et des enfers réunis. Ceci est mon corps, que ta lumière l’avale. Ceci est mon sang, qu’il coule entre tes lèvres jusque dans le trou sans fond de tes entrailles divines… Bruno s’approche et me tend la main. Il me dit que ma fille morte est là, tout près, et qu’elle m’attend depuis le jour où elle est partie. Sa main tremble comme celle d’un désespéré qui veut vous faire visiter son abîme. Je sais que si je le laisse m’entraîner jusque-là, jamais je ne pourrai revenir sur mes pas. Mais j’entends la voix de ma fille morte percer la lumière qui nous entoure. Chacun de ses « papa » m’arrache un morceau de chair. Oui, mon amour, papa est là, papa a toujours été là, avec toi. Tu as nourri chaque seconde de ma vie depuis la nuit où la mort t’as emportée. Laisse-moi voir ton sourire pour me prouver que tu es bien là, montre-moi tes yeux et la mer qui vient avec, fais-moi sentir l’odeur de tes cheveux et je plonge avec toi dans la lumière. Bruno insiste, prend ma main de force et m’attire à la limite de la pièce maintenant suspendue au-dessus du soleil. Il me dit regarde elle est là avec son sourire et ses yeux de mer et ses cheveux dorés. Excité, je la cherche partout, mais ne la vois nulle part. Tu voulais une preuve, ajoute Bruno sans lâcher ma main, alors la voilà. Te reste plus qu’à plonger pour la rejoindre. Mais il n’y a que le soleil, ostentatoire dans la noirceur de l’univers, et les « papa » de ma fille morte se sont perdus dans le cosmos. Bruno répète : vas-y, qu’est-ce que t’attends ? Mais vas-y, saute, saute, saute, SAUTE ! Et je comprends qu’il se cherche quelqu’un pour sauter avec lui, parce qu’il a peur de sauter tout seul, bien sûr. Alors ma fille morte et la lumière, c’était… Tu vas sauter, oui ? Il s’accroche à mon bras et me pousse vers le vide. Le soleil en dessous me brûle la plante des pieds. Je pivote sur moi-même et Bruno se retrouve en déséquilibre, prêt à tomber. Il agrippe mon bras, me défie du regard. Il sait qu’il peut me faire plonger avec lui s’il le veut. Son corps penché par l’arrière, il me sourit et je le découvre heureux pour la première fois, heureux et libre tout à coup. Ses lèvres m’envoient un baiser au moment où il desserre son étreinte, puis lâche mon bras. Il tombe sans crier vers le soleil qui l’avale aussitôt. À genoux au bord de la pièce, j’appelle ma fille morte par son prénom. Mais il n’y a plus que le silence des sphères et la froideur de l’univers pour me faire comprendre qu’on crie toujours en vain le nom de ses enfants disparus.
Quand je reviens dans la côte de la Pente douce, mes personnages m’entourent. Je lis sur leurs visages un mélange d’inquiétude et de stupéfaction. De toute évidence, Bruno a disparu. Mes personnages l’ont vu s’envoler, aspiré par un rayon de soleil comme le Christ sur sa montagne. Dans un réflexe, je cherche Diane du regard. Elle se tient en retrait, son cellulaire à l’oreille. Dans mon roman, c’est elle que Bruno emmène avec lui. Venez, vite ! Agrippez-vous à elle ! Mes personnages obéissent et s’agglutinent autour de Diane qui ne comprend pas ce qui se passe et nous ordonne de la lâcher. Son tailleur deux pièces nous permet de la retenir un instant, mais déjà nous la sentons s’élever. Ses deux fils se mettent à pleurer quand les pieds de leur mère quittent le bitume de la côte de la Pente douce. Paul, son mari, s’accroche à ses jambes au moment où tout le monde abdique, aspiré avec elle. Deux mètres, trois mètres, quatre mètres… Il sait qu’il n’y arrivera pas, regarde ses fils, qui le supplient de ne pas les abandonner. Il se laisse finalement tomber, puis voit sa femme suivre Bruno dans la lumière aveuglante du soleil.
Une fois le choc encaissé, mes personnages me dévisagent, comme si j’étais responsable des malheurs qui leur arrivent, et ils se disent qu’il vaut mieux s’éloigner de moi, que je suis dangereux, que je cache, sous mes habits de compassion, le plaisir sadique de les faire souffrir. Ils se regroupent autour des enfants de Diane et me défient du regard. Au moment où je vais tenter une explication, leur parler de contingences et de déterminisme, Paul s’approche et, sans prévenir, me décroche la mâchoire d’un solide coup de poing. Mes genoux flanchent, et c’est assis sur l’asphalte brûlant de la Pente douce que je les vois me tourner le dos et s’engager dans le petit escalier qui les mènera au parc des Braves.
Incapable de fermer la bouche, figée par l’os probablement fracturé, je lorgne du côté de l’hôpital du Saint-Sacrement. Les badauds que je croise en claudiquant jusqu’aux urgences me dévisagent sans comprendre le cri muet que je semble leur lancer. Le médecin de garde, grand galet au teint juvénile, tente de décoder les « han-han » que je lui sers en guise de réponses à ses questions avant d’enfiler des gants de latex d’un bleu amical pour me replacer la mâchoire sans ménagement. Curieusement, une fois l’os rebouté, je réussis à le remercier sans trop de difficulté. Une douleur persistante gonfle ma joue, mais tout porte à croire que je m’en sortirai sans trop de dommage.
Quand je sors de l’hôpital, je cherche mes personnages dans le couchant du soleil. Je ne peux pas croire qu’ils m’aient abandonné, mais puisque je ne les trouve nulle part… Je marche sans but dans les rues du quartier Montcalm, longe le Parc des champs de bataille jusqu’au Vieux-Québec, traverse la porte Saint-Louis, puis enfile la petite rue Saint-Denis vers le belvédère qui la termine. Et là, plus seul qu’un moine au monastère, fouetté par le vent qui, de l’Île d’Orléans, vient lécher le Cap Diamants, j’attends que la nuit tombe, confiant que mes personnages referont bientôt corps autour de moi pour me protéger de ce que je pourrais devenir sans eux.
Mais lorsque les lampadaires s’illuminent enfin, je n’ai que le froid pour me tenir compagnie. Je ne compte plus depuis longtemps les aller-retour des traversiers qui, sur le fleuve, se croisent dans une danse réglée par la marée, et ne cherche plus à sourire aux touristes qui me saluent en se demandant si je vais bien. Non, madame, je ne vais pas bien. Pas bien du tout parce que je n’accepte pas que mes personnages me larguent ainsi. Je les trouve mesquins, irrespectueux, incapables de reconnaître que sans moi, ils n’existeraient pas.
Une fois ma colère passée, je me décide à bouger. Mais déjà je me perds dans cette ville que je connais pourtant si bien. Je me laisse porter par les pentes de la haute ville jusqu’au pied de la côte d’Abraham et m’affale sur un banc du parc Saint-Roch, entouré de clochards endormis, que rien ne dérange. Je fouille ma poche pour en tirer mon carnet de notes, mais je n’ai plus de mots que pour parler de ma fille morte puisqu’il n’y a plus qu’elle qui veuille encore de moi. Alors je plonge dans le grand feu de peine que j’ai jadis allumé sur la grève de Saint-Jean, Ile d’Orléans, pour y reprendre ses vêtements et ses jouets d’enfant. Et quand le feu perce des brèches dans ma chair déjà brune, j’y enfourne mes rêves où je la vois grandir et devenir une femme comme sur la cassette rose de Nadine. Au moment où le souffle me manque pour lui crier que je l’aime parce que je viens de tomber et que de la cendre remplit déjà mes poumons, mes personnages se pointent, un à un, trop tard pour me sauver, puisque déjà ma fille morte a retrouvé son père.
Appendices
Note biographique
Alain Beaulieu
Écrivain et professeur de création littéraire à l’Université Laval, Alain Beaulieu est l’auteur de huit romans dont Fou bar (Montréal, Québec-Amérique, 1997), Le dernier lit (Montréal, Québec-Amérique,1998), Le fils perdu (Montréal, Québec-Amérique,1999), Le solo d’André (Montréal, Québec-Amérique, 2002) et Le joueur de quilles (Montréal, Québec-Amérique, 2004). Il a remporté à deux reprises le Prix littéraire Ville de Québec-Salon international du livre de Québec, soit, en 2006, pour Aux portes de l’Orientie (Montréal, Québec-Amérique jeunesse, 2005) et, en 2007, pour La Cadillac blanche de Bernard Pivot (Montréal, Québec-Amérique, 2006). Il a écrit aussi pour le théâtre et la radio. Parallèlement à ses activités de création, il a participé à plusieurs manifestations littéraires et s’est impliqué activement dans la promotion et la diffusion de la littérature du Québec, donnant à ses consoeurs et confrères écrivains des tribunes pour se faire entendre et rejoindre un plus vaste public.