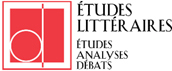Abstracts
Résumé
La poésie française, dès 1980, permet d’interroger les variations historiques du verset et ses actualisations les plus récentes. Si une indétermination marque d’emblée cette forme, il apparaît progressivement que la porosité entre vers et prose engage une déstabilisation manifeste des identités discursives en poésie. Ainsi se détache-t-on de la seule structuration lyrique du verset pour l’associer à la trame narrative. Le verset contemporain favorise l’entrelacement des discours davantage que leur distinction. C’est ce que montrent les études sur la narrativité déceptive chez James Sacré et Olivier Barbarant, ainsi que sur la dimension épique chez Hervé Micolet.
Abstract
The verset and discursive instabilities in contemporary French poetry since 1980 invite reflection on the historical variations of verse and its most recent actualizations. If an indeterminacy marks this form from the start, it gradually becomes clear that porosity between verse and prose destabilizes discursive identities in poetry. Thus the primarily lyric structure opens itself to narrative modes. The contemporary verset favors the interlacing of discourses, rather than their strict separation. This can be seen in the deceptive narrativity in works by James Sacré and Olivier Barbarant, as well as in the epic dimension of Hervé Micolet’s poetry.
Article body
Les définitions rhétoriques du verset se fondent avant tout sur la tension entre vers et prose. Le verset serait un entre-deux qui produit une hésitation dans la reconnaissance précise d’une forme. Conçu davantage par la négative que par la positive, le verset est déterminé par le fait qu’il n’est ni de la prose ni du vers. Ces définitions tentent alors de trouver une justification par le décompte des syllabes, par la dynamique accentuelle ou par les jeux rythmiques[1]. Les retours réguliers, l’inscription d’une cadence mènent aussitôt le verset vers une association au vers, tandis que l’irrégularité et la narrativité le conduisent vers la prose. Dans ces définitions rhétoriques, le verset est saisi de manière microstructurale, en superposant des niveaux d’interrogation différents : la cadence, le rythme, la cohésion discursive, la narrativité en poésie. Il n’est donc pas étonnant que cette question soit soumise à un certain flottement théorique. Pourtant, lorsqu’un recueil se bâtit sur des versets, ceux-ci sont relativement aisés à repérer, pour de simples raisons typographiques (les longueurs importantes et variables, l’alinéa ou le retrait, la majuscule au début du verset). Il semblerait alors que le verset soit avant tout un enjeu graphique de la poésie, sans que cela soit réducteur, puisque cette dimension peut être une première ouverture rythmique. D’un point de vue opératoire, la dimension graphique pourrait bien évidemment servir de première reconnaissance. Toutefois, il est intéressant d’observer que certaines spécificités du verset pourraient également tenir dans la cohésion discursive de la poésie. Plutôt que de se centrer sur une séquence, l’approche du verset gagne à être prise dans la construction globale des poèmes et même des recueils. Quand apparaît le verset ? Pourquoi du verset plutôt que de la prose ou du vers ? Comment justifier ce changement typographique ?
Répondre de manière générale à ces questions serait sans doute vain. Le verset relève d’une historicité importante en poésie française, débutant dès la fin du XIXe siècle et prenant son essor à partir du début du XXe siècle[2]. Les variations quant à ses définitions et aussi à ses emplois chez les poètes sont considérables. Si nous pouvons trouver des liens entre les textes de Paul Claudel, de Saint-John Perse et de Victor Segalen, il est en revanche plus difficile de maintenir ces liens avec les productions françaises plus contemporaines. Aussi l’étude critique du verset doit-elle se décentrer de cette première période, qui correspond certes à une fondation, pour considérer un éventail plus vaste d’oeuvres, notamment dans la nécessité de maintenir cette forme par-delà les décennies. Pourquoi le verset est-il toujours d’actualité ? Que permet-il de produire que le vers ou la prose n’offrent pas ? Déjoue-t-il et rejoue-t-il certaines attentes liées au genre de la poésie ? Par rapport à notre questionnement sur la cohésion discursive, il semble clair que la méfiance vis-à-vis d’une dominante lyrique trop importante a son rôle dans le débat contemporain.
Afin d’explorer les problématiques qui émergent sur le verset dans une période récente (de 1980 à nos jours), nous allons tout d’abord voir ce qui peut rester d’une des définitions les plus précises du verset, celle de Paul Claudel. Ensuite, nous entrerons dans certaines oeuvres emblématiques à partir de la tension entre les constructions lyriques et narratives. Dans un premier temps, nous prendrons des textes marqués par l’évocation du quotidien, selon des perspectives minimalistes, comme celles de James Sacré. Nous interrogerons dans un deuxième temps le verset et la traversée urbaine chez Olivier Barbarant, qui propose un décentrement désenchanté, et chez Hervé Micolet, qui ouvre un chant épique urbain à la suite de Jacques Réda.
De la détermination de Claudel à l’indétermination actuelle
Parmi les réflexions les plus approfondies des fondateurs du verset moderne français, nous trouvons les propos de Paul Claudel. Bien que sa théorie ne s’appuie pas sur le « verset » mais sur ce qu’il appelle le « vers », il est intéressant de reprendre certains principes énoncés par l’auteur des Cinq grandes Odes dans ses Réflexions et propositions sur le vers français[3]et dans ses écrits théoriques. Il apparaît en effet rapidement que l’approche de Claudel offre une assurance pour qualifier ce qui serait du verset, car le vers tout comme le verset devraient être clairement identifiés d’après cet auteur. D’une telle détermination, qui restreint la qualification du verset, nous avons ainsi la possibilité de mieux comprendre combien certaines productions récentes ont mis à mal — ou au contraire ont poursuivi — ce qui peut paraître comme un fondement du verset dans la modernité. Mais il convient d’emblée de mentionner que la théorie de Claudel ne s’exerce pas sur l’unique poésie, mais également sur le théâtre. Le verset ne serait pas ainsi exclusivement réservé à un genre et il pourrait même franchir les frontières littéraires en se dirigeant vers l’oralité quotidienne.
La réflexion claudélienne place directement le vers et le verset sous le signe de la discontinuité : « éclairs » et « secousses » donnent une part active au lecteur. Toutefois, bien que centrés sur un principe de discontinuité, le vers et le verset auraient également un principe d’ordre plus prévisible, celui de l’alternance d’un temps fort (marqué par l’animus) et d’un temps faible (lié à l’anima). Se fondant sur un imaginaire singulier de la langue française, Claudel pense ainsi pouvoir reproduire la puissance des combinaisons grecques et latines. Il y aurait dès lors des pieds possibles en langue française, qui ne seraient pas uniquement rattachés à l’accent en fin de groupe syntaxique. Si cet imaginaire est discutable d’un point de vue linguistique, il est en revanche intéressant d’observer la nécessité pour Claudel de trouver des justifications au verset par-delà les simples éléments typographiques, le décompte syllabique ou le travail des rimes. La discontinuité ouverte est garantie par un pendant de continuité afin de maintenir un équilibre et surtout une distinction d’avec la prose. Nous voyons là un des moyens courants pour affirmer la distance entre verset et prose : le recours théorique à une forme prévisible, parfois cadencée, en lien avec la puissance rythmique, qui pourrait être plus discontinue. Ainsi, dans le domaine contemporain, chez un poète comme Pierre Oster, nous avons le désir d’une mesure avec une reprise des accents de groupe (alliant versets métriques et cadencés[4]), qui peut se rapprocher d’un souhait que la poésie française soit proche de celle des langues antiques ou étrangères, avec des combinaisons de pieds, des alternances de syllabes longues et brèves ou des temps forts et faibles. Cet imaginaire permet de donner une détermination précise au verset par-delà la simple distinction graphique, assez peu reconnue par les auteurs, notamment d’un point de vue rythmique. Mais à l’exception de quelques poètes, nous trouvons globalement à partir des années 1980 une volonté de se défaire d’un ordre repérable aussi restreint que celui de la cadence ou de l’alternance. Quelque chose de plus aléatoire se produit, qui parvient néanmoins à être identifiable et à mobiliser puissamment la sensibilité.
Un autre trait marquant de la théorie claudélienne sur le vers et le verset est celle de l’oralité quotidienne, très souvent associée à la prose. Au contraire d’une vision qui ferait du texte en vers un éloignement du quotidien, Claudel conçoit dans l’oralité une puissance propre au vers. Une dimension naturelle apparaît alors, qui fait du verset une concrétion formelle de ce que l’oralité a de plus abouti rythmiquement. Une telle question sur le quotidien et l’oralité se posera notamment avec les oeuvres de James Sacré et d’Olivier Barbarant dans le champ contemporain. Mais ce sont plus largement des auteurs de différents mouvements, comme Jacques Réda, Hervé Micolet, Emmanuel Hocquard ou Jean-Marie Gleize, qui vont intégrer dans le verset des problématiques du quotidien, parfois en opposition au style soutenu ou à la « Haute Poésie » liés historiquement à cette forme.
Enfin, parmi les questions que nous traiterons figure également celle de la narrativité. Claudel distingue les « vers libres » des « vers iambiques ». Ces derniers, marqués par des dimensions épiques, sont l’objet d’une critique, car ils ne sont souvent qu’une mécanique monotone, comme l’oeuvre de Hugo selon Claudel. Ce type de vers se limite à une cadence prévisible. Les principaux écueils dans le « vers iambique » sont la perte de la dynamique rythmique et de la discontinuité, au nom des principes d’ordre d’une versification fondée sur la répétition ainsi que sur l’énumération. La platitude qui se dégage de ces structurations est d’après Claudel typique des romantiques, qu’il déconsidère dans leurs traitements de la versification. La libération du vers, avec l’ouverture du verset, permet ainsi un accroissement de l’expressivité poétique. Une telle méfiance à l’égard de la répétition sera d’autant plus accrue dans le champ contemporain que la narrativité apparaîtra dans le verset comme une combinaison discursive bénéfique pour la construction lyrique. Mais celle-ci devra maintenir une prérogative d’expressivité sensible, pour donner à éprouver l’expérience affective au lecteur par la forme même.
Nous voyons apparaître un horizon possible pour envisager une spécificité du verset. Toutefois, l’approche théorique de Claudel, bien que majeure et approfondie, prend un arrière-fond qui connote vers et prose d’un point de vue discursif. De cette dimension, il est peu question, alors qu’elle détermine grandement les théories poétiques du XXe siècle. Comme l’a montré Dominique Combe[5], la poésie au XIXe siècle se construit sur la base d’une rhétorique des genres qui tend à remplacer l’opposition vers/prose par celle de poésie/prose. Dès lors, outre le genre littéraire qui adopte les caractéristiques d’une forme, nous trouvons une série de bipartitions des genres de discours, des actes de langage et des imaginaires de la langue, qui sépare la poésie (associée à la structuration lyrique) du récit, de l’argumentation, de l’ironie. Une telle bipartition implique que la poésie adopte les caractéristiques de la composition, de la clôture, de l’essence, de l’intériorité, du silence, alors que la prose ne serait que de l’ordre de la succession, de la référence, de l’arbitraire, de la prolixité, de l’imaginaire.
Aussi, dans la « zone médiane » du vers et de la prose, il est intéressant d’observer le croisement, voire la perturbation, de cette bipartition. En effet, cette dernière se fonde sur un imaginaire théorique des genres qui ne rencontre pas la complexité des réalisations poétiques. Alors que la théorie oppose les constructions discursives, par des exclusions successives, les textes poétiques ne cessent de proposer une hétérogénéité, favorisant l’insertion de séquences narratives ou critiques dans les poèmes à dominante lyrique. Dès lors, c’est l’idée même d’une frontière purement théorique que les poèmes tentent de défaire : outre les mixités discursives, des traits formels apparaissent, comme le verset. Celui-ci est d’emblée une forme qui implique une médiation et une tension dans cette bipartition. C’est pourquoi il favorise des définitions par la négative ou par des traits qui le rapprochent tantôt du vers tantôt de la prose, selon les poètes. La spécificité même d’un texte en versets tient, outre son identification graphique, à une atteinte à la bipartition théorique du début du XXe siècle. Cela est marquant d’un point de vue discursif, avec l’accroissement des séquences narratives dans des poèmes à dominante lyrique.
L’hétérogénéité discursive n’est pas le propre du verset. On trouve de nombreux poèmes narratifs qui conservent le vers : pensons à Chêne et chien (1937) de Raymond Queneau ou à la Vie ordinaire (1967) de Georges Perros. Raymond Queneau qualifie son recueil de « roman en vers », mais celui-ci trouvera sa place dans la tradition et dans les collections poétiques. Georges Perros prend l’octosyllabe comme mètre pour développer son autobiographie, avec l’exploration de la banalité quotidienne. Les poésies critiques sont également présentes au XXe siècle, que ce soit sous forme d’interférences, comme les approches affectives de la science chez Francis Ponge, Eugène Guillevic, Jacques Roubaud, ou sous forme de dominante chez Louis Aragon, Olivier Cadiot ou Emmanuel Hocquard. S’il convient ainsi de bien saisir les identités discursives multiples en poésie (lyrique, narratif, critique), comme nous l’avons proposé dans le Pacte lyrique[6], il est nécessaire de toujours les penser en séquences et en dominantes, avec l’interaction du lecteur. Il est rare de trouver une pureté lyrique ou une pureté critique, notamment dans la poésie moderne. Car parmi les caractéristiques de cette « modernité » poétique[7], nous trouvons justement la mixité discursive. Une Saison en enfer de Rimbaud devient alors emblématique d’une telle hétérogénéité, car cet ensemble peut être lu comme un récit autobiographique, comme une parodie critique, comme une évocation lyrique de la perdition et de la résurgence du sujet. Dans des textes aussi complexes du point de vue de l’identification discursive, chaque lecteur choisit en définitive la dominante qui lui semble la plus compatible avec ses attentes.
Le verset contemporain s’inscrit clairement dans cette tension de l’hétérogénéité, et il est une forme emblématique de ce brouillage des frontières génériques. S’il a pu passer dans la réception comme une forme rattachée à la « Haute Poésie », relativement conservatrice, il apparaît, depuis une trentaine d’années, comme un moyen marquant de travailler les attentes poétiques. En cela, il accompagne deux mouvements esthétiques principaux : d’une part, l’accroissement des structurations narratives et critiques en poésie depuis les années 1970 ; d’autre part, le retour en force de la versification et des formes fixes dans le domaine poétique dans les années 1980. Ce double mouvement place ainsi le verset dans une certaine ambivalence au sein des débats contemporains sur la place du lyrique en poésie, car il relève tant d’une consolidation des attentes du genre, du point de vue de la versification, que d’une perturbation de la dominante lyrique associée théoriquement à la poésie. C’est pourquoi il est intéressant de se concentrer sur le contemporain, malgré certaines difficultés critiques, car il se passe quelque chose d’important autour du verset. Nous allons ainsi visiter certaines oeuvres qui présentent des différences mais qui se regroupent autour de caractéristiques communes.
Narrativité déceptive et banalité du quotidien chez James Sacré
Afin de situer quelques enjeux de versets contemporains, nous allons nous centrer sur l’oeuvre marquante de James Sacré (né en 1939). Ses textes ont une manière singulière d’entrer dans des narrations bancales, notamment pour évoquer le quotidien. Toutefois, ces dimensions déceptives, elliptiques, alliées à une volonté de platitude première, engagent une esthétique singulière qui manifeste des traits marquants du verset de « bas voltage[8] » d’aujourd’hui. Ce sont souvent des évocations de rencontres amicales, amoureuses, des découvertes de paysages, des lieux qui ouvrent une construction proche de l’élégie. Dans cette oeuvre, nous trouvons la perte magnifiée de l’autre, de l’enfance, de l’adolescence avec une perspective évidée sur l’ici et maintenant. Les textes de Sacré travaillent ainsi, par des versets boiteux et par une narration inachevée, la tension entre la perte fondatrice, le quotidien désenchanté et la possibilité de s’émerveiller face à ce qui est déconsidéré (par exemple, un âne ou des graminées).
James Sacré a publié de nombreux recueils, de son premier ouvrage majeur, Coeur Élégie Rouge (1972) à Âneries pour mal braire (2006). Sa poésie centrée sur le monde rural de l’enfance en Vendée s’ouvre sur les paysages maghrébins, notamment dans un de ses recueils les plus connus, Une fin d’après-midi à Marrakech (1988), ou sur ceux de la Nouvelle-Angleterre où il a enseigné[9]. L’univers poétique de Sacré implique une constante instabilité, qui se déploie en inquiétude, voire en incrédulité, face à la possibilité d’être entièrement. Cette préoccupation se retrouve avant tout dans le lien entre le nom et son référent, que James Sacré interroge régulièrement. Ses travaux académiques à partir de la sémantique greimasienne ont sans doute marqué cette méfiance vis-à-vis des signes et de leur manière de convoquer le monde. Sa poésie joue sur cette instabilité avec une gaucherie, pour justement trouver ses éléments fondateurs. S’il y a ontologie chez Sacré, celle-ci est masquée par l’épaisseur, la discontinuité, la mise à mal des liens. Dès lors, il n’est pas étonnant de trouver une entreprise de ressassement de certaines expériences, qui conduit à interroger les origines, par les figures de l’enfance, de l’innocence, du temps passé. Nous nous confrontons ainsi à des interrogations profondes sur les fondations de l’être-au-monde, mais celles-ci sont immédiatement différées et dissoutes par la banalité et l’opacité du quotidien.
D’un point de vue discursif, la poésie de James Sacré entrelace diverses structurations discursives, tout en privilégiant les dominantes lyrique et narrative. Nous lisons avant tout des séquences d’évocation sensible du monde, qui partent d’ancrages narratifs rappelant un souvenir ou un lieu, par exemple. Que ce soit à travers le voyage, le paysage ou de simples photographies, le texte se déploie à partir d’un événement simple pour traiter de la perte, du sentiment de vide. Les recueils de Sacré livrent également des séquences critiques, notamment par rapport à l’acte d’écriture, à la volonté de tenir le monde en mots, mais ces séquences ne sont que des étapes d’un parcours avant tout narratif et lyrique. Le parcours dans ses recueils n’adopte pas la trame d’un récit en tant que tel. Nous ne sommes ni dans le récit de voyage ni dans une autobiographie, mais davantage dans un ensemble difficile à situer, propre à l’entre-deux. L’intérêt consiste justement à saisir des amorces de récits qui ne parviennent jamais à un aboutissement attendu. La sensation d’un inachèvement fait partie de cette poésie qui va justement utiliser le verset comme une forme privilégiée. Le verset sera fréquemment le lieu d’embrayage et de perte de la narrativité.
Car le récit chez Sacré produit des déceptions. Il ouvre des digressions, des mises en abyme, en finissant par conduire le lecteur dans une alternance d’évocations lyriques et d’interrogations métapoétiques. Les nombreux doutes énoncés affectent la construction habituelle d’une trame narrative, même discontinue. Afin de défaire ces attentes narratives, le sujet lyrique aime à prendre des événements sans importance au premier abord, qui ancrent le récit dans une forme d’errance, de lassitude et de banalité :
[…] Un peu grasses les frites, pourtant la patronne me demande
Si c’est bon, si ça va ; oui ça va d’être à Bruxelles comme ça
Cette espèce de grosse ville campagnarde et punk, tout un mélange semble-t-il
De gens nature ou compliqués, la belgitude en ses langues dépareillées, je viens d’acheter,
Dans une bouquinerie du quartier,
Des poésies paysannes de Francis André. On est content.
J’aime bien les gestes du patron qui colle sur la vitrine de son restau, avec application,
Des lettres en papier rouge qui sont celles du mot « fritures »[10].
La platitude du dialogue (« si c’est bon, si ça va ; oui ça va »), le cliché sur les frites, la simplicité des actions et des constats (« on est content ») soulignent le manque de tension narrative lié à ce type de récit. Par ailleurs, nous trouvons chez Sacré une stratégie, souvent utilisée par Blaise Cendrars ou Jacques Réda, de l’entrelacement des lieux, des souvenirs, qui crée une profondeur spatio-temporelle. Ce sont des sortes de métaphores, au sens étymologique du terme, qui transportent le sujet d’un point à l’autre. Ainsi, certains villageois maghrébins, ou simplement certains objets, rappellent les parents, l’enfance. Les passages entre la France et d’autres continents sont fréquents, ramenant les enjeux de l’origine dans l’ailleurs : « Bas-Poitou dans l’Amérique en été[11] ». Cette stéréoscopie enchâsse parfois les récits, mais elle conduit le plus souvent à l’évocation lyrique. Il n’est dès lors pas rare de trouver une nouvelle section dans le recueil pour ne revenir qu’ensuite à un élément du récit commencé mais jamais achevé. Les événements ou les lieux évoqués deviennent l’occasion d’une exploration de la constitution affective de soi, notamment dans le sentiment d’appartenance : « La ville a davantage / Un air d’appartenir au monde[12] ». La construction des recueils sur la base de narrations déceptives, qui mènent à des interrogations lyriques sur l’origine et l’être-au-monde, est typique de ce poète.
Or, le verset participe à cet entre-deux discursif. Il manifeste justement une indétermination qui soumet les normes poétiques à des distorsions. Les recueils de James Sacré se construisent souvent sur la base de vers, de versets et de proses. Même si le verset est emblématique de sa démarche, il convient de préciser que cet auteur aime mener le lecteur dans la discontinuité. Il est évidemment tentant d’observer de près les différences entre ces formes, pour voir si elles reflètent l’hétérogénéité discursive. Les versets et les proses sont souvent relativement faciles à distinguer. Ainsi, dans une réflexion esthétique des Mots longtemps, James Sacré démarque la montée des mots du jaillissement de ceux-ci par le changement de forme :
Les mots venus lentement gardés longtemps sans que vraiment tu le saches, cueillis, ramassés dans l’attention portée au monde… les mots venus, revenus, lenteurs de leur fixation peu à peu sur ce qu’on retient du monde à cause de ce qu’on est ou de ce qu’on devient,
Soudain les voilà précipités en formulations qui ne sont
Ni vraiment des phrases, ni
De si précises mesures de rythme : un poème.
On n’y reconnaît plus rien mais quelque chose y bat, on aime à s’imaginer
Que cela nous parle et que c’est
Un commerce familier de notre corps
Avec le monde et ces mots qu’il nous a donnés[13].
Ainsi, le passage de la prose au verset peut marquer une variation discursive, comme le début d’une narration après une partie lyrique, ou une évocation lyrique après des commentaires critiques. Le verset chez James Sacré favorise néanmoins l’alliance des souvenirs et le déploiement de la sensibilité : le premier poème en versets de Si peu de terre, tout souligne ainsi la jonction entre le récit de la mère qui plie le linge et l’ouverture d’un paysage par la fenêtre, qui figure les temps à venir. Dans ces variations au sein des recueils, la prose apparaît avec plus de fluidité. Néanmoins, il est parfois difficile de distinguer clairement verset et prose, si on excepte les enjeux typographiques, qui sont importants pour la dynamique rythmique. C’est pourquoi ces scissions formelles sont périlleuses à systématiser, comme dans le recueil intitulé Si peu de terre, tout paru en 2000. La différence entre le vers libre et le verset se fait en revanche plus clairement, car la plupart des vers de Sacré se construisent de manière plus elliptique que le verset : la parataxe et l’énumération participent à cette forme.
La nuit est là comment venue ?
N’a pas couru, elle respire léger ;
On a peur on a plaisir.
Tout l’monde l’attend
Pour s’endormir, ou mieux faire quelque chose.
Quelqu’un s’en va retourner à la nuit un vieux chemin qui va jusqu’à l’odeur d’un lavoir abandonné ; du foin pas coupé dans les prés.
Faire l’amour à la nuit devient un grand moment de silence et de noir tranquille dans les arbres[14]…
La première laisse du poème, faite de vers libres, offre diverses indéterminations pour le lecteur. Absence de sujet, parataxe s’y manifestent, tandis que la laisse en verset engage une continuité plus grande, avec une ampleur nouvelle. L’alternance entre les vers, les proses et les versets permet de voir que les changements sont avant tout justifiés par des contrastes macrostructuraux. Nous avons des ruptures dans les séquences discursives, des changements de rythme, de voix et parfois de thèmes. S’il est délicat de systématiser un usage du verset chez ce poète, nous pouvons néanmoins le considérer comme une articulation dans la complémentarité des formes du vers et de la prose.
Du point de vue accentuel, les poèmes de Sacré présentent également des variations importantes : certains textes offrent une régularité de l’accent, tandis que d’autres travaillent la discontinuité. Ces ruptures sont motivées par l’expressivité. Ainsi, dans un poème des Mots longtemps[15], la première laisse sur la sieste engage une régularité importante (les accents sont notamment placés aux douzième et quatorzième syllabes, avec des écarts réguliers), alors que les versets de la deuxième laisse manifestent une discontinuité, au moment où l’on passe de la plénitude perdue à l’inquiétude thématisée de l’écriture. Ces jeux de continuité et de discontinuité se retrouvent constamment dans la surprise des enjambements, dans les heurts syntaxiques, dans les articulations défaillantes. Mais sans doute un des traits les plus marquants des versets de Sacré tient à la porosité d’une oralité qui pourrait paraître prosaïque mais qui renvoie plus profondément aux origines vendéennes. Ainsi, les lourdeurs syntaxiques apparaissent fréquemment : « À cause que j’apprends, oui, qu’un ami d’il y a quelques années / Est toujours là trois soirs par semaine, Driss Lebbar[16] ». Une certaine crudité vient également souligner la volonté d’instaurer une horizontalité profane face aux attentes du verset :
Je me souviens que Jésus est entré dans Jérusalem
Sur un âne.
Souvent je me demande ce que Jésus faisait avec son sexe
Si ça le faisait penser
Ou si, parfois, ça lui pesait agréablement entre les jambes[17] ?
L’âne, que James Sacré a particulièrement évoqué dans son recueil de 2006, Âneries pour mal braire, semble justement illustrer l’esthétique boiteuse. Car cet animal, jadis utile et toujours déconsidéré, est une figure « grotesque » qui parvient néanmoins à s’adapter aux terrains les plus accidentés. Sa voix ne peut le conduire qu’à braire, mal, et son « chant » ressemble selon l’auteur au patois des paysans vendéens :
Ah ! vive la France ! Comme ils ont eu sa peau, peu à peu !
Le patois, qu’ils disaient, cette espèce d’âne grotesque
Avec ses yeux sales, ses bruits !
De temps en temps on le fait braire, pour en rire[18].
Le verset ressemble ainsi dans l’imaginaire de la production au chant de l’âne et non plus à celui du cygne : solitaire, déconsidéré, mais finalement tenace et vigoureux. Il permet de retrouver un sol, sans chercher une verticalité immédiate ou évidente. Nous ne trouvons pas de versets à teneur métaphysique, mais une volonté de platitude qui engage malgré tout une profondeur. Celle-ci vient justement du fait que cette poésie est bancale. Le rôle de l’écriture consiste alors à dire le monde « mal fini », dans l’interférence de l’écrit et de l’oral, avec des difficultés à identifier les formes et la discursivité. De là, une stratégie qui pourrait tenir du ressassement, mélancolique avec des traits d’humour, pour explorer sans expliquer l’ « inachevé perpétuel » du monde et de l’écriture. C’est bien à partir d’une faille que se déploie l’expérience chez Sacré :
Dans le silence de livres qui n’existent plus
Ou dans ceux qui ne sont pas encore parus
Ça n’est que moi longtemps… pas encore vivant et déjà vécu
Je m’en suis mal aperçu
Qu’est-ce que j’attends[19] ?
Ainsi, narrativité déceptive et ouverture d’une profondeur au quotidien parviennent par les versets, généralement non métriques et non cadencés, à une forme emblématique de la tension qui est à l’oeuvre. Leur flottement, leur aspect minimal et la difficulté à les identifier participent alors à une esthétique singulière qui est devenue majeure dans le champ contemporain.
La traversée urbaine : la banlieue poétique (Olivier Barbarant) et l’épopée renouvelée (Hervé Micolet)
La ville se retrouve comme un thème privilégié de certaines oeuvres contemporaines. C’est le cas notamment de deux jeunes poètes comme Olivier Barbarant (né en 1966) et Hervé Micolet (né en 1965). Mais comment dire la ville, qui passe pour un thème typique de la « modernité » poétique, après les multiples formes et stratégies employées depuis la deuxième moitié du XIXe siècle ? Si Olivier Barbarant propose, dans une démarche parfois proche de celle de James Sacré, une narrativité de « bas voltage », centrée sur des souvenirs et la banalité du quotidien, Hervé Micolet préfère quant à lui l’actualisation des poésies qui mêlent un souffle épique à des constructions lyriques, comme celle d’Émile Verhaeren. Aussi est-il intéressant d’observer ces deux oeuvres pour saisir d’autres approches marquantes dans l’actualité. Pour ce faire, nous nous centrerons avant tout sur deux recueils : Odes dérisoires, et quelques autres un peu moins d’Olivier Barbarant (Champ Vallon, 1998) et L’enterrement du siècle d’Hervé Micolet (Gallimard, 1992).
L’oeuvre de Barbarant a les traits typiques d’un « déchant[20] », fait à la fois de discontinuité, de croisements discursifs et de désenchantement. Elle possède en cela de nombreux aspects communs à d’autres oeuvres contemporaines. La banalité du quotidien habite la plupart de ses textes, à partir de son premier recueil, Parquets du ciel (1991), et d’une formule aussitôt posée qui pourrait synthétiser un des enjeux de sa démarche : « Il n’y a de ciel qu’à hauteur de parquet ». À nouveau, comme chez James Sacré, la part déceptive prend une dimension fondamentale dans un ton qui se rapproche fortement de l’élégie. L’enfance, l’adolescence, les amours passées prennent un ascendant sur un présent qui cherche la célébration de la perte : « Je deviendrais élégiaque que ça ne m’étonnerait pas ». Le recueil des Odes dérisoires, qui se fonde sur des versets[21], est des plus intéressants pour notre propos. Par le terme « odes », le titre marque d’emblée un lien avec la tradition du verset, mais il est immédiatement en tension avec l’épithète « dérisoires », qui place la célébration du côté du peu, du moindre et de l’insuffisant. Le sous-titre « et quelques autres un peu moins » joue sur l’humour, mais la section dite « odes moins dérisoires » du recueil débute par un texte « pour des prunes » et se poursuit par l’« Ode à l’inconnu du Café de l’Univers sur la Grand Place de Saint-Quentin ». Ainsi cette poésie est-elle ponctuée de nombreux doutes sur sa consistance face au monde ou aux souvenirs : « Je me demande ce que j’ajoute à la terrible nudité des choses » ; « Écrire à cru sans plus rien de moi-même qui s’entortille à l’évidente platitude[22] ». Nous ne considérerons pas les enjeux de la banalité dans le verset, déjà vus avec Sacré, mais uniquement ceux de l’instabilité discursive, notamment dans le poème intitulé « Ode écrite à Créteil ». L’intérêt de ce poème tient à l’interpénétration du lyrique et du narratif pour produire une approche habituelle chez ce poète. Celle-ci est accentuée par la thématique : le sujet de l’énonciation se centre sur une banlieue populaire de Paris, avec ses centres commerciaux, ses tours et son urbanisme en apparence chaotique et un lac, rejouant alors une tradition lamartinienne :
Le lac
Pâle et bleu cru traîne en chiffon entre des tours
Pour quel caprice d’architecte en forme d’artichauts[23].
Les deux premières laisses traitent dans une description lyrique d’un paysage urbain, passant du linge sur le balcon aux voiles sur le lac. Dès la troisième laisse commence une séquence narrative liée à un souvenir personnel :
L’alliance des aspects perfectifs et imperfectifs, accomplis et inaccomplis, des temps verbaux (présent et imparfait de l’indicatif) se manifeste dans les deux laisses suivantes :
Voici le théâtre posé sur la Place Salvador Allende
Naguère on connaissait le nom
Désormais c’est un long dallage dédié à l’exotisme[25].
Le présentificateur « voici » s’ancre dans les dimensions déictiques face à un récit qui, détaché dans le temps, amorce la commémoration nostalgique : « Un jour entier on remettait le même disque de Barbara[26] ». Les paroles de cette chanson de Barbara apparaissent dans le poème avec des italiques. Dans d’autres poèmes, c’est par exemple le discours direct d’un personnage qui est ainsi mis en évidence[27]. Loin du patois vendéen, c’est de cette manière, ou avec du discours indirect libre, que l’oralité se manifeste dans les poèmes de Barbarant. À partir de la dixième laisse, l’évocation se resserre pour traiter d’un épisode dans un appartement et enchaîner ensuite sur la rencontre avec un homme : « Nous nous étions connus chez un marchand de fripes / Au centre commercial[28] ». Cette longue séquence narrative se termine par une laisse typiquement élégiaque qui revient sur le lac lamartinien et sur l’irrémédiable oeuvre du temps :
Le lac
À présent meurt plus sombre que la nuit
Les jeunes gens ont disparu les voiles depuis longtemps
Roulées humides dans leur étui[29].
L’enchaînement de séquences lyriques et de séquences narratives s’harmonise pour produire un effet général de remémoration et de célébration de la perte. Certains traits distinguent cependant l’approche de Barbarant de celle de Sacré. Car si l’élégie, le récit déceptif, les digressions, l’oralité les mettent à proximité, l’usage de la métaphore est en revanche différent, tout comme la régularité dans le verset. Barbarant aime charger certaines séquences d’une surabondance de métaphores : « Un ciel que l’hiver ébrèche mettant au bleu très pâle ses couteaux transparents », par exemple. Sans doute trouvons-nous dans ces procédés les traces de la passion critique que Barbarant a pour Aragon[30]. Bien qu’il ait également travaillé sur Pierre Oster[31], l’oeuvre de l’auteur du Crève-coeur reste pour lui fondamentale. Par ailleurs, la forme est nettement plus stable chez Barbarant que chez Sacré. Les recueils sont globalement homogènes, les versets offrent des régularités importantes, devenant parfois cadencés et métriques comme chez Pierre Oster :
Quelquefois le passé ne passe pas vraiment
Il résiste et c’est comme un sable ou des oiseaux disséminés
Sur le minuit de la mémoire tout un désordre d’équinoxe
Chaque étoile coupée saignant d’un souvenir[32].
Deux alexandrins (accents à 6/12) encadrent deux versets avec des accentuations proches (accents à 3/8/16 et à 8/17). Toutefois, les mouvements et les irrégularités restent tout de même importants dans cette poésie, notamment lorsque les séquences discursives s’enchaînent.
Loin d’une narrativité minimaliste, L’enterrement du siècle d’Hervé Micolet cherche plutôt un souffle épique dans l’évocation des villes. Reprenant, une fin de siècle plus tard, certains enjeux de la poésie d’Émile Verhaeren, ce recueil de Micolet, centré sur le verset, offre un contrepoint intéressant à la narrativité minimale contemporaine. Cet auteur, marqué par l’oeuvre de Jacques Réda, sur laquelle il a travaillé théoriquement, a cessé (momentanément) d’écrire depuis 1995, mais ce recueil paru chez Gallimard se construit de manière puissante sous forme d’évocations lyriques à partir de petits récits :
Je suis allé à la rencontre des villes.
J’ai vu cette belle inconvenance des époques entre elles,
et partout ces chantiers, ces brouillons que mille écritures surchargent,
et partout ces raccourcis entre les siècles,
ces voisinages indécents,
la grandeur, la frénésie, les styles[33] !
Tout comme la ville, la poésie elle-même est prise dans ce recueil entre les âges, avec la tension des discours. Aussi, « peu à peu on se défait de tout purisme », car c’est bien l’idée d’une poésie autoréférentielle et uniquement lyrique qui est problématique pour la période contemporaine. La perte d’une dominante lyrique est dès lors manifestée par la narrativité, et le verset fonctionne à nouveau comme un entre-deux. Néanmoins, il y a chez Micolet le désir particulier d’une hauteur de ton, qui serait inhérente à cette forme. La célébration impliquée par le verset n’est ainsi plus minimaliste, comme chez Sacré et Barbarant, elle cherche à élever la narrativité vers l’épique :
Savez-vous, poètes d’il y a cent ans
les villes n’ont pas tellement changé que le ton épique
soit requis pour les dire
et pour imiter le souffle colossal[34].
Aussi n’est-il pas rare de trouver de nombreuses marques d’emphase (« j’ai parcouru la grande plaine d’Europe / comme on tisse sa mémoire au gré des distances[35] »), de jeux mythiques sur le quotidien (« Tu n’as pas tort, j’y songe aujourd’hui, le réel / est ce mythe qui devrait suffire[36]… »), ou de superpositions temporelles :
La haute façade chrétienne, la Vierge dont on aima le visage
reçoivent l’insulte des fous, des relanceurs de guerre sainte.
La bourgeoisie raciste, parmi les étendards, chante des psaumes,
et un prédicateur, voix cassée par l’âge, injecte son message[37].
L’analyse des versets montre une certaine régularité : bon nombre d’entre eux sont de chiffre pair, les accents se retrouvent à intervalle régulier, souvent à la même position. Le poème peut servir de base. Le premier verset du poème « Marches dans la vieille Europe » se constitue ainsi de 20 syllabes, avec des accents qui ponctuent chaque cinq syllabes : « Je marchais beaucoup dans les grandes villes décourageantes de belles femmes[38] ». Nous trouvons ensuite de nombreux versets pairs (12, 16, 14… 22, 6). De nombreux alexandrins parsèment le texte, et les accents tombent fréquemment sur la sixième et la seizième syllabe. Cette régularité s’observe d’un point de vue graphique, où nous constatons qu’un dispositif est globalement adopté par poème et par laisse. Cette régularité ménage la syntaxe, évitant les enjambements trop heurtés, et elle cède fréquemment devant l’expressivité. Ainsi, dans « Les fuyards », nous voyons bien les apports du verset dans des stratégies lyriques et narratives. La longueur des versets varie selon la thématique : s’allongeant lorsqu’il est question d’un accroissement de la disposition affective et diminuant lors de la fuite :
Il nous faut ces régions ! : nous partons, et aussitôt (13)
notre état d’âme (comment dire ?) s’améliore, s’ouvre et s’accorde à la mesure des grandes inventions du relief (31)
où nous fonçons par des voies rapides. (9)
Les étendues augmentent, les formes se multiplient, sur les côtés : des crêtes, par exemple, dans une bande du ciel bleu foncé, (35)
et de grands terrassements routiers où s’étiolent, comme des phares éteints autour desquels se répand la mer démontée, (32)
des fermes, des manoirs, des villages inutiles et poignants[39]. (17)
Nous voyons une dynamique métrique et accentuelle s’adapter à l’expressivité de l’ouverture et de la clôture par un jeu d’alternance.
Ainsi, Olivier Barbarant et Hervé Micolet nous permettent de montrer deux traitements de la ville et du verset relativement différents. En cela, la distinction entre une narrativité minimaliste et une autre qui maintient une dimension soutenue proche de l’épique est extrêmement intéressante dans l’observation de l’hétérogénéité discursive.
Horizon narratif et horizon critique. Conclusion
En travaillant sur la narrativité dans le verset contemporain, nous avons choisi des auteurs qui entrelaçaient cette structuration à celle de la logique lyrique. Situant leurs textes dans l’entre-deux d’une identification, ces poètes font perdre une dominante unique au texte pour jouer sur l’instabilité discursive. Or, il apparaît que cette instabilité reflète celle, plus existentielle ou ontologique, du rapport au monde. C’est l’être, voire la notion même d’être, qui devient bancale, impossible à circonscrire sous la forme d’un récit habituel ou d’une évocation affective directe. Parallèlement, ce sont les possibilités de chanter, en célébrant immédiatement le monde, qui deviennent problématiques, car les dissonances et les contre-chants sont permanents. La stratégie de la zone médiane du verset vient alors activer le brouillage : quelque chose tient en même temps que quelque chose ne tient pas. Exploitant alors la perte d’une métrique ou d’une cadence d’avance délimitées, ces poètes engagent davantage l’expressivité par la discontinuité, par la vitesse, par la dynamique accentuelle française. Nous voyons ainsi que le verset n’est pas qu’un choix formel parmi d’autres, avec un simple enjeu typographique, mais qu’il ouvre une voie discursive de tension, propre aux esthétiques favorisant la mixité.
L’instabilité discursive de la poésie actuelle n’est cependant pas uniquement liée au narratif. On trouve également un autre mouvement contemporain qui travaille l’interférence entre lyrique et critique. Nous pensons bien évidemment à la poésie philosophique de Pierre Oster, un des poètes majeurs pour l’étude du verset contemporain. Car chez ce poète les dimensions affectives côtoient la pensée ontologique : « Plus est dense la pensée, plus l’art doit être profond. Que les deux ordres de recherche, poétique et philosophique, soient en toi l’un à l’autre intimes[40]. » Par ailleurs, sans la célébration ontologique et la hauteur de ton, nous trouvons également dans les mouvements littéralistes et objectivistes des versets qui mêlent lyrique, ironie et argumentation. Nous pensons au travail de Jean-Marie Gleize dans Non, paru en 1999[41], dont la théorie finalement, malgré certaines postures « post-poétiques », est propice pour penser l’entre-deux du verset. Il nous faudrait également évoquer dans ce cadre certaines élégies d’Emmanuel Hocquard[42]. Mais cela est un nouvel horizon, complémentaire à cette première approche, que nous ne faisons qu’esquisser dans cette étude, afin de ne pas limiter l’instabilité lyrique du verset à la seule narrativité. Cette mise au point étant faite, nous pouvons souhaiter que cette forme hybride soit désormais l’objet d’une attention accrue de la part de la critique, pour les dimensions emblématiques qu’elle engage, à un niveau macrostructural, dans la configuration discursive de la poésie.
Appendices
Note biographique
Antonio Rodriguez
Docteur de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, Antonio Rodriguez enseigne la littérature française à l’Université de Lausanne. Spécialiste de poésie moderne, il a publié plusieurs essais et articles sur le discours lyrique (Le pacte lyrique, Liège, Mardaga, 2003 ; Modernité et paradoxe lyrique : Max Jacob, Francis Ponge, Paris, Jean-Michel Place, 2006).
Notes
-
[1]
Il n’est dès lors pas étonnant de trouver des propositions sur le verset avant tout dans des traités de versification, comme chez Jean Mazaleyrat, Élements de métrique française, 1974.
-
[2]
Voir Michèle Aquien, « Une forme paradoxale : le verset claudélien dans Tête d’Or », 2006.
-
[3]
Paul Claudel, Réflexions et propositions sur le vers français, dans Positions et propositions. Oeuvres en prose, 1965, p. 3-45.
-
[4]
Selon la terminologie de Michèle Aquien ; voir le Dictionnaire de poétique, 1993.
-
[5]
Dominique Combe, Poésie et récit : une rhétorique des genres, 1989.
-
[6]
Antonio Rodriguez, Le pacte lyrique : configuration discursive et interaction affective, 2003.
-
[7]
Sur cette question du lyrique dans l’horizon d’attente d’une « modernité », nous renvoyons à nos développements plus récents : Modernité et paradoxe lyrique : Max Jacob, Francis Ponge, 2006.
-
[8]
Cette expression est de Jean-Marie Gleize. Voir « Le choix des proses », http://cep.ens-lsh.fr/ponge/gleize/un.html.
-
[9]
Pour plus de détails biobibliographiques, voir Jean-Claude Pinson, « James Sacré », dans Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, 2001, p. 734-736.
-
[10]
James Sacré, Écrire à côté, 2000, p. 63.
-
[11]
James Sacré, Les mots longtemps, qu’est-ce que le poème attend ?, 2003, p. 121.
-
[12]
Ibid., p. 10.
-
[13]
Ibid., p. 52.
-
[14]
James Sacré, Si peu de terre, tout, 2000, p. 17.
-
[15]
James Sacré, « La sieste à l’Ébaupinaie », dans Les mots longtemps, op. cit., p. 113-114.
-
[16]
James Sacré, Écrire à côté, op. cit., p. 12.
-
[17]
James Sacré, Âneries pour mal braire, 2006, p. 96.
-
[18]
James Sacré, Si peu de terre, op. cit., p. 49.
-
[19]
James Sacré, Les mots longtemps, op. cit., p. 8.
-
[20]
Sur la question du chant et du déchant dans les écritures lyriques, un colloque a eu lieu en juin 2006 à l’Université de Lausanne, dont les actes sont à paraître prochainement.
-
[21]
Olivier Barbarant utilise d’autres formes (vers et proses) dans des ouvrages antérieurs ou postérieurs.
-
[22]
Olivier Barbarant, Odes dérisoires et quelques autres un peu moins, 1998, p. 19.
-
[23]
Ibid., p. 57.
-
[24]
Id.
-
[25]
Ibid., p. 58.
-
[26]
Ibid., p. 59.
-
[27]
Comme dans ce poème où le sujet lyrique est avec quelqu’un face à un tableau :
On fronce les sourcils on se prend au sérieux
Oui ce doit être la transparence À moins que la netteté du dessin
Tu ne trouves pas qu’il y a dans cette tremblante raideur l’idée même du classicisme (ibid., p. 67).
-
[28]
Id.
-
[29]
Ibid., p. 61.
-
[30]
Olivier Barbarant, Aragon : la mémoire et l’excès, 1997 ; Olivier Barbarant, Les yeux d’Elsa, Aragon, 1995.
-
[31]
Olivier Barbarant a consacré son mémoire de maîtrise à l’oeuvre de Pierre Oster : Le chant, la chute et l’architecte, étude sur la poésie de Pierre Oster, 1987.
-
[32]
Olivier Barbarant, Odes dérisoires et quelques autres un peu moins, op. cit., p. 25.
-
[33]
Hervé Micolet, L’enterrement du siècle, 1992, p. 9.
-
[34]
Ibid., p. 13.
-
[35]
Ibid., p. 135.
-
[36]
Ibid., p. 148.
-
[37]
Ibid., p. 68.
-
[38]
Ibid., p. 17.
-
[39]
Ibid., p. 100.
-
[40]
Pierre Oster, Paysage du Tout, 2000, p. 217.
-
[41]
Jean-Marie Gleize, Non, 1999.
-
[42]
Emmanuel Hocquard, Les élégies, 1990.
Références
- Aquien, Michèle, Dictionnaire de poétique, Paris, Librairie générale française (Livre de poche), 1993.
- — — —, « Une forme paradoxale : le verset claudélien dans Tête d’Or », dans
- Thérèse Vân-Dung Le Flanchec (dir.), Marguerite de Navarre, cardinal de Retz, André Chénier, Paul Claudel, Marguerite Duras, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (Styles, genres, auteurs, n° 5), 2006, p. 105-118.
- Barbarant, Olivier, Aragon : la mémoire et l’excès, Seyssel, Champ Vallon (Champ poétique), 1997.
- — — —, Le chant, la chute et l’architecte, étude sur la poésie de Pierre Oster, mémoire de maîtrise, Paris, Université de Paris-Sorbonne, 1987.
- — — —, Les yeux d’Elsa, Aragon, Paris, Nathan (Balises), 1995.
- — — —, Odes dérisoires et quelques autres un peu moins, Seyssel, Champ Vallon (Recueil), 1998.
- Claudel, Paul, Réflexions et propositions sur le vers français, dans Positions et propositions. Oeuvres en prose, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1965 (préface de G. Picon, éd. établie et annotée par J. Petit et C. Galpérine), p. 3-45.
- Combe, Dominique, Poésie et récit : une rhétorique des genres, Paris, José Corti, 1989.
- Gleize, Jean-Marie, « Le choix des proses », [en ligne] http://cep.ens-lsh.fr/ponge/gleize/un.html.
- — — —, Non, Romainville, Al Dante, 1999.
- Hocquard, Emmanuel, Les élégies, Paris, P.O.L., 1990.
- Mazaleyrat, Jean, Éléments de métrique française, Paris, Armand Colin (U2), 1974.
- Micolet, Hervé, L’enterrement du siècle, Paris, Gallimard, 1992.
- Oster, Pierre, Paysage du Tout, Paris, Gallimard (Poésie), 2000.
- Pinson, Jean-Claude, « James Sacré », dans Michel Jarrety (dir.), Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 734-736.
- Rodriguez, Antonio, Le pacte lyrique : configuration discursive et interaction affective, Liège, Mardaga (Philosophie et langage), 2003.
- — — —, Modernité et paradoxe lyrique : Max Jacob, Francis Ponge, Paris, Jean-Michel Place (Surfaces), 2006.
- Sacré, James, Âneries pour mal braire, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2006.
- — — —, Broussailles de proses et de vers, Sens, Obsidiane, 2006.
- — — —, Écrire à côté, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2000.
- — — —, Les mots longtemps, qu’est-ce que le poème attend ?, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2003.
- — — —, Si peu de terre, tout, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Le dé bleu, 2000.