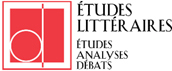Abstracts
Résumé
La prédilection de Sand pour le personnage de sang-froid remonte à son choix, non seulement d’un pseudonyme masculin, mais aussi d’une identité masculine. Maîtriser ses passions, vertu virile à ses yeux, permet de dominer l’autre, et le personnage sandien, surtout s’il est femme, aspire avant tout à dominer. La théorie du désir mimétique élaborée par René Girard s’avère particulièrement appropriée à l’étude de cette figure hautaine, obsédée par l’imitation du modèle aristocratique que lui offre le héros cornélien, jusqu’à ce que la romancière découvre, avec Lélia, que cette rivalité mimétique ne mène qu’à la folie et à la mort. La conversion de Sand au socialisme évangélique l’engage alors à créer, avec Consuelo, un nouveau type de personnage, le personnage bon, au coeur maternel, inspiré par l’imitation du Christ. Mais ce nouveau personnage ne parvient pas à abjurer la volonté de puissance de son prédécesseur, de sorte que le personnage de sang-froid qui, de son côté, refuse de disparaître, pourrait bien être en fin de compte le personnage sandien par excellence, d’autant qu’il incarne les caractéristiques majeures du roman sandien, notamment son intellectualisme et sa facticité.
Abstract
The predilection Sand shows for self-possessed characters goes back to her decision to adopt a male identity as a writer. Self-control, according to her a masculine attribute, means power, and power is what the sandian character wants most, especially if it is a woman. René Girard’s theory of mimetic desire proves to be remarkably relevant to the understanding of these masterful characters, who are obsessed with the aristocratic, Cornelian, heroic model, until the novelist discovers, with Lélia, that such mimetic rivalry leads only to madness and death. Sand’s conversion to a religious socialism prompts her to switch to a new type, the kind-hearted, motherly character, inspired by Christ as a new model. This new type however does not succeed in eliminating the domineering propensity of its predecessor, nor the self-possessed character itself which, therefore, may be the typical sandian character after all, since it embodies the main characteristics of the sandian novel, most notably its intellectualism, and its artificiality.
Article body
Au début de sa carrière surtout, Sand montre une prédilection certaine pour le personnage de sang-froid. Ralph et Indiana, Trenmor et Lélia, Quintilia (Le secrétaire intime), Jacques et Sylvia, Fiamma (Simon), Edmée (Mauprat), en sont les exemples éminents. Ces personnages, qui ont en principe le sang chaud, mais sont doués d’une étonnante capacité à contenir leurs désirs et leurs émotions, constituent l’élite du personnel sandien. En eux, la romancière valorise la présence d’esprit, l’endurance, le courage, l’héroïsme. Leur maîtrise n’est cependant pas à toute épreuve. Elle est sujette à des crises ou à des défaillances qui révèlent une proximité de la folie et une fascination de la mort plutôt curieuses chez des personnages apparemment si fermes. Mais c’est précisément leur vulnérabilité qui les distingue des personnages à sang froid, dont le sang-froid pour ainsi dire naturel se manifeste chez l’homme du monde par une politesse vaine ou cruelle, ou bien, parce qu’il fonctionne à vide, facilite le mensonge et l’habileté du séducteur ou de l’ambitieux. De l’un à l’autre, toutefois, le glissement est toujours possible, la dissimulation leur étant un attribut commun. En tant que personnage à double fond, sinon à fonds multiples, le personnage de sang-froid s’avère riche en possibilités dramatiques, que Sand exploite sciemment, cultivant en particulier l’attrait de l’énigme qui s’y attache. Mais son intérêt majeur vient de ce qu’il met en jeu un aspect essentiel du désir mimétique tel que l’a redéfini René Girard dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, désir qui n’a rien de spécifiquement sexuel et qui, parce qu’il est imitation du désir de l’autre, « tend à déserter l’objet et à se fixer sur le modèle lui-même[1] », lequel, de simple médiateur qu’il était, devient alors ou l’idole à adorer ou le rival à supplanter. Girard ignore Sand, et pourtant, elle aurait pu attirer son attention par l’intérêt qu’elle montre, dès Indiana, pour les modèles, les rôles et les doubles ; par son rejet de la concurrence orgueilleuse et de l’esprit de domination ; par son choix du modèle évangélique comme seul capable de mettre fin à la violence de la rivalité mimétique. En tant que produit de cette rivalité, le personnage de sang-froid, d’abord prestigieux, deviendra la cible de l’ironie ou de la condamnation morale de la romancière qui, à partir de Consuelo, le remplacera, sans pouvoir l’oublier cependant, par le personnage « bon ».
1. Le modèle cornélien
Au départ, le personnage de sang-froid doit son existence au choix qu’a fait la romancière, non seulement d’un pseudonyme masculin, mais d’une identité masculine dominante. Pour elle, le sang-froid est une vertu « mâle », inconnue des femmes, à moins qu’elles ne soient précisément « viriles ». Dès son premier roman, Sand introduit son idéal masculin, Ralph, prototype de l’Anglais « flegmatique » qui réapparaîtra plus d’une fois dans l’oeuvre ultérieure, cachant sous une apparente impassibilité une âme sensible, susceptible d’émotions vives et de passion ardente, mais toujours capable de les soumettre au contrôle de la raison et de la volonté. Misogyne comme le narrateur qui le double, Ralph méprise les femmes, parce qu’il les juge incapables de ce self-control. Indiana est l’exception qui confirme la règle. Douée d’un « courage plus que masculin[2] », elle possède toutes les qualités de l’homme de sang-froid : l’audace, la détermination, la lucidité, la ténacité. Aussi est-elle, de son côté, le prototype des héroïnes sandiennes à venir qui se feront gloire d’égaler, sinon de surpasser leur modèle masculin, réel ou imaginaire. Car le modèle s’intériorise. Indiana, Lélia et Sylvia bénéficient encore d’un alter ego en la personne de Ralph, Trenmor et Jacques, mais Quintilia, Fiamma et Edmée n’ont plus besoin de tuteur.
Sand accouple volontiers le personnage de sang-froid au personnage émotif : Indiana et le colonel Delmare, Lélia et Sténio, Sylvia et Octave, Jacques et Fernande, Fiamma et Simon, Edmée et Bernard, et c’est toujours le premier des deux qui domine l’autre. Et, à une exception près, le premier des deux est toujours une femme. Impérieuses, ces héroïnes ont le goût du pouvoir et savent qu’il ne peut se penser et s’exercer qu’en termes masculins. Lélia aurait aimé être homme pour satisfaire son « ambition de régner par l’intelligence, de dominer les autres hommes par des paroles puissantes[3] », et si elle y parvient, c’est précisément parce qu’elle s’est faite homme. Le renversement des rôles si caractéristique des couples sandiens met en lumière l’intense rivalité mimétique suscitée par le modèle masculin et l’extraordinaire volonté de puissance qui l’anime. Parce qu’il est par sa « féminité » le pôle négatif du couple qu’il forme avec Lélia, Sténio se montre particulièrement sensible au prestige de la force mâle et à l’irrésistible désir d’imitation qu’il entraîne chez celui (ou celle) qui se tient (ou que l’on tient) pour inférieur(e). Sténio admire la fermeté de Trenmor, mais moi, dit-il,
[…] je n’ai pas la volonté qui fait la grandeur et l’énergie du rôle viril, je n’ai pas l’égoïsme invulnérable qui soumet à ses desseins les passions qui le gênent, les intérêts qui l’embarrassent, les destinées jalouses qui encombrent sa route. […] J’ai vécu dans l’admiration assidu des caractères supérieurs et j’ai senti frémir au-dedans de moi-même le besoin impérieux de les imiter et de les suivre. Mais, errant sans relâche de désir en désir, […] mes prières ferventes n’ont jamais obtenu du Dieu qui m’a créé la force d’accomplir ce que j’avais convoité […].
Eh bien! Lélia, c’est pour cela que je vous aime, vous avez pris mon rôle, que les hommes vous refusaient. Loin de répudier le vôtre, je vous le demande à genoux. […].
[…] ce que je vous demande, ô Lélia, c’est de me laisser vous obéir, c’est de souffrir que ma vie se modèle sur la vôtre […][4].
L’idolâtrie qu’inspire la « femme supérieure », c’est-à-dire virile, reproduit comme en miroir la sacralisation du modèle masculin qu’opère le désir mimétique.
Un autre modèle cependant, littéraire et théâtral, vient affiner et ennoblir le modèle masculin. Homme ou femme, le personnage de sang-froid est en effet si fortement aimanté par l’idéal de la maîtrise qu’il rappelle inévitablement le héros cornélien. Corneille est une référence discrète mais essentielle de Sand. Il satisfaisait son exigence morale de loyauté et d’élévation, son esthétique du sublime, son refus de la fatalité, sa volonté d’optimisme, son idéalisme en somme, qu’elle définit elle-même en termes réputés cornéliens, tout en s’identifiant obliquement au maître, dans la notice qu’en 1851, elle place en tête du Compagnon du Tour de France. Sand y reprend en effet le fameux parallèle de La Bruyère entre Racine et Corneille en substituant le nom de Balzac (le vrai rival) à celui de Racine et le sien propre à celui de Corneille. À Balzac donc, l’ambition de « peindre l’homme tel qu’il est », tandis qu’elle le peindra, dit-elle, « tel que je souhaite qu’il soit, tel que je crois qu’il doit être[5] ». Dans Antonia, Julien peut s’élancer « de parti pris dans les régions de l’idéal », simplement parce que « de tout ce qui avait nourri son adolescence, le grand Corneille était ce qu’il avait savouré avec le plus de satisfaction et de fruit. C’est là qu’il avait trouvé, sous la forme la plus élevée, la plus forte et la plus fière aspiration à l’héroïsme[6] ». Mais alors qu’Antonia explique, La marquise met littéralement en scène le privilège du modèle cornélien grâce à la dissociation qu’opère l’héroïne entre Lélio le comédien et le personnage qu’il joue :
Ce n’était pas lui que j’aimais, mais le héros des anciens jours qu’il savait représenter ; ces types de franchise, de loyauté et de tendresse à jamais perdus, revivaient en lui, et je me trouvais avec lui et par lui reportée à une époque de vertus désormais oubliées. […] Lélio n’était pour moi que l’ombre du Cid, que le représentant de l’amour antique et chevaleresque dont on se moquait maintenant en France[7].
Autant que chez Le Tasse, Cervantès et les légendes de la chevalerie, la romancière rencontrait chez Corneille son idéal du héros valeureux et de l’héroïne virile, passionnée et impassible à la fois. Comme Corneille lui-même dans Le Cid, Sand regarde vers l’arrière pour y retrouver ce qu’elle croit être la vraie grandeur. Selon Serge Doubrovsky, Le Cid « ressuscite le mythe médiéval » parce qu’il se veut « retour en arrière », réaction contre l’avilissement de la noblesse, visant à « retrouver et dégager dans toute sa pureté l’existence aristocratique exemplaire[8] ».
Au personnage de sang-froid, le modèle cornélien lègue son orgueil aristocratique. Non que Sand ait beaucoup d’estime pour la noblesse française en tant que classe, dont Corneille avait déjà dramatisé l’asservissement progressif à travers la métamorphose du héros en courtisan. Commençant à écrire sous la Restauration, Sand ne pouvait qu’être encore plus frappée par l’inanité du rôle politique et social de cette aristocratie factice et surannée. Aussi la plupart des personnages de sang-froid ne lui appartiennent-ils pas. Seules Quintilia et Edmée sont nobles de naissance, Fiamma n’étant pas réellement la fille du comte de Fougères. Et pourtant, nobles ou non, ils se comportent tous comme s’ils l’étaient. Sand elle aussi « restaure », mais contre la Restauration, en ressuscitant l’héroïsme chevaleresque.
Chevaleresques, les personnages de sang-froid le sont littéralement par leur passion pour l’équitation et la chasse, ces deux sports aristocratiques qui exigent la possession et la maîtrise de l’animal noble par excellence. Les femmes surtout sont des amazones accomplies et volontiers téméraires. Le cheval leur permet de satisfaire leur « ardeur martiale[9] », puisque leur sexe leur interdit de guerroyer. « Homme », avoue Lélia, « j’eusse aimé les combats, l’odeur du sang, les étreintes du danger[10] », et comme Indiana, Sylvia, Fiamma et Edmée aiment l’excitation de la chasse, « cette image abrégée de la guerre[11] ». Et si l’héroïsme consiste à affronter délibérément le risque de la mort, ces personnages fiers et intrépides, surtout s’ils sont femmes, sont effectivement héroïques. Fiamma saurait « braver la mort pour une noble cause[12] », et Edmée défie Bernard avec autant de « coeur » que Rodrigue, le Comte : « Crois-tu que j’aie peur de mourir ? », lui-dit-elle « avec calme[13] », tout en s’armant pour défendre son « honneur ».
Aussi le personnage de sang-froid est-il, comme le héros cornélien, convaincu de sa grandeur, de sa valeur exceptionnelle, de son incontestable supériorité. Indiana s’enorgueillit d’être très « au-dessus » des femmes « de l’espèce commune[14] ». Bien qu’il se veuille « un homme comme les autres[15] », Jacques estime qu’il n’a pas son pareil en ce monde : « Un autre que moi n’aurait pas pu certainement supporter mon destin : il n’y a que moi sur la terre qui aie la force d’accomplir une pareille vie […][16] ». Sylvia, Fiamma, Edmée sont toutes des « femmes supérieures », et bien entendu, « au-dessus de tout », s’élève « la grande figure isolée de Lélia[17] ». La romancière affectionne les comparaisons hiérarchiques et place volontiers sur les hauteurs ses personnages hautains. Comme celui de Corneille, son univers est un « univers du “ haut ” et du “ bas ”[18] » où l’on ne peut que s’élever ou descendre. Si le personnage de sang-froid ne proclame pas lui-même sa supériorité, ce sont les autres qui s’en chargent et leurs éloges incessants et dithyrambiques abondent en superlatifs de toutes sortes. Ainsi, aux yeux de Trenmor, Lélia incarne « toute la puissance intellectuelle de notre époque », résume « les plus grands noms de l’histoire, du théâtre et de la poésie », et réunit à elle seule « la grandeur de tous les héroïsmes[19] ». Vue par Sténio, elle est « plus grande par [son] âme et [son] génie que tout ce qui existe sur la terre[20] ». Il est vrai que Lélia vient après Indiana, ce « coup d’essai » qui fut un « coup de maître », et que la romancière voulait relever la femme de son abjection en lui donnant le beau rôle dans ses romans. Le lecteur peut cependant juger cette glorification de l’héroïne sandienne d’autant plus excessive que l’auteur s’applique souvent à modeler son personnage de prédilection sur sa propre image. Mais Le Cid n’hésite pas à se célébrer lui-même devant le miroir de l’admiration de tous. L’ostentation est indispensable à la « gloire » aristocratique.
Supérieur, le personnage de sang-froid ne peut tolérer la sujétion (à moins qu’il ne la choisisse ou ne l’impose). Il prétend n’être esclave de rien ni de personne. « Je ne dépends que de moi sur la terre » et « je n’obéirai jamais qu’à moi-même[21] », déclare fièrement Indiana à son mari qui voudrait être son maître. Tout despotique qu’il soit, le comte de Fougères n’a jamais réussi lui non plus à dominer Fiamma. Le mépris de l’opinion qu’affichent tous les personnages de sang-froid affirme sans doute leur rejet des préjugés d’une société qu’ils tiennent pour injuste, mais il trahit aussi leur dédain de l’inférieur. Comme les héros cornéliens qui ne peuvent être reconnus que de leurs pairs, ils ne reconnaissent l’autre que s’il est semblable à eux, c’est-à-dire également supérieur, et ils affichent leur intolérance orgueilleuse à tout ce qui pourrait restreindre leur indépendance. « Quiconque n’est pas la première n’est rien[22] », déclare la seconde Lélia qui refuse tout emploi subalterne au couvent des Camaldules. Sand « divinise » volontiers ses héroïnes à travers le culte et l’adoration dont elles sont l’objet. À la limite, comme Polyeucte, le personnage de sang-froid aspire à l’autonomie absolue, entend se suffire à lui-même, comme Dieu. Le Trenmor de 1833 a indéniablement atteint cette autosuffisance quasi divine.
Mais Trenmor est au-delà des passions. En effet, le projet d’autarcie s’accorde mal avec l’amour, fatalement aliénant. Pas plus que le héros cornélien, le personnage de sang-froid n’accepte d’être mené par les passions, ressenties comme pulsions instinctives et trouble émotif qui menacent son self-control et sa volonté d’autonomie. « En m’aimant », dit Sténio à Lélia, « tu crains d’aliéner ta liberté[23] » ; et pour Lélia, en effet, s’abandonner au « désordre des sens », c’est « perdre l’empire de [s]a volonté[24] ». Là sans doute est une des clefs du recul devant la sexualité qui caractérise l’héroïne de sang-froid, à commencer par Indiana : elle ne veut pas être « possédée », dans aucun des sens du terme. Aussi Fiamma et Edmée reculent-elles le plus longtemps possible le moment de leur « chute » : ces cavalières intrépides n’aiment pas être désarçonnées. La domestication de l’animalité, la victoire sur la « nature », est le substrat de la conquête héroïque de soi. Edmée, qui elle-même a su « dompter son caractère » au point de pouvoir contrôler « jusqu’à la circulation de son sang[25] », exige que Bernard apprenne à contenir ses instincts pour « s’élever » jusqu’à elle, l’estime étant pour le personnage de sang-froid comme pour le héros cornélien une condition de l’amour plus impérieuse que le désir. La souffrance du renoncement semble alors effacée par la jouissance du pouvoir exercé sur l’autre ou sur soi. « Je pris un orgueilleux plaisir », confie Lélia à Pulchérie, « à contempler cette obéissance passive d’une partie de moi-même et cette puissance prolongée de l’autre, cette sainte abnégation de la matière et ce règne magnifique de la volonté calme et persistante[26] ». Se dominer soi-même pour pouvoir dominer l’autre, telle est la stratégie de la maîtrise aristocratique. Il n’est alors pas surprenant que le personnage de sang-froid soit jugé « cruel » par ceux qui ont à subir son autorité. Fiamma et Edmée prolongent comme à plaisir le temps des épreuves qu’elles imposent à leur prétendant. Du moins ont-elles pour excuse une ambition pédagogique que Lélia n’a pas avec Sténio. En ce poète adolescent, frêle et craintif, elle s’est choisie un amant « féminin » qu’elle s’amuse à tourmenter comme autrefois son premier objet d’un amour qu’elle voulait également garder platonique :
J’enchaînais l’élan quelquefois involontaire et fougueux de ses sens par une ironie glaciale. Puis, je reprenais le voile de l’amitié pour le consoler de mes dédains. Je l’enivrais malignement de caresses douces et chastes. Je jouais avec lui comme le vautour avec sa proie. Tantôt je le faisais souffrir et je jouissais de son mal ; tantôt je le rendais heureux avec de légères concessions. En toutes choses et en tout temps, il était sous ma domination et je lui faisais sentir la supériorité de mon adresse, sans qu’il sût à quoi attribuer réellement le sang-froid et le calcul qui me rendaient plus forte et plus habile que lui[27].
On ne saurait mieux illustrer la perversité du jeu sadique à laquelle aboutit l’identification au modèle tout-puissant. Commentant ce passage en note, Pierre Reboul doute que Sand soit capable d’une telle lucidité et il préfère penser qu’elle s’inspire ici de la Foedora de La peau de chagrin. Mais c’est oublier que tout occupés à s’observer, à s’étudier, à « se rendre compte » d’eux-mêmes, les personnages de sang-froid aiment voir clair, en eux et chez les autres, qu’ils observent, étudient et surveillent inlassablement, tout en prétendant rester eux-mêmes impénétrables. Et c’est encore la puissance du modèle masculin que Lélia vénère lorsqu’elle se soumet à la violence d’un « maître de [s]on choix » : « Plus il me faisait sentir sa domination, plus je la chérissais, plus je mettais d’orgueil à porter ma chaîne[28] », confirmant par là la thèse de Girard, pour qui « ce n’est pas à la souffrance et à la sujétion que [le « masochiste »] aspire, c’est à la souveraineté quasi divine dont la cruauté du modèle suggère la proximité[29] ».
2. La dénaturation mortelle
Le projet d’arrachement à la « nature » qu’exige l’héroïsme explique que, pas plus que les héros cornéliens, les personnages de sang-froid n’aient de mère ; de mère vivante et présente du moins, le cas particulier de Sylvia pouvant difficilement être considéré comme une exception. Sand avait de surcroît des raisons personnelles de se distancier de l’origine maternelle. Le caractère volcanique de sa propre mère justifiait en effet la volonté de maîtrise des passions, et le recul devant l’abandon sexuel s’autorisait de la « souillure » attachée par la grand-mère paternelle à la vie, non exemplaire à ses yeux, de sa belle-fille. La création du personnage de sang-froid confirmait alors le désir de filiation paternelle, et partant aristocratique, de la romancière. Mais l’identification paternelle de Sand a nécessairement contribué à l’inflexion funèbre du modèle masculin. En prenant la place du père, Sand s’engageait à l’existence paradoxale du mort vivant, qui est souvent celle du personnage de sang-froid. De Lélia surtout, qui s’éprend « du portrait d’un homme mort depuis plusieurs siècles[30] » et que Sténio compare à « un cadavre qui aurait ouvert son cercueil et qui viendrait se promener au milieu des vivants[31] ». Dans les ruines du monastère où elle s’est retirée du monde, elle s’adonne, auprès d’un squelette humain qui lui inspire « une sainte et folle affection[32] », à une véritable imitation de la mort. Quintilia, elle, s’enferme chaque jour dans un caveau, auprès de la tombe qu’elle y a fait construire pour garder vivante l’image de son amant disparu ou absent. Et pour s’expliquer le voeu de célibat de Fiamma, Simon pense que « c’était peut-être à un mort qu’elle conservait cette noble fidélité[33] ». Quant à Trenmor, qui a « tué [ses] passions de sang-froid[34] », il porte la mort jusque dans son nom.
Sand enfant a vécu l’apprentissage de la maîtrise, froidement dispensé par la grand-mère paternelle, comme un apprentissage de la mort, exigeant l’extinction de l’ardeur des instincts que la mère, elle-même tout feu tout flamme, n’avait guère réprimés chez sa fille. La domestication des passions est un processus violent qui glace et pétrifie. Se civiliser, c’est se refroidir, dira Lélia. Aussi le personnage de sang-froid est-il souvent accusé par les autres d’être froid et dur. Le froid et la pierre, que la mort réunit dans le tombeau, sont pour ainsi dire ses attributs. Ralph porte un « masque de pierre[35] » et s’entoure « d’un triple mur de glace[36] » afin de ne pas trahir son amour pour Indiana. Jacques disparaît dans les glaciers. La première Lélia est constamment comparée à un marbre funéraire et glacé, tandis que la seconde meurt de froid sur un rocher. L’imitation du modèle masculin est particulièrement néfaste à la femme « féminine » que Sand considère comme faite exclusivement pour aimer. Indiana appartient aussi à cette catégorie et, en tant que telle, elle est l’objet de l’ironie du narrateur qui n’hésite pas à l’évincer au dénouement où elle est comme absorbée par Ralph, réduite au silence, et semble ne plus avoir d’existence à elle[37]. Lélia admire et envie le calme auquel est parvenu Trenmor, mais « moi femme », dit-elle, « dans vos murs de glace et de pierre, il ne me resterait pas un jour à vivre[38] ». Le tombeau de Viola, cette femme qui n’avait vécu que pour l’amour et pour qui Lélia ressent une sympathie profonde, atteste le potentiel suicidaire de la maîtrise pour l’héroïne sandienne.
Lélia est précisément une exploration affolée de l’impasse à laquelle peut aboutir l’imitation du modèle masculin. En se faisant homme elle-même, Lélia transforme inévitablement les hommes en « frères » ou en « fils », barrant ainsi leur désir par l’interdit de l’inceste. « Soyez donc mon frère et mon fils », dit-elle à Trenmor et Sténio, « et que la pensée d’un hymen quelconque vous semble incestueuse ou fantasque[39] ». L’homme n’est l’objet de son intérêt que dans la mesure où il incarne le pouvoir, la supériorité, l’autosuffisance, comme Trenmor, ou s’il est au contraire assez faible, comme Sténio, pour qu’elle puisse exercer sur lui sa propre domination. Mais il n’est pas un objet d’amour. Si Girard avait songé à Sand en élaborant sa théorie du désir mimétique, il aurait sans doute conclu que Lélia vise avant tout à s’approprier le prestige et la violence d’un modèle qu’elle-même a divinisé, pour devenir à son tour une idole fascinante qui vit d’admiration, voire d’adulation, non d’amour. Indiana déjà cherchait moins à aimer Raymon qu’à en être aimée, sinon adorée, et son union finale avec Ralph, pour qui elle n’a jamais exprimé le moindre désir mais qui, lui, l’adore, laisse le lecteur sceptique sur la réalité de sa conversion soudaine à l’amour. Mais en réservant à l’homme les tourments du désir, comme elle le fait dans Simon et Mauprat, la romancière, elle, pouvait se donner un objet d’amour féminin.
Il faut en effet qu’à l’origine du désir d’imitation du modèle masculin, il y ait eu un objet désirable, puisque, toujours selon Girard, « tout commence par la rivalité pour l’objet[40] ». Histoire de ma vie nous apprend que l’identification masculine de Sand trouve sa première raison d’être dans son désir de remplacer le père auprès de son objet d’amour, à savoir la mère[41]. Plus tard, l’absence définitive du père, la « trahison » de la mère et sa désacralisation par la grand-mère, ont sans doute favorisé le détournement du désir de son objet féminin maintenant méprisable, et son report désexualisé sur le prestige du modèle masculin. L’erreur de la première Lélia, la source de son « impuissance » (défaillance expressément masculine), est de s’obstiner à croire, contre toute évidence, qu’un homme, surtout véritable et vivant, pourrait être l’objet de son amour. Noun dans Indiana, Pulchérie dans Lélia sont là pour rappeler la présence originelle de l’objet féminin du désir. La soeur y remplace la mère, mais elle est « souillée » à présent. L’issue est donc barrée de ce côté-là aussi. Si « être raisonnable ou fonctionnel, c’est avoir des objets, et c’est s’affairer autour d’eux », et si « être fou, c’est se laisser accaparer par les modèles du désir[42] », Lélia est en effet bien proche de la folie dont elle se sent justement menacée. En s’insérant dans la communauté des femmes et en travaillant à leur éducation, la seconde Lélia se trouvera un objet d’intérêt plus conforme à son objet d’amour originel. Mais la première Lélia erre sans ancrage dans le monde. Sans vraie passion à contenir, sinon la souffrance de ne pouvoir aimer, que d’ailleurs elle ne contient guère, sa maîtrise n’est plus que de façade et son sang-froid vire au sang froid de la cruauté et de la mort. Sa rage se tourne contre « l’idole », le modèle qu’elle avait divinisé, et le roman est tout imprégné de ressentiment contre « l’homme » ou « les hommes ».
Cornélienne ou sandienne, la maîtrise ne mérite son titre que si elle a des passions à maîtriser. Sans elles, le personnage de sang-froid ne peut prouver son héroïsme. Aussi, après la Lélia de 1833, Sand va-t-elle s’appliquer à revaloriser les passions et à prouver que le personnage de sang-froid est capable d’aimer. Le secrétaire intime cherche visiblement à corriger l’impression désagréable laissée par la mégalomanie arrogante de Lélia en dotant Quintilia d’une bonhomie dont Lélia était assurément dépourvue, en lui prêtant un amour clandestin, et en attribuant à la malveillance de Galeotto l’interprétation négative du caractère de la princesse. Dans Jacques, même si le héros éponyme s’engage, sous l’oeil sceptique de Sylvia et du lecteur, dans une expérience de l’amour qui/que trahit rapidement son désir premier de contrôle et de domination, il se sacrifie néanmoins au bonheur de Fernande, au nom de la « fatalité » de la passion dont il admet, chez les autres, la puissance incontrôlable. Il disparaît pour laisser le champ libre à celui qui récuse l’idéal de la maîtrise : « Ils se croient forts parce qu’ils sont froids », dit Octave de Jacques et Sylvia, sa conviction à lui étant que « la vraie force » ne consiste pas à « étouffer ses passions », mais à « les satisfaire[43] ». La force des passions comprimées est telle dans Mauprat qu’elle explose dans une « crise » qui marque le choc en retour du refoulé, la revanche de la nature contre la dénaturation qui lui a été infligée. La « crise » restera un événement fréquent dans le roman sandien, où elle se manifeste par des troubles somatiques et psychiques tels que la fièvre, l’évanouissement, la « commotion électrique », les convulsions, les cauchemars, le délire. Dans Mauprat, la violence répressive de l’acculturation à laquelle Edmée assujettit Bernard provoque en lui une « maladie de nerfs » qui le rend fou au point qu’il fallait deux hommes pour le « tenir de force » lorsqu’il était « en proie aux fureurs du délire[44] ». Et Edmée à son tour perd la raison pour s’être crue victime des instincts sauvages de Bernard, mais aussi pour s’être imposé à elle-même une longue et dure répression de ses affects : « Cette grande volonté, qui avait été capable de dompter les plus violents orages […] s’en allait à la dérive sur une mer morte[45]. »
La « crise » révèle clairement dans Mauprat la dimension politique de l’idéal de la maîtrise, en ce qu’elle opère chez l’individu un bouleversement traumatique que Sand assimile à la Révolution par l’emploi d’un vocabulaire interchangeable. Ainsi, la crise personnelle que traverse Bernard est une « effroyable révolution[46] », tandis que la Révolution est évoquée en termes de « passions », d’ « orages » et de « convulsions ». « La grande convulsion révolutionnaire » qui s’approche est donc la crise qui menace la souveraineté de la noblesse, tandis que le projet de maîtrise aristocratique vise à contenir « le pressentiment d’un réveil prochain et terrible du peuple[47] ». Aussi n’est-ce pas un hasard si le personnage de sang-froid réapparaît dans le contexte doublement révolutionnaire de Nanon, au moment où la Commune ravive la « crise » de la Terreur. Bien que noble de naissance, Edmée accueille la Révolution avec sympathie et met en pratique ses théories égalitaires. Mais elle ne renonce pas à exercer sa suprématie sur Bernard dont elle continue à diriger impérieusement la conduite, décidant à sa place des engagements historiques de sa vie :
Quand le désir de jouer un rôle populaire vint tenter mon enthousiasme, elle m’arrêta […]. Quand l’ennemi fut aux portes de la France, elle m’envoya servir en qualité de volontaire ; quand la carrière militaire devint un moyen d’ambition et que la république fut anéantie, elle me rappela […][48].
Et s’il lui a survécu, c’est encore parce qu’elle lui en a donné « l’ordre […] à son lit de mort[49] ». Nanon ne partage plus la vénération d’Edmée pour la Montagne, mais comme elle est peuple (« n’a nom »), elle ne peut qu’approuver un bouleversement qui l’a tirée de la misère et de l’ignorance. Pourquoi faut-il qu’elle devienne Mme la marquise de Franqueville ? En anoblissant son héroïne, la romancière ennoblit le peuple et affirme une fois de plus que la vraie noblesse n’est pas l’apanage d’une caste, mais elle révèle aussi qu’elle persiste à penser l’autorité et la supériorité en termes aristocratiques, alors que la maîtrise dont Nanon fait preuve, dans la seconde moitié du roman surtout, est bien plus bourgeoise que chevaleresque. Tout en continuant à dénoncer le préjugé nobiliaire, Sand ne se départira jamais d’une certaine déférence pour l’aristocratie.
3. La démolition du héros
« Lélia n’avait pas de sympathie pour la race humaine[50]. » « Entre Lélia et la foule, il n’y avait pas d’échange[51]. » Le rapprochement du personnage de sang-froid avec le peuple commence avec Fiamma, non seulement à cause de ses convictions républicaines ou de son amour pour Simon, mais aussi grâce à son amitié passionnée pour Jeanne Féline. Sand privilégie dans Simon le personnage républicain de la mère, tandis que la figure du (faux) père qui n’a de noble que le nom, est discréditée par la conduite infâme du comte de Fougères. Jeanne tient lieu de mère à Fiamma et Fiamma défend énergiquement l’honneur de sa propre mère en soulignant la noblesse de la « faute » qui l’avait liée à un chef de partisans « chevaleresque ». Dans la mesure où la mort du père est symbolique de celle du roi et du coup porté au patriciat par la Révolution, la disparition de Jacques, et plus encore celle du père d’Edmée, qui perd la tête avant de mourir, sont indicatives du virage idéologique que Sand est en train d’entreprendre autour du personnage de sang-froid.
Jacques introduit un autre signe de la distance que prend la romancière avec le modèle aristocratique, à savoir l’hypothèse, qu’Horace convertira en certitude, que la « grandeur » pourrait bien être un rôle qu’on joue, un beau rôle qu’on se donne, par orgueil et par vanité. Octave se montre en effet sceptique sur la générosité du sacrifice de son rival, qu’il juge affectée, pompeuse. Jacques, selon lui, « aime le genre héroïque » :
Les héros sont des hommes qui se donnent à eux-mêmes pour des demi-dieux, et qui finissent par l’être en de certains moments, à force de mépriser et de combattre l’humanité. À quoi cela sert-il, après tout ? À se faire une postérité de séides et d’imitateurs ; mais de quoi jouit-on au fond de la tombe ?[52]
Même si elle ne souscrit pas au dénigrement de l’héroïsme de Jacques, Sand ouvre avec Octave une perspective ironique sur la rivalité mimétique qui en est le mobile, et elle fera de cette intuition le sujet même d’Horace. Dans ce roman, elle démolit en effet les prétentions aristocratiques de son personnage éponyme en procédant à un démontage du désir mimétique si railleur et si pertinent qu’il est difficile de ne pas lui prêter une intention d’autocritique, d’autant plus qu’elle fait d’Horace un romancier. Comment expliquer sinon la singulière indulgence que l’auteur et le narrateur montrent pour cet individu somme toute peu recommandable ? Peter Dayan juge cette indulgence « aveugle et puérile[53] », mais c’est ne pas voir qu’avec Horace, Sand raille son propre « personnage » antérieur et qu’il lui est cher « quandmême[54] » parce qu’à bien des égards il a été (et est encore) son double. Comment n’aurait-elle pas de sympathie en effet pour celui qui est de ces gens
qui semblent jouer un rôle, tout en jouant sérieusement le drame de leur propre vie ? Ce sont des gens qui se copient eux-mêmes. Esprits ardents et portés par nature à l’amour des grandes choses, que leur milieu soit prosaïque, leur élan n’en est pas moins romanesque ; que leurs facultés d’exécution soient bornées, leurs conceptions n’en sont pas moins démesurées : aussi se drapent-ils perpétuellement dans le manteau du personnage qu’ils ont dans l’imagination[55].
Quel personnage hante l’imagination d’Horace ? Ce n’est sans doute pas par hasard qu’il porte le nom d’un héros cornélien (et que sa soeur se prénomme Camille), puisqu’il n’hésite pas à se camper comme tel :
[…] le ciel m’a fait grand et bon. J’ignore quelles épreuves il me réserve ; mais, je le dis avec un orgueil qui ne pourrait faire rire que les sots, je me sens généreux, je me sens fort, je me sens magnanime ; mon âme frémit et bouillonne à l’idée d’une injustice. Les grandes choses m’enivrent jusqu’au délire. Je n’en tire et n’en peux tirer aucune vanité, ce me semble ; mais, je le dis avec assurance, je me sens de la race des héros ![56]
Mais à la différence de Sténio en admiration devant la grandiloquence de Lélia, Théophile ne prend pas trop au sérieux la déclamation de son ami. Naturellement, le goût de l’élévation, inscrit et tronqué à la fois dans son nom propre à suffixe diminutif, Dumontet, qu’il finira par écrire Du Montet, pousse le héros à fréquenter de préférence les gens de qualité : « Malgré tout son républicanisme, Horace était aristocrate dans l’âme[57]. » Aussi entreprend-il la conquête de la vicomtesse de Chailly en jouant au cavalier audacieux, en même temps qu’il s’entiche de son premier amant, ce vieux roué qu’est le marquis de Vernes, pour qui, « sans songer que les courtisans de la royauté absolue avaient dégénéré dans leur genre, tout aussi bien que les preux de la féodalité », il se prend « d’un respect et d’une admiration qui se résumaient dans le désir de l’égaler et de le copier autant que possible[58] ». Car tout en déclarant ne pas avoir « l’instinct de l’imitation[59] », Horace est un possédé de la mimésis. Avec Arsène et Marthe, il occupe la place du tiers qui, selon Girard, forme et ferme le triangle du désir. Horace est en effet infiniment plus obsédé par son rival abhorré/adoré qu’il ne l’est par l’objet de son amour, puisqu’il ne s’intéresse à Marthe que pour la soustraire à l’amour d’Arsène. Chacune de ces passions triangulaires tourne inévitablement au désastre.
Mais, dira-t-on, Horace n’est pas un personnage de sang-froid. N’est-ce pas Arsène qui sait contenir ses émotions, rester impassible, sacrifier héroïquement son désir ? Sans doute, mais Arsène, comme nous verrons, est le nouveau type du personnage sandien tandis qu’Horace est une caricature de l’ancien. À ce titre, même ridiculisé, il faut qu’il soit un personnage de sang-froid et effectivement, Sand s’applique à le présenter comme tel. Horace, dit le narrateur, n’est pas « un froid égoïste » comme on pourrait le croire : « Il est bien vrai qu’il était froid ; mais il était passionné aussi[60]. » De ce fonds passionné, Théophile voit la manifestation sincère dans les crises nerveuses, avec convulsions et délire, qui le secouent à l’occasion. L’explosion se produit au dénouement : « Horace, pour la première et pour la dernière fois de sa vie, n’était pas maître de lui-même[61]. » Toutes les émotions pénibles qu’il se flattait d’avoir stoïquement surmontées, à l’instar d’Arsène, s’extériorisent tout à coup dans « un accès de véritable démence » qui lui fait (presque) retrouver l’accent du « véritable » Horace au moment de tuer Camille ; il s’élance sur Marthe, un poignard à la main, en s’écriant : « Meurs donc, prostituée, et ton fils, et moi, avec toi. » Mais l’ironie du narrateur conclut « platement », sur « une légère égratignure », « la seule tragédie un peu sérieuse qu’Horace eût jouée dans sa vie…[62] », de même que l’impitoyable incrédulité de Laravinière transformait les crises nerveuses du héros en une comédie jouée froidement par un acteur désireux de mobiliser l’attention d’autrui. Horace est en effet dévoré par ce que Sand appelle, avec Jean-Gaspard Spurzheim (disciple de Gall et inventeur de la bosse de la « merveillosité »), l’« approbativité », autrement dit le besoin d’approbation. En fait, Horace cherche plutôt l’admiration, est soucieux de l’effet qu’il produit, se compare constamment aux autres, se montre envieux de leur éventuelle supériorité, aime dominer, se plaît à faire souffrir, est avide de gloire. Il serait une autre Lélia s’il n’était percé à jour par l’ironie de l’auteur.
Le premier paragraphe d’Horace oppose l’affection à l’admiration. Alors que l’admiration hiérarchise, l’affection égalise, car elle « nous fait chercher dans un ami un semblable, un homme sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes passions que nous[63] ». Autrement dit, elle nous permet d’aimer les hommes tels qu’ils sont. L’admiration est aristocratique (et cornélienne), l’affection, démocratique. Convertie au socialisme évangélique de Pierre Leroux, Sand change radicalement de cap à partir d’Horace. L’orgueil du héros s’avère peu compatible avec l’humilité chrétienne. Doubrovsky a souligné que malgré leurs similarités, notamment leur volonté commune de subjuguer la bête humaine, le projet de maîtrise est aux antipodes du christianisme, parce qu’il vise à diviniser l’homme au lieu de le soumettre à Dieu. Le héros cornélien se donne Dieu pour modèle et par conséquent pour rival. Aussi Sand aura-t-elle du mal à transformer la première Lélia en disciple du Christ et en adepte d’une religion de l’égalité. Arsène, par contre, de « nature évangélique[64] », renonce à toute « personnalité » (c’est le terme que Sand emploie dans la dédicace même d’Horace pour désigner le culte du moi), pratique sans ostentation un dévouement total à l’autre, choisit l’amour contre la haine, le pardon contre le ressentiment. Autrement dit, il refuse la violence de la rivalité mimétique. Ralph et Jacques avaient déjà donné l’exemple d’une générosité peu commune en s’effaçant devant leur rival. Sans doute parce qu’il a été conçu avant la gloire de son auteur, Ralph est proche d’Arsène par son dévouement absolu à celle qu’il aime ; mais bien que le Christ soit le modèle que lui assigne Sylvia, Jacques n’a pas la modestie nécessaire à un adepte de la morale évangélique. Comme Lélia, ce qui l’attire dans la sainteté, c’est la victoire de la volonté, la grandeur héroïque encore une fois.
4. La conversion maternelle
« Consuelo n’avait jamais monté à cheval de sa vie[65]. » Ce détail apparemment anodin signe l’adieu de Sand à l’idéal aristocratique de la maîtrise. La démolition du héros cornélien qu’elle venait d’accomplir avec Horace amenait nécessairement la romancière à abandonner le personnage de sang-froid, du moins tel qu’elle l’avait originellement conçu. Consuelo certes a du sang-froid et sait être héroïque quand il le faut (ne serait-ce qu’en s’enfuyant à cheval du Riesenburg), mais elle n’est pas un personnage de sang-froid. Elle ne peut l’être parce qu’elle choisit la mère contre le père (un « contre » sans hostilité cependant), c’est-à-dire la passion contre la maîtrise, le peuple contre l’aristocratie, l’avenir contre le passé, la vie contre la mort. Sans père et sans nom, Consuelo revendique son origine maternelle et plébéienne. À travers le comte Christian, le patriciat est montré comme le domaine du froid, de la pierre et de la mort, et Consuelo se sent comme enterrée vivante pendant son séjour au château des Géants (et Albert et Wanda le sont littéralement). La mère, par contre, appartient à l’espace du dehors, au monde de la chaleur, de la végétation, de la vie. Même brutale, elle était aimée parce que passionnée et démonstrative, en cela tout à fait étrangère à l’idéal de la maîtrise. Aussi la parfaite maîtrise de soi, à supposer qu’elle soit possible, n’est-elle plus un idéal dans Consuelo. La folie même y est accueillie avec sympathie en la personne d’Albert. Consuelo rejette comme monstrueux, contre nature, le sacrifice de tout attachement humain que le Porpora, son père adoptif, exige de la cantatrice. Être « condamnée à étouffer ses sentiments et à refouler ses émotions » lui paraît « un supplice atroce[66] », et chaque fois qu’elle doit faire preuve de sang-froid, son héroïsme est suivi de crises nerveuses parfois violentes à l’extrême. Au reste, elle ne se fait pas une gloire de rester impassible en toutes circonstances. Malgré son grand courage, elle se laisse souvent submerger par des émotions qu’elle avoue expressément ne pas pouvoir contenir, l’angoisse et la terreur surtout, mais aussi la joie, l’enthousiasme, la tendresse, le rire, et c’est cette irruption de l’affectivité qui distingue agréablement Consuelo de tous les romans antérieurs auxquels l’idéal de la maîtrise conférait un air guindé. Quant au modèle masculin, il n’est plus pour l’héroïne qu’un déguisement commode et comique qui n’engage pas la personne.
En faisant de la mère un objet d’amour aussi bien d’ailleurs pour Albert que pour Consuelo, la romancière revient à la source de son propre désir et libère la féminité refoulée par l’imitation du modèle masculin. Les paroles que Wanda adresse à Consuelo juste avant de dépouiller son déguisement consacrent cette conversion maternelle de Sand : « Une mère t’est donnée aujourd’hui pour t’assister et t’éclairer dans tes nouvelles résolutions […]. Cette mère, c’est moi, Consuelo, moi qui ne suis pas un homme, mais une femme[67]. » Le désir de la mère informe dans les deux sens l’amour d’Albert et de Consuelo, qui sont en effet tour à tour une mère l’un pour l’autre. Albert surtout, à vrai dire, qui est une sorte de mère porteuse pour Consuelo, depuis le jour où il l’a portée quand elle était enfant jusqu’à celui de son évasion de Spandaw où il la porte « contre son coeur, comme une mère qui tient son enfant[68] ». Le « repos sur le sein maternel » est une telle jouissance qu’à cette occasion la romancière trouve la formule de la volupté, « sainte », il est vrai, ce qui pour Sand signifie toujours asexuée : « un néant senti et savouré[69] ». Autrement dit, l’homme ne peut devenir objet du désir qu’à la condition de se transformer en mère. Juste après Consuelo, Jeanne confirmera, si besoin est, que l’attachement maternel de Sand se fonde sur la peur de la sexualité masculine, qu’elle a toujours tendance à voir comme viol et violence qui arrachent l’adolescente à l’intimité d’un monde essentiellement féminin. Sans rien en elle qui soit ascétique ou morbide, Jeanne n’est que pur amour indifférencié dont la mère est la source (Sand a d’ailleurs souvent déclaré que l’amour n’est pas exclusivement sexuel et qu’il y a beaucoup de façons d’aimer). C’est l’irruption de l’homme et de la brutalité du désir masculin qui l’expulse de son paradis maternel et la fait entrer dans le cycle infernal de la rivalité masculine dont elle finit par être la victime, fournissant ainsi la preuve tragique que « la violence ne peut pas tolérer que se maintienne dans son royaume un être qui ne lui doit rien[70] ».
La conversion à l’amour maternel est aussi une conversion à l’amour divin. Dieu et mère sont quasiment synonymes pour Consuelo qui n’invoque jamais l’un sans l’autre. Elle ne peut concevoir un Dieu qui ne soit pas un Dieu d’amour, étranger à toute idée de colère, de vengeance, de tyrannie. L’Église romaine et le christianisme officiel l’ont fait tel, à leur image sans doute, mais tel n’était pas le message encore incompris de l’Évangile, où Jésus prêche une religion de charité, de fraternité et d’égalité, la seule capable de fonder le royaume de Dieu sur la terre, c’est-à-dire une société qui aurait éliminé la violence, une communauté enfin réconciliée. Car la violence ne provient pas de Dieu, mais des hommes. Selon Girard, dont la lecture de l’Évangile s’appuie sur les mêmes convictions que celles de Sand (sauf qu’elle ne croit pas, comme lui, à la divinité du Christ), toute violence est le produit de la rivalité mimétique qui pousse à répondre à la violence par une violence égale ou accrue, au cours d’une surenchère qui ne peut avoir de fin qu’apocalyptique, à moins que n’y mette fin la seule imitation qui ne soit pas violente, celle du Christ. Les modèles maternel et évangélique se combinent dans le socialisme sandien. Dès Le compagnon du Tour de France, la figure de la Mère (La Savinienne) se joint à celle du Christ (Pierre, fils de charpentier) dans l’espoir d’ « humaniser » une société jusque-là fondée sur le « principe de rivalité », « ce principe abominable qu’ils appellent la concurrence, l’émulation, et que j’appelle, moi, le vol et le meurtre[71] ». Selon Erich Fromm, qui a relevé la sympathie de socialistes tels que Marx, Engels et Bebel pour le livre de Bachofen, Das Mutterrecht (1861), les valeurs « maternelles » telles que la compassion, l’amour des faibles, le dévouement à l’autre, le désir de paix, le souci du bonheur matériel, l’affirmation de la vie, sont des valeurs socialistes. Pour Girard, ce sont des valeurs évangéliques. Ce sont, en tout cas, des valeurs que Sand affirme dans son socialisme évangélique.
Consuelo retrace l’effort de Sand de sortir de l’impasse de la rivalité mimétique en remplaçant le modèle aristocratique par le modèle christique. Bien que chacun encense à l’envi son génie et sa bonté et que les Invisibles lui accordent un statut d’exception, Consuelo condamne l’égocentrisme, l’orgueil de la supériorité, le désir de domination, l’ostentation, l’enivrement de la célébrité, la vanité du triomphe. Son adieu définitif au théâtre est la preuve ultime de son humilité et la romancière a certainement conçu son personnage comme une anti-Lélia. C’est maintenant Anzoleto qui est le prisonnier du désir mimétique : « Il était de ces hommes qui ne s’enthousiasment que pour ce qui est applaudi, convoité et disputé par les autres[72]. » Il ne se pense qu’en termes de supériorité ou d’infériorité et ni lui ni la Corilla ne peuvent tolérer d’être surpassés par Consuelo, laquelle évite au contraire de se comporter en rivale. Lorsqu’elle chante, c’est l’amour de l’art qui la motive, non le besoin d’être applaudie ; dépourvue de la vanité de la fausse modestie, elle sait s’évaluer et s’applaudir elle-même quand elle croit l’avoir mérité. Elle n’est donc plus, comme Horace, dévorée d’« approbativité » et elle ne recherche plus l’admiration mais l’amour, et l’amour non seulement reçu mais donné : « Il faut que je retrouve une partie de mon ancien bonheur, se disait-elle, celui […] qui consistait tout entier à aimer les autres et à en être aimée. Le jour où j’ai cherché leur admiration, ils m’ont retiré leur amour[73]. »
Consuelo descend des hauteurs où se tenait Lélia et rentre dans le réel et dans la vie. Elle explique la première folie d’Albert par son identification « rétrograde » et orgueilleuse aux « plus grands rôles dans l’histoire de [ses] ancêtres[74] » et elle l’exhorte à se résoudre à vivre humblement dans le présent (de même qu’elle essaie, apparemment sans trop de succès, d’amener le Porpora à accepter les hommes tels qu’ils sont). Elle comprend fort bien que la folie d’Albert est une folie des grandeurs qui se nourrit de « la violence des doubles[75] », fondée sur la méconnaissance de leur identité foncière. En s’identifiant à Jean Ziska, le chef fanatique des Hussites, Albert entretient l’illusion de la différence entre les deux camps de la guerre civile, mais Consuelo l’admoneste avec sévérité :
Je me demande pourquoi vous rendez un culte exclusif à la mémoire et à la dépouille de ces victimes, comme s’il n’y avait pas eu des martyrs dans l’autre parti, et comme si les crimes des uns étaient plus pardonnables que ceux des autres[76].
Le rejet de la violence sera désormais la signature de Sand, sa conviction originale dans un siècle encore fortement « masculin », c’est-à-dire structuré par des rapports de domination. Mais ce rejet de la violence n’est pas simplement motivé par une répugnance instinctive ou affective. Par sa remarquable lucidité sur la nature illusoire du principe de la différence (entre soi et l’autre) et sur le caractère fatalement mimétique de la violence qui en résulte, Sand aurait mérité de figurer au palmarès de Girard, aux côtés de Stendhal, Proust et Dostoïewski, trois écrivains que l’on a ou qui se sont apparentés à la romancière et que Girard admire pour leur capacité à mettre à nu le fonctionnement du désir mimétique et à se déprendre de ses pièges, au prix d’une « conversion » difficile à la « vérité » consistant à rejeter la vieille illusion « romantique » de la supériorité du moi. Reconnaître en l’autre son semblable et son frère, aimer même ses ennemis, tel sera désormais le nouvel idéal sandien qui devrait en principe chasser l’orgueilleux personnage de sang-froid. Le choix du personnage bon suppose un réel changement de régime : psychologique (de l’orgueil à la bienveillance), politique (de l’aristocratie à la démocratie), social (de l’individualisme au socialisme), moral (du mépris au respect de l’autre) et, d’une certaine manière, féministe (du patriarcat au matriarcat).
5. Le revenant
Mais le personnage de sang-froid refuse de disparaître. Non seulement il revient, mais il s’incarne et se manifeste dans la vie même de son auteur. En 1847 en effet, l’année du mariage de Solange, il devient l’enjeu d’un conflit aigu entre la mère et la fille, conflit dont Sand, si lucide soit-elle, ne semble pas avoir reconnu la dimension mimétique fatale, sans doute parce qu’elle y était personnellement engagée et, par conséquent, plus sujette encore que de coutume au « grand aveuglement où chacun est pour soi ». Dans sa correspondance, Sand décrit Solange exactement dans les mêmes termes que ses héroïnes de sang-froid. Cavalière intrépide, aimant se donner des airs de princesse, ne s’avouant jamais coupable, elle est hautaine, dominatrice, d’une fierté indomptable, froide et dure, et même cruelle parfois jusqu’au sadisme. « Toutes ses joies étaient dans l’orgueil du triomphe[77] », dit la romancière qui la voit comme « la plus superbe des Edmée de Mauprat[78] », personnage que Solange, à quinze ans, admirait tout particulièrement : « Edmonde [sic] est la plus belle de toutes tes filles. Moi, je suis la plus mal faite. C’est comme elle, et non comme Consuelo que je voudrais être[79]. » Et Sand de s’étonner que « la maxime de S[olange] a[it] toujours été qu’elle avait besoin d’émotions afin de les dominer. Étrange maxime dans la bouche d’une enfant[80]. » Elle ne se demande pas d’où sa fille peut avoir tiré cette maxime et ne se reconnaît pas dans le miroir qu’elle lui tend. Et comme dans le conflit entre doubles c’est toujours l’autre qui est démonisé, lorsque le personnage de sang-froid réapparaît dans le roman sandien, il devient inévitablement la cible de la romancière. Césarine Dietrich, par exemple, si judicieusement prénommée dans le roman du même nom, est une jeune fille masculine, intelligente, « altière et impérieuse[81] » (et, cela va sans dire, une cavalière audacieuse), en qui on peut facilement reconnaître le « personnage » de Solange, d’autant plus que Sand a prêté des ambitions littéraires, vaines bien sûr, à son héroïne. L’auteur la punit en lui faisant épouser un mort qui malheureusement revit, revient et devient fou : châtiment parfaitement approprié au sang-froid du personnage.
Incapable d’aimer, de se donner à l’autre, au propre et au figuré, le personnage de sang-froid est fasciné par la bonté. Dans Malgrétout, par exemple, Carmen d’Ortosa, qui a passé pour inspirée de l’impératrice Eugénie alors qu’elle doit peut-être tout à Sand elle-même dans son rôle viril de jeune amazone (on la juge excentrique parce qu’elle fume le cigare, pratique l’équitation et la chasse, affiche son indépendance, ne veut être la propriété d’aucun homme, mais prend plaisir à les « rendre fous » pour « leur administrer ensuite la douche glacée de [s]on dédain[82] »), est attirée par Sarah comme par un aimant. « Comment donc faire pour être patiente, douce et généreuse comme vous ? C’est la force, cela, c’est la santé, la beauté, l’éternelle jeunesse[83] », lui dit-elle. Elle voudrait imiter son modèle, mais le personnage de sang-froid peut-il devenir bon ? Comme Carmen qui fait le bien afin de passer pour bonne, Césarine peut seulement singer la bonté, tout comme elle imite à s’y tromper l’écriture de Pauline, la gouvernante qui lui tient lieu de mère. Elle prétend se dévouer et se sacrifier, elle est capable d’être une infirmière admirable à l’occasion, mais selon Pauline, elle ne cherche qu’à séduire les autres pour se les soumettre par des attentions qui révèlent seulement « l’hypocrisie de [s]on instinct dominateur[84] ». La bonté est un rôle que Césarine peut jouer à la perfection quand il sert son impérialisme. Que penser alors de la célèbre bonté sandienne ? Serait-elle un rôle ? Le nouveau déguisement de la volonté de puissance du personnage de sang-froid ?
Il est certain que la bonté sandienne n’a rien d’impulsif ; elle est raisonnée et raisonneuse, au contraire, et volontiers didactique : une bonté de sang-froid en somme[85], qui paraît souvent un peu factice et forcée. Avec ses alliés, le calme, la patience et la douceur, Sand la conçoit comme une force (maternelle) supérieure à la violence (masculine), parce que plus habile à s’imposer. Dès lors, le matriarcat qu’instaure Consuelo[86] risque d’être seulement un transfert d’autorité. De fait, idéalisée et divinisée, la mère se transforme en modèle aussi dominateur à sa manière que le modèle masculin, dont le prestige contamine d’autant plus facilement l’objet d’amour que la censure interdit à la femme la satisfaction directe d’un désir homosexuel. Dès Consuelo, l’idolâtrie de la mère se nourrit de celle du fils. Dans les romans ultérieurs, le matriarcat s’avérera d’autant plus contraignant qu’il fera de la mère une figure autosacrificielle qui se réclame explicitement ou implicitement du Christ. La « mère » est la femme qui, mère ou non, s’oublie elle-même totalement, ne vit que pour les autres, se dévoue à leur bonheur avec abnégation[87]. Mais même si elle est censée y trouver son propre bonheur, elle expose son dévouement en termes de sacrifice, et la grandeur de ce sacrifice est tellement soulignée, valorisée, exaltée, qu’il est difficile de ne pas penser, avec Girard, que ce « « masochisme » du se sacrifier », qu’il estime d’ailleurs contraire à l’esprit du texte évangélique, lequel est toujours orienté vers l’affirmation de la vie, « pourrait bien dissimuler […] un désir de se sacraliser et de se diviniser toujours situé, visiblement, dans le prolongement de la vieille illusion sacrificielle[88] ». Et effectivement, l’évidente autocélébration de Sand à travers Lucrezia Floriani ou Thérèse Laurent, figures maternelles qui s’immolent, non sans ressentiment, à l’objet de leur amour, ne diffère guère dans son intention de celle qu’elle opérait à travers Lélia. Le « démon », que Sand définit comme « une idolâtrie de soi-même[89] », n’a donc pas été tout à fait exorcisé et l’adoration de la mère se montre aussi excessive qu’autrefois celle de la femme supérieure : « Notre sainte mère […] a été le rêve enchanté de ma vie, l’éternelle aspiration de mon coeur, mon idéal, mon aspiration céleste, ma pensée intérieure, ma muette prière, mon mystère et ma foi[90] ». Ainsi s’exprime Gaston dans Les deux frères, roman qui, avec Flamarande, sa première partie, est le roman de la maternité sacrificielle par excellence.
Cette persistance du désir de supériorité explique que le modèle cornélien ne s’efface pas complètement après Consuelo. Antonia, on l’a vu, s’y réfère encore explicitement en 1862. Mais Sand met à présent Corneille au service d’une morale de l’abnégation. L’héroïsme va consister dès lors à renoncer à toute satisfaction personnelle autre que celle de la bonne conscience, et le sang-froid, à savoir cacher sa souffrance aux autres, à sa mère surtout comme Julien dans Antonia. La dissimulation devient une vertu héroïque, et le souci de l’opinion, le désir de respectabilité, prennent une importance démesurée, pour la femme surtout, et la mère plus encore qui se doit d’être absolument irréprochable. À cet égard, le Second Empire a été fatal à la romancière, qui était certainement plus à l’aise dans les romans franchement orgueilleux de sa jeunesse. Accorder la morale du renoncement avec la revalorisation de la « nature » à laquelle l’idéal doit maintenant s’adapter n’allait pas non plus sans difficultés. Plusieurs des romans tardifs de Sand, Ma soeur Jeanne par exemple, manifestent le même embarras que les pièces de Corneille après Polyeucte. Les relations amoureuses deviennent alambiquées et sonnent faux. L’intrigue s’embrouille et ses complications tournent autour de l’énigme de la naissance, de la légitimité problématique, du risque de l’inceste, problèmes qui se rattachent tous au rapprochement conflictuel du héros avec « la nature-mère[91] ».
En tant qu’imitation du modèle évangélique, en tant que travail visant à extirper l’orgueil du personnage de sang-froid, la bonté sandienne est nécessairement un rôle (Girard souligne que le Nouveau Testament ne prêche pas « une morale de la spontanéité[92] »), mais qu’elle soit un rôle n’ôte rien à ses qualités. Au contraire, c’est son caractère voulu, réfléchi, qui lui a permis d’être une bonté intelligente. Et parce qu’elle est une bonté conquise, elle a ses limites et ses défaillances, plus visibles dans les romans que dans la correspondance, sans doute parce que l’auteur s’y observe moins (contrairement à l’idée reçue, dans le cas de Sand, c’est plutôt le roman qui est le révélateur de la correspondance que l’inverse). Sand n’a pas la naïveté de croire avec Rousseau à la bonté naturelle de l’homme ; elle le croit perfectible par une éducation appropriée, mais aussi toujours capable de retomber dans son animalité originelle. Sous l’effet de la jalousie, par exemple, le Sylvestre du Dernier amour se sent devenir aussi féroce qu’une bête de proie, tout comme Jacques se transformait en « brute vindicative et cruelle[93] ». Dans son effort de contenir la sauvagerie de l’instinct, la bonté poursuit effectivement l’idéal de la maîtrise, d’où les affinités qui, dans Jeanne, rapprochent, jusqu’à un certain point, sir Arthur de l’héroïne.
Cette parenté entre la maîtrise et la bonté explique que le personnage bon soit souvent impérieux. Il peut être franchement autoritaire, telle Célie dans Mademoiselle Merquem ; adroitement dominateur, tel Émile dans Mademoiselle La Quintinie, qui, sous le couvert de la « tolérance », n’a de cesse qu’il n’ait « amené » Lucie à ses idées à lui, lesquelles s’opposent à l’immixtion du prêtre dans la vie privée des époux[94] ; ou aveuglément tyrannique, tel Sylvestre dans Le dernier amour, ce roman qui va jusqu’à accréditer le despotisme, voire le sadisme de la bonté sandienne, du moins si l’on souscrit à l’idée que Sylvestre y est le porte-parole de l’auteur, ce qu’il semble difficile de dénier[95]. La réaction de Félicie à la « bonté » de Sylvestre est exactement la même que celle d’Isidora. Mais la Sand de 1865 n’est plus celle de 1845. Dire que la romancière nous laisse choisir entre les récits du médecin, de Félicie et de Sylvestre[96] néglige le soin qu’elle prend toujours d’orienter l’interprétation du lecteur. Or, comme l’a souligné Lucienne Frappier-Mazur, Sylvestre partage en effet toutes les convictions essentielles de Sand[97], y compris celle d’incarner la douceur, la patience, la compassion, la sagesse et même la charité évangélique. Félicie elle-même l’admire et le défend contre Tonino. Le Sylvestre de Monsieur Sylvestre lui aussi est sympathique à son auteur. N’a-t-elle pas donné à cet « homme de grande valeur[98] », socialiste convaincu, « les plus beaux yeux qu’il soit possible de voir, gros, ronds, noirs, saillants et remplis d’un feu sauvage et doux[99] » ? L’absence totale, dans Le dernier amour, de l’ironie dont Horace était l’objet dans le roman du même nom, rend peu vraisemblable que Sand condamne un personnage si conforme à elle-même et à son idéal moral. Frappier-Mazur décode dans la paradoxale violence de la bonté de Sylvestre l’irruption de la haine et l’assouvissement du « désir de mort[100] » refoulé que Sand nourrit contre Solange. L’hypothèse est d’autant plus plausible que Solange est fille de l’adultère (en même temps que son châtiment vivant) et que M. Sylvestre est affligé d’une fille dominatrice, « railleuse et froide », douée d’une « volonté inexpugnable[101] », et qui a fini par se faire courtisane. Mais il faut admettre aussi que dans les romans, la bonté sandienne est plus raisonnable que généreuse, et qu’elle peut se montrer effectivement perverse, en ce qu’elle pactise toujours avec un besoin de domination qu’elle ne s’avoue pas et ne reconnaît qu’en l’autre.
Par sa persistance, le personnage de sang-froid pourrait bien être le personnage sandien par excellence, celui qui correspond le mieux à la volonté de lucidité, de contrôle, d’intelligence de l’auteur. Le narrateur sandien est lui aussi un personnage de sang-froid, placé en position d’observateur, sinon d’espion, toujours aux écoutes et aux aguets, avide de tout voir, tout entendre, tout savoir, tout expliquer. Les personnages eux-mêmes pensent leur vie plus qu’ils ne la vivent et leurs passions dénotent plus de raison et de rationalisation que d’élan affectif, sensuel ou sexuel. Le personnage de sang-froid est sans doute le meilleur représentant possible de cette faculté d’abstraction et de distanciation qui redoute l’incarnation tout en en reconnaissant la nécessité. Aussi est-il le vecteur privilégié de l’intellectualisme du roman sandien. Et par sa dévotion au modèle plutôt qu’à l’objet du désir, le personnage de sang-froid est un miroir de concentration de l’artifice, de la facticité qui, pour le meilleur et pour le pire, caractérise et singularise le roman sandien.
Appendices
Note biographique
Yvette Bozon-Scalzitti
Professeur émérite de l’Université Roosevelt à Chicago, Yvette Bozon-Scalzitti est l’auteur d’études sur Le verset claudélien (Minard, Archives des Lettres Modernes, 1965), Blaise Cendrars et le Symbolisme (Minard, Archives des Lettres Modernes, 1972), les romans de Blaise Cendrars : Blaise Cendrars ou la passion de l’écriture (L’âge d’Homme, 1977) et, plus récemment, d’articles sur Blaise Cendrars, George Sand, Francis Ponge et Maryse Condé.
Notes
-
[1]
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 1978, p. 356.
-
[2]
George Sand, Indiana, 1984, p. 162.
-
[3]
George Sand, Lélia (1833), 1960, p. 170.
-
[4]
Ibid., p. 225-226.
-
[5]
George Sand, « Notice », dans Le compagnon du Tour de France, 1885, vol. 1, p. 2.
-
[6]
George Sand, Antonia, 1882, p. 151.
-
[7]
George Sand, La marquise, 1986, p. 74.
-
[8]
Serge Doubrovsky, Corneille et la dialectique du héros, 1963, p. 95-96. C’est de ce livre que s’inspire notre lecture de Corneille.
-
[9]
George Sand, Simon, 1991, p. 90.
-
[10]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 170.
-
[11]
George Sand, Indiana, op. cit., p. 162.
-
[12]
George Sand, Simon, op. cit., p. 68.
-
[13]
George Sand, Mauprat, 1969, p. 84.
-
[14]
George Sand, Indiana,op. cit., p. 208.
-
[15]
George Sand, Jacques, 1889, p. 299.
-
[16]
Ibid., p. 319
-
[17]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 45.
-
[18]
Serge Doubrovsky, Corneille et la dialectique du héros, op. cit., p. 169.
-
[19]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 45-46.
-
[20]
Ibid., p. 27.
-
[21]
George Sand, Indiana, op. cit., p. 233-234.
-
[22]
George Sand, Lélia (1839), 1960, p. 459.
-
[23]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 222.
-
[24]
Ibid., p. 232.
-
[25]
George Sand, Mauprat, op. cit., p. 205.
-
[26]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 179.
-
[27]
Ibid., p. 201.
-
[28]
Ibid., p. 173.
-
[29]
René Girard, Des choses cachées, op. cit., p. 354.
-
[30]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 203.
-
[31]
Ibid., p. 48.
-
[32]
Ibid., p. 191.
-
[33]
George Sand, Simon, op. cit., p. 111.
-
[34]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 96.
-
[35]
George Sand, Indiana, op. cit., p. 156 et 315.
-
[36]
Ibid., p. 324.
-
[37]
Voir à ce propos l’analyse perspicace d’Indiana dans le chapitre un du livre de Françoise Massardier-Kenney, Gender in the fiction of George Sand, 2000.
-
[38]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 51.
-
[39]
Ibid., p. 233.
-
[40]
René Girard, Des choses cachées, op. cit., p. 319.
-
[41]
Voir à ce propos Yvette Bozon-Scalzitti, « Vérité de la fiction et fiction de la vérité dans Histoire de ma vie : le projet autobiographique de George Sand », 1984.
-
[42]
René Girard, Des choses cachées, op. cit., p. 335.
-
[43]
George Sand, Jacques, op. cit., p. 252-253. Sand hésitera toujours entre les deux possibilités : avoir le courage d’aimer ou celui de vaincre son amour. Isidora ou Alice dans Isidora, 1990.
-
[44]
George Sand, Mauprat, op. cit., p. 152.
-
[45]
Ibid., p. 283.
-
[46]
Ibid., p. 152.
-
[47]
Ibid., p. 38.
-
[48]
Ibid., p. 313.
-
[49]
Ibid., p. 312.
-
[50]
George Sand, Lélia (1833), op. cit., p. 135.
-
[51]
Ibid., p. 48.
-
[52]
George Sand, Jacques, op. cit., p. 296.
-
[53]
Peter Dayan, Lautréamont et Sand, 1997, p. 34.
-
[54]
George Sand, Horace, 1969, p. 4, dédicace « À M. Charles Duvernet ».
-
[55]
Ibid., p. 11.
-
[56]
Ibid., p. 16.
-
[57]
Ibid., p. 246.
-
[58]
Ibid., p. 249.
-
[59]
Ibid., p. 127.
-
[60]
Ibid., p. 224.
-
[61]
Ibid., p. 346.
-
[62]
Ibid., p. 351.
-
[63]
Ibid., p. 5.
-
[64]
Ibid., p. 185.
-
[65]
George Sand, Consuelo, la comtesse de Rudolstadt, 1959, vol. 2, p. 89.
-
[66]
Ibid., vol. 1, p. 149.
-
[67]
Ibid., vol. 3, p. 385.
-
[68]
Ibid., vol. 3, p. 264.
-
[69]
Ibid., vol. 3, p. 266.
-
[70]
René Girard, Des choses cachées, op. cit., p. 233.
-
[71]
George Sand, Le compagnon du Tour de France, op. cit., vol. 2, p. 178-179.
-
[72]
George Sand, Consuelo, op. cit., vol. 1, p. 95.
-
[73]
Ibid., p. 228.
-
[74]
Ibid., p. 321.
-
[75]
René Girard, Des choses cachées, op. cit., p. 422.
-
[76]
George Sand, Consuelo, op. cit., vol. 2, p. 10.
-
[77]
George Sand, « Lettre 3697, à Eugène Delacroix, 19 (?) juillet 1847 », dans Correspondance, 1964-1991, vol. 8, p. 15.
-
[78]
George Sand, « Lettre 3558, à Pierre-Jules Hetzel, 25-30 décembre 1846 », dans Correspondance, op. cit., vol. 7, p. 574.
-
[79]
George Sand, « Lettre de Solange à sa mère, 27 mai 1843 », citée par Georges Lubin dans Correspondance, op. cit., vol. 6, p. 158, note 2.
-
[80]
George Sand, « Lettre 3699, à Emmanuel Arago, 18-26 juillet 1847 », dans Correspondance, op. cit., vol. 8, p. 24.
-
[81]
George Sand, Césarine Dietrich, 1871, p. 170.
-
[82]
George Sand, Malgrétout, 1992, p. 117.
-
[83]
Ibid., p. 165.
-
[84]
George Sand, Césarine Dietrich, op. cit., p. 268.
-
[85]
« Il raisonne tout, non par froideur, comme tu le crois, mais par bonté » : c’est en ces termes que Félicie défend Sylvestre contre Tonino (George Sand, Le dernier amour, 1882, p. 238).
-
[86]
Maryline Lukacher fait commencer le matriarcat chez Sand avec Mauprat : après le parricide figuré par l’extermination de la « horde primitive » des Mauprat, Sand incarne en Edmée la mère idéale selon Rousseau (Maternal Fictions : Stendhal, Sand, Rachilde, and Bataille, 1994, p. 91-93). Edmée est certainement une éducatrice persistante pour Bernard, mais elle obéit encore au modèle aristocratique et le roman frappe au contraire par l’oblitération de toute présence maternelle.
-
[87]
Dans sa lecture adlérienne de Malgrétout, Ruth Carver-Carpasso a bien montré le désir du pouvoir qui se cache sous l’humilité de l’héroïne (« Malgrétout : A Psychological Study », 1996).
-
[88]
René Girard, Des choses cachées, op. cit., p. 259-260.
-
[89]
George Sand, Jean de la Roche, 1988, p. 182.
-
[90]
George Sand, Les deux frères, 1885, p. 238.
-
[91]
Serge Doubrovsky, Corneille et la dialectique du héros, op. cit., p. 309.
-
[92]
René Girard, Des choses cachées, op. cit., p. 452.
-
[93]
George Sand, Jacques, op. cit., p. 316.
-
[94]
L’intolérance de l’« intermédiaire » entre le sujet et son objet d’amour, que ce dernier soit Dieu, femme, ou toute autre passion, est une constante de l’oeuvre sandienne qui privilégie le « tête-à-tête », conçu d’après le modèle originel de la relation duelle avec la mère, exclusive de tout rival. Le tête-à-tête amoureux de Thérèse avec sa mère au début d’Elle et lui en est la parfaite reproduction. Aussi, le fait que Lucrezia Floriani blâme en Karol ce que Sand valorise le plus par ailleurs : l’amour passionné du fils pour la mère, le culte de la femme maternelle, l’exclusion du tiers, trahit-il l’intensité du ressentiment qui couve sous le dévouement sacrificiel de l’héroïne. C’est peut-être cette intolérance du tiers qui motive la sévérité de Sand envers l’adultère, alors qu’elle pardonne plus volontiers la « faute » en dehors du mariage. Sylvestre lui-même exprime à plusieurs reprises sa répugnance à voir Tonino, ou son image, s’interposer entre lui et Félicie.
-
[95]
Dans la petite polémique qu’a suscitée l’interprétation du Dernier amour et plus spécialement du personnage de Sylvestre, ceux qui lui dénient le rôle de porte-parole de Sand ont négligé un précédent qui aurait pourtant apporté beaucoup d’eau à leur moulin : non pas le Jacques de Jacques, mais celui d’Isidora, op. cit., p. 84, qui se propose de relever, purifier, réhabiliter la courtisane, ce qui lui attire la réponse suivante :
— Tu es meilleur que les autres, pauvre Jacques, mais tu n’es pas plus grand! Tu vois toujours dans l’amour l’idée de pardon et de correction, tu ne vois pas que ton rôle de purificateur, c’est le préjugé du pédagogue qui croit sa main plus pure que celle d’autrui, et que la châsse où tu veux replacer la relique, c’est l’éteignoir, c’est la cage, c’est le tombeau de ta possession jalouse ?
— Femme orgueilleuse ! m’écriai-je, tu ne veux pas même de pardon ?
— Le pardon est un reproche muet, le mépris subsiste après. Je donnerais une vie de pardon pour un instant d’amour.
-
[96]
Béatrice Didier, George Sand écrivain : « Un grand fleuve d’Amérique », 1998, p. 672.
-
[97]
Lucienne Frappier-Mazur, « Écriture et violence chez Honoré de Balzac et George Sand »,1996, p. 68.
-
[98]
George Sand, Monsieur Sylvestre, 1866, p. 93.
-
[99]
Ibid., p. 32.
-
[100]
Lucienne Frappier-Mazur, « Écriture et violence… », art. cit., p. 69.
-
[101]
George Sand, Monsieur Sylvestre, op. cit., p. 166.
Références
- Bozon-Scalzitti, Yvette, « Vérité de la fiction et fiction de la vérité dans Histoire de ma vie : le projet autobiographique de George Sand », Nineteenth Century French Studies, vol. XII-XIII, n° 4-1 (1984), p. 95-118.
- Carver-Capasso, Ruth, « Malgrétout : A Psychological Study », George Sand Studies, vol. XV, n° 1-2 (1996), p. 29-42.
- Dayan, Peter, Lautréamont et Sand, Amsterdam, Rodopi (Faux Titre), 1997.
- Didier, Béatrice, George Sand écrivain : « Un grand fleuve d’Amérique », Paris, Presses universitaires de France (Écrivains), 1998.
- Doubrovsky, Serge, Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard (Bibliothèque des idées), 1963.
- Frappier-Mazur, Lucienne, « Écriture et violence chez Honoré de Balzac et George Sand », dans Jeanne Goldin (éd.), George Sand et l’écriture du roman, Actes du XIe colloque international George Sand, Université de Montréal, Département d’Études françaises (Paragraphes), 1996, p. 59-70.
- Fromm, Erich, Love, Sexuality, and Matriarchy : About Gender, New York, Fromm International Publishing Corporation, 1977 (éd. de R. Funk).
- Girard, René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 1978.
- Lukacher, Maryline, Maternal Fictions : Stendhal, Sand, Rachilde, and Bataille, Durham, Duke University Press, 1994.
- Massardier-Kenney, Françoise, Gender in the Fiction of George Sand, Amsterdam, Rodopi (Faux Titre), 2000.
- Sand, George, Antonia (1862), Paris, Calmann Lévy, 1882.
- — — —, Césarine Dietrich (1870), Paris, Calmann Lévy, 1871.
- — — —, Consuelo, la comtesse de Rudolstadt (1842-1844), Paris, Garnier (Classiques Garnier), 3 vol., 1959 (éd. de L. Cellier et L. Guichard).
- — — —, Correspondance (1812-1876), Paris, Garnier, 25 vol., 1964-1991 (éd. de G. Lubin).
- — — —, Elle et lui (1859), Meylan, Éditions de l’Aurore, 1986 (éd. de J. Barry et T. Bodin).
- — — —, Flamarande (1875), Paris, Calmann Lévy, 1882.
- — — —, Horace (1841), Paris, Éditions du Livre Club Diderot (Permanence), 1969 (éd. de H. Juin).
- — — —, Indiana (1832), Paris, Gallimard (Folio), 1984 (éd. de B. Didier).
- — — —, Isidora (1845), Paris, Éditions des Femmes, 1990 (éd. de E. Sourian).
- — — —, Jacques (1834), Paris, Calmann Lévy, 1889.
- — — —, Jean de la Roche (1859), Meylan, Éditions de l’Aurore, 1988 (éd. de C. Tricotel).
- — — —, Jeanne (1844), Meylan, Éditions de l’Aurore, 1986 (éd. de S. Vierne).
- — — —, La marquise (1832), dans George Sand, Nouvelles, Paris, Éditions des Femmes, 1986, p. 45-92 (éd. de E. Sourian).
- — — —, Le compagnon du Tour de France (1841), Paris, Calmann Lévy, 2 vols., 1885.
- — — —, Le dernier amour (1865), Paris, Calmann Lévy, 1882.
- — — —, Lélia (1833 et 1839), Paris, Garnier (Classiques Garnier), 1960 (éd. de P. Reboul).
- — — —, Les deux frères (1875), Paris, Calmann Lévy, 1885.
- — — —, Le secrétaire intime (1834), Meylan, Éditions de l’Aurore, 1991 (éd. de L. Schwartz).
- — — —, Lucrezia Floriani (1846), dans George Sand, Vies d’artistes, Paris, Presses de la Cité (Omnibus), 1992, p. 679-847 (éd. de M. Fragonard).
- — — —, Mademoiselle la Quintinie (1863), Paris, Michel Lévy Frères, 1863.
- — — —, Mademoiselle Merquem (1868), Paris, Michel Lévy Frères, 1868.
- — — —, Malgrétout (1870), Meylan, Éditions de l’Aurore, 1992 (éd. de J. Chalon et C. Tricotel).
- — — —, Ma soeur Jeanne (1874), Paris, Michel Lévy Frères, 1874.
- — — —, Mauprat (1837), Paris, Garnier (Garnier-Flammarion), 1969 (éd. de C. Sicard).
- — — —, Monsieur Sylvestre (1866), Paris, Michel Lévy Frères, 1866.
- — — —, Nanon (1872), Meylan, Éditions de l’Aurore, 1987 (éd. de N. Mozet).
- — — —, Simon (1836), Meylan, Éditions de l’Aurore, 1991 (éd. de M. Hecquet).