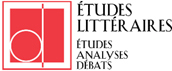Abstracts
Résumé
Selon le penseur martiniquais Édouard Glissant, l’arrière-pays culturel et physique constitue une ressource de résistance qui provoque une reconfiguration autant de la conquête coloniale que de son impact sur les communautés colonisées. Cet arrière-pays définit les modalités d’une résistance le plus souvent non violente aux aventures de dépossession initiées par la colonisation. Il est souvent en soi une résistance inscrite dans le paysage culturel et physique. Le déploiement de la résistance aux guerres coloniales dans l’oeuvre de Mongo Beti, J. R. Essomba et de Maryse Condé permet une exploration des multiples dimensions de la puissance du pays profond.
Abstract
Africa appears in Édouard Glissant’s theoretical or poetic schemas either as an example of resistance or as a counterexample of the West Indian reality. The presence of a cultural, social, or political hinterland can provoke significant reconfigurations that are crucial to the understanding of colonial processes in Africa. Domination and infiltration are attenuated or opposed by the existence of a mythological hinterland. This essay uses the works of Mongo Beti, Maryse Condé and J. R. Essomba to address resistance strategies based on the power of cultural and physical space.
Article body
L’Afrique rentre dans le fonctionnement des schémas théoriques ou poétiques d’Édouard Glissant comme figure de l’exemplarité de la résistance ou comme contre-exemple du vécu antillais. L’artificialisation de la société martiniquaise par la stratégie coloniale française s’explique en partie par l’absence de l’arrière-pays culturel, social ou politique ; autant de manques qui provoquent une exacerbation de la violence coloniale. En Afrique, les embuscades des indépendances engendrent une autonomisation des contradictions et des tensions, contribuant ainsi au renforcement de la conscience collective. La domination y est atténuée par l’existence d’un arrière-pays mythologique. La densité politique et culturelle qui en résulte constitue les communautés africaines en partenaires de la Relation mondiale là où la Martinique risque de disparaître en tant que collectivité sur la scène du monde. La situation africaine ne débouche pas sur l’impasse, mais sur une reconfiguration de la distribution du pouvoir : « L’importance de cette absence d’antécédents sociaux est ici (Martinique) évidente. La colonisation en Afrique ne débouche pas sur une “ morbidité ” liée à la structure sociale, elle renforce les contradictions en germe dans la société africaine traditionnelle[1]. » La voix du griot africain est l’une des manifestations de cet arrière-pays culturel, lequel griot a préservé pour le patrimoine imaginaire la mémoire des empires et des peuples :
De l’Afrique monte la voix du griot. Peu à peu elle se libère ; enfin nous l’entendons. Nous distinguons maintenant sa part dans notre voix. Nous écoutons l’explication des origines, le pérégrinage des ancêtres, la séparation des éléments. Et puis, ce bruit de mer qui bat dans nos mots. La cadence irrémédiable du bateau. Ce rire qu’ils n’ont pu noyer[2].
À la conférence annuelle de la Modern Language Association (MLA) tenue à Toronto en 1993, Glissant, répondant à une question que je lui avais posée sur l’arrière-pays mythologique, suggéra que l’arrière-pays culturel africain était en train de traverser une phase de mutations tourmentées. Le tourbillon des mutations en cours était peut-être, laissait-il entendre, le signe de quelque chose en devenir, une sorte de parturition douloureuse. Au cours du colloque sur Glissant tenu au Graduate Center de la City University of New York en 1999, j’ai ressassé mes inquiétudes sur les cultures africaines ataviques et Glissant, citant l’exemple du Congo de Kabila et de toute l’Afrique centrale, a proposé que l’arrière-pays était complètement ravagé. Le démembrement de l’arrière-pays est donc la résultante des assauts répétés des macoutismes, et les conséquences sont à méditer dans les crises identitaires, les crises des valeurs, la destruction des réflexes coutumiers de survie qui prolifèrent en famines, en villes monstrueuses qui affament les campagnes, en génocides. La prolifération des macoutismes néocoloniaux serait, selon Glissant, une reproduction caricaturale du destin des grands fugitifs et dynastes africains qui, après avoir taillé des empires, ont presque tous fini dans l’exil, les geôles ou la dépendance. Leur histoire se répète de « manière caricaturale dans l’entreprise de ces pseudo-conquérants apparus dans les bagages de l’après-colonisation, anciens sous-officiers ou officiers des armées colonialistes, dont l’Occident, qui les a faits, autorisés, maintenus, se gausse ou s’indigne tant[3] ». Face à cette tragédie au quotidien, il importe de risquer une autre hypothèse : l’arrière-pays s’est peut-être banalisé, je veux dire par là qu’il s’est douloureusement adapté à la modernité africaine, devenant une composante poétique déterminante de cette modernité qui constitue l’un des théâtres les plus vertigineux de la Relation. Même si on retenait l’hypothèse de Glissant sur la décomposition de l’arrière-pays physique et culturel africain, il apparaît que cet arrière-pays, qui a opposé une résistance à la violente pénétration coloniale, est victime des violences engendrées par les guerres civiles. Il définit les modalités d’une résistance inscrite dans le paysage culturel et physique. Le déploiement de la résistance aux guerres coloniales dans l’oeuvre de Mongo Beti, de J.R. Essomba et de Maryse Condé permet une exploration des multiples dimensions de la puissance des arrière-pays face aux expéditions guerrières des empires coloniaux.
Dans L’histoire du fou de Mongo Beti, le patriarche Zoaételeu, réagissant à une lecture économique qui dévalue la forêt, fait remarquer que « derrière chacun de ces fourrés, derrière chaque baobab, il y a un fantôme qui nous regarde, le fantôme d’un ancêtre[4] ». La forêt sert d’asile aux communautés villageoises violentées par les militaires : « Réfugiez-vous tous dans la forêt, asile traditionnel de nos ancêtres, ordonna le patriarche[5]. » La forêt-refuge instaure une autonomie par rapport à la situation coloniale, un espace qui permet d’échapper au harcèlement colonial :
Pour eux, le monde se restreignait à leur village ou plus exactement aux forêts environnantes. Ils étaient toute la journée dans leur forêt. Quand ce n’était pas pour travailler dans leur champ, c’était pour boire du vin de palme en toute sécurité, ou pour chasser ou pour se livrer à certaines activités que la « loi » réprouvait et que la forêt protégeait très maternellement[6].
L’édit colonial rythme son avancée par la violence, mais entre en conflit avec la forêt, véritable mère protectrice. La configuration des villages dans le sud forestier du Cameroun, résultat des contraintes historiques récentes, témoigne de la fonction-refuge de la forêt devant le harcèlement des conquérants de la pénétration coloniale : « Certains hameaux, très rares, dont les habitants, qui craignaient les tracasseries de l’administration coloniale, ne se sont jamais résolus à venir s’installer sur la route[7]. » Ville cruelle articule la fonction de refuge et de résistance de la forêt contre la pénétration coloniale à travers la fragilité des résidents de la ville ou vivant en bordure des routes devant l’action des missionnaires du christianisme ou de l’administration coloniale. Le discours sur l’arrière-pays est produit exclusivement du point de vue de Banda, maître de la forêt qui est témoin de la fonction dissuasive que la forêt exerce sur les policiers de la coloniale. La densité du paysage (la grande forêt) oppose une résistance déterminante à la poursuite policière. À ce stade, Banda a une confiance si totale dans la protection de l’arrière-pays qu’il peut se soustraire au harcèlement colonial en quittant tout simplement la route hostile :
Moi je vous laisse la route, je préfère la forêt : d’abord il y fait toujours frais ; et puis les arbres, ce sont mes grands amis. Pour tout te dire, les arbres sont les meilleurs hôtes aussi pour qui les connaît, les plus sûrs…[8]
La résistance naturelle consiste tout simplement en l’exploitation des ressources du paysage culturel, mythologique et physique comme armes de résistance à la pénétration coloniale. À ce stade, la résistance est davantage inspirée par le paysage que par une intention méditée de contestation de l’ordre colonial. C’est l’arrière-pays qui, pourrait-on dire, invite à la résistance face à la violence et aux expéditions militaires.
Dans Perpétue, malgré l’indépendance, la route demeure toujours un traquenard pour les peuples africains. Ainsi, « Amougou se mit en route dans la nuit du 14 au 15 août, en coupant à travers la forêt qu’il connaissait à la perfection, pour éviter les tracasseries du couvre-feu[9] ». La valorisation de l’arrière-pays dans la marche des rubénistes vers le théâtre de leur bataille, Ekoumdoum, transite par les pistes coutumières. Le rubénisme, après sa mise hors-la-loi par l’administration coloniale, va entreprendre une retraite stratégique dans l’arrière-pays physique et ancestral. Le symbole de ce retrait, dans la longue marche des rubénistes qui est l’objet de La ruine presque cocasse d’un polichinelle, est le réflexe instinctif du colonisé envers l’ordre colonial qui consiste à éviter la route coloniale pour emprunter les pistes coutumières. La route est porteuse de la violence coloniale, c’est l’itinéraire qui définit en même temps la dépossession de la colonie, les modalités d’exploitation et le lieu où le colonisé perd l’initiative au profit de l’ordonnance coloniale. La piste coutumière préexiste au tracé colonial malgré son inconfort ; elle est la voie tracée par le peuple africain pour sa marche dans le monde. La pénétration européenne, notamment à travers l’évangélisation, l’exploitation économique et le quadrillage de l’administration coloniale, fragilise l’arrière-pays. La route coloniale 13 est ainsi présentée par les résidents de la forêt comme un tombeau des valeurs ancestrales :
Les riverains de cette importante voie avaient la réputation injurieuse de s’être laissé subjuguer et même abâtardir par quelques décennies d’évangélisation missionnaire, au point d’être désormais dépourvu de toutes les vertus ancestrales de courage et de vaillance. Leur inaptitude à la révolte élémentaire était le lieu commun des conversations et si certains s’en félicitaient et s’en réjouissaient, d’autres le déploraient. La soumission obséquieuse de ces populations avaient attiré de nombreux trafiquants européens, séduits par l’espoir de profits rapides extorqués dans la sécurité et l’impunité[10].
Le grand détour par le pays profond est, quant à lui, une entreprise de réadaptation aux traditions du clan. Celle-ci indique une conscience de la déperdition culturelle et un souci de réimmersion afin de pouvoir enrichir le rubénisme de l’apport de l’Afrique des villages. Les pistes coutumières offrent aux trois rubénistes non seulement la protection de la grande forêt, mais toutes les ressources des traditions ancestrales telles que l’hospitalité instantanée des riverains alors que la forêt, le moment venu, leur sert de refuge. Pour les rubénistes, celui-ci est une « hutte merveilleusement camouflée, un énorme nid dont les contours, les formes et les diverses nuances de vert devaient le jour se fondre dans le décor environnant de fourrés inextricables[11] ». L’éloignement des routes coloniales et de la ville, outre les avantages pour la sécurité des militants rubénistes, leur permet d’entreprendre la reconnection avec le pays profond, de réapprendre le geste communautaire afin de le féconder avec l’expérience de la ville.
L’expression poétisée de l’intimité avec le paysage produit une envolée lyrique mémorable qui est aussi, pour Mor-Zamba, une manière d’interpellation de la grande forêt, sa vieille complice :
Grands arbres sans âge, votre rassemblement n’a pas de pareil ailleurs dans le monde, je le sais ; vastes fourrés, mes amis, vous vous déployez en volutes boursouflées qui ne me sont point inconnues, sans m’être tout à fait familières. Oui, vous me vîtes passer ici même il y a environ vingt ans. J’étais presque un enfant et les chaînes de l’esclavage broyaient mes hanches, je ne parle pas du fusil dont le canon était pointé dans mon dos. Vous me revoyez aujourd’hui allant dans l’autre sens, libre, instruit par le malheur, ayant miraculeusement échappé à la mort, ayant moi-même tué un homme, avec mes mains[12].
Le déferlement de jubilation lyrique qui soutient cette prosopopée est significative du rôle déterminant de la grande forêt dans l’issue de la marche des trois rubénistes vers la libération d’Ekoumdoum. Mor-Zamba, par cette performance poétique, rétablit définitivement sa « familiarité pour ainsi dire consanguine[13] » avec la forêt : il peut donc mener les deux autres rubénistes, enfants de la ville, dans les mystères de la forêt équatoriale. La marche des rubénistes se fait sous la conduite de Mor-Zamba, « adapté à la reptation parmi les ronces autant qu’à la glissade entre les lianes, à l’escalade d’un fût, au dépistage d’une bestiole venimeuse ou à la détection d’un fruit comestible[14] ». Mor-Zamba, « à qui son prestige récent d’homme rompu aux embûches de la vie des bois conférait une autorité accrue[15] », conduit les deux autres rubénistes qui, citadins, n’ont aucune connaissance de la forêt. La fréquentation du pays profond se fait aussi avec les armes de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences ; l’intention n’est pas simplement de replonger dans le limon mythologique, mais de revisiter la mémoire de l’arrière-pays avec les yeux définitivement rivés sur le chantier de la modernité africaine : c’est ce que Glissant appelle la vision prophétique du passé.
Cependant, l’avancée de la pénétration coloniale s’accompagne d’une fragilisation de l’arrière-pays, comme le constate Banda dans Ville cruelle :
Pendant que les gardes régionaux le conduisaient au commissariat de police, il éprouvait un profond, très profond sentiment de frustration : cette impression non plus n’était pas nouvelle dans sa vie. À maintes circonstances déjà, il lui avait semblé éprouver cette même chose : seulement, à cet instant elle prenait une forme suraiguë. Elle s’accompagnait aujourd’hui comme avant, de cette autre impression, elle aussi rendue aiguë par les circonstances, que la sécurité s’était à jamais retirée de la grande forêt[16].
La pulsion conquérante guerrière, dans l’entreprise de pénétration coloniale, organise une destruction des ressources de survie de la forêt, menaçant la sécurité existentielle et alimentaire des populations. La destruction des ressources de survie matérielle ne doit cependant pas faire oublier la déstabilisation de la sécurité existentielle et identitaire.
Le dernier gardien de l’arbre de J.R. Essomba propose une approche assez originale des relations entre l’esclavage et la colonisation. L’appropriation de la logistique coloniale aux fins de réparation des torts commis par la traite transatlantique fait écho dans le roman au maquis anticolonialiste, autre modalité de subversion de la colonisation. Le projet de rédemption du jeune missionnaire allemand est cependant interprété de manière différente par les populations locales qui y voient une démarche providentielle du Justicier blanc envoyé par les ancêtres pour les restaurer à leur histoire. Le roman est une allégorie qui se propose d’expliquer la configuration inégalitaire du monde avant de proposer le pardon et la rédemption comme des modalités de restauration de la paix originelle. L’allégorie est cependant interrompue par une irruption de l’histoire dans ce récit qui jusque-là se construisait exclusivement par le mythe, le sacré et le merveilleux. Le roman commence par le mythe originel de l’unité originelle : « À l’aube des temps, la terre se résumait à une seule race, un seul continent, un seul pays, une seule région, un seul clan et une seule famille[17]. » Mada et sa femme Vévé, les fondateurs de cette genèse romanesque, ont deux fils, Labé et Nica, qui reçoivent de leurs parents des semences. Labé plante ses graines au Nord pendant que Nica plante les siennes au Sud. Mais la première pomme de discorde survient avec la polémique autour de la démarcation des frontières entre le Nord et le Sud :
Quelques semaines plus tard, le père mourut. Suivant ses dernières volontés, Labé et les serviteurs qui lui revenaient se dirigeaient vers le Nord, Nica et les siens prirent la direction du Sud. Les deux fils allaient commencer à semer les graines reçues en héritage, lorsqu’il se posa un grave problème : Où était la frontière entre le Nord et le Sud ? Mada le Sage, avant de mourir, n’avait pas pris le soin de tracer cette ligne qui aurait évité bien des litiges. Les deux frères se lancèrent alors dans une bataille sans merci, car l’un désirait que le nord finît un peu plus au sud, et l’autre voulait que le sud commençât plus au nord[18].
La bataille fratricide qui s’ensuit aboutit à une démarcation des frontières par des tranchées creusées entre les deux camps, tranchées qui se transforment en un fossé irrémédiable de séparation. Le fossé de haine entre le Nord et le Sud est renforcé par l’épanouissement des semences de Labé au Nord et le rabougrissement des pousses de Nica au Sud : « C’est ainsi que la splendeur et la prospérité restèrent circonscrites dans le Nord, alors que dans le Sud, Nica et les siens végétaient[19]. » Les bonnes fortunes climatiques du Nord vont être consolidées par la conquête et l’asservissement du Sud :
Bien des années passèrent, les enfants de Labé et Nica héritèrent de cette situation avant de la céder plus tard à leurs enfants. Ainsi, pendant des générations et des générations, le Nord prospéra, et le sud végéta. Le nord avait atteint un tel degré de puissance qu’il lui était de plus en plus difficile de maîtriser sa fougue et sa pétulance. Il lui fallait de nouvelles terres pour étendre ses cultures, et de nouveaux bras pour cueillir les fruits des arbres qui continuaient à produire à profusion. Alors, Néola, le descendant de Labé qui régnait à cette époque-là sur le nord regarda les terres sauvages du sud et pointa son doigt conquérant. La conquête fut sanglante et impitoyable. Les descendants de Nica qui ne se rendaient pas immédiatement étaient massacrés et leurs terres confisquées. Les survivants étaient réduits à l’esclavage. Très vite, les guerriers de Néola, qui étaient militairement supérieurs, vinrent à bout des dernières résistances[20].
La prise des terres du Sud par les conquérants venus du Nord participe de ce que Glissant, modelant en cela sa pensée sur celle de Deleuze et de Guattari, nomme le nomadisme en flèche : « Le nomadisme envahisseur, celui des Huns par exemple ou des Conquistadores, qui a pour but de conquérir des terres, par extermination de leurs occupants[21]. » La colonisation ne se définit-elle pas comme une vaste expropriation despeuples colonisés de leurs terres ? Le scénario classique de la marche conquérante des hommes de Néola se poursuit avec l’imposition de nouvelles plantes :
Ainsi, lorsque Néola ordonna à ses hommes d’abattre tous les arbres qui ne produisaient pas et de les remplacer par ceux du Nord beaucoup plus productifs, il ne savait pas qu’il était en train de condamner le monde. Il décréta même qu’il était interdit à quiconque de conserver un seul de ces arbres, car ses hommes de science lui avaient fait comprendre que si l’arbre ne produisait pas, c’était parce qu’il secrétait une substance toxique qui empoisonnait le sol et le rendait stérile. Était donc puni de mort, tout homme ou femme qui n’abattait pas tous les arbres de Nica qu’il possédait[22].
L’imposition des arbres du Nord aux peuples vaincus réactive le livre des lamentations et des résistances de la situation coloniale : Patrick Chamoiseau nous invite à penser aux peuples Agni de Côte d’Ivoire, « versant de l’eau chaude sur les plants de cacao imposés[23] ». Thierno Monenembo, dans Les écailles du ciel, sauvegarde la mémoire du combat mené par les peuples de Guinée contre l’imposition du caoutchouc au détriment du manioc. L’imposition des arbres venus du Nord et la destruction des arbres du Sud sous le couvert de leur improductivité équivaut aussi à l’amputation de la diversité du monde. L’imposition d’un ordre monologique qui est à l’origine des entreprises coloniales se manifeste ici par ce qu’on peut appeler un projet mono-écologique. La soumission des écosystèmes à la logique prédatrice des conquérants guerriers venus du Nord mène à un appauvrissement des écosystèmes du tout-monde.
La normalisation écologique et économique du monde par l’imposition des plantes apportées par le Nord ampute le monde de sa diversité, mais aussi fragilise la densité culturelle et physique des peuples du Sud. L’arbre, comme on le voit dans le roman, est porteur d’un projet de conquête, mais devient aussi le lieu de la résistance des descendants de Labé. La résistance est autant une entreprise de préservation de la diversité écologique du monde qu’une actualisation des virtualités culturelles à même de raffermir les positions des descendants de Néola devant la poussée de la conquête :
Cependant, une femme, Abéta, qui avait l’étrange pouvoir de converser avec les morts, reçut un jour la visite de l’esprit de Nica qui lui rappela l’importance des arbres qu’on était en train d’abattre. L’esprit lui ordonna de sauver l’un des arbres. Obéissante, elle s’exécuta. Elle arracha un arbre pas très gros, rassembla sa famille et les amis qui voulaient bien la suivre et après avoir déjoué la vigilance des gardes de Néola, s’enfonça dans la forêt la plus épaisse et la plus profonde[24].
La muraille protectrice de la forêt contraste évidemment avec toutes les mythologies sur la virginité des forêts qui ont accompagné le projet colonial. L’arrière-pays mythologique, matérialisé ici par la conversation avec les morts, oppose sa densité à l’ordre monologique et guerrier de la coloniale. L’arbre sacré est le lieu de convergences entre les arrière-pays physique et mythologique. Cet arbre est une cristallisation de la résistance à la culture menacée et au projet de destruction de l’écosystème. Symbole de la continuité et de la pérennité de la voix du Sud dans un univers dominé par les conquérants venus du Nord, l’arbre sacré est le symbole de la transmission du savoir ancestral, antidote contre la mort écologique et incarnation d’une volonté déterminée de survie. En ce sens, l’arbre sacré occupe une place déterminante dans la formulation du projet anti-esclavagiste et anticolonial. L’une des différences entre l’esclavage dans les îles antillaises et la colonisation en Afrique est à chercher précisément dans le rôle joué par l’arrière-pays culturel et physique dans les mouvements des résistances. Abéta, l’élue des Ancêtres et première gardienne de l’arbre, transmettra tous ses pouvoirs à sa fille avec ses recommandations :
Pour l’avoir fait moi-même, je sais que garder l’arbre est une tâche très éprouvante pour une femme, c’est un travail d’homme. Mais l’homme qui devra protéger l’arbre contre tout et tous, c’est moi-même qui le choisirai. Lorsqu’il faudra un nouveau gardien à l’arbre, mon esprit reviendra parmi les miens et voguera au gré des songes. Si une eau pure se caractérise par sa limpidité, un homme pur se reconnaît par la clarté de ses rêves. Cet homme que j’aurai choisi, ce sera ensuite toi et ensuite une de tes descendantes qui l’initiera à la protection de l’arbre. Ce sera ainsi jusqu’au jour où l’arbre fleurira[25].
Les descendants de Nica vaincus sont divisés en deux camps : le camp du pardon qui est pour une réconciliation avec le Nord et le camp de la vengeance. Cette division fait écho à celle du Nord polarisé par le camp de ceux qui sont pour la perpétuation de la domination afin peut-être de prévenir toute éventuelle vengeance et le camp de la rédemption et de ceux qui sont pour une pénitence comme prélude à toute réconciliation : notre négrier hypnotisé appartient à ce camp de la rédemption.
La tradition des gardiens de l’arbre est respectée jusqu’à Mevoa qui refuse de s’y soumettre parce que la condition pour devenir gardien de l’arbre est ni plus ni moins la castration. Apprenant la drastique condition, Mevoa, élu par les esprits pour garder l’arbre, refuse de choisir entre la castration et la mort, et s’enfuit. La condamnation à mort de Mevoa par la grande prêtresse Minoba le pousse à une fuite dans les profondeurs de la forêt. Il est arrêté par des inconnus qu’il prend pour des chasseurs d’esclaves. En fait, le rapt de Mevoa est loin d’être d’origine esclavagiste. Il est plutôt victime d’une action de combattants anticolonialistes. Mevoa est enlevé par les résistants à la pénétration coloniale :
Nos armements disposent d’un armement beaucoup plus performant et leurs hommes sont plus rompus que nous à l’art de la guerre. Jusqu’à présent, nous nous contentions juste de quelques actes de sabotage tels que détruire un pont, brûler des maisons ou plus audacieux encore, attaquer de petits convois. Mais bientôt, les choses vont changer, et cela pour trois raisons principales : nos effectifs en hommes ont augmenté ; la guerre que nos envahisseurs livrent sur leur propre continent est en train de les affaiblir ; et nous avons aussi désormais le soutien de quelques pays du Nord qui nous envoient des armes et des instructeurs[26].
La castration accidentelle de Mevoa au cours d’une tentative vaine de s’échapper de la prison des troupes allemandes sera interprétée par l’intéressé comme un accomplissement du voeu communautaire et ancestral. Il retournera alors assumer ses fonctions de gardien de l’arbre. Mais entre le départ et le retour de Mevoa, la communauté a connu un événement exceptionnel, soit l’expédition armée conduite par le Colonel allemand Wolf, « l’homme blanc, ce descendant de Néola[27] », qui a pour mission de localiser un site idéal pour l’implantation de la capitale de la colonie allemande.
Le pauvre Christ de Bomba met en scène un missionnaire qui pose un regard autocritique sur sa mission d’évangélisation et décide de la fermeture de son église à Bomba. L’avertissement de l’auteur nous dit cependant que le scénario est trop beau pour être vrai. Dans Le dernier gardien de l’arbre, la cristallisation de cette conscience critique de l’activité missionnaire sur le personnage du jeune religieux se manifeste par une critique du vieux prêtre et le passage à l’étape que n’avait pas osé franchir Le pauvre Christ de Bomba. Le jeune missionnaire passe de la critique de l’activité missionnaire à la pénitence et à la rédemption. La bienveillance envers les résidents, même quand il est agressé, s’oppose à l’intransigeance de l’administrateur qui se propose de faire subir aux habitants du pays de Tala un « Congo-Océan ». Les frictions entre le missionnaire et le colonisateur tournent à la rupture dans Le dernier gardien de l’arbre. Nicolas apparaît comme un missionnaire peu orthodoxe qui refuse d’asservir les peuples indigènes, procède à une condamnation de l’expropriation foncière qu’il assimile au vol et refuse de monter sur la chaise à porteurs, attitude qui correspond à une dénonciation du portage qui fit jadis le bonheur de André Gide lors de son Voyage au Congo. La critique ouverte de l’activité missionnaire et de la mission colonisatrice provoque la mise aux arrêts du jeune missionnaire par l’armée allemande, sous la recommandation de son supérieur religieux qui, dans l’attente de sa déportation vers l’Allemagne, le considère comme un fou dangereux pour l’entreprise coloniale.
L’expiation pour les crimes commis pendant la traite négrière transforme Nicolas en danger pour la mission évangélisatrice et l’entreprise coloniale. La persécution du missionnaire lui vaut des appréciations des partisans de la réconciliation qui voient en lui « notre frère du pardon[28] » : « Je ne doute point que parmi ces hommes blancs, il y ait des gens comme nous qui n’aspirent qu’à la paix et à la réconciliation[29]. » Nicolas, « le Blanc qui ne ressemble pas au Blanc », inspire confiance aux habitants de Tuzi :
À l’exception de quelques irréductibles comme Anakan et Atila, les Tuzis qui dans un premier temps avaient mis tous les colons dans un même sac, avaient vite fait d’en ressortir Nicolas. Ils s’étaient en effet rendu compte que le jeune homme était toujours prêt à donner plus qu’on ne lui demandait. Il était homme et blanc, pourtant les corvées les plus dégradantes ne lui répugnaient pas. On le voyait ainsi le matin, une calebasse perchée sur la tête, marchant au milieu des enfants et des femmes qui étaient assignés à la corvée d’eau. L’après-midi, au milieu des hommes noirs, la soutane retroussée au niveau des hanches, il malaxait de ses pieds nus la boue qui allait servir à crépir les murs des cases neuves des colons. Et le soir, alors que tout le monde n’aspirait qu’à un repos bien mérité, il cherchait encore à se rendre utile. En réalité, Nicolas avait peur de s’arrêter. Lorsque par exemple il s’allongeait pour se reposer, le souvenir de sa vie antérieure et les remords qui en découlaient, affluaient dans sa mémoire. Alors il se relevait, faisait de sa vie une suite ininterrompue de mortifications. Pour lui, c’était le Prix de la Rédemption[30].
L’activisme de Nicolas a une origine dans la séance d’hypnose qui l’a entièrement traumatisé. L’expédition dans le pays des Tuzi, nom qui renvoie Nicolas à la séance d’hypnose qui avait provoqué sa rentrée sous les ordres et sa vocation africaine, est l’occasion rêvée par le négrier-hypnotisé pour faire justice aux crimes de l’esclavage :
Pendant ce temps-là, Nicolas en était revenu à s’étonner que le village dans lequel ils se trouvaient eût pour nom Tuzi. Quelques années avant, bien qu’il ne fût pas certain que ce village existât vraiment, il s’était juré de le chercher. Le trouver aussi facilement avait un caractère étrange qui ne relevait certainement pas du simple hasard. Était-ce la suite de cette mystérieuse histoire qui hantait encore ses nuits ? Il l’espérait et le souhaitait même de toutes ses forces, car il pourrait alors expier et avec un peu de chance, connaître la rédemption[31].
En août 1914, alors qu’il a 17 ans, une séance d’hypnose transporta Nicolas dans la journée fatidique du 1er août 1750 à dix heures du matin. Nicolas Gansen officiait alors comme capitaine d’une cargaison de trois cents hommes pendant la traite négrière sur les côtes africaines. L’intermédiaire au sol Kodjo remplissait la fonction bien connue de chasseur d’esclaves alors que l’esclave en tête de file s’identifiait comme étant Tambô de Tuzi. La maquette posée au-dessus de son lit était la « réplique presque exacte du bateau dans lequel il s’était trouvé dans l’expérience[32] » de l’hypnose. Parti chez le médium dans l’intention de démystifier un charlatan, Nicolas en revient négrier. Dans un monologue avec sa défunte mère, il jure de réparer le tort commis : « Comme j’ai enlevé à l’Afrique, je dois lui donner[33]. » La promesse de réparation du tort commis trois siècles plus tôt passe par le sacerdoce :
Il avait endossé un froc pour arriver sans encombre en Afrique, il était désormais prêt à croire aux esprits si c’était là la condition incontournable de son acceptation par les indigènes. Il était venu pour vivre avec eux et comme eux[34].
L’immersion dans la vie des indigènes et la rupture d’avec son monde de colonisateurs et de missionnaires allemands précèdent l’embarcation dans l’aventure de la rédemption comme prélude à une éventuelle réconciliation.
Tambo est le fils rebelle d’Abéta, la grande prêtresse originelle, le fils banni pour avoir refusé de sacrifier son existence afin de devenir le gardien de l’arbre et qui, « dans ses errances à travers la forêt, allait finalement tomber dans les filets des chasseurs d’esclaves[35] ». Tambo, victime de la rigidité des traditions, victime expiatoire originelle, est le premier d’une lignée d’enfants mâles qui allaient être sacrifiés sur l’autel de l’arbre-fondateur :
Dans la lignée des grandes prêtresses, ce secret était transmis de mère en fille. La première expliquait à la seconde pourquoi une grande prêtresse devait accoucher dans le plus grand secret et pourquoi tout enfant mâle devait tout de suite être étranglé avec le cordon ombilical. Abéta, cruellement trahie par son fils, avait décidé qu’il n’y aurait plus jamais d’homme dans sa lignée[36].
D’après la grande prêtresse Minoba qui consacre Nicolas dernier gardien de l’arbre, la colonisation de Tuzi par les Allemands est une revanche de l’esprit de Tambo qui n’a jamais pardonné à la communauté de l’avoir banni. L’arrière-pays mythologique est aussi porteur des pratiques qui, comme le sacrifice rituel des enfants mâles, peuvent paralyser la marche de toute une communauté.
L’expédition en direction de la forêt sacrée, lieu où se trouve l’arbre préservé de la dévastation orchestrée par les forces venues du Nord, peut se lire comme la prise du dernier bastion de résistance que les descendants de Nica opposent à la marche conquérante de ceux de Néola. Nicolas confesse à Minoba les véritables raisons de sa venue en Afrique :
Je sais qu’il y a un peu plus de cent-soixante ans, dans une autre vie, je suis venu sur ces mêmes terres et j’ai capturé Tambo. J’ai fait de lui un esclave et je l’ai emmené là-bas, de l’autre côté des eaux, pour le faire travailler dans des plantations de cannes à sucre. Ce que j’ai fait m’a donné de très grands remords. C’est pour payer ma dette que je suis venu. J’avais enlevé un fils à votre tribu. Je me donne aujourd’hui en échange, si vous m’acceptez bien entendu[37].
La forêt retarde l’expédition allemande en infligeant des maladies qui paralysent la marche conquérante de l’armée allemande. Nicolas, au lieu de convertir les prétendus païens au christianisme, est converti à la religion du pays des conquis et devient le « dernier gardien de l’arbre ». La puissance de l’arrière-pays physique et mythologique est à l’oeuvre.
Dans Forts and Castles of Ghana, Albert van Dantzig nous informe que, pendant la pénétration européenne en Afrique occidentale, les forts permettaient aux nations commerciales de maintenir une importante présence sur la côte par rapport aux peuples indigènes tout en décourageant les autres concurrents européens. À la fin du dix-septième siècle, la transformation progressive des forts en comptoirs pour le commerce des esclaves vient confirmer une fois pour toutes que la fortification représente un maillon crucial dans la logistique avancée de la soumission des peuples qui prend le nom de colonisation. Dans Ségou, les murailles de terre, Maryse Condé évoque la ville de Cape Coast qui, avec ses rues larges, bien entretenues et bordées de somptueuses maisons de pierre, était considérée par certains comme la plus belle de cette partie du littoral africain. Toutefois, le fort représente la construction la plus impressionnante :
Il avait changé dix fois de propriétaire, passant entre les mains des Suédois, puis des Danois, puis des Hollandais avant d’être fermement tenu par les Anglais. Ceinturé par un mur épais, il avait la forme d’un triangle dont deux côtés faisaient face à la mer et surveillaient les alentours à travers les yeux noirs et fixes de ses soixante-dix sept canons que l’air marin rongeait, mais qui savaient encore faire feu[38].
La victoire des Anglais sur leurs adversaires leur permettent évidemment d’utiliser les forts pour le commerce des esclaves et ensuite pour la colonisation. L’abolition de la traite négrière transatlantique a été suivie par la colonisation : les forts négriers devenant l’objet d’un commerce moins honteux, mais non moins dévastateur pour les peuples qui subissaient cette mutation de la présence européenne sur les côtes africaines. Dans Ségou, Maryse Condé nous apprend que les menaces de suppression du commerce des esclaves, consécutives à la Révolution française, ont pour conséquence un regain d’intérêt pour la colonisation agricole :
Les Français avaient fait de Saint-Louis du Sénégal la capitale de leur établissement de la côte d’Afrique et, se servant de cette ville comme d’une base, tentaient de pénétrer toujours plus en avant à l’intérieur du pays. Ayant passé des accords avec les souverains du Dimar, du Toro, du Danga, du Lao, du canton des Irlabé, non seulement, ils inondaient toute la région de leurs produits, portant un coup mortel aux productions traditionnelles, ruinant des familles entières, mais encore ils s’emparaient des terres dont les cultivateurs devenaient de véritables esclaves[39].
Les fortifications européennes forment la tête de pont d’une logistique avancée de la soumission violente des peuples africains. La destruction des murailles de Ségou par les canonnières de l’armée coloniale française consacrent l’asservissement des Bambaras à l’ordonnance coloniale :
Quand une ville se prépare à mourir, elle émet une longue plainte. Ceux qui l’entendent croient qu’elle naît de la détresse des habitants, se lamentant à l’intérieur des maisons. Il n’en est rien. […] Ségou se plaignit cette nuit-là. Longuement. Sourdement. Ségou se plaignit toute la nuit. À huit heures du matin, cette plainte fut étouffée par le fracas des pièces mises en batterie pour protéger le passage des soldats. […] Au milieu du jour, les Somonos firent leur soumission, tandis que le feu de l’artillerie avait pratiqué des brèches énormes dans les murailles de la ville[40].
Les murailles de Ségou sont la manifestation visible d’un arrière-pays physique et culturel qui déploie une résistance acharnée contre l’invasion guerrière et culturelle venue du Nord. Face à la puissance de feu des armées coloniales, face à la marche conquérante des missionnaires de la civilisation et de l’Évangile, l’Afrique déploie une résistance qui est moins le fait des guerriers que de ce que Glissant nomme un arrière-pays mythologique et physique. La destruction des murailles de Ségou découvre des formes de résistance qui permettent au peuple bambara de ruser avec les armées conquérantes afin de ne pas disparaître de la scène du monde. L’arrière-pays physique offre des refuges inaccessibles aux soldats de la coloniale, tandis que l’arrière-pays mythologique oppose aux missionnaires de la civilisation et de l’évangélisation la densité d’une culture qui, même dans la conquête, « indigénise » la culture assimilée. Le peuple bambara s’arc-boute sur les profondeurs du passé mythique pour résister aux forces de la destruction venant du Nord. Omar Traoré, qui préconise un panafricanisme pragmatique pour contrer l’avancée des troupes françaises, est tué dans une confrontation avec l’armée française. Au lieu de l’aide promise à Ségou contre les forces musulmanes, les Français détruisent les murailles et colonisent Ségou comme Omar Traoré l’avait prédit. Omar devient une source de référence et est immortalisé par les griots qui « trouvèrent là le héros qui manquait à leur épopée[41] ». Outre la réalisation d’une biographie célébrant les exploits d’Omar Diémogo Traoré, « le sage de Tacharant[42] », le camp d’Ouéta où il mourut en s’opposant à l’avancée de l’armée française devient un lieu de pèlerinage. Transformer Omar vaincu en symbole mythique du résistant visionnaire, c’est postuler un socle pouvant engendrer et alimenter les révoltes futures. La mythologisation des combattants exemplaires permet à une société vaincue par la puissance des armes de créer des pôles de cristallisation d’une tradition de résistances. « Transformer en victoire mythique une défaite réelle[43] » participe de la création des figures emblématiques qui sont des lieux de reconstruction de mythologies instruites des exigences de la modernité.
L’édit colonial, qui rythme son avancée par la violence, la guerre et le sang, entre en conflit avec la protection maternelle de la forêt et la mère protectrice. L’univers de l’écriture va donc être vécu très tôt comme une menace de l’univers du matrimoine. Le défi des écrivains sera donc celui-ci : comment recréer la forêt-refuge du dedans de la trajectoire de l’écriture conquérante ? Comment convertir les ressources de résistance de l’arrière-pays conquis et peut-être ravagé en nouvelles modalités de résistance dans un monde soumis aux soubresauts d’une occidentalisation effrénée, moins d’une occidentalisation que d’une désintégration vertigineuse des asiles de survie pour les peuples africains ? Le projet du maquis est une contestation de l’édit colonial. La loi coloniale pousse les résistants à une existence clandestine qui est une contestation radicale de l’édit colonial. La résistance interdite par l’occupation coloniale cherche refuge dans la forêt dense. La fragilisation de l’arrière-pays, la fascination de la ville, la pression de l’oppression matérialisée par la pénétration coloniale dans les profondeurs du corps social, de l’existence individuelle et collective, la prise de conscience diffuse du malaise du colonisé dans la situation coloniale et les instincts de survie qui commandent de prendre des initiatives pour durer délimitent les frontières culturelles, politiques et existentielles d’une résistance exclusivement articulée sur l’arrière-pays. L’intrusion des agents de la conquête dans l’arrière-pays concourt à l’instauration d’un sentiment d’insécurité. L’évanouissement de la sécurité mythologique découle d’une fragilisation des mécanismes de défense de l’arrière-pays physique symbolisé par la grande forêt équatoriale.
Appendices
Note biographique
Cilas Kemedjio
Cilas Kemedjio est diplômé de l’université de Yaoundé (Cameroun) et The Ohio State University (États-Unis). Il est actuellement professeur agrégé (« Associate Professor ») d’études francophones à l’Université de Rochester. Il a publié un ouvrage qui porte sur des questions théoriques liées aux écritures africaines et caribéennes (De la négritude à la créolité. Édouard Glissant, Maryse Condé et la malédiction de la théorie, Hamburg, LIT Verlag, 1999). Ses publications récentes portent sur la ville postcoloniale (Patrick Chamoiseau, Mongo Beti, Lucie Julia, Calixthe Beyala) et les stratégies de résistance, sur les questions de l’ethnicité au Cameroun contemporain, sur l’imaginaire africain d’Édouard Glissant et sur le mythe de l’Assistant Technique (occidental) en Afrique. Il a donné des conférences dans de nombreuses universités dont Columbia University, State University of New York at Buffalo, University of New Mexico, l’Université de Yaoundé et Case Western Reserve University. Il termine actuellement un ouvrage sur Mongo Beti ainsi qu’un numéro spécial de la revue Présence francophone sur les mythologies postcoloniales.
Notes
-
[1]
Édouard Glissant, Discours antillais, 1981, p. 110.
-
[2]
Ibid., p. 391.
-
[3]
Ibid., p. 246.
-
[4]
Mongo Beti, L’histoire du fou, 1994, p. 48.
-
[5]
Ibid., p. 26.
-
[6]
Mongo Beti, Ville cruelle, 1954, p. 176.
-
[7]
Mongo Beti, La France contre l’Afrique, 1993, p. 12.
-
[8]
Mongo Beti, Ville cruelle, op. cit., p. 177.
-
[9]
Mongo Beti, Perpétue ou l’habitude du malheur, 1978, p. 273.
-
[10]
Mongo Beti, La ruine presque cocasse d’un polichinelle, 1979, p. 60.
-
[11]
Ibid., p. 156.
-
[12]
Ibid., p. 79-80.
-
[13]
Ibid., p. 145.
-
[14]
Ibid., p. 93.
-
[15]
Ibid., p. 95.
-
[16]
Mongo Beti, Ville cruelle, op. cit., p. 48.
-
[17]
Jean Roger Essomba, Le dernier gardien de l’arbre, 1998, p. 29.
-
[18]
Ibid., p. 31.
-
[19]
Ibid., p. 33.
-
[20]
Id.
-
[21]
Édouard Glissant, Poétique de la relation, 1990, p. 24.
-
[22]
Jean Roger Essomba, Le dernier gardien, op. cit., p. 33.
-
[23]
Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, 1999, p. 33.
-
[24]
Jean Roger Essomba, Le dernier gardien, op. cit., p. 33-34.
-
[25]
Ibid., p. 34.
-
[26]
Ibid., p. 62.
-
[27]
Ibid., p. 66.
-
[28]
Ibid., p. 116.
-
[29]
Ibid., p. 67.
-
[30]
Ibid., p. 115-116.
-
[31]
Ibid., p. 75.
-
[32]
Ibid., p. 87.
-
[33]
Ibid., p. 90-91.
-
[34]
Ibid., p. 118.
-
[35]
Ibid., p. 122.
-
[36]
Id.
-
[37]
Ibid., p. 134.
-
[38]
Maryse Condé, Ségou. La terre en miettes, 1984-1985, vol. I, p. 232.
-
[39]
Ibid., vol. I, p. 283.
-
[40]
Ibid., vol. II, p. 399.
-
[41]
Ibid., vol. II, p. 414.
-
[42]
Id.
-
[43]
Édouard Glissant, Discours antillais, op. cit., p. 135.
Références
- Beti, Mongo, La France contre l’Afrique, Paris, Maspero, 1993.
- — — —, La ruine presque cocasse d’un polichinelle, Paris, Éditions des peuples noirs, 1979.
- — — —, Le pauvre Christ de Bomba, Paris, Robert Laffont, 1956.
- — — —, L’histoire du fou, Paris, Julliard, 1994.
- — — —, Perpétue ou l’habitude du malheur, Paris, Buchet / Chastel, 1978.
- — — —, Remember Ruben, Paris, L’Harmattan, 1982.
- — — —, Ville cruelle, Paris, Présence africaine, 1954.
- Chamoiseau, Patrick, Écrire en pays dominé, Paris, Stock, 1999.
- Condé, Maryse, Ségou. La terre en miettes, Paris, Robert Laffont, 2 vol., 1985.
- Dantzig, Albert van, Forts and Castles of Ghana, Accra, Sedco, 1980.
- Essomba, Jean Roger, Le dernier gardien de l’arbre, Paris, Présence africaine, 1998.
- Glissant, Édouard, Discours antillais, Paris, Éditions du Seuil, 1981.
- — — —, Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990.
- Monenembo, Tierno, Les écailles du ciel, Paris, Éditions du Seuil, 1986.