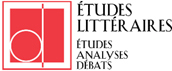Abstracts
Résumé
Mille eaux, le recueil de souvenirs d’enfance d’Émile Ollivier, montre de façon exceptionnelle qu’on ne revient pas indemne de l’étonnement haïtien. Inscrivant au coeur du texte, comme au coeur de son existence initiale, dans la thématique et dans l’écriture, les nombreuses failles qui ravinent les représentations du champ social haïtien, l’auteur se situe résolument dans un entre-deux des langues et des cultures qui fonde une solitude paradoxale : cette situation lui permet d’approcher au plus près et de nommer ces représentations, mais en même temps l’oblige à s’en détacher. Les figures marquantes de la séparation et de l’exil, de l’écart et de la marginalisation vont ainsi de pair avec celles de l’exubérance lyrique de la description, illustrée notamment par les images du flux et de l’écoulement traversé, celui des Mille eaux.
Abstract
Mille eaux, the collection of Émile Ollivier’s childhood memories, demonstrates exceptionally well that one does not shake off the commotion of Haiti without a scrape or two. In terms of theme and the handling of theme, the author inscribes, at the very centre of both the text and his first existence, the numerous fault lines running through representations of Haitian society. So doing, Ollivier resolutely locates himself in a no-man’s-(is)land between languages and cultures that is the basis of a paradoxical solitude : this locus is the scene of a “cleaving” in both, opposing senses of the word, wherein he is able to embrace and name these representations while having, simultaneously, to detach himself from them. The signature figures of separation and exile, of distance and marginalization, go hand-in-hand with the figures deriving from the lyrical exuberance of description, as illustrated in particular by the thousand waters of Mille eaux and its images of the movements of the tides and the outpassage.
Article body
La représentation littéraire et esthétique de la misère a toujours quelque chose d’obscène et de choquant, contre quoi la mauvaise foi n’a de cesse de se fabriquer des masques protecteurs. Parmi ceux-ci, une certaine élégance de la forme alliée à l’espoir des « révolutions » nous est devenue insupportable. On y perçoit trop souvent la reconstitution stéréotypée qui manque à dire finalement ce qu’elle ne considère uniquement que comme un objet[1].
De la compassion
Mais aussi, la représentation de la misère est devant nous, et nous ne pouvons la passer, car la misère réelle, vécue quotidiennement par des êtres autrement sans nom, ne saurait se réduire à un spectacle rassurant chacun, le littérateur comme les lecteurs. Notre souci est avant tout celui de comprendre ce qui n’a presque pas de nom, et quand nous l’oublions, nous passons devant ce spectacle, comme ces voyageurs indifférents, blasés même, surtout quand l’émotion leur est accordée en supplément. Michel Onfray rappelle ce que la compassion, dernière forme de l’intérêt porté sur les pauvres et néanmoins vieille lune occidentale, apporte comme faire-valoir :
L’humanisme des droits de l’homme agit sur le principe d’une machine à capter les énergies révolutionnaires pour les transformer en compassion, en sympathie, en condouloir et autres sentiments qui dispensent d’attenter à l’ordre du monde, auquel on doit pourtant la généalogie des misères sales[2].
Une communauté de qualité
Cette opération critique cependant ne s’achève pas là : la compréhension nous amène progressivement à entendre comment le monde est tissé par cette présence commune des uns et des autres. Voilà donc bien la tâche essentielle du généalogiste. Si l’on décide de changer le désordre du monde, c’est d’abord à partir de cette communauté de qualité, et par acte volontaire, que la décision est rendue possible. Il me semble que dans Mille eaux, ce récit de moments de son enfance, Ollivier parvient à dépasser l’échec vécu par Adrien Gorfoux, le personnage des Urnes scellées, qui n’arrivait plus à rentrer dans le temps local de la ville d’enfance, ville saturée de récits de vies et de morts, de violences et de fatalisme, toute barrée par une archéologie essentiellement factuelle. Ce sont quelques pistes autour de cette généalogie, des significations qu’elle désigne et des conséquences qu’elle entraîne, que je me propose d’explorer ici.
Dire la misère
Ce n’est pas la moindre qualité du très beau livre d’Émile Ollivier, de faire partager au lecteur l’émerveillement ressenti en face de cette découverte. Une découverte qui ne se décrit pas comme expérience brutale sur le mode de la révélation, mais au contraire comme lente maturation, venue du plus lointain de l’enfance, du plus obscur de nos histoires partagées. Déjà, de Mère-Solitude aux Urnes scellées, Émile Ollivier avait choisi les voies de la traversée des signes pour entretenir les liens : entre les tenants de l’espace haïtien, entre ceux-ci et ceux qui sont en dehors. Dépassant l’ordre du constat des raisons de la misère, il nous avait fait part de ses manifestations les plus aiguës, les plus concrètes, mais enfin les plus subtiles. La misère ne se révèle pas seulement dans la nudité de la pauvreté et ses manifestations les plus abjectes s’emparent sans aucun doute aussi des plis du discours. Un discours paradoxal, puisque si souvent bordé de silence. On se souvient des réflexions d’Adrien, au petit matin qui suit la veillée funèbre de Sam Soliman. Il observe ces paysans en route vers « un ailleurs improbable » : « Les femmes, majestueuses, vêtues de haillons aux couleurs de l’arc-en-ciel […] fredonnaient une longue plainte sans les paroles. Si elles avaient été prononcées, elles auraient donné la chair de poule[3]. » Et c’est sans doute pour dépasser cette horreur, que le narrateur, qui n’est déjà plus archéologue, mais un peu journaliste, comme Normand Malavy, s’adressant à lui-même dans un dédoublement qui vaut déjà comme mise à distance propice à l’action littéraire, se donne comme projet de renoncer aux légendes et d’écrire : « la saga de ces trimardeurs sauvages […], les vies minuscules de ces sans grades […] de leurs femmes-deuils […]. Tu décriras les péripéties des enfants […][4]. »
Éprouver les discours
Ne pas considérer ces êtres comme au centre des préoccupations littéraires haïtiennes revient enfin à rater son objet. Le texte de Mille eaux mène avec une rare rigueur cette exploration, en la rapportant à soi, ce qui en accentue encore la difficulté[5] : si c’est bien à partir d’une visée ethnographique — et non plus strictement archéologique — que se déploie le projet du narrateur, celle-ci s’empare rapidement de tous les champs qui tentent de décrire la place de l’être concerné par cette étude, c’est-à-dire lui-même. Dans une discrète spirale sont convoqués les modes d’approche et les langages des autres sciences de l’homme : la psychologie, la sociologie, l’histoire, la géographie, les sciences politiques et la philosophie, pour n’évoquer que celles qui sont les plus manifestes. Toutes ont pour objectif d’éclairer le lecteur sur le sens que l’autre perçoit de l’être au monde haïtien : « Curieux destin que celui de naître dans un tel pays. On reçoit en legs un singulier regard et un étrange rapport à la réalité[6]. » La gageure tenue par l’auteur est ainsi de se situer dans un entre-deux du langage et de la culture, entre le dire haïtien sur soi et le monde, et le dire de l’autre sur cette singularité si souvent considérée comme sauvage. C’est reconnaître combien la tâche est délicate et combien la définition d’un langage s’avère essentielle.
Scènes primitives
Ainsi de la psychologie : le texte s’ouvre sur l’évocation trouble de la scène primitive, le père observé de dos, le regard de la mère déjà perdu dans une léthargie qui ne cesse d’interroger l’enfant tout au long du récit. La folie de la mère — et l’on sait combien les figures de ce décalage provoqué par la folie féminine est un des socles majeurs de l’oeuvre de l’auteur — constitue un axe directeur de l’ouvrage. Folie est le terme rassurant qui à la fois retranche l’être concerné de la communauté et qui permet à ceux qui profèrent ce diagnostic de se rassurer. Mais le mot avancé l’est aussi dans un contexte qui permet d’en prendre la mesure, pour l’auteur :
À force de creuser, j’ai fini par en dégager une impression de plus en plus nette, de plus en plus claire. J’ai pu pénétrer ce que fut le mystère de cette vie hantée de démons qui ne l’avaient jamais lâchée ni à l’état de veille ni dans son sommeil. Elle disait que la société était un noeud de vipères et, où que tu mettes la main, tu te fais mordre. Quel abîme terrifiant, cette coupure entre le monde et elle ! Je me dis aujourd’hui qu’il est des plaies qui, pareilles à la lèpre, rongent l’âme, lentement. Jusqu’à présent, je ne m’en étais ouvert à personne[7].
L’opposition classique qui se manifeste ici entre l’ombre et la lumière, entre l’être isolé et le monde auquel pourtant il participe, nous invite à comprendre encore une fois de quelle manière l’auteur lui-même procède de la solitude qu’il explore.
Du côté du père : l’écriture
En face de cette solitude, celle du père, lui-même hanté par le désir de littérature et de carrière politique, semble se dessiner en contrepoint. Au père revient la part de la socialité, celle qui permet déjà de mettre en perspective le devenir du pays, et notamment la place grandissante de Duvalier. Socialité qui déborde d’Haïti, puisqu’elle se réfère à un homonyme français[8], l’académicien Émile Ollivier, dont Bergson prononça l’éloge funèbre. Oswald, le père de l’auteur, voit son existence littéralement possédée par cette présence, au point que le discours du père se révèle saturé par l’écriture de l’académicien ou par l’éloge prononcé par Bergson. Le discours imposé ici, comme une latence admirée et redoutée, toujours / déjà là, est celui de la phrase nombreuse et cadencée, propice à la récitation lyrique. D’emblée, l’expérience est cruciale pour l’auteur qui ne cesse de s’interroger sur cette présence, qui fait de la signification une construction lentement maturée. L’expérience de l’enfance est ici approchée au plus près :
Les mots, on les entend d’abord, on les répète sans trop savoir ce qu’ils veulent dire exactement ; et ensuite vient leur sens. Et, en même temps qu’on les comprend et les interprète, on découvre de quel fil est cousu le tissu profond des êtres et on découvre aussi toute la complexité du monde[9].
La langue est imposée comme seule médiatrice de l’expérience au monde. Et pourtant, elle connaît aussi des failles. Celles-ci sont perçues dès l’expérience primitive de l’écriture, tout entière déterminée par ce regard jaloux et si pesant des grands prédécesseurs, expérience indéfiniment réitérée, qui littéralement prend au corps :
Je date ma naissance à la vie d’écrivain de cet instant où, assis pieds ballants devant le bureau de mon père, sur cette chaise en acajou massif qui, compte tenu de ma taille, m’engloutissait, je dus rédiger une lettre de circonstance. J’avoue qu’aujourd’hui encore, installé à ma table de travail, il m’arrive de ressentir sinon la même panique, du moins un pincement au coeur que j’attribue, à tort ou à raison, à ce premier contact avec la langue comme appât, cette langue française à la fois écueil, refuge et tribune aux dimensions du monde. C’est elle qui donne à ma voix ce ton âpre, comme si ma propre musique, sur un autre clavier, ne peut se jouer que dans le registre du grave. J’écris d’une main tremblante, car je sais quelle violence sourde, retenue, bouillonne en moi. Et si l’écriture est si peu précise, c’est qu’elle hésite, encore aujourd’hui, à parler de cet enfant taciturne, petit corps noir aux pieds poudrés qui n’a cessé de marcher, d’errer depuis l’aube de sa vie[10].
Du côté de la mère : l’interdit
À l’instrumentalisation forcée et stéréotypée de l’écriture, le narrateur répond par une patiente appropriation. Contrainte par l’imposition et l’assignation extérieures, l’écriture se déploie néanmoins comme un espace illimité de liberté intérieure. D’autres expériences de l’écriture soulignent ce qui apparaît à cette conscience comme à la fois un désastre et un miracle : ainsi la lettre d’amour à Evita, la jeune bonne, est considérée comme marque de la double infamie : la première, celle d’adresser des mots d’amour à une domestique, la seconde de les lui adresser par l’écriture.
Sans relâche, l’auteur s’attache à débusquer les interdits, les répressions de diverses natures qui contraignent la parole, gravée la plupart du temps à coups de rigoise, de mépris et d’humiliation. D’où le long chemin parcouru pour rencontrer les mots, non pas selon les rituels paternels, maternels et scolaires, mais avec la force de celui qui est entouré de solitude :
J’ai compris très tôt que les mots, gonflés de sève, marchent au-dessus de l’humanité. J’avais au fond découvert que les mots avaient une mission : ils devaient nous apprendre à vivre. Alors, je les pistai, je les traquai, et, sur ce chemin, j’entendis le bruissement des pas d’immenses tribus qui m’avaient précédé et je me réjouissais, en secret, d’avoir cette foule innombrable d’amis. Je savais que je poursuivrais ma conversation avec eux et que je disposais pour le faire de l’infini de l’espace et de l’infini du temps[11].
Cette expérience maturée dit mieux que beaucoup d’autres comment est transformée l’extériorité de la langue en langage du dedans, pour reprendre la formule de Véronique Bonnet[12]. Écrire, pour Émile Ollivier, pour Milo, dont on devine qu’il a été le diminutif de son prénom, s’ouvre sur une hésitation à entrer dans ces Mille eaux de l’existence et de la mémoire. Faut-il observer et analyser, c’est-à-dire maintenir une distance avec elles ? Faut-il, au contraire, y nager, et l’on se souvient ici de la grande remontée à contre-courant du dernier chapitre de Mère-Solitude ? Il ne s’agit pas là d’une réticence élégante, mais bien d’un questionnement récurrent : cette langue, le français, et ce discours, celui du père, parviennent-ils vraiment à dire ce qui doit l’être ?
Comment la mémoire assure-t-elle l’enchaînement du temps au-delà des ruptures qui en scandent les différents moments ? Y aurait-il une autre manière de comprendre qui ne soit pas qu’avec son corps ? Il y a des foules de choses qu’on ne comprend qu’avec son corps, sans trouver des mots pour le dire. Il y a des souvenirs qu’on ne sait pas dire[13].
La mémoire comme texte premier
Pour susciter ce passé disparu, les mots ne manquent pas, mais sans doute ils manquent à dire. La mémoire se réveille comme un palimpseste couvert de milliers de mots, mais ceux-ci ne parviennent pas à faire ressentir ce qui n’est plus. Ils sont comme des coquilles vides, séparés de l’exubérance du réel.
C’est que la rupture est en quelque sorte, elle aussi, fondatrice : si le père demande au fils de lui écrire, c’est qu’il est parti, comme le rappelle la seconde scène primitive racontée d’emblée, celle de la violente dispute entre les parents, à l’occasion de l’anniversaire d’Émile. Le récit d’Ollivier se construit ainsi comme un tissu ravaudé de ces séparations, de ces oppositions : si les parents se sont rencontrés, c’est à la faveur du procès intenté par la mère à sa propre famille, par exemple.
La faille
À y regarder de plus près, on s’aperçoit que la grande figure haïtienne de la faille traverse tout le texte. Une fissure familiale, comme on l’a relevé, mais qui touche aussi la famille étendue, celle des nombreux enfants engendrés par Oswald :
Mon père avait onze enfants, neuf filles, deux garçons ; j’étais le plus jeune de la bande. Aucun de nous n’avait la même mère, chose qui n’a rien de surprenant dans un pays où les hommes essaiment à tout vent avec un sens inné de l’irresponsabilité[14].
Or, cette famille ne se révèle à l’enfant que le jour de l’enterrement pour se perdre immédiatement dans le son « des pas traînants derrière le fourgon mortuaire, un bruit semblable à celui de la vague quand elle vient mourir sur une plage de galets ». Le lien familial est même articulé depuis la séparation, comme le reproche la mère, Madeleine : le père a pris toute l’affection d’Émile, et pourtant il est lui même désormais retranché des vivants, dissous, voué à la décomposition comme elle le décrit à l’enfant, désormais seul, à distance de sa mère. L’image est saisissante :
Elle aurait voulu que nous vivions comme si j’étais, moi, une île, elle, l’eau. Elle m’entourait d’un anneau de tendresse si étroit qu’elle aurait pu m’étouffer. Elle jetait sur moi ses larmes de souffrance, me changeant en tertre sur lequel elle construisait sa vie[15].
On entend ici un écho du leitmotiv de l’ouverture de Passages :« Il y a la mer, il y a l’île. » Fissure sociale, également rappelée dans les déménagements incessants de Madeleine. Il s’agit pour elle de reconstituer sans cesse cette île quasi déserte, malgré la promiscuité, malgré la présence des autres dans les lakou, notamment. De nombreux personnages témoignent eux aussi de cette coupure, qui les entraîne vers l’ailleurs. Tel l’officier, qui s’évade par les images cinématographiques, tels les frères jumeaux du chemin des Dalles, retranchés de la communauté par leur manière de vivre, telle les tantes de la Croix des Bouquets qui vivent hors du temps, ou Madame Gano, accusée de dévorer la cervelle des enfants. Mais les figures les plus marquantes de cette séparation, demeurent celles des exilés. Ainsi la tante Aricie, partie, « évadée de la prison que l’île constituait à ses yeux, [ayant] déserté comme un soldat fatigué de mener une guerre absurde. Avait-elle laissé derrière elle des lambeaux d’elle-même[16] ? »
L’énigme de la solitude
Toute la question des traces invisibles du passé se concentre dans la figure étrange de l’Allemand. Il n’a plus de nom, il ne parle pas, n’a pas de famille, commande son cercueil de son vivant. L’expérience de la solitude dont sa présence témoigne est exemplaire : il est à la fois seul, mais hanté d’absences ; à la fois isolé, mais désigné par la communauté dans laquelle il s’est installé. La fêlure le transperce au plus profond du regard : « Le désespoir qui habitait ses yeux ressemblait à l’honneur qui aurait perdu jusqu’à son ombre[17]. »
La fissure historique
Fissure historique enfin, initiale, marquée par la présence d’un emblème à la fois révéré, et en même temps dénié : celui de l’empereur Dessalines sur le Champ de Mars. Réitérant le discours historique de l’exclusion, Ollivier rappelle qu’il procède d’une interprétation rapace et héritière de l’économie plantationnaire qui a fini par recouvrir tous les plis du discours, justement : le deuxième temps de la révolution des origines a procédé d’une exclusion, celle des pères : « Et ceux dont les pères sont en Afrique, ils n’auront donc rien ! », s’exclame le Dessalines que retrouve l’auteur dans l’espace-temps topologique des souvenirs. L’ambiguïté fondatrice de la légitimation du Marron et de son exclusion s’inscrit au coeur du projet de reconstruction et de compréhension de l’enfance que mène l’auteur. Par cette exclusion, on s’en souvient, tout un pan de la société haïtienne a fait le choix de l’autre, le choix de procédures d’acculturation qui inscrivent la marginalisation au coeur de la société. Le sentiment de solitude en est le témoignage le plus prégnant, et le « roman familial » dont l’auteur tente de rapporter des bribes n’en constitue pas la part la moins douloureuse.
La première solitude est imposée par la dépossession et par la misère qui en est la conséquence. Cette pauvreté se manifeste dans le texte par les multiples déménagements de Madeleine qui hypothèque les propriétés héritées avant de les perdre. Elle se manifeste ensuite par l’évocation rapide des contraintes imposées par le manque d’argent, notamment le manque de place. Les corps sont enfermés dans des espaces réduits, nocturnes, propices à la répétition des mêmes reproches.
La mémoire retrouve le souvenir
C’est seulement lorsque l’enfant sort de cet enfermement que la parole redevient lyrique. L’image du paradis alors resurgit, mais un paradis des sens, un paradis dans lequel le corps caresse enfin la présence du monde en s’y laissant caresser :
Je n’avais qu’à me couler dans l’exubérance paranoïde de la faune et de la flore, au mirage des couleurs coruscantes où la vie puise sa fête ; de l’aube au crépuscule, à l’ombre des arbres parasols, aire vibrante de chants de cigales ou sous les lampadaires, au millieu du virevoltement des lucioles, des papillons et des bêtes de pluie, le vieux vent caraïbe apportait en provenance de la Plaine, le son des tambours, rappel énergique des rivages perdus[18].
La fluidité des mille eaux du monde intervient comme le leitmotiv du texte, mais aussi comme le contrepoint des discours courant sur Haïti. Il se passe en effet dans le texte d’Ollivier comme une tentative d’acculturation nouvelle, qui consiste à apprivoiser et à s’approprier ces discours des autres et à se refonder, à se désaltérer. Ainsi, l’inscription géographique de l’île est réactualisée, mettant en scène les différentes figures de cette présence, bien évidemment inscrite, elle aussi, dans la généalogie haïtienne :
Toutes les histoires du monde sont venues échouer sur le côté de cette île, à la mâchoire de caïman endormi : galions remplis d’or et d’émeraude, navires aux cales chargées de princes bantous, fausses Indes de l’Ouest, anthologie de paysages, encyclopédies de jungles, survivance de peaux cuivrées, créoles, une seule humanité aux prises avec la chaleur des Tropiques et les rivages méphistophéliques du temps[19].
Présence d’Haïti
Découverte bouleversante : à partir d’une commande presque banale de récits d’enfance, émile Ollivier retrouve Milo et avec lui, sinon par lui, et peut-être aussi pour lui, il déchiffre le texte toujours / déjà là qui fonde l’espace géographique de la présence d’Haïti :
[…] ces entrelacs de récits boiteux et tronqués au fil desquels je m’échine à rétablir une cohérence de façade alors que je mesure à chaque pas combien ma vie est soumise au seul principe du hasard[20].
On peut traduire autrement cette opposition, comme l’écrit le philosophe Miguel Benasayag, dans Le mythe de l’individu :
S’il existe des tragédies, s’il existe un pathos humain, c’est parce que toute Aufhebung, toute synthèse, toute bonne solution est impossible.
Dès lors, l’homme qui n’est pas réduit à l’unidimensionnalité de l’individu, existe à travers et malgré sa multiplicité. Être soi-même implique d’assumer ce que moi en tant qu’autre a fait dans le passé. Il n’y a d’unité dans l’individu qu’à travers et grâce à la mémoire[21].
Et cette mémoire, c’est la langue qui la porte. On se souvient des mots du personnage de Brigitte Kadmon, devenue Man-Hosange, après les funérailles d’Amédée ; ils témoignent contre cette maladie de la mort que portent en elles les économies développées :
Je veux vivre, prier, être enterrée dans ma langue. Ici, sous les reflets blafards des néons, à l’ombre des gratte-ciel de béton, d’acier et de verre, les gens ont quelque chose de triste qui laisse l’impression qu’ils sont au terme de leur vie. Là-bas, face à la mer, à marcher contre le vent, contre les brisants, on ressent un élan de vie, un désir de lutter. Rien. Vraiment rien[22].
La Croix-des-Bouquets : l’archipel des individus
De la mémoire resurgit ce que l’auteur lui-même considère comme la source[23] de cet espace-temps énigmatique, lors de l’été à la Croix-des-Bouquets. Une source ? Plutôt une ravine. Dans le même chapitre, des fils nombreux sont noués ensemble : les souvenirs enchanteurs d’une socialité d’un autre âge et d’un autre monde, mais qui témoignent de la solitude de femmes abandonnées, vieillies et repliées comme en dehors du temps ; l’anecdote terrible de « la bêtise d’un être qui pourtant en gouvernait des milliers d’autres », le meurtrier roi Henri Christophe, figure marquante s’il en est de la fondation d’Haïti ; la traversée nocturne du cimetière, marque initiatique de courage, dans la proximité avec les morts. Le noeud central est enfin déterminé par la compréhension de la folie maternelle qui à la fois témoigne et révèle cette béance que le narrateur se donne désormais pour tâche de « creuser[24] » et de communiquer à ses lecteurs.
Le mot d’étonnement me paraît caractériser le sentiment dont témoigne le narrateur dans sa traversée d’une intimité tissée par l’extériorité. Ainsi est rectifiée l’image de l’île-Milo entourée par la mer-Madeleine. Comme l’écrit encore Benasayag, empruntant le détour d’une image paradoxale, « si nous pouvons dire que les individus sont comme des îles dans la mer, ce n’est qu’en tant que les îles sont elles-mêmes des plis de la mer[25] ».
On ne revient pas indemne de l’étonnement haïtien
Ollivier, remontant les spirales temporelles et discursives, plie et déplie le texte où s’entremêlent les fils de la mémoire. En ne réduisant pas celle-ci au souvenir, il fait à son lecteur un don incomparable : il lui offre précisément ce qui se dérobe au souvenir et qui a été vécu en dehors du temps, qui n’aura pas été vécu au présent. La comparaison entre deux moments du texte permet d’éclairer ce paradoxe. Le premier concerne le retour à Martissant : Ollivier confronte les deux pans de la vision stéréoscopique, commune à l’espace littéraire haïtien. à l’exubérance de la faune et de la flore tropicale de l’enfance s’est substitué un paysage : « Poussière, mouches, chiens faméliques, mendiants et tout ce qui oscille entre ces espèces […][26]. » Le projet du narrateur était de « rebâtir l’enfance ». Projet impossible dans ces termes. On comparera ce passage à celui de l’échappée vers Jacmel, quelques pages plus loin. Même si la vision stéréoscopique tente d’annihiler le paysage retrouvé, même si la déraison des êtres et des lieux semble un instant pulvériser le regard, c’est en fait le choc devant la merveille qui l’emporte : « Jacmel est violemment beau[27]. » Dans cet effort pour dépasser un lieu commun littéraire, par une écriture qui caresse littéralement le texte mémoriel, Ollivier semble ainsi faire sien ce très vieil aphorisme rappelé par le rabbin Marc-Alain Ouaknin : « Si j’estime que le monde ne correspond pas à ce que dit le texte, c’est parce que je perçois mal le monde, et non parce que le texte est faux. » C’est, me semble-t-il, la démarche intellectuelle qui s’accomplit sous notre regard, une tentative menée pour approcher « les contradictions, le sens fondamental […] pertinemment caché, énigmatique[28] ». Par là aussi, ces histoires méritent enfin « d’être contées à ceux qui leur sont étrangers[29] ». Parce que l’étonnement est de fait partagé. Parce que cette entaille estampée sur le corps haïtien, pour reprendre les mots de Des Rosiers, nous concerne également :
La Caraïbe n’est pas en périphérie. Moderne, contemporaine, elle détermine depuis 1492 le destin de l’Amérique tout entière. Nous sommes tous des Caraïbes urbains. Le goût des guerres et des massacres, l’appétit de conquête, de pouvoir et d’exploitation ont d’abord ensanglanté cet archipel d’Amérique. Chacun soupçonne le tropisme secret et silencieux pour la mort, l’aimantation de tout un continent pour la violence[30].
Appendices
Note biographique
Yves Chemla
Yves Chemla est né en 1957 à Tunis (Tunisie), où il a passé son enfance. Il a ensuite vécu à Genève, puis à Paris où il a mené des études de lettres. En 1979, il devient, pour peu de temps, le secrétaire particulier et privé de Roland Barthes. Entre 1982 et 1984, il travaille à l’Institut français d’Haïti, à Port-au-Prince. Professeur de français dans un collège de Seine-Saint-Denis de 1986 à 1999, il collabore jusqu’en 1990 aux éditions du dictionnaire Le Robert comme rédacteur. En 1999, il obtient un doctorat de l’Université de Paris IV en soutenant une thèse — sous la direction de Jacques Chevrier — consacrée à La question de l’autre dans le roman haïtien contemporain. La même année, il est détaché au rectorat de l’académie de Créteil, dans la cellule académique chargée de l’organisation de la formation continue des personnels de l’éducation nationale. Depuis 1989, il est chargé de cours dans diverses universités : à Paris I, Paris V, à l’I.U.F.M. de Créteil, à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il publie régulièrement des articles et des notes de lecture dans la revue Notre librairie, mais aussi dans Conjonction, revue de l’Institut français d’Haïti, et Boutures (Port-au-Prince). Ses dernières publications sont consacrées à Émile Ollivier, Lyonel Trouillot, Louis-Philippe Dalembert, Édouard Glissant, Sven Linqvist, Alice Cherki. La version remaniée de La question de l’autre dans le roman haïtien contemporain a été publiée par Ibis Rouge en mars 2002.
Notes
-
[1]
Roland Barthes, Essais critiques, 1964. Maurice Blanchot, La communauté inavouable, 1983.
-
[2]
Michel Onfray, Politique du rebelle. Traité de résistance et d’insoumission, 1997, p. 176.
-
[3]
Émile Ollivier, Les urnes scellées, 1995, p. 229.
-
[4]
Ibid., p. 231.
-
[5]
Voir « Émile Ollivier : écrivain aux pieds poudrés », entretien avec Rodney Saint-Éloi, 2000, p. 5.
-
[6]
Émile Ollivier, Mille eaux, 1999, p. 47.
-
[7]
Ibid., p. 146.
-
[8]
Né en 1825, il fut le dernier premier ministre du Second Empire. Élu au septième fauteuil, précédemment celui de Lamartine, il manifesta à cette occasion une indépendance d’esprit qui lui valut de solides inimitiés, et ne put jamais prononcer son discours. C’est Bergson qui lui succéda.
-
[9]
Ibid., p. 61.
-
[10]
Ibid., p. 25.
-
[11]
Ibid., p. 160.
-
[12]
Véronique Bonnet, « Émile Ollivier, Mille eaux », 1999-2000, p. 168.
-
[13]
Émile Ollivier, Mille eaux, op. cit., p. 77.
-
[14]
Ibid., p. 37.
-
[15]
Ibid., p. 51.
-
[16]
Ibid., p. 153.
-
[17]
Ibid., p. 106.
-
[18]
Ibid., p. 101.
-
[19]
Ibid., p. 102.
-
[20]
Ibid., p. 98.
-
[21]
Miguel Benasayag, Le mythe de l’individu, 1998, p. 68.
-
[22]
Émile Ollivier, Passages, 1994, p. 229.
-
[23]
« Il m’arrive aujourd’hui de penser que dans ce théâtre minuscule, dans cette cour vouée à l’ordre féminin, j’ai connu les moments les plus significatifs de ma vie, comme s’ils contenaient tous les autres moments de ma vie » (Émile Ollivier, Mille eaux, op. cit., p. 141).
-
[24]
Ibid., p. 146.
-
[25]
Miguel Benasayag, Le mythe de l’individu, op. cit., p. 29.
-
[26]
Émile Ollivier, Mille eaux, op. cit., p. 122.
-
[27]
Ibid., p. 164.
-
[28]
Ibid., p. 100.
-
[29]
Ibid., p. 99.
-
[30]
Joël Des Rosiers, Théories caraïbes. Poétique du déracinement, 1996, p. 143.
Références
- Barthes, Roland, Essais critiques, Paris, Éditions du seuil, 1964.
- Benasayag, Miguel, Le mythe de l’individu, Paris, La découverte (Armillaire), 1998.
- Blanchot, Maurice, La communauté inavouable, Paris, Éditions de minuit, 1983.
- Bonnet, Véronique, « Émile Ollivier, Mille eaux », Notre librairie, n° 138-139 (septembre 1999-mars 2000), p. 168-169.
- Des Rosiers, Joël, Théories caraïbes. Poétique du déracinement, Montréal, Triptyque, 1996.
- Ollivier, Émile, Les urnes scellées, Paris, Albin Michel, 1995.
- — — —, Mille eaux, Paris, Gallimard (Haute enfance), 1999.
- — — —, Passages, Paris, Le serpent à plumes, 1994.
- Onfray, Michel, Politique du rebelle. Traité de résistance et d’insoumission, Paris, Grasset, 1997.
- Saint-Éloi, Rodney, « Émile Ollivier : écrivain aux pieds poudrés », Boutures, vol. I, n° 2 (février 2000), p. 4-7.