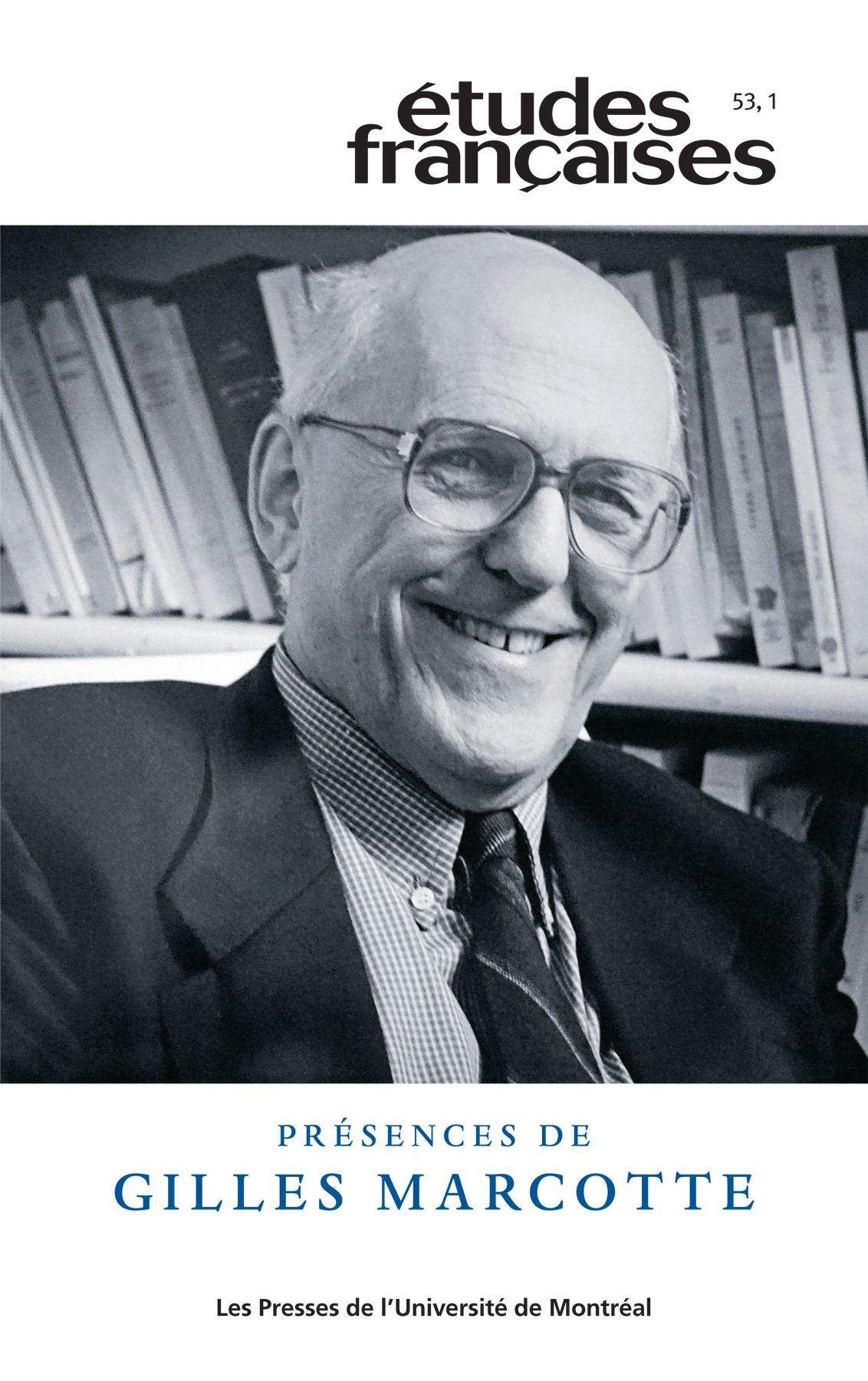Article body
On sait que Gilles Marcotte a été critique. Journaliste au Devoir et à La Presse, chroniqueur à L’Actualité, collaborateur de revues – notamment Les Écrits du Canada français, Cité libre, Liberté, Études françaises –, essayiste – Une littérature qui se fait, en 1962, a durablement défini le discours sur la littérature québécoise –, il s’est imposé, dès les années cinquante, comme le critique littéraire auquel chacun devait se reporter. Très jeune, il a joui d’une autorité manifeste. Le compte rendu d’un roman ou d’un recueil de poèmes par Gilles Marcotte dans Le Devoir ou La Presse du samedi, certains ne l’oubliaient pas aussitôt qu’ils l’avaient parcouru en prenant leur café. Ils sentaient qu’ils venaient de se mesurer, sur papier journal, à une pensée complexe et nuancée, qui n’esquivait pas les difficultés et qui était un moment dans une réflexion de longue haleine, développée tout au long de six décennies.
On sait aussi qu’il a été professeur, à l’Université de Montréal, où il a marqué des générations d’étudiants. Un cours de Gilles Marcotte – j’ai suivi celui qu’il a donné, en 1968, sur la poésie québécoise contemporaine – était une pensée à l’oeuvre ; je me souviens que nous nous imaginions fort bien connaître la poésie québécoise, mais nous avons vite mesuré les limites de notre petit savoir et compris que nous avions tout à apprendre de ce maître, en commençant par apprendre à lire un poème. Il a dirigé je ne sais combien de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat, dont plusieurs sont devenus des livres qui comptent. Il a apporté des contributions substantielles à la sociocritique, bien qu’il n’était pas trop porté sur la théorie littéraire, il a écrit un livre exceptionnel sur La Prose de Rimbaud, publié des articles savants – oui, savants. Il a dirigé de grands projets : une Anthologie de la littérature québécoise et le groupe de recherche « Montréal imaginaire ». Chacun sait cela, dont je ne rappelle rapidement que quelques faits saillants.
Mais on ignore, on oublie, on minimise l’écrivain que fut Gilles Marcotte, l’un des plus considérables de sa génération. Écartons un malentendu. Gilles Marcotte ne s’est pas fait écrivain, romancier en parallèle ou en sus d’être critique, essayiste ou chercheur universitaire. Écrivain, c’est-à-dire non seulement attentif à la langue mais faisant de la langue le lieu de sa pensée et de sa vie intérieure, il ne l’était pas moins dans un article de journal ou dans un essai critique que dans un roman ou une nouvelle. Il était écrivain naturellement, sans se départir de sa façon d’être coutumière, jusque dans sa correspondance et même dans sa conversation. Lorsque je l’entendais me dire « c’est un peu plus compliqué que ça », je savais qu’allait se déployer une pensée souvent imprévisible, portée par des phrases parfaitement construites, parfois drôles, un peu brusques ou même apparemment incongrues. Sans jamais se départir du ton de la conversation familière ; il ne parlait pas comme un livre, trop maître de la langue pour tomber dans ce travers de demi-savant.
On se fait généralement, de nos jours, une idée rudimentaire et partielle de la littérature, réduite à quelques genres actuellement canoniques – le roman, la poésie, le théâtre et une sorte de fourre-tout, souvent appelé essai ou prose, dans lequel on entasse tout écrit un peu remarquable qu’on ne peut ranger dans les genres conventionnels. Il y a bien des explications à cet état de fait, mais je ne me lancerai pas ici dans des considérations de théorie littéraire. Ce serait inutile. Cette conception restreinte de la littérature n’est qu’une convention, sans prise sur le commerce réel que nous entretenons avec les livres. Nous lisons sans nous en encombrer. Toute correspondance, par exemple, n’est pas littéraire, mais celle d’un écrivain s’incorpore à son oeuvre, dont elle devient une partie intégrante, parfois avec le statut ambigu d’une annexe essentiellement documentaire comme chez Baudelaire ou chez Proust, parfois en tant qu’oeuvre de plein droit comme chez Saint-Denys Garneau ou Jean Paulhan.
Gilles Marcotte n’écrivait pas autrement un article ou une nouvelle, un essai critique ou un roman : « À propos de mon étude sur Ducharme et Lautréamont, pour la revue Études françaises. J’ai réussi à me créer des difficultés. L’essentiel est acquis. Il ne me reste plus qu’à faire semblant de les résoudre[1]. » Cette note comporte une bonne dose d’humour et de modestie non feinte. Elle témoigne d’une attitude qui n’est pas celle du faiseur d’articles ni celle du chercheur soucieux de méthode et de cohérence théorique – mais Marcotte, faut-il le dire ? se souciait autant que quiconque de cohérence et de méthode lorsqu’il écrivait un essai. Elle n’exprime pas une saute d’humeur, c’est une constante de sa pensée, témoin cette autre note, quelques années plus tard : « Ce que c’est qu’un livre, un récit : tu creuses un trou sous tes propres pieds, et tu essaies de t’en extraire. »
Gilles Marcotte ne concevait pas autrement l’écriture d’un article critique et celle d’un récit. L’article, bien entendu, repose sur des lectures abondantes et présuppose un savoir qu’il mettra en oeuvre et transformera. Mais il s’agit toujours d’écrire, sans qu’il soit possible de prévoir à quoi l’écriture aboutira :
Je m’installe à ma table, ce matin, en doutant fortement que je puisse écrire les quelques lignes dont j’ai besoin. J’attends. Et cela vient, je ne sais d’où, peut-être de l’attente elle-même, de ce réduit obscur où naissent les pensées et les mots qui leur conviennent.
S’installer à sa table, là où on a l’habitude d’écrire – écrire est aussi une habitude, c’est-à-dire une discipline –, sans autre projet que celui d’écrire, et attendre, c’est se placer dans un état de disponibilité absolue, on dirait presque d’indifférence ou d’abandon. L’écriture ne répond fondamentalement à aucun autre projet qu’elle-même. Et si un autre projet existe, qui risquerait de faire obstacle, par exemple celui d’un article sur Ducharme et Lautréamont, la première démarche consiste à neutraliser celui-ci, à le circonscrire, un peu à l’écart de la conscience, en se créant « des difficultés » afin que puisse surgir, sans qu’on sache trop comment, « les pensées et les mots qui leur conviennent ». Je simplifie à l’excès, c’est un petit peu plus compliqué, aurait dit Marcotte, mais je tiens à faire comprendre la prise de risques dans le langage, qui définissait la littérature pour Gilles Marcotte, et qui est présente dans tous ses écrits. Bien des amateurs d’idées reçues ne comprenaient pas ou refusaient de comprendre qu’un article n’était pas moins risqué à ses yeux qu’un récit ou un poème. Il en avait conscience, et il a sans nul doute souffert de ce refus :
Rien n’est lu avec moins d’attention qu’un texte de critique, dans un journal ou un magazine. Quand je me corrige, quand j’apporte des nuances, quand j’essaie de trouver la formule juste, je travaille pour rien. Ou presque rien. Il faudrait que je manie la grande épée, la faucille, le marteau.
Cela ne revient pas à dire qu’il n’y a aucune différence entre un roman comme Retour à Coolbrook et les essais réunis dans Écrire à Montréal, entre ceux-ci et ceux de L’amateur de musique, entre tous ces livres et les notes sans ordre et sans apprêt, semble-t-il – semble-t-il –, qui forment Les livres et les jours. La littérature se ramifie en de multiples genres – bien plus nombreux et finement distincts les uns des autres que le quatuor roman-poésie-théâtre-essai –, qui entraînent des régimes de langage différents, mais il y a bel et bien un hiatus insurmontable entre la littérature et, disons, le reste : « L’oeuvre littéraire est trop incertaine des sens qu’elle livre pour se croire forte, apte à l’emporter dans la foire aux discours. » Je ne souhaite pas me livrer ici à des considérations théoriques sur la définition de la littérature. Je dirai seulement, pour ce que cela vaut, que la littérature se signale par une sorte de tremblement du langage, par une incertitude, par une prise de risques qui lui interdit de prétendre porter tout uniment une vérité aussitôt utilisable, transportable et traduisible, en opinions ou en actes, sans perte ni supplément. Un lecteur qui ne lit pas tout écrit comme un éditorial ou le mode d’emploi d’une cafetière sent immédiatement cette différence.
Revenons à cet article « sur Ducharme et Lautréamont » – plus précisément « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont », qui a paru dans Études françaises en 1990. Il est substantiel à tous égards : quarante et une pages serrées, ce qui est inusité pour un article même dans une revue universitaire, et on y apprend tant de choses sur Ducharme et Lautréamont que sa lecture – mieux que sa simple consultation comme un élément d’une bibliographie – est indispensable si on prétend travailler sur ces auteurs. Marcotte a travaillé avant de l’écrire, il s’est documenté – le mot est faible –, comme en témoignent d’abondantes notes : c’est un article savant. Mais ce savoir, réel, assumé, contrôlé, discuté plutôt que simplement allégué, fait l’objet d’un soupçon qui le met constamment à l’épreuve des textes : « Lisons, ne cessons pas de lire, de pratiquer cette lecture soupçonneuse, un peu maniaque, à laquelle on n’échappe pas quand on a parcouru les romans de Réjean Ducharme plus d’une fois. » Le savoir et le décorum professoral sont aussi mis à l’épreuve par des incongruités délibérées : « Par quelle perversion universitaire en viendrais-je à penser que… », « Donnons encore, en commençant, un os ou deux à la méfiance, au scepticisme », « Essayons autre chose », « Mais l’affaire n’est pas si simple ». On n’a pas l’habitude d’en lire dans un article savant. Elles ont pour fonction, me semble-t-il, d’enfoncer une aiguille dans le ballon du sérieux, du trop sérieux et du pompeux, qui pourraient donner l’illusion d’un savoir définitif et parfaitement assuré, réutilisable tel quel par qui voudrait produire – je ne dis pas écrire – un autre article sur Ducharme et Lautréamont. Gilles Marcotte n’oubliait jamais le risque et la précarité de l’écriture : « Qu’il s’agisse d’un compte rendu littéraire, de fiction, de considérations sur la musique ou de tout autre sujet, je ne sais pas ce que je vais dire si je ne l’ai pas écrit. » Ce n’est pas lire son oeuvre multiforme et diverse que de mettre à part les livres de « l’écrivain » – les romans, les nouvelles – et les textes du « critique » et du « professeur ». Écrivain, Gilles Marcotte l’a été dans chaque page qu’il a écrite, avec une discipline et un goût du risque dont il y a bien peu d’exemples :
Je n’ai rien à dire, vraiment. De tout ce que je croyais avoir à dire, de cette idée qui voltige dans ma tête depuis quelques jours, de l’observation que j’ai faite ce matin en me rendant à l’université et qui me semblait si intéressante, du sentiment que j’ai éprouvé devant telle personne, il ne reste rien. Tout est à faire, et l’écriture part de ce rien, de ce blanc (la page blanche…) pour tenter de fabriquer quelque chose qui n’aura avec les circonstances du monde que des rapports incertains.
Cet écrivain, si imposant qu’on a fini par ne plus le remarquer, reste à découvrir. Il suffit pour cela de le lire en se désencombrant l’esprit des idées reçues sur la littérature. Les écrivains sont ailleurs que ces idées voudraient qu’ils soient.
Appendices
Note biographique
Professeur émérite, Robert Melançon a enseigné au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal de 1972 à 2007. Il est essayiste (on lui doit entre autres Qu’est-ce qu’un classique québécois ?, Montréal, Fides, 2004 et Pour une poésie impure, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2015) et poète, auteur, entre autres, de Peinture aveugle, Montréal, VLB, 1979 ; L’avant-printemps à Montréal, Montréal, VLB, 1994 ; Le dessinateur, Montréal, Éditions du Noroît, 2001 ; Exercices de désoeuvrement, Montréal, Éditions du Noroît, 2002 ; Le paradis des apparences, Montréal, Éditions du Noroît, 2004 et du recueil Au petit matin écrit avec Jacques Brault (Montréal, L’Hexagone, 1993). La traduction du roman Le second rouleau d’A.-M. Klein (Montréal, Boréal), qu’il a signé avec Charlotte Melançon, a obtenu le prix du Gouverneur général en 1990.
Note
-
[1]
Gilles Marcotte, Les livres et les jours. 1983-2001, Boréal, coll. « Papiers collés », 2002. La plupart des citations sont tirées de cet ouvrage. Je ne le signalerai plus, et je n’indiquerai pas la pagination ; qu’on lise ce livre incomparable si on tient à les retrouver.