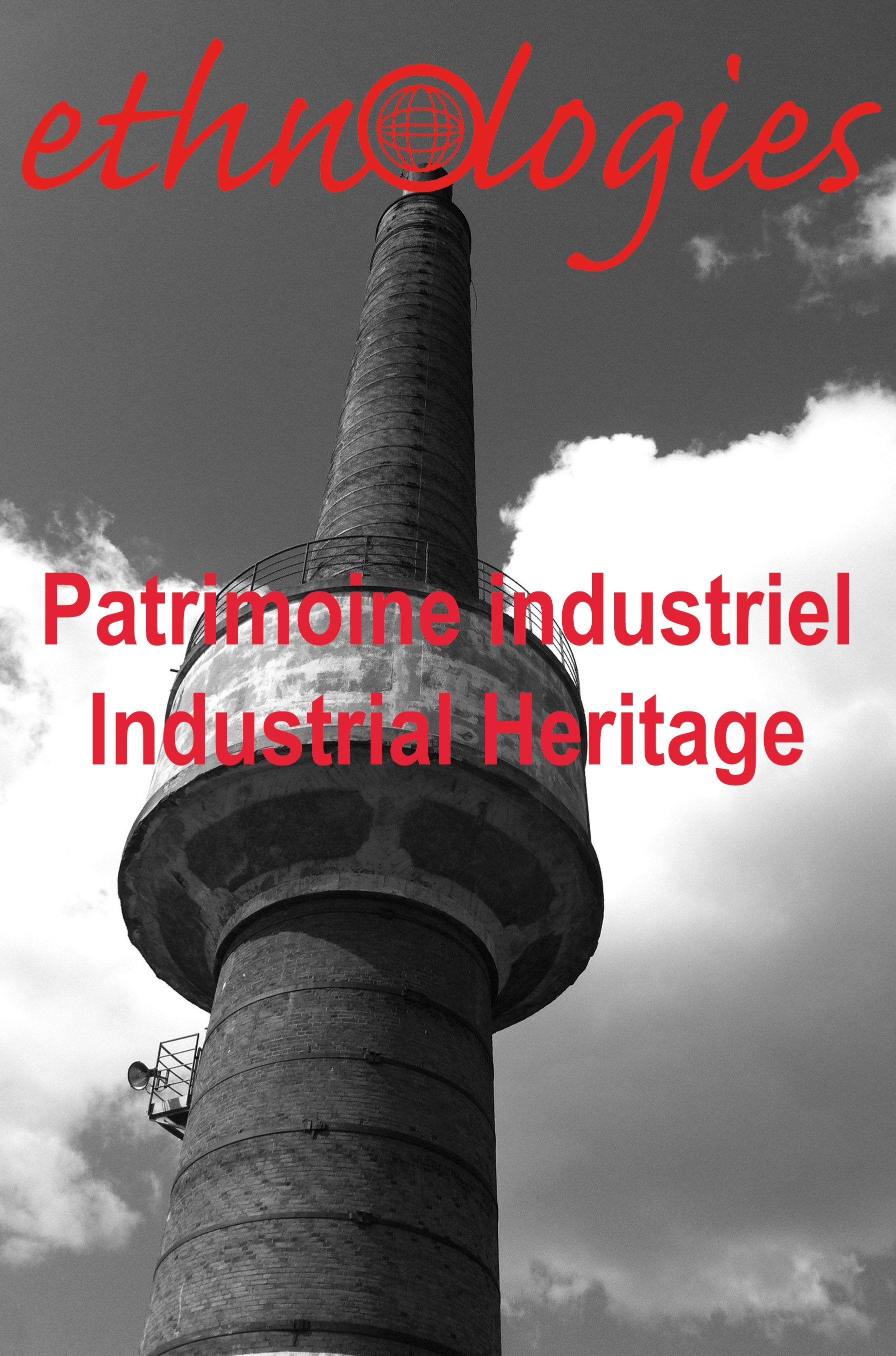Abstracts
Résumé
Parce que leur requalification rencontre nécessairement le problème du traitement des traces de l’activité disparue, les friches questionnent le rapport que la société entretient avec le patrimoine industriel. Scories à éliminer car portant la marque de l’archaïsme pour les politiques fordistes d’aménagement, les héritages de l’industrialisation ancienne sont devenus des atouts à exploiter pour se distinguer dans la concurrence territoriale généralisée qui prévaut depuis les années 1980. L’instrumentalisation opportuniste du décor industriel qui marque les opérations alors engagées, rencontre ses limites au tournant des années 2000. L’émergence d’une sensibilité au patrimoine industriel dans les territoires concernés, la montée des contraintes environnementales, signent l’épuisement des recettes éprouvées. La mobilisation des ressources académiques apparaît alors comme un palliatif de l’impuissance des aménageurs. Il en résulte un approfondissement sur le sens historique du legs qui dépasse les effets de la seule séduction du bâti et transforme le statut du patrimoine de plus value dérobée en argument d’aménagement. Les logiques de requalification restent cependant essentiellement économiques et ne se démarquent pas d’objectifs de revalorisation et de promotion territoriale imposés aux populations.
Abstract
Because the requalification of industrial wastelands is necessarily entangled with the challenge of dealing with traces of an obsolete activity, it questions the relationship that a society entertains with its industrial heritage. As slags to be eliminated because they bear the mark of the archaism of Fordist development policies, the heritage of industrialization from a bygone era have become assets to be exploited in order to stand out in the general competition between territories that has prevailed since the 1980s. The opportunistic instrumentaization of industrial landscapes which characterizes these operations met its limits at the turn of the 2000s. The emergence of an awareness to industrial heritage in the territories concerned with these tendencies and the rise of environmental constraints, led to the exhaustion of established methods. The mobilization of academic resources now appears to be a palliative for the incapacity of planners, and the result is a deepening of the historical sensitivity to industrial heritage, which goes beyond the effects of the mere seduction from the built environment, and transforms its status from the heritage of a stolen surplus value into a asset for development. The logic of this requalification, however, remains essentially economic and does not differ from the objectives of territorial upgrading and promotion imposed on the populations.
Article body
Le patrimoine industriel entretient avec la friche une forme de relation de nécessité. D’abord parce que l’émergence de cette nouvelle catégorie patrimoniale est née d’un déplacement du regard sur l’obsolescence dont la friche est pour partie une manifestation. Ensuite parce que ce changement de regard interroge les modalités de traitement des espaces en déshérence qui, par delà les questions strictement techniques d’aménagement, recouvrent des enjeux économiques et sociaux de développement des territoires et des choix politiques de gouvernement qui, les uns et les autres, sont tôt ou tard amenés à soulever la question patrimoniale.
C’est au Royaume-Uni, berceau de la Révolution industrielle et précocement touché par le déclassement de certains territoires, que l’on se soucia d’abord de préserver, dès les années 1950, les traces d’une histoire industrielle périmée (Edelblutte 2008 : 3-5). Dans le contexte du fordisme triomphant, le traitement des friches relevait alors de politiques nationales d’aménagement qui imposèrent ensuite la norme d’un aggiornamento modernisateur. Le basculement des économies dans une mise en concurrence globalisée à partir du milieu des années 1970, remet au premier plan le local et ses spécificités (Benko et Pecqueur 2001 : 10-17). Dans cette perspective, la recherche de la distinction territoriale devient un pivot des stratégies de développement qui conduit à privilégier la dimension qualitative des aménagements dans les dispositifs d’adaptation des lieux à d’autres usages, qui n’incluent pas nécessairement la démolition. Les ressources puisées dans l’héritage architectural et l’imaginaire historique qui y est associé sont alors mobilisées à cet effet, conduisant de facto à une valorisation de celui-ci. Au tournant du XXIe siècle, la recette, devenue banale, montre les limites de son efficacité. S’impose alors un approfondissement de la réflexion sur l’héritage pour en explorer le sens et l’utilité.
On voit donc se dessiner ainsi trois temps de l’aménagement de la friche industrielle dans son rapport à la patrimonialisation. Ce sont ces trois temps que se propose d’analyser la présente contribution en s’appuyant sur l’examen des opérations conduites dans le bassin stéphanois depuis les années 1960, élargie à la sollicitation d’exemples observés dans la région de Swansea (Pays de Galles, Royaume-Uni). Enquêtes de terrain à base d’entretiens et investigations en archives conduites dans le cadre de diverses opérations de recherche[1] sont au principe de la constitution du matériel sur lequel s’appuie cette analyse. La question de recherche posée porte donc sur la place du patrimoine dans le réaménagement des friches industrielles en questionnant les processus et le rôle qui y est donné à la valorisation de celui-ci.
La modernisation fonctionnaliste et la conservation par défaut
De la ville fantôme désertée suite à l’épuisement de la ressource qui avait suscité sa création, à l’abandon d’installations par fermeture de l’entreprise qui les avait construites, la déshérence des territoires industriels est presque aussi ancienne que l’industrialisation elle-même. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le phénomène reste toutefois ponctuel et le recyclage de ces espaces est laissé aux dynamiques du marché. Ainsi en 1889, la faillite de la Compagnie des Fonderies et Forges de Terrenoire, La Voulte et Bessèges, laisse exsangue la petite ville de Terrenoire, à l’est de Saint-Étienne avec 35 hectares de terrains et de bâtiments sans affectation, mais après leur rachat en 1890 par deux négociants lyonnais qui les revendent ensuite par lots, ils sont à nouveaux entièrement occupés par des activités industrielles au seuil du XXe siècle.
C’est au Royaume-Uni, au début de la seconde moitié du XXe siècle, que se mettent en place les premières politiques coordonnées nationalement de traitement de ce qu’en 1966 John Rudolph Oxenham qualifie de « derelict land », terre négligée ou rendue inutilisable, et que Jean Rossano (1967 : 600), à la suite de Philippe Pinchemel, propose de traduire en français par « friches industrielles ». Celles-ci font l’objet d’un suivi régulier dès les années 1950 dans la perspective de récupérer de l’espace pour accueillir de nouvelles activités ou du logement afin de soulager la pression foncière pesant sur l’espace agricole. L’opportunité d’y trouver également des espaces récréatifs dans des régions souvent densément occupées oriente leur réhabilitation dans le sens d’une renaturation et d’une priorité donnée à l’enjeu paysager. Effacer les stigmates de l’industrie pour donner aux populations un cadre de vie gratifiant, s’affirme comme l’objectif premier de ces opérations d’aménagement.
En 1961 est ainsi constituée une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l’université de Swansea afin de préparer la réhabilitation paysagère de la basse vallée de la Tawe au nord-est de la ville. Là, sur 320 hectares se développe alors le long de la rivière « un véritable cimetière industriel » (Rossano 1968 : 477-479) de ce qui fut le centre mondial de production du cuivre jusqu’à la fin du XIXe siècle, industrie relayée ensuite par la production de fer blanc. Après la Première Guerre mondiale, la ferblanterie fut progressivement tuée par l’intégration de l’étamage aux laminoirs en Amérique du Nord si bien qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le site n’est plus qu’un champ de ruines et de déchets qui sert, entre autres, de terrain de manoeuvre aux réservistes de l’armée britannique. Le « Lower Swansea valley project » (Projet pour la basse vallée de Swansea) issu de la recherche lancée en 1961 s’inscrit donc exclusivement dans une perspective de verdissement du site, étudiant les possibilités de reconquête par la végétation sans prendre en considération une quelconque préservation des traces de l’activité industrielle.
Dans le même temps, en France, le bassin stéphanois est confronté à une première expérience de reconversion massive d’espaces industriels abandonnés avec le repli programmé de l’activité minière. Amorcé dès 1960, avec le plan Jeanneney, la diminution de la production de charbon dans le cadre d’une rationalisation de l’industrie houillère qui conduit à une réduction du nombre de sièges d’extraction, prend un tour plus radical en 1967, date à laquelle les Houillères engagent un processus de conversion de la main d’oeuvre, prélude à une fermeture du bassin alors prévue en 1975. Afin de préserver le niveau d’emploi global, la conversion de l’économie régionale en attirant de nouvelles industries, doit accompagner celle des mineurs. Pour ce faire, les Houillères s’engagent dans une politique de réutilisation de leurs installations abandonnées en les transformant en lotissements industriels. Elles aménagent ainsi près de 300 hectares de terrains délaissés selon des principes communs d’aménagement : à la différence de ce qui se passe à Swansea où l’objectif premier est la réhabilitation paysagère, la logique est ici exclusivement économique; les terrains aménagés ne peuvent avoir d’autre utilisation qu’industrielle, les bâtiments ne sont conservés que s’ils se prêtent à une réutilisation, sans égards pour d’autres qualités, et la méthode privilégiée est celle de la table rase pour livrer des plateaux nus aux futurs utilisateurs.
Dans ce contexte, on voit rapidement disparaître les traces de l’exploitation minière : les chevalements sont systématiquement abattus, les configurations spatiales sont bouleversées par le réaménagement des réseaux de circulation, seuls subsistent les terrils (appelés ici « crassiers ») les plus volumineux, des bâtiments administratifs et de logement (les « cités »), et tous ceux qui, situés dans les angles mort ou à la périphérie du domaine des Houillères, ont échappé à la vigilance des aménageurs ou qui, en raison de leurs potentialités de réutilisation, ont trouvé grâce à leurs yeux. Il faut attendre 1973 pour voir enfin une initiative de conservation volontaire avec la proposition des ingénieurs des mines de faire du dernier puits exploité à Saint-Étienne, le puits Couriot, un musée.
Ceci étant, cette frénésie destructrice, bien que parfois ressentie douloureusement, se développe avec l’assentiment, au moins tacite, de la société locale. Même s’il n’est pas premier dans l’ordre des motivations d’aménagement, l’enjeu d’image, comme à Swansea d’ailleurs, est un repère de l’action et les élites partagent largement le point de vue du géographe Jacques Schnetzler qui écrit en 1971 que la « fin de l’exploitation houillère est aussi une chance » qui permet « une modification dans un sens heureux de l’“image de marque” de l’agglomération stéphanoise »[2]. L’enjeu mémoriel et plus encore cognitif, n’est pas pour autant oublié; dans cette perspective historiens, géographes, architectes de l’université de Saint-Étienne entreprennent, à partir de 1974, un inventaire descriptif et photographique des installations minières afin de sauvegarder la mémoire d’un paysage et de rassembler des matériaux pour des recherches futures. Néanmoins, toute perspective conservatoire est d’emblée exclue car considérée comme implicitement illégitime parce que contraire aux objectifs poursuivis par les politiques de réaménagement. La seule réalisation issue de ces recherches est une exposition qui se tient 1979 à la Maison de la Culture de Saint-Étienne, « La mine dans le paysage stéphanois » (Gay 2012b : 14). Le déplacement du regard sur l’obsolescence, évoqué en introduction, ne s’est donc pas encore produit. Et au milieu des années 1980, le maire de Saint-Étienne élu en 1983, opposé à la muséification du site Couriot, « ne veut [toujours] pas de ces ferrailles[3] » contraires à sa vision modernisatrice de l’avenir de la ville.
Figure 1
Ce qui reste du « plâtre » (terme désignant les installations de surface dans le vocabulaire utilisé dans le bassin houiller de la Loire) du puits Saint-Joseph sur la zone industrielle de Molina La Chazotte à l’est de Saint-Étienne : le château d’eau qui masque partiellement le bâtiment des chaudières, à droite le bâtiment des ventilateurs et des bureaux sont actuellement occupés par une grande société de travaux publics qui a absorbé l’entreprise locale de maçonnerie qui en était le premier utilisateur
Réaction post-fordiste et patrimonialisation en trompe-l’oeil
Le projet modernisateur trouve toutefois ses limites avec la remise en question de la rationalité fordiste par le retournement de conjoncture qui s’amplifie au tournant des années 1980. Le « fordisme » entendu comme mode de régulation articulant production de masse et consommation de masse et envisagé ici à travers ses implications en termes d’aménagement regroupées dans les politiques dite d’« aménagement du territoire », voit son efficacité s’éroder et entre en crise au cours des années 1970. De notre point de vue, cela a deux conséquences : la multiplication brutale des défaillances d’entreprises et de la vacance de locaux industriels qui en découle d’une part, le retrait de l’État aménageur qui laisse les collectivités locales prendre en charge les opérations d’aménagement d’autre part. La friche devient alors un phénomène massif surtout dans les régions d’ancienne industrialisation. En 1985, le rapport Lacaze (1985 : 9-10) évalue leur superficie totale à 15 ou 20 000 hectares pour la France entière dont 10 000 pour la seule région du Nord Pas-de-Calais et 2300 en Lorraine; les 450 hectares recensés en Rhône-Alpes se concentrent dans une proportion de 44% dans le département de la Loire. Cette inflation quantitative se double d’une mutation qualitative : ce ne sont plus simplement des sites miniers en situation périphérique qui sont concernés mais, la crise touchant tous les secteurs d’activité, des usines enchâssées dans le tissu urbain voire, parfois, en position centrale. Le croisement de ce constat avec celui de la nécessité d’un dépassement du fonctionnalisme et des horizons locaux pour assurer une réutilisation des sites impose un renouvellement des conceptions de l’aménagement, car les enjeux d’attractivité et de distinction territoriale se substituent alors aux considérations portant sur la simple mise à niveau des infrastructures et l’adaptation aux besoins techniques des entreprises. La friche industrielle devient une question urbaine, moins pour des raisons élémentaires de localisation qu’en raison d’une évolution du rapport de l’économique à l’urbain remettant en cause les cloisonnements fonctionnalistes de l’espace qui séparaient l’usine de la ville et qui fait de l’ouverture des sites et de leur intégration dans le tissu urbain, un incontournable de leur aménagement (Blanc 1991 : 107).
Dans ce contexte, à côté de considérations pratiques attachées aux potentialités de réutilisation des lieux, se développe une approche plus qualitative sensible à l’esthétique des bâtiments valorisée comme atout territorial. Ainsi, en 1981, la ville de Saint-Chamond (15 km à l’est de Saint-Étienne, dans la vallée du Gier) acquiert à titre conservatoire les locaux de la teinturerie Gillet, à la suite de la disparition de l’entreprise de fabrication de cuves de fioul domestique qui y avait remplacé, en 1975, l’ancienne activité de teinture. Si les projets de réutilisation sont vagues et la volonté d’enrayer la dégradation du site est avancée comme première justification, la qualité architecturale des bâtiments et la valeur symbolique des lieux ne sont pas pour rien dans la décision. Sept ans plus tard, et la création d’une pépinière d’entreprises ayant permis entre temps une valorisation des locaux, « la réhabilitation de l’ensemble architectural [contribuant] à la sauvegarde du patrimoine industriel régional » est retenue par le bulletin municipal « Vivre ensemble à Saint-Chamond » de décembre 1988 comme l’un des trois acquis majeurs en matière d’urbanisme, de l’opération de réhabilitation de la friche industrielle. Celle-ci a cependant été modeste, n’a pas porté sur l’ensemble des locaux et a consisté principalement en des travaux de redistribution interne qui n’ont pas concerné l’extérieur des bâtiments. Même si elle débouche sur une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1994, la préservation de l’usine Gillet participe encore d’une forme de conservation par défaut où la justification patrimoniale n’est assumée qu’au titre d’une plus-value dérobée, sans qu’un travail de fond soit engagé sur la méthode et les modalités d’intervention.
D’une toute autre ampleur et signification sont les opérations engagées durant la même période sur des sites intra-urbains à Saint-Étienne. La ville est alors concernée par le défi représenté par la présence de deux friches d’importance en situation péricentrale : en bordure sud du centre-ville, près de 4 hectares de l’usine de velours Giron qui a cessé brutalement son activité entre 1975 et 1978, et, le long de ce qui est considéré comme l’avenue de prestige de la ville, le cours Fauriel, près de 6 hectares de Manufrance, emblème industriel dont la production d’armes et de cycles ainsi que les activités de vente par correspondance ont assuré la renommée de la ville au-delà des frontières nationales et qui baisse pavillon en 1985 au terme de huit années de rebondissements et de conflits sociaux. Les deux opérations sont méthodologiquement liées, la première, Giron, ayant servi de propédeutique à la seconde, Manufrance. Elles représentent l’importation sur le territoire stéphanois de techniques et de savoir-faire expérimentés ailleurs : la transformation en logements de la filature Le Blan dans le quartier des Moulins à Lille, initiée en 1978, celle de l’usine Blin & Blin à Elbeuf engagée à la fin des années 1970 ou celle de l’usine Motte-Bossut à Roubaix pour accueillir l’« Eurotéléport » et les Archives du monde du travail, entreprise dans la première moitié des années 1980. Les unes et les autres s’inspirent de la reconversion des « fronts d’eau » industrialo-portuaires qui se diffuse dans le monde anglo-saxon à partir de la fin des années 1950, où les constructions nouvelles qui sont le support d’un renouvellement des usages (activités tertiaires, logement, activités récréatives) n’excluent pas la conservation/réhabilitation de bâtiments emblématiques en raison de leur valeur symbolique et de leurs qualités architecturales (Chaline 1988 : 714).
Ce sont ces qualités qui sont au principe des opérations de requalification engagées dans le cadre de zones d’aménagement concertées (ZAC) en 1985 pour la friche Giron et en 1987 pour celle de Manufrance. La commission municipale d’urbanisme réunie le 17 novembre 1984, justifie ainsi le projet de ZAC portant sur la friche Giron, d’abord, par la volonté « de sauvegarder l’architecture correspondant à une époque […] de sauver un patrimoine architectural industriel ». L’argumentaire est plus ambigu en ce qui concerne Manufrance où certes le préambule du rapport de présentation souligne qu’il s’agit d’un « ensemble immobilier d’une qualité architecturale certaine, doublé d’une valeur de patrimoine culturel et d’un passé industriel et commercial prestigieux » mais où la « conservation et la mise en valeur d’un patrimoine architectural local » n’arrive qu’en sixième position parmi les justifications venant à l’appui du projet de ZAC présenté au Conseil municipal du 6 avril 1987, après l’invocation de la dynamique créée par l’opération, la diversité et la qualité des activités devant être installées, le renforcement espéré de la centralité, le développement du secteur tertiaire et la création d’emplois. L’argument économique passe clairement avant l’argument patrimonial. Mais surtout, la ZAC Manufrance est une ZAC privée confiée à la SARI (Société d’Administration et de réalisation d’Investissements, alors filiale de la Compagnie Générale des Eaux), l’aménageur de la Défense à Paris et de l’Eurotéléport à Roubaix, évidemment attentive à la rentabilité de l’affaire en appliquant des recettes éprouvées. L’intérêt pour l’architecture est donc subordonné aux impératifs économiques du projet d’aménagement et les façades des bâtiments s’en trouvent en de nombreux points altérées. D’une manière générale, et la remarque est aussi valable pour Giron où selon le Directeur de l’époque de la maîtrise d’ouvrage urbaine à la ville de Saint-Étienne, la réflexion patrimoniale qui était un sujet nouveau pour les praticiens, n’a pas été suffisamment approfondie[4]. On s’est donc contenté d’appliquer les modes véhiculées par un urbanisme « post-moderne » qui puise dans un stock d’objets et de codes censés matérialiser l’atmosphère d’une époque, des éléments de composition urbaine comme un accessoiriste fabrique un décor de cinéma. Il en résulte une réinterprétation les lieux à partir de stéréotypes préétablis dont le traitement de la friche Giron offre un exemple accompli. L’usine est requalifiée en « manufacture » (implicitement « royale ») et ce qui était initialement une aile devient façade affublée d’un porche monumental d’inspiration néo-classique qui voisine avec des choix « victoriens » dans l’aménagement de l’espace public ou l’aspect de certaines constructions nouvelles.
Figure 2
Légende : La façade de l’ex-usine Giron dénommée aujourd’hui « Parc Giron » sur la rue de la Richelandière à Saint-Étienne
Figure 3
Légende : Pont levant transformé en aire de pique-nique sur les docks réhabilités de Swansea
Tout cela compose un univers industriel de convention fort éloigné d’une restitution du sens historique de l’héritage. Surtout, sont soigneusement gommées les traces du monde du travail. À Giron comme à Manufrance, la destruction des ateliers couverts de sheds dont la silhouette est un symbole usuel de l’« usine », s’impose comme une évidence sans que soient apparemment réfléchies leurs potentialités de réutilisation (Gay 2012a : 25-27). C’est un héritage patronal, celui de la monumentalité industrielle qui est privilégié, même lorsqu’il fait référence à des modalités d’organisation de la production comme l’« usine à étages » édifiée par Étienne Mimard, le fondateur de Manufrance, sur un modèle taylorien importé des Etats-Unis, que l’on retrouve aussi dans le Lingotto[5] à Turin. En fait, la recherche de valeurs urbaines de représentation aisément intégrables à la valorisation marchande des lieux s’enlise dans une fascination des formes, déconnectée de leur histoire. Il en résulte une patrimonialisation en trompe-l’oeil qui souvent s’épuise dans l’artifice et la parodie à l’instar de ce que l’on peut observer dans les anciens docks réhabilités de Swansea.
Les chercheurs à la rescousse pour pallier l’impuissance des aménageurs
La gratuité de cette démarche s’impose alors de manière d’autant plus incontestable que dans le même temps se poursuivent, dans le bassin stéphanois, des destructions d’objets patrimoniaux à forte valeur cognitive, au mépris, par ailleurs, des mesures institutionnelles de protection prises à leur égard. Si la démolition, en 1994, dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine, de la halle des fours Bessemer de l’ancienne usine de Terrenoire, alors en instance d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, relève encore de la logique de la table rase qui a prévalu dans les réaménagements de sites miniers, l’affaire du puits Combélibert à Rive-de-Gier (1996-1999), officiellement protégé depuis 1995 comme l’un des deux derniers chevalements en bois subsistant en France, est cependant révélatrice du caractère de plus en plus insoutenable d’une telle politique associant abandon à la facilité et instrumentalisation opportuniste de l’héritage. Dans cette commune située à l’extrémité est du bassin stéphanois, un projet de démolition avancé par les Houillères pour sécuriser le site à moindre coût, comme elles y sont tenues dans le cadre de leur retrait définitif du territoire, rencontre une telle levée d’oppositions qu’il aboutit à un compromis : le chevalement est démonté pour être installé auprès d’une autre installation préservée dans ce qui ne parvient pas cependant à être autre chose qu’un petit musée « de rencontre ».
L’action du monde associatif et du monde de la recherche n’est évidemment pas pour rien dans ce revirement. Historiens locaux, universitaires, amateurs et techniciens du patrimoine se sont mobilisés pour la défense de ces vestiges mais il faut aussi noter le changement de posture des responsables politiques et de l’administration. Le maire de Rive-de-Gier, pourtant élu en 1993 sur un programme modernisateur synonyme d’effacement des traces du passé industriel, accepte de contribuer au sauvetage. Sans doute est-il sensible au fait que la reconnaissance de celui-ci n’est pas seulement une lubie passagère d’intellectuels et de passionnés, mais aussi un enjeu social émergeant. Le choc de la désindustrialisation s’éloignant, le temps de la colère et des luttes aussi, vient le temps de l’hommage qui réintègre la mémoire des hommes dans la célébration du monument. Selon le président d’une association de valorisation du patrimoine industriel, « ces vestiges sont un hommage à tous ceux qui ont fait de la vallée [du Gier] un fleuron de l’histoire industrielle du XIXe siècle ». Il ne s’agit évidemment que d’une pétition de principe dont les effets en termes d’appropriation par la population restent à construire. Par contre c’est la prise au mot de ces enjeux qui, à la fin des années 2000, mobilise des chercheurs en sciences humaines et sociales à Swansea, dans un réinvestissement de la basse vallée de la Tawe qui avait fait l’objet d’un traitement paysager dans les années 1970.
L’objectif est, d’abord, de reconnecter à une histoire industrielle dont ils sont les derniers acteurs, les immigrés de dernière génération, originaires d’Asie méridionale, très présents au sein de la population de la zone où ils ont remplacé les descendants des paysans gallois recrutés par l’industrie du cuivre. Un travail de valorisation fondé sur une véritable archéologie, la plupart des installations ayant été détruites et ensevelies, et des opérations de médiation à destination de la population, est entrepris dans un cadre académique. Dans ce contexte, la Ville de Swansea est interpellée sur l’importance historique du site et la nécessité d’en tenir compte dans les projets de reconquête commerciale qu’elle nourrit alors. Ceci étant, dans une situation économique difficile, les nombreuses contraintes du site (pollution des sols, présence de vestiges d’installations industrielles dorénavant protégés, enclavement) s’avèrent dissuasives pour de potentiels investisseurs. L’interpellation de l’Université est alors prise au mot et retournée en aubaine. La Ville lui demande une étude de réutilisation durable du site fondée sur la mixité des usages et centrée sur la valorisation du patrimoine industriel dans la perspective de s’en servir comme argument pour faire subventionner des travaux de remise en état[6]. Que, par le jeu des circonstances (l’opportunité de répondre à un appel à projet du gouvernement gallois sur le tourisme patrimonial), le processus se recentre en 2011 sur une mise en valeur touristique, ne doit pas en escamoter la signification principale : en s’imposant dans les stratégies de développement, la valeur patrimoniale place les aménageurs devant les limites de leurs compétences et change le rapport qu’ils entrÉtiennent avec le monde académique. Les chercheurs ne sont plus cantonnés à un rôle d’experts plus ou moins entendus ou de supplétifs chargés de la mise en oeuvre de solutions préétablies, mais acquièrent un statut d’acteurs à part entière et de force de proposition.
Une situation analogue produit des effets similaires à Rive-de-Gier où, en 2005, un tournant patrimonial déjà évoqué conduit à la mise à l’étude d’une ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager), transformée depuis en SPR (site patrimonial remarquable). Ainsi s’enclenche un processus de classification des paysages urbains, revêtu de l’autorité de l’expertise, qui produit un cadre intellectuel et réglementaire pour les opérations d’aménagement. Il s’applique naturellement à la requalification, dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain portant sur le centre-ville, d’une vaste zone de 27 hectares comportant près de 10 hectares de friches industrielles au sein desquelles se trouve une ancienne halle de laminoir, la halle « Couzon », répertoriée par Saint-Étienne Métropole comme bâtiment d’« intérêt patrimonial remarquable » (figure 5). La reconversion du lieu considérée comme nécessaire et prioritaire parce qu’associée à de forts enjeux d’image sur un site qui constitue l’entrée de la « métropole » de Saint-Étienne en venant de Lyon, se heurte toutefois à des contraintes qui ne permettent pas d’envisager des solutions puisées dans le répertoire éprouvé des aménageurs : les exigences de dépollution des sols limitent financièrement les possibilités de réutilisation et l’exposition au risque inondation exclut les activités accueillant du public.
Figure 4
Légende : Paysage actuel de la vallée de la Tawe à Swansea
Figure 5
Légende : Intérieur de la halle Couzon à Rive de Gier
L’impuissance des aménageurs croise alors l’intérêt d’un Groupement d’Intérêt Scientifique centré sur la requalification des friches industrielles et la pollution des sols et constitué par plusieurs institutions universitaires stéphanoises, à la recherche de « sites ateliers » pour le développement de ses activités[7]. Sur sa suggestion, il est chargé en 2015, par le maître d’ouvrage, la « métropole » de Saint-Étienne, d’une étude sur la mise en place d’une plateforme pluridisciplinaire de recherche et de transfert d’innovations sur le traitement de la pollution des sols et la reconquête des sites en déshérence. Le travail engagé dans ce cadre, par des architectes, sur les modalités d’installation matérielle de celle-ci, entend tirer parti des contraintes et singularités du bâtiment pour lui trouver un avenir lui permettant de renouer avec son histoire. Quel que soit le formalisme de la posture, elle témoigne cependant d’une recherche de cohérence dans les usages, portant la marque du « préalable académique » qui se démarque des logiques d’instrumentalisation du patrimoine pour en faire un argument d’aménagement. Reste cependant ouverte la question de la réalité de ces usages et de leur investissement par les attentes des habitants.
Conclusion
Au terme de cet exposé, il convient de ne pas se laisser abuser par son déroulé chronologique qui pourrait laisser croire à la réalité d’un processus vertueux d’apprentissage entraînant les requalifications de friches industrielles, de ténèbres fonctionnalistes indifférentes à l’héritage, à la lumière d’un horizon patrimonial éclairé par la recherche académique. Même si, depuis le début des années 2000, la valorisation patrimoniale est devenue un nouveau poncif d’aménagement, l’utilitarisme destructeur ou l’opportunisme falsificateur restent encore largement partagés, l’évolution des pratiques relevant davantage d’une adaptation aux circonstances que des effets d’un apprentissage méthodiquement capitalisé. Il en reste néanmoins que l’évolution du contexte, le basculement de la friche en problème urbain et en enjeu des politiques de développement local, ont entraîné une évolution du système d’acteurs qui se noue autour de la requalification. La sollicitation et l’autonomisation du monde académique relèvent de dispositifs qui se généralisent et dont les exemples analysés révèlent la logique : c’est l’épuisement des recettes d’aménagement en même temps que la complexification des situations avec l’obligation d’assumer le passif de l’héritage (pollution des sols, contraintes de localisation) qui rend nécessaire le retour réflexif apporté par la recherche académique.
Ceci étant, la vertu parfois affichée dans la collaboration des aménageurs avec le monde de la recherche, n’est pas désintéressée. L’enjeu reste de trouver une solution de recyclage à des infrastructures en déshérence afin de fournir une justification économique ou sociale à leur préservation. La requalification de friches n’est pas une fabrique gratuite de patrimoine mais reste, quelles qu’en soient les modalités de mise en oeuvre, une opération à finalité économique qui doit trouver les ressources de son fonctionnement. C’est aussi une opération politique destinée à faire de l’accommodement des traces une réponse aussi bien matérielle que symbolique à la désindustrialisation. Dans cette perspective, on ne peut que relever l’ambiguïté de la valorisation patrimoniale qui s’affirme dans les opérations de requalification : entre alibi mémoriel et atout de commercialisation, et par delà les effets indiscutables de la diffusion d’une obsession patrimoniale chez les acteurs de l’aménagement comme dans l’ensemble du corps social, elle est surtout révélatrice de l’affûtage des logiques entrepreneuriales de revalorisation et de promotion territoriale qui, depuis la fin des années 1970, travaillent ces politiques de réhabilitation, imposées plus que construites avec les populations.
Appendices
Notes
-
[1]
Il s’agit principalement des travaux préparatoires à une communication au colloque international « Le patrimoine industriel : nouvelles politiques urbaines et sens de la reconversion », tenu à Belfort en 2011, de la recherche EMIR (Élision Mais Inexorabilité du Risque : quelle résilience face à la pollution des sols dans les territoires industriels?) conduite dans le cadre du programme du Ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie, Risques Décision Territoires 2013 « La résilience des territoires face aux risques dans un contexte de nouvelles approche de gestion et de risques émergents », du projet ALARIC (À La Recherche de l’Incrémentation du Changement) sur le changement urbain, financé par le labex IMU de 2014 à 2017, du programme POPSU-Territoire « Rive de Gier en prospective. Une démarche contributive pour une transition réussie » (2018-2019) et de deux missions exploratoires à Swansea en 2011 et 2013.
-
[2]
Ce point de vue est exposé dans une communication sur « L’agglomération de Saint-Étienne après le charbon » lors d’un colloque sur les villes du Massif Central qui se tient à Saint-Étienne en novembre 1970 (Actes du colloque, Centre d’Études Foréziennes CIER-Structures Régionales : 341-351).
-
[3]
Témoignage du conservateur des musées de Saint-Étienne et du dernier directeur des Houillères cité par Jacques Roux in « Entre célébration et travail de deuil. La mine et les musées à Saint-Étienne (1889-1997) », Rapport de fin de recherche, Programme « Production, producteurs et enjeux contemporains de l’histoire locale », Direction du patrimoine, Mission du patrimoine ethnologique, Saint-Étienne, CRESAL-CNRS 1999.
-
[4]
Entretien S B, Directeur de l’aménagement et de la maîtrise d’ouvrage urbaine à la ville de Saint-Étienne, 7 juillet 2011.
-
[5]
Usine de montage automobile construite par FIAT entre 1916 et 1923.
-
[6]
Entretien avec H. M., responsable des stratégies immobilières à la ville de Swansea et entretien avec H. B., historien, professeur à l’université de Swansea 9 décembre 2011.
-
[7]
Il s’agit du GIS PILoT (Groupement d’intérêt scientifique redéploiement Post-Industriel Loire et Territoires urbains) créé en 2013 par l’université Jean Monnet Saint-Étienne, l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne.
Références
- Benko, Georges et Bernard Pecqueur, 2001, « Les ressources de territoires et les territoires de ressources ». Finisterra 36 (71) : 7-19.
- Blanc, Jean-Noël, 1991, « Les friches industrielles de l’économique à l’urbain ». Revue de géographie de Lyon 66 (2): 103-107.
- Chaline, Claude, 1988, « La reconversion des espaces fluvio-portuaires dans les grandes métropoles ». Annales de Géographie 97 (544) : 695-715.
- Edelblutte, Simon, 2008, « Paysages et territoires du patrimoine industriel au Royaume-Uni ». Revue Géographique de l’Est 48 (1-2), en ligne : http://rge.revues.org/1165.
- Gay, Georges, 2012a, « Que reste-t-il de l’argument patrimonial dans les espaces industriels reconvertis? Trois sites de l’agglomération stéphanoise vingt-cinq ans après : Gillet, Giron, Manufrance ». L’archéologie industrielle en France 60 : 24-31.
- Gay, Georges, 2012b, « L’impossible palimpseste industriel ». L’archéologie industrielle en France 61 : 11-19.
- Lacaze, Jean Paul (dir.), 1985, Les grandes friches industrielles. Paris, La Documentation française.
- Rossano, Jean, 1967, « Les « friches industrielles » en Grande-Bretagne, d’après J.R. Oxenham ». Annales de géographie 76 (417) : 599-602.
- Rossano, Jean, 1968, « Une enquête inter-disciplinaire sur les friches industrielles à Swansea (Pays de Galles) ». Annales de géographie 77 (422) : 476-479.
List of figures
Figure 1
Ce qui reste du « plâtre » (terme désignant les installations de surface dans le vocabulaire utilisé dans le bassin houiller de la Loire) du puits Saint-Joseph sur la zone industrielle de Molina La Chazotte à l’est de Saint-Étienne : le château d’eau qui masque partiellement le bâtiment des chaudières, à droite le bâtiment des ventilateurs et des bureaux sont actuellement occupés par une grande société de travaux publics qui a absorbé l’entreprise locale de maçonnerie qui en était le premier utilisateur
Figure 2
Légende : La façade de l’ex-usine Giron dénommée aujourd’hui « Parc Giron » sur la rue de la Richelandière à Saint-Étienne
Figure 3
Légende : Pont levant transformé en aire de pique-nique sur les docks réhabilités de Swansea
Figure 4
Légende : Paysage actuel de la vallée de la Tawe à Swansea
Figure 5
Légende : Intérieur de la halle Couzon à Rive de Gier