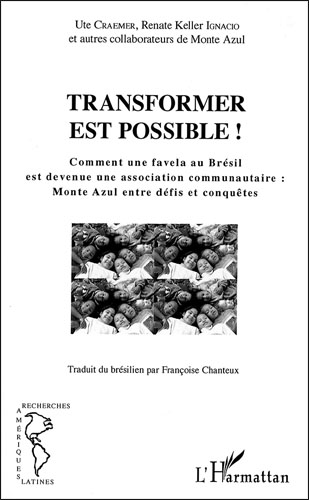Article body
Quand on pense Brésil les mêmes mots-clés viennent à l’esprit : samba, futebol (avec Pelé), Rio (le Sacré-Coeur et le Pain de sucre) et, bien sûr, favelas. C’est à une de ces dernières, à Belo-Horizonte, que je dois ma première invitation comme professeur invité, [2] en 1992. Celle dont il s’agit ici, Monte Azul, se trouve à São Paulo et donnera son nom à une association communautaire fondée en janvier 1979 à l’instigation d’Ute Creamer, une Allemande qui fut professeur de langues et traductrice avant de prendre pied à long terme dans un Brésil alors sous le joug d’une dictature militaire.
Évidemment, l’importance des favelas est fonction de la pauvreté dans un pays reconnu comme l’un des plus inégalitaires au monde (les progrès dans la lutte contre la pauvreté, réalisés lors des deux mandats de Lula, sont compromis par la crise politicoéconomique en vigueur depuis deux ans). Le soleil permet de survivre dans des abris de fortune s’avérant ainsi une condition nécessaire, mais non suffisante. Il faut aussi de l’eau. Comme le montre avec éloquence une photo, l’existence d’une source d’eau potable a servi d’attrait aux « damnés de la terre » venant des États du Nordeste, du Minas Gerais et du Paraná. Quand Ute Creamer y mit les pieds une première fois, elle fut accueillie dans un bourbier où les baraques, les unes sur les autres, n’étaient que des assemblages de bouts de bois séparés par de menus espaces déambulatoires servant à l’évacuation des égouts. Oui, tout était à faire. Le témoignage d’une résidante le révèle : « Dans ma baraque, il y avait deux portes : une par où l’eau entrait, l’autre par où l’eau sortait. Après une averse, il ne restait que de la boue, des morceaux de bois, des rats morts, les casseroles de la voisine. » L’histoire de Monte Azul commence par une question : as-tu quelque chose à donner ? Celle qui, effectivement, a beaucoup donné évoque un proverbe hindou : « Si tu as deux pains, garde l’un pour manger et donne l’autre : ainsi germera une fleur. » Personnellement, je préfère le proverbe chinois appris lors de mes études à l’Université Laval, au début des années 1960 : « Si tu me donnes un poisson, demain j’aurai encore faim. Si tu m’apprends à pêcher, je n’aurai plus jamais faim. » Alors, il vaut mieux montrer à faire du pain plutôt qu’en donner, mais encore faut-il aussi avoir la farine…
Le travail d’Ute Creamer a pris appui sur la pédagogie anthroposophique (la science de l’esprit attribuable à la pensée du Suisse Rodolf Sterner, 1861-1925) et sur une conception de la médecine également imprégnée d’anthroposophie. Le tout s’ajoutant à de solides convictions – basées sur des valeurs chrétiennes – va permettre le développement de Monte Azul. On peut lire que Sterner propose une étude approfondie de l’être humain, de la terre, de l’histoire du monde, du cosmos, basée sur le fait que tout organisme vivant possède aussi bien un aspect physique que matériel (…) qui est le monde psychospirituel. C’est ce qui va entretenir la flamme tout au long des années. À savoir : un ensemble de valeurs qui s’expriment à travers une mission et se concrétisent par des actions quotidiennes (p. 189).
L’ouvrage comprend 10 chapitres faisant appel parfois à divers intervenants. Les titres des chapitres et de leurs sections se veulent évocateurs, tels L’art social, Décider en groupes, Comment vivre avec la violence, Entre malheur et espérance, Le travail communautaire, La Participation.
Mais, au Brésil peut-être plus qu’ailleurs, la vie se situe bien loin d’un long fleuve tranquille ; c’est connu, les problèmes ne manquent pas. Tout lecteur un tant soit peu familier avec les problèmes du « communautaire », au Brésil comme ailleurs, va comprendre la pertinence de ceux soulignés ici. Ainsi, Keller Ignacio soulève la question liée aux entrées de fonds générées par diverses activités (ex. la fabrication de jouets) : « Quel sont les critères selon lesquels nous devons partager notre gâteau financier et verser les salaires ? » Un problème classique : toute association fait face au dilemme : augmenter les salaires ou investir de façon à mieux relever le défi de la concurrence. Et que dire du processus décisionnel ? En principe, toute association fonctionne sur la base d’un partage des décisions. Oui, il en faut, parfois, des réunions et encore des réunions pour prendre une décision qui n’exige qu’une heure pour une entreprise privée. Et, comme on dit au Québec : là où il y a des hommes, il y a de… l’hommerie. On comprend la pertinence d’une section intitulée Comment dépasser les conflits pour que la vie communautaire soit plus harmonieuse.
Le chapitre Comment vivre avec la violence m’a rappelé l’expérience vécue dans la favela Maré de Rio alors que mon entrevue fut interrompue par des… coups de feu. [3] Pour Monte Azul, une question s’est posée : que doit-on privilégier : la police ou le travail social ? La réponse n’a pas tardé, les animateurs étant convaincus que la culture facilite la diminution de la violence. Ainsi donc, on apprend aux enfants à connaître la culture de leur pays et celle d’autres pays, sans oublier, il va sans dire, le jeu, la méditation et… la prière.
Le chapitre sur le développement communautaire insiste sur le rôle du leader. Au Québec, au début des années 1980, l’expression développement local s’est substituée à développement communautaire, laquelle provient de l’américain community development pour désigner une stratégie des années 1960, à l’époque de Lyndon B. Johnson et de son projet Great Society. Or, il n’y a pas de développement local sans un leader fort. Ce fut la responsabilité de l’association de faire appel, non pas aux leaders qui se manifestent à travers la violence, mais à ceux qui acceptent d’agir pour le mieux-être de la communauté. Ce sont ces derniers qui contribuent à faire bouger les choses dans le sens souhaité.
Le témoignage d’un infirmier allemand arrivé sur place en 1992 est très éloquent alors que la situation – malgré le retour récent à la démocratie – était loin d’être reluisante. Qu’on en juge : il devint parrain d’un bébé dont les parents furent exécutés. Mais voilà, quelques années plus tard, le gamin devint un joyeux élève d’une école Waldorf en Allemagne. On en veut la preuve que « chaque être humain arrive à développer ses talents si on lui en donne l’occasion à son enfance » (p. 181).
Plusieurs photos et schémas couleur agrémentent un texte dont, ici et là, les longues descriptions empreintes d’une spiritualité à l’eau de rose parviennent à lasser. Par ailleurs, le lecteur ne peut retenir son admiration en présence de réalisations marquées du sceau de l’espérance.