Abstracts
Résumé
Cet article traite du roman Ourse bleue de Virginia Pésémapéo Bordeleau, premier roman en français au Québec écrit par une auteure autochtone, et de la quête identitaire de sa narratrice. Cette oeuvre a été traduite en anglais par Susan Ouriou et sa fille, Christelle Morelli. Une entrevue avec Ouriou permet de mettre en relief les particularités de ce projet de traduction, notamment celles qui ont trait à la traduction collaborative mère-fille.
Mots-clés :
- Pésémapéo Bordeleau,
- Ourse bleue,
- littérature autochtone,
- traduction,
- Susan Ouriou
Article body
Il y a quinze ans à peine paraissait le premier roman en français au Québec écrit par une auteure autochtone : Ourse bleue de Virginia Pésémapéo Bordeleau, aux Éditions de la Pleine Lune, à Montréal. Sa traduction anglaise, par Susan Ouriou et Christelle Morelli, est, quant à elle, toute récente : elle a en effet paru en 2019 sous le titre Blue Bear Woman, aux éditions Inanna, à Toronto. J’aimerais me pencher ici sur cette oeuvre et sa traduction, pour montrer notamment que les livres sont le fruit du travail patient, amoureux de femmes écrivaines, traductrices et éditrices. Sera abordée également la traduction collaborative mère-fille, puisque Christelle Morelli est la fille de Susan Ouriou.
Née à Rapides-des-Cèdres, en Abitibi, en 1951, Virginia Pésémapéo Bordeleau est la fille d’une mère crie et d’un père québécois ayant lui-même des origines algonquines. Elle a publié un recueil de poèmes, De rouge et de blanc (2012), et deux romans chez Mémoire d’encrier : L’amant du lac (2013), qui a été traduit par Ouriou (The Lover, the Lake, Freehand Books, 2021), et L’enfant hiver (2014), paru dans la traduction d’Ouriou et Morelli en 2017 (Winter Child, Freehand Books).
Pésémapéo Bordeleau est également peintre. Son oeuvre picturale s’entremêle d’ailleurs avec sa poésie, notamment dans un titre tel Ourse bleue – Piciskanâw mask iskwew (Éditions du Quartz, 2020), rétrospective de sa pratique artistique accompagnée de ses poèmes, dont plusieurs avaient paru dans De rouge et de blanc. Son roman L’amant du lac contient également des illustrations de l’auteure.
Ourse bleue est le premier titre publié de Pésémapéo Bordeleau. Dans ce roman, la narratrice Victoria entreprend une quête identitaire à l’occasion d’un voyage qu’elle effectue avec son compagnon Daniel à l’été 2004 à la baie James, par la route, ce qui inscrit l’oeuvre dans la longue liste des « romans de la route » nord-américains, comme le souligne David Laporte (2016 : 68). Tout comme l’auteure, Victoria est de mère crie, et de père québécois et algonquin. L’un des objectifs de son voyage est l’élucidation de la mort de son grand-oncle Georges, disparu en 1953 lors d’une expédition de chasse. Dans une série de rêves, Victoria est appelée à résoudre l’énigme de cette disparition. Le récit est entrecoupé de retours en arrière dans lesquels la narratrice revient de manière prenante sur certaines scènes de son enfance. Victoria prendra graduellement conscience du don de vision qu’elle possède, lequel lui a été conféré par l’esprit de l’Ourse bleue. Tomson Highway explique : « At first, Victoria resists the gift of shamanism that she was born with. Eventually, however – and with the help of a number of people and circumstances – she gives in. In doing so, she accepts the responsibility » (2017 : 75). En acceptant la responsabilité qui lui incombe de servir de médiatrice entre le monde des vivants et celui des esprits, Victoria entreprend un travail de reconnexion avec ses origines autochtones.
Une quête d’identité
Dans une étude portant sur Ourse bleue ainsi que sur La saga des Béothuks de Bernard Assiniwi, Marie-Hélène Jeannotte insiste sur la place accordée, dans les deux oeuvres, aux identités souvent métissées ou composites qui découlent des contacts entre les cultures autochtones et européennes (2010 : 299). Le personnage de Victoria, dans Ourse bleue, oscille entre son identité crie et blanche. Le voyage sur la terre de ses ancêtres cris et le ressouvenir de son enfance témoignent d’une « adhésion alternée » à ses deux identités. « La reconnaissance des deux identités simultanément ne se réalisera pleinement que dans la deuxième partie, alors que Victoria réalisera sa quête spirituelle » (306-307).
Comme le souligne Jeannotte, « le totem que se choisit Victoria illustre la réconciliation identitaire à l’oeuvre au sein du personnage : alliant la spiritualité amérindienne à la religion catholique, Victoria devient Ourse bleue, l’animal renvoyant au sacré autochtone, et la couleur bleue à la Vierge Marie[1] » (308). Cela constitue, comme l’écrit l’auteure elle-même, « une façon originale d’unir [ses] deux cultures » (Pésémapéo Bordeleau, 2007 : 176). Jeannotte relève en outre l’hétérolinguisme du texte, notamment les nombreux emprunts à la langue crie qui le parsèment, quelquefois sans être accompagnés d’une traduction, ce qui signale un renversement de « l’ordre usuel qui demanderait une version dans la langue majoritaire » (309).
Tomson Highway va plus loin, affirmant que la véritable langue d’écriture d’Ourse bleue est le cri et que le français serait déjà une langue de traduction :
The Cree language resonates throughout these pages. In a sense, even though it comes out in French, the novel is written in Cree. The Indigenous people portrayed are not enraged by colonization so much as they are beleaguered by it. Victoria does her best to help them heal. Her quest to lay her great-uncle’s spirit to rest is a metaphor for this healing. That she finds within herself the wisdom to love under any circumstances earns her her status as medicine woman. And that is the victory over colonization.
2017 : 76
Il met en relation de façon intéressante la spiritualité autochtone et la lutte contre le colonialisme, laquelle passe par une réappropriation et une remise en circulation, sous diverses formes, des langues autochtones.
Ourse bleue met également en forme le rapport fondamental au territoire qui anime les autochtones et leur littérature. Or, le pays jamésien où retourne Victoria en 2004 n’est plus celui de son enfance, car il a été profondément transformé en raison de la construction de barrages hydroélectriques par le gouvernement du Québec. Aux inondations des territoires ancestraux s’ajoutera bientôt une autre : celle qu’engendrera la dérivation imminente de la rivière Rupert, au bord de laquelle se rend Victoria lors de la dernière étape de son périple[2]. David Laporte souligne avec justesse que cette dernière étape « construite autour d’inondations imminentes prend toutes les allures de variations sur le mythe biblique du déluge » (2016 : 74). Il y a, dans ces bouleversements diluviens, quelque chose de l’ordre du grand nettoyage et d’une forme de recommencement, lequel est précisément souhaité par le personnage de Victoria à l’occasion de son voyage vers le pays natal.
Regard sur les traductrices
Susan Ouriou a traduit des oeuvres de fiction d’auteurs québécois, français, latino-américains et espagnols. Parmi les prix et distinctions qu’elle a obtenus, notons le Prix littéraire du Gouverneur général, en 2009, pour sa traduction d’un roman de Charlotte Gingras. Ouriou est également romancière, ainsi qu’interprète. Pendant de nombreuses années, elle a été traductrice et interprète lors de la résidence annuelle des Écrivains autochtones émergents, au Banff Centre, en Alberta. Elle a également servi d’interprète dans le cadre des travaux de la Commission de vérité et réconciliation, et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle vit à Calgary, tout comme sa fille Christelle Morelli, traductrice littéraire et enseignante dans une école francophone (où elle enseigne en français toutes les matières de la sixième année, en plus d’un cours d’anglais). Ouriou et Morelli ont traduit ensemble une douzaine de romans, d’essais et de livres pour enfants. Parmi les titres qu’elles ont traduits en collaboration, notons Stolen Sisters – The Story of Two Missing Girls, Their Families and How Canada Has Failed Indigenous Women d’Emmanuelle Walter (HarperCollins, 2015 ; traduction de Soeurs volées : enquête sur un féminicide au Canada, Lux éditeur, 2014).
Susan Ouriou a généreusement accepté de répondre à nos questions au sujet de sa collaboration avec Morelli et de la traduction vers l’anglais de livres de Pésémapéo Bordeleau[3]. Ouriou a rencontré cette dernière pour la première fois en 2009 lors d’une des résidences annuelles d’écrivains autochtones à Banff. L’anthologie de poèmes et de contes autochtones Languages of our land / Langues de notre terre, qui paraît en 2014 sous la direction d’Ouriou, contient la traduction anglaise, par Morelli, d’un long poème de Pésémapéo Bordeleau. Puis, c’est sur la recommandation d’Ouriou que l’éditeur Freehand Books publie en 2017 Winter Child, premier titre de cette auteure en traduction anglaise. Les éditrices Deborah Wilson et Kelsey Attard cherchent alors à faire traduire un autre livre d’elle. Comme le précise Ouriou :
Freehand avait beaucoup aimé l’expérience de publier Winter Child et nous avait donc demandé de traduire un autre livre de Virginia. Ourse bleue était le choix naturel puisqu’il s'agissait de son premier livre phare. Quand je leur ai proposé l’idée, les éditrices m’ont appris que les droits d’Ourse bleue appartenaient déjà à l’éditeur torontois Inanna.
Ouriou, 2022
Ouriou contacte alors Luciana Ricciutelli, éditrice d’Inanna[4], pour savoir si elle a déjà une traductrice pour Ourse bleue. Comme elle n’en a pas, Ouriou et Morelli ont eu « le grand plaisir de travailler sur Blue Bear Woman avec Luciana et Inanna » (Ouriou, 2022). Pour elles, le désir de traduire Ourse bleue tenait à la qualité du livre lui-même et à sa singularité du fait qu’il était le premier roman écrit par une autochtone en français.
Comme on l’imagine bien, la traduction collaborative mère-fille est d’un type particulier. Ouriou explique que Morelli et elle ont traduit le roman au complet chacune de son côté avant d’échanger leurs traductions. Elles ont noté ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, pour ensuite en discuter entre elles afin d’arriver à une entente. C’est Ouriou qui a préparé la version définitive en tenant compte de tous leurs commentaires :
Je crois que cette méthode ne marcherait pas pour la plupart des traducteurs car leurs premières versions risqueraient d’être trop différentes. Elle marchait pour nous car, dans notre cas, ce n’est pas juste la même langue maternelle que nous parlons, l’anglais, mais aussi, comme d’autres traducteurs qui travaillent à deux, la même langue « familiale ». Ainsi, nous avons à la fois la même façon de manier la langue dans laquelle nous traduisons et la même connaissance de la langue de l’original, le français, à savoir la langue paternelle de Christelle et la langue que j’ai adoptée en épousant mon mari.
Ouriou, 2022
À la fin de Blue Bear Woman, les traductrices remercient l’auteure d’avoir répondu à leurs questions (Pésémapéo Bordeleau, 2019 : 157). Ouriou adore travailler avec des auteurs contemporains justement parce que cela lui permet d’avoir ce genre d’échanges. Elle ne consulte cependant l’auteur qu’en fin de processus, car un grand nombre des questions qui surgissent au début trouvent leurs réponses dans le texte même, une fois qu’elle l’a mieux compris et qu’elle en a saisi le sous-texte, « qui fait partie de toute oeuvre littéraire » (Ouriou, 2022). Ce sous-texte est constitué du champ sémantique propre au livre à traduire, mais aussi de son réseau de significations contextuelles, symboliques et intertextuelles, de même que des émotions qui leur sont sous-jacentes. Concernant Ourse bleue, quelques questions des traductrices portaient sur certains mots cris (tels mistigouji ou mitâwiou) ou encore, vu le contexte du livre, sur le sens précis de certaines expressions.
L’auteure souhaitait quant à elle que son nom soit écrit sans accent – Pesemapeo. Ricciutelli était d’abord hésitante, car les accents se trouvaient dans le roman en français. Ce à quoi l’auteure a répondu qu’en cri, on écrit les noms sans accent et que c’étaient les institutions, telles que les écoles, qui en avaient modifié l’écriture. Au moment de la parution d’Ourse bleue, elle n’avait pas pensé à demander à son éditrice d’enlever les accents, mais elle voulait y remédier au moment de sa publication en traduction anglaise.
La traduction du français vers l’anglais d’oeuvres autochtones du Canada soulève des questions particulières sur lesquelles se sont penchées certaines chercheures, telle Lianne Moyes. À propos de sa traduction anglaise d’un texte de Nastasha Kanapé Fontaine, Moyes écrit : « Translating into English is always a gesture worth thinking about ». Elle ajoute : « [T]ranslating the work of an Indigenous writer from French to English in a colonial context such as Canada is even more worthy of pause » (Moyes, 2018 : 64). Elle souligne notamment l’importance de ne pas perdre de vue, en cours de traduction vers l’anglais, le rapport spécifique qu’entretient l’auteur dans le texte original avec la première langue coloniale, c’est-à-dire ici le français.
À cet égard, on observe, dans Blue Bear Woman, le souci qu’ont eu les traductrices de maintenir la présence du français tel qu’il se vit pour la narratrice dans sa quête d’identité, entre autres quand elle passe à la langue crie pour se faire reconnaître comme une des leurs par les Cris qu’elle croise lors de son périple (2007 : 63-68 ; 2019 : 39-43). Dans de tels passages, le français est clairement la langue coloniale. Aussi est-il particulièrement réussi, dans la version anglaise, de conserver le mot français « métissage » dans la phrase suivante : « My métissage suddenly sinks in » (2019 : 42).
On note en outre, en plusieurs endroits dans la traduction, une juxtaposition non pas seulement de deux langues comme dans l’original (le cri et français), mais de trois langues (le cri, le français et l’anglais). Par exemple, au début du roman, dans une scène remémorée de l’enfance de la narratrice, son père, tenant dans ses bras la petite dernière surnommée Sibi, s’écrie : « Sibi a encore creusé une autre rivière. » La narratrice poursuit : « Il l’a surnommée Rivière, car il prétend qu’elle pisse comme une rivière » (Pésémapéo Bordeleau, 2007 : 22). En version anglaise, le passage se lit comme suit : « He says, “Sibi’s unleashed a river again.” His nickname for her is “Rivière” because he claims she pees like one » (2019 : 6). Le lectorat de langue anglaise a donc accès ici à un petit lexique trilingue – sibi, river, rivière.
Ailleurs, certains mots sont conservés en français dans la traduction et sont suivis de leur équivalent anglais. On en observera un exemple dans l’extrait suivant : « I see a sign : Camping sauvage. I touch his arm and nod at the sign for wilderness camping » (2019 : 2). L’éditeur n’a pas remis en question ces choix, précise Ouriou. Pour les traductrices, il importait que le lecteur de la traduction sache bien situer l’action et reçoive les mêmes renseignements que le lecteur de l’original. Dans l’exemple cité, explique Ouriou, « les personnages se promènent au Québec où le panneau serait forcément en français. Nous l’avons donc laissé tel quel. Mais comme le fait de garder le français ne permet pas au lecteur de la traduction de comprendre de quoi il s’agit, alors le petit ajout “sign for wilderness camping” est venu combler cette lacune sans détonner » (Ouriou, 2022).
Rôle de la traduction dans les échanges entre auteurs autochtones
Sur la quatrième de couverture de Blue Bear Woman, on peut lire un commentaire critique élogieux de l’auteure autochtone Carol Rose GoldenEagle[5] à l’endroit de ce roman qu’il lui a été donné de lire en traduction anglaise grâce au travail d’Ouriou et Morelli. Ouriou aime beaucoup voir de telles critiques, par des auteures autochtones, de livres autochtones qu’elle a traduits car celles-ci sont très sensibles à la fois au contexte historique en général et au sous-texte propre à chaque oeuvre. Elle donne l’exemple de l’auteure autochtone Lindsay Nixon, qui a décrit Winter Child, dans la Montreal Review of Books, comme un chant de survie (« a song of survivance[6] ») face à « l’affect colonial » (Nixon, 2017).
Ouriou souligne à cet égard le cadre particulièrement riche et stimulant des résidences littéraires à Banff où des autochtones de partout au Canada se retrouvaient et échangeaient pendant deux semaines :
Étant là pour interpréter tous ces échanges et traduire tous ces écrits, je n’en revenais pas de la grande sagesse, de la grande souffrance et de la grande joie exprimées lors des séances, lesquelles se retrouvaient dans cette écriture autour de vérités et de vies qui avaient été si longtemps étouffées. Ce qui me motive surtout, c’est de participer enfin à leur diffusion.
Ouriou, 2022
Ouriou ajoute qu’elle a beaucoup apprécié, au cours de ces rencontres, d’être invitée à partager elle aussi ses impressions et ses émotions, comme les participants à la résidence, et donc de « faire partie du cercle » avec eux.
Lianne Moyes souligne quant à elle l’urgence de promouvoir la traduction des littératures autochtones, dans un contexte de financement des projets qui a privilégié jusqu’ici les débats entre Euro-Canadiens aux dépens de ceux entre peuples autochtones (Moyes, 2018 : 67). Elle cite Lacombe, MacFarlane et Andrews :
In a context in which English represents the dominant discourse and French is simultaneously celebrated by some and resented by others, Indigenous writers who use French rather than English find themselves in an especially complex situation, experiencing double marginalization.
Lacombe [et al.], 2010 : 6
Dans un tel contexte, la diffusion accrue de la pensée autochtone d’expression française constitue une retombée importante de la traduction vers l’anglais des oeuvres autochtones écrites en français au Canada.
En conclusion, le fait que le premier roman autochtone à paraître en français au Québec soit l’oeuvre d’une femme est digne de mention. Sans oublier que ce titre a été publié aux Éditions de la Pleine Lune, une maison féministe créée en 1975 qui a joué un rôle majeur dans la diffusion de la parole des femmes. En outre, le corpus en émergence de littérature autochtone au Québec doit beaucoup aux femmes. Pensons à Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Natasha Kanapé Fontaine, Marie-Andrée Gill, J. D. Kurtness, Rita Mestokosho, Maya Cousineau Mollen et à plusieurs autres.
On observe également, dans le cas de la traduction anglaise d’Ourse bleue, que c’est la maison d’édition féministe Inanna de Toronto qui s’y est intéressée la première et l’a fait paraître en anglais, dans la traduction d’Ouriou et Morelli, mère et fille. Ce sont autant de femmes qui se donnent la main pour écrire, traduire et publier des oeuvres nous permettant d’entrer à notre tour dans le cercle et de poursuivre avec elles diverses réflexions et recherches esthétiques, sociales et spirituelles.
Appendices
Note biographique
Patricia Godbout est professeure associée au Département des arts, langues et littératures de l’Université de Sherbrooke. Elle est présidente du comité de direction du Centre Anne-Hébert et collabore au Groupe de recherche et d’études sur le livre au Québec. Elle participe également à un projet de centre de documentation des langues et cultures autochtones en Estrie. Sa traduction française de l’essai The Black Atlantic Reconsidered de Winfried Siemerling vient de paraître aux Presses de l’Université d’Ottawa.
Notes
-
[1]
Au sujet du bleu marial, Michel Pastoureau rappelle que c’est à partir du XIIe siècle que Marie est prioritairement associée dans la peinture occidentale à la couleur bleue et que celle-ci devient « un de ses attributs obligés » (2000 : 44).
-
[2]
David Laporte fait d’ailleurs un rapprochement intéressant avec le roman L’herbe verte, l’eau vive de Thomas King (2016 : 74). Il est en effet question, dans l’une des scènes de ce roman, d’une inondation survenue à la suite non pas de la construction d’un barrage hydroélectrique, mais de sa destruction.
-
[3]
Susan Ouriou y a répondu par courriel le 5 mars 2022 et nous avons échangé par visioconférence le 10 mars.
-
[4]
Luciana Ricciutelli a dirigé la maison d’édition féministe Inanna Publications pendant de nombreuses années. Elle est décédée en décembre 2020, à l’âge de 62 ans.
-
[5]
Carol Rose GoldenEagle est elle-même une auteure de la maison Inanna.
-
[6]
L’écrivain autochtone américain Gerald Vizenor emploie le mot « survivance » en anglais dans ses essais critiques, notamment dans Manifest Manners: Postindian Warriors of Survivance (1994). Dominique Letellier propose le mot « survivrance » en français pour traduire ce concept (dans sa traduction de la préface de Vizenor au recueil Nouvelles des Indiens d’Amérique du Nord, 2008).
Bibliographie
- HIGHWAY, Tomson (2017), « Ourse bleue », From Oral to Written: A Celebration of Indigenous Literature in Canada, 1980-2010, Vancouver, Talonbooks : 75-76.
- JEANNOTTE, Marie-Hélène (2010), « L’identité composée : hybridité, métissage et manichéisme dans La saga des Béothuks, de Bernard Assiniwi, et Ourse bleue, de Virginia Pésémapéo Bordeleau », International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d’études canadiennes, no 41 : 297-312.
- KING, Thomas (2011), L’herbe verte, l’eau vive, trad. Hugues Leroy, Montréal, Boréal.
- LACOMBE, Michèle [et al.] (2010), « Indigeneity in Dialogue: Indigenous Literary Expression Across Linguistic Divides / L’autochtonie en dialogue : l’expression littéraire autochtone au-delà des barrières linguistiques », Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne, vol. 35, no 2 : 5-12.
- LAPORTE, David (2016), « Sur les routes/roots : Identité culturelle et “poétique de l’espace métissé” dans Ourse bleue de Virginia Pésémapéo Bordeleau », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 46, nos 2-3 : 67-76.
- MOYES, Lianne (2018), « From one colonial language to another: translating Natasha Kanapé Fontaine’s “Mes lames de tannage” », TranscUlturAl, vol. 10, no 1 : 64-82.
- NIXON, Lindsay (2017), « Intergenerational constellations. A review of Winter Child by Virginia Pésémapéo Bordeleau », Montreal Review of Books, 7 juillet.
- OURIOU, Susan (2022), Courriel adressé à Patricia Godbout, 5 mars.
- OURIOU, Susan (dir.) (2014), Languages of Our Land / Langues de notre terre : Indigenous Poems and Stories from Quebec / Poèmes et récits autochtones du Québec, Banff, Banff Centre Press.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2021), The Lover, The Lake, trad. Susan Ouriou, Calgary, Freehand Books.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2020), Ourse bleue – Piciskanâw mask iskwew, Rouyn-Noranda, Éditions du Quartz.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2019), Blue Bear Woman, trad. Susan Ouriou et Christelle Morelli, Toronto, Inanna.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2017), Winter Child, trad. Susan Ouriou et Christelle Morelli, Calgary, Freehand Books.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2014), L’enfant hiver, Montréal, Mémoire d’encrier.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2013), L’amant du lac, Montréal, Mémoire d’encrier.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2012), De rouge et de blanc, Montréal, Mémoire d’encrier.
- PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia (2007), Ourse Bleue, Montréal, Éditions de la Pleine Lune.
- PASTOUREAU, Michel (2000), Bleu : histoire d’une couleur, Paris, Seuil.
- VIZENOR, Gerald (1994), Manifest Manners: Postindians Warriors of Survivance, Hanover, N.H., University Press of New England.
- VIZENOR, Gerald (2008), Nouvelles des Indiens d’Amérique du Nord, trad. Dominique Letellier, Paris, Métailié.

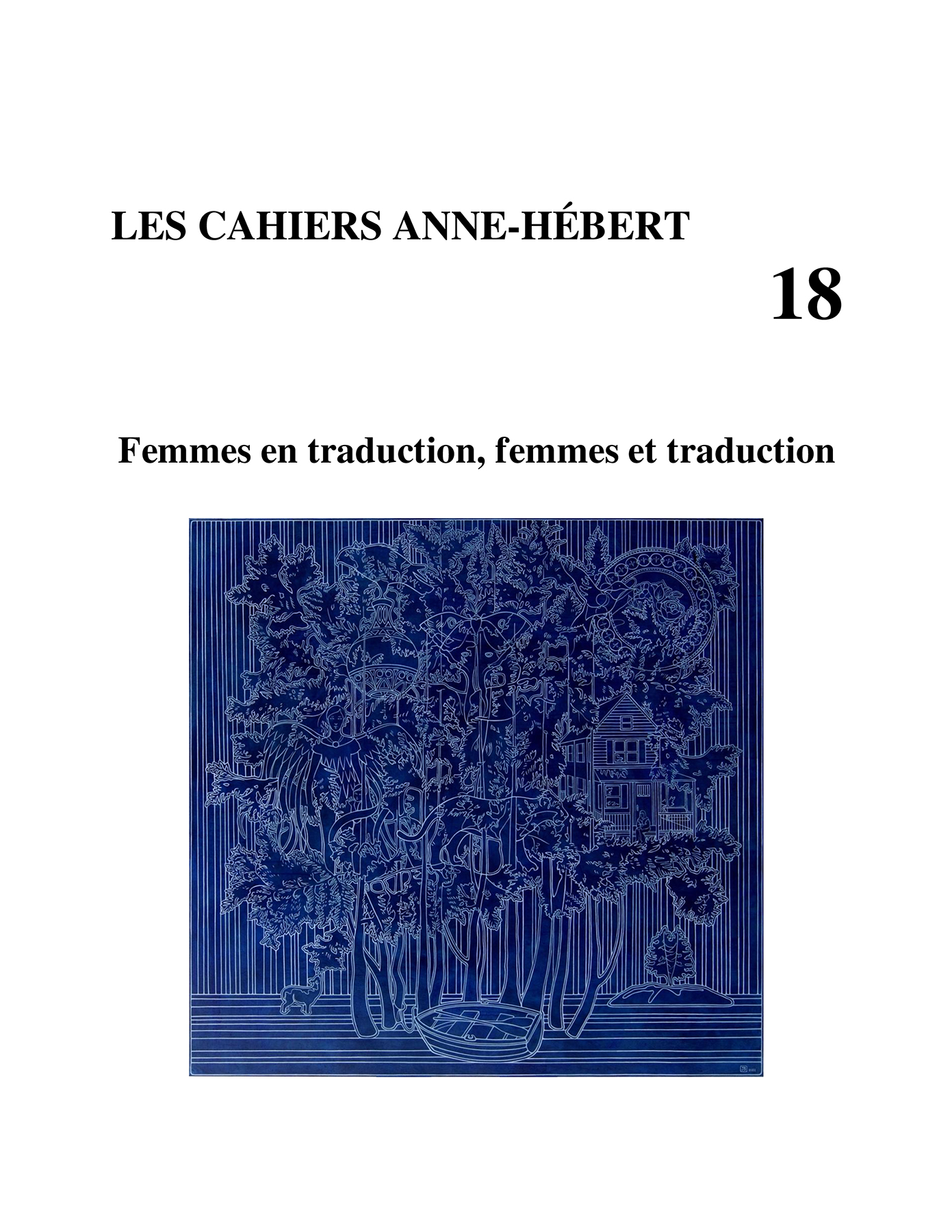

 10.7202/044172ar
10.7202/044172ar