Abstracts
Résumé
Dans cet article, l’autrice s’intéresse aux complexités et aux défis que pose la traduction littéraire des poètes yiddish Rachel (Rokhl) Korn et Kadia Molodowsky. Reconnues comme des figures majeures de la littérature yiddish moderne, Korn et Molodowsky sont pourtant méconnues de nos jours en raison de la rareté des traductions de leurs oeuvres respectives. En rappelant l’histoire récente de la langue et de la littérature yiddish, de son effervescence dans la diaspora au début du XXe siècle jusqu’à son déclin après la Shoah, l’autrice retrace les principaux défis que pose la traduction de cette langue et la prise de parole féministe dans la tradition littéraire de langue yiddish. Ainsi, l’autrice distingue les particularités des contextes français et nord-américain et elle s’appuie sur son propre travail de traductrice pour faire découvrir le parcours et l’oeuvre de ces poétesses, qu’elle situe ensuite dans le contexte de la traduction littéraire au Québec.
Mots-clés :
- Traduction littéraire,
- traduction féministe,
- littérature yiddish,
- poétesses,
- modernité,
- Rachel Korn,
- Kadia Molodowsky
Article body
Lorsqu’on évoque la traduction de la littérature des femmes au Québec (et en Amérique du Nord), la liste des écrivaines – qu’elles soient poètes, romancières ou essayistes – en langue française et anglaise domine largement, et la traduction de textes écrits en langues minoritaires[1] n’apparaît que dans une très faible proportion. C’est le cas, en particulier, de la littérature yiddish, vaste univers qui s’est implanté avec force au Québec dès les lendemains de l’insurrection russe (1905) et qui n’a cessé de croître en importance jusqu’aux années 1950. La situation est un peu différente au Canada anglais où, bien qu’il s’agisse d’une pratique associée à un petit nombre, certaines traductrices ont porté dans la langue de la majorité le flambeau de cette littérature profondément enracinée dans la diaspora[2]. Si la littérature yiddish s’est développée rapidement au Québec – en particulier dans la métropole, Montréal –, à travers de solides réseaux de publication et de diffusion, au point de s’imposer, au fil des décennies, comme la troisième tradition littéraire dans la ville aux côtés des littératures francophone et anglophone, comme le souligne Sherry Simon (2008), il reste qu’une faible proportion d’oeuvres appartenant à ce corpus ont été traduites, surtout si elles sont signées par des femmes[3].
Dans cet article, je discuterai des travaux de traduction que j’ai entrepris depuis les dernières années sur les écrivaines Rachel Korn[4] (1898-1982) et Kadia Molodowsky (1894-1975). Afin de situer les lecteurs et lectrices face aux particularités de la langue yiddish et à son statut à l’ère actuelle, la première partie de mon texte s’attachera à la définir et à commenter son histoire récente au XXe siècle. J’enchaînerai avec les enjeux principaux que pose la traduction du yiddish vers l’anglais et vers le français, ce qui nous amènera à faire un détour par la France avant de revenir en Amérique du Nord. Je discuterai ensuite des parcours respectifs de ces deux écrivaines issues de l’Europe de l’Est qui étaient bien connues dans le monde juif de l’entre-deux-guerres en Europe, et qui ont émigré en Amérique du Nord en raison de l’émergence croissante de l’antisémitisme en Europe durant les années 1930, afin d’analyser quelques défis et enjeux de traduction associés à leurs oeuvres respectives.
Discuter de la traduction des textes de Korn et de Molodowsky, poètes reconnues pour leur vision féministe relativement à la tradition juive, dans le contexte géopolitique du Québec actuel semble d’autant plus intéressant que celui-ci est reconnu pour avoir été le terreau de l’émergence des théories et des pratiques associées à la « traduction féministe » depuis les années 1970 et 1980. C’est en effet dans ce contexte marqué par le bilinguisme et l’affirmation du féminisme que certaines chercheuses et traductologues de renom ont revendiqué cette expression pour décrire leurs efforts d’intégrer les valeurs féministes dans leurs projets de traduction et de recherche sur la traduction, tout en créant de nouvelles manières de subvertir les discours patriarcaux. Ainsi, dans les études sur la traduction, le Québec est souvent représenté comme le paradigme original et universel de la traduction féministe ; une situation qui a été renforcée par trois publications qui sont devenues des références incontournables dans le domaine : celles de Susanne Lotbinière-Hartwood (1991) ; Sherry Simon (1996) et Louise Von Flotow (1997). C’est dans cette perspective que certains théoriciens de renom, dont Bassnett and Lefevere (1990) et Lawrence Venuti (2000), ont discuté d’une « école canadienne » (Canadian school) de traduction qui visait primordialement à rendre justice au genre (« gender justice »). Dans les termes d’Olga Castro et d’Emek Ergun, cela signifiait valoriser « l’usage stratégique de la traduction en tant que dispositif de dialogue transfrontalier pour disséminer les idées féministes et construire des solidarités féministes transnationales[5] » (Castro et Ergun, 2018 : 127). Ce contexte, on le devine, se prête particulièrement bien à l’étude des textes de Korn et de Molodowsky du point de vue des femmes et de la traduction.
Particularités du yiddish
Avant de plonger dans les particularités associées à la traduction du yiddish, il importe de brosser un portrait rapide de cette langue. Le yiddish, langue vernaculaire des communautés juives ashkénazes d’Europe, est né vers l’an mille dans la vallée du Rhin. Dès son émergence, cette langue germanique a été utilisée, dans sa forme écrite, avec les caractères hébraïques (qui se lisent de droite à gauche) afin de la distinguer de l’allemand et pour insister sur sa spécificité juive. Au cours des siècles, le yiddish a été parlé et utilisé de l’Allemagne du Nord à la Pologne, à l’Ukraine et à la Biélorussie, de la Hollande jusqu’à l’Italie du Nord. Les diverses formes dialectales de cette langue sans territoire sont le résultat de nombreuses migrations et d’une absence d’orthographe standardisée jusqu’à une période aussi tardive que les années 1930. Souvent associé au monde des shtetlekh, les petites bourgades juives d’Europe de l’Est habitées par une population souffrant de marginalisation et de paupérisation, le yiddish a été péjorativement qualifié de « zhargon » ou de « mauvais allemand en dialecte juif ». Associée à un vaste folklore et à une littérature durant le Moyen-Âge, cette langue a évolué en intégrant, au fil de son histoire, des termes et expressions tirés des cultures environnantes où elle s’est implantée, ceux-ci se mélangeant à une composante hébraïque et araméenne, aux langues romanes et aux dialectes slaves. On l’a ainsi définie comme une « langue de fusion » (Baumgarten, 2002).
Intimement liée à l’histoire juive, à la tradition religieuse, aux coutumes et à la situation des Juifs d’Europe, ainsi qu’à leur humour, cette langue a évolué en adoptant plusieurs formes et dialectes. À l’époque moderne, elle est intimement liée aux idées progressistes de la Haskalah (les Lumières juives) et à une modernité littéraire et artistique foisonnante en Europe et dans la diaspora. Avec l’extermination des populations juives d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale, cet idiome, qui était la langue maternelle de la majorité des victimes des camps et de la Shoah, a connu un déclin irréversible. De nos jours, il en reste très peu de locuteurs dans le monde séculier. Depuis les dernières décennies, cependant, le yiddish connaît un renouveau grâce à une majorité de traducteurs et d’acteurs associés à des organisations qui font revivre son esprit et la riche littérature de ce monde dorénavant englouti.
Aujourd’hui, traduire cette langue pose de nombreux défis qui sont inhérents à son histoire, à la violence qu’elle a subie au fil du temps dans la diaspora, et particulièrement au cours du XXe siècle, dont la mémoire reste vive, voire brûlante. En Amérique du Nord, ces défis sont différents pour les traducteurs, puisque le territoire n’a pas été marqué par la Seconde Guerre mondiale et qu’il ne comprend aucune trace concrète des violences commises envers les Juifs durant la Shoah. Par ailleurs, à Montréal en particulier, l’acte de traduire le yiddish vers le français relève presque d’un tour de force de l’histoire. Comme l’explique Sherry Simon :
Le yiddish a été la langue des immigrants juifs au début du vingtième siècle. L’anglais était la langue dominante de la ville – les Juifs et les Canadiens français avaient peu de relations véritables. Le français, certes, était la langue de la majorité à Montréal, mais il accusait une infériorité culturelle face à l’anglais et avait donc le statut d’une langue mineure. Pendant la majeure partie du vingtième siècle, un transfert latéral du yiddish vers le français était impensable. Or, ce qui apparaissait intraduisible, opaque, ou excessivement chargé sur le plan culturel, à un moment donné, peut être apprécié autrement à une autre époque. Une traduction peut être une intervention opportune entreprise eu égard à des intérêts et des sensibilités du moment. Un projet d’écriture en français sur le Montréal juif, l’ouverture d’un nouvel espace de discussion et de débats dans les milieux des sciences sociales québécoises représentent un nouveau tournant dans la vie culturelle de Montréal[6].
Simon, 2008 : 141-142
Enjeux et défis généraux de traduction du yiddish
Comme le yiddish est une langue souple qui comprend une variété de formes dialectales, la traduction soulève des enjeux particuliers relatifs à la « perte » inhérente à l’acte de traduction lui-même. Selon la professeure et traductrice Anita Norich, « les lecteurs du yiddish craignent que ce qui soit perdu relève non seulement de nuances particulières sur le plan culturel, le tam (le goût, la saveur) de l’original, mais l’histoire et la culture d’un peuple[7] » (2014 : 9). Car le tam ne réside pas seulement dans le vocabulaire, il se cache aussi dans un certain nombre de connotations et dans l’organisation de la langue elle-même. Dans son ouvrage bien connu The Meaning of Yiddish, le traducteur américain Benjamin Harshav explique la situation dans les termes suivants :
Par comparaison avec l’anglais ou le russe, le vocabulaire du yiddish est assez restreint, mais chaque mot possède une aura de connotations qui dérive de ses relations multidirectionnelles et codifiées au sein d’un paradigme sémantique, comme c’est le cas des autres langues, mais aussi avec des mots parallèles issus d’autres langues-sources, jusqu’à un ensemble actif de proverbes et d’idiomes, et à des groupes et à des situations typiques.
1990 : 39
Si le vocabulaire somme toute limité de la langue yiddish entraîne une dépendance lexicale accrue envers un contexte d’émergence multilingue, les sens émotif et dénotatif ne sont pas dépourvus d’ironie. Ainsi, les traductions d’oeuvres littéraires en yiddish devraient être aussi multilingues que les oeuvres originales ; en d’autres termes, il s’agit de les réaliser sans que la langue ne soit « déracinée » de ses ancrages linguistiques, géographiques et culturels.
Par conséquent, la traduction du yiddish ne devrait pas faire l’objet d’une uniformisation qui laminerait, voire effacerait les nombreuses références à la religion et à l’ethnicité qui composent le texte. Ces références, il faut le souligner, ne sont pas rares dans le yiddish « séculier » ; elles comprennent une série de termes qui servent à nommer des personnes et des choses particulièrement associées à la religion. Celles-ci sont, d’un côté, « les noms pour les parties constituantes et les rituels du shabbat et des fêtes juives, pour la vie présente et celle à venir, pour les fonctionnaires religieux tels que les rabbins, les rebeim, le rabonim et les tsaddikim[8] » (Rosenwald, 2002). De l’autre, ces références comprennent un ensemble d’interjections pour décrire l’attitude d’une personne dans des situations qui ont été mentionnées ou qui sont sur le point d’être décrites. Dans son ouvrage Blessings, Curses, Hopes and Fears, James Matisoff les appelle « expressions psycho-ostensibles » dans la quatrième de couverture de l’ouvrage (2000). De telles expressions sont utilisées afin de reconnaître, d’appeler ou d’avertir soit Dieu, soit le diable lorsqu’il entre en relation avec les autres. La plus populaire d’entre toutes est sans doute le célèbre tosaphot keyneynhore, signifiant « que le mauvais oeil soit écarté » ; cette expression est utilisée « lorsqu’on mentionne toute réalisation gratifiante » (1977), comme le souligne Uriel Weinreich dans son dictionnaire yiddish-anglais (Yiddish-English Dictionnary[9]).
Le problème typique renvoyant à ce qui serait « perdu en traduction » (lost in translation) comporte ici différents niveaux de signification. L’acte de traduire la littérature yiddish, qu’elle soit classique ou non, renvoie à plusieurs exigences, et ses paradigmes varient selon les contraintes avec lesquelles les traductions sont réalisées, de même que selon le contexte s’y rattachant. Comme l’explique Rosenwald,
Les traducteurs des textes yiddish devraient retenir ces deux aspects concernant le caractère juif de leurs personnages. Cela n’est pas une tâche facile, car si le traducteur en tient compte, il pourrait réaliser des traductions plus sèches et non familières aux lecteurs Gentils ou à ceux qui ne connaissent pas la culture juive. En agissant autrement, il risquerait de déraciner et d’aplanir les personnages[10].
Rosenwald, 2002
Un autre facteur s’ajoute à ces considérations. Après la Seconde Guerre mondiale, le yiddish est devenu la langue de la commémoration et de la mémoire par excellence. Sur un plan populaire, les landsmanshaftn ont ravivé l’élan qui a donné lieu en grande partie à cet acte de commémoration : plusieurs centaines de yizker-bikher (livres de mémoire) ont été publiés dans le monde entier par ces organisations. Ceux-ci comprennent de précieuses informations de première main sur les communautés juives de l’Europe de l’Est, à la fois à propos de la vie en Europe de l’Est avant la Shoah et sur la destruction. Ainsi replacé dans le contexte de la khurbn, la grande catastrophe qui a détruit la vie juive en Europe, le célèbre adage renvoyant à ce qui est « perdu en traduction » revêt des connotations supplémentaires associées à la perte du Yiddishland lui-même. Autrement dit, comment faire revivre cette vie juive d’autrefois qui nous est transmise par les textes en respectant son authenticité, alors qu’elle a été anéantie?
Paroles de traductrices
Quelques réponses nous proviennent de traductrices oeuvrant dans une autre aire géographique, celle de la France, d’où nous sont transmis plusieurs témoignages de cet acte de traduction singulier. Pour Rachel Ertel (née en 1939 en Pologne), le traducteur du yiddish se trouve dans une situation paradoxale. « Sa langue de départ, une inconnue, constitutive pourtant de son être, [est] vouée à la “traduction absolue” selon la formule de Derrida. Il est condamné, souffle coupé, à prendre, cueillir, accueillir des fragments, des éclats, à recoller des morceaux de la langue, les arracher au chaos de l’Histoire, les apprivoiser. » (Ertel, 2009 : XI) Dès lors, il s’agit de faire renaître de ses cendres le yiddish, langue « assassinée » qui représente inéluctablement un « fardeau » pour le traducteur qui en assure la transmission, et qui en éprouve pourtant le désir. De son côté, Carole Matheron-Ksiazenicer, soulignant la charge émotive qui hante souvent les traducteurs et traductrices nés durant la période 1939-1945, tient un propos un peu différent :
Traduire du yiddish fut pour moi, tout d’abord, chose relativement simple, en tout cas sans ces complications affectives qui inhibent la génération née pendant la guerre, soumise au refoulement et à l’angoisse devant la langue proscrite. Rien de tel chez moi, qui appris cette langue lors de cours du soir à l’Université[11].
citée dans Gepner, 2012 : 44
Il en va autrement pour Batia Baum, qui a dû « traduire sa langue maternelle (le yiddish) dans une autre langue (le français), devenue maternelle par injonction et nécessité » (citée dans Gepner, 2012 : 50). Chez Baum, durant son enfance vécue pendant la guerre et l’Occupation en France, le yiddish se trouve frappé d’interdiction : « parler yiddish s’apparente à une condamnation à mort. Il faut changer de langue, comme il faudra aussi changer d’environnement. » (citée dans Gepner, 2012 : 50)
Si, pour l’ensemble des traductrices, ce travail se définit comme une « entreprise délicate, émotionnellement chargée du fait de l’Histoire » (2012 : 44), ainsi que le fait remarquer Corinna Gepner, c’est aussi parce qu’il renforce souvent le lien générationnel. Par conséquent, il contribue à « l’émergence d’une certaine forme de conscience historique qui s’enracine dans la violence, la disparition et l’absence ». Par ailleurs, comme la traduction du yiddish porte sur un monde englouti, celui du Yiddishland, « elle pourrait se comprendre, fondamentalement, comme un travail de remaillage, de renouage » (Gepner, 2012 : 44). En ce sens, la traduction engage « une expérience fondamentale de l’étrangeté » (2012 : 44) qui n’est cependant pas dépourvue de familiarité, comme le souligne encore Gepner.
Pour la professeure américaine Kathryn Hellerstein, à qui l’on doit de nombreuses traductions et recherches sur les femmes poètes de langue yiddish, dont Kadia Molodowsky, cet acte de traduction s’est imposé de la manière suivante :
J’ai réalisé que les femmes poètes de langue yiddish avaient été peu représentées, qu’elles avaient été reçues avec des préjugés, et entendues et comprises seulement de façon partielle par leurs contemporains et par les miens. Il semblait nécessaire, voire urgent, de mettre en lumière – c’est-à-dire de lire, d’écrire au sujet et de traduire – le plus de poésie yiddish par autant de femmes que possible, afin de voir ce qui s’y trouvait et afin de définir et d’analyser les traditions d’écriture dans lesquelles les femmes s’étaient engagées.[12]
Hellerstein, 2000 : 193
Pour les rares traductrices et traducteurs qui n’ont pas reçu le yiddish et la culture juive en héritage, ce « travail de deuil pour la langue assassinée » (2008 : C1), ainsi que l’évoque Ertel, représente une charge émotive moins percutante. Les investissements affectifs, qui s’exercent en dehors d’un lien de filiation, ne sont pas du même ordre, car le traducteur entretient une certaine distance avec son sujet.
Sur ce plan, le concept de postmémoire élaboré par la théoricienne américaine Marianne Hirsch, et qui porte surtout sur les oeuvres visuelles, s’avère utile. S’agissant de la relation entre la deuxième génération et le traumatisme de celle d’avant, la postmémoire est associée aux images photographiques, ce « prisme au travers duquel il est donné d’étudier l’espace postmoderne de la mémoire culturelle, composée de résidus, de débris, d’objets à rassembler de diverses façons[13] » (Hirsch, 1997 : 13). S’il n’y a nulle image, aucune symbolisation, la souffrance se transmet directement à la deuxième génération, souvent « en creux », à travers les effets d’événements qui n’ont pas été vécus mais dont la charge émotive est telle qu’elle les éprouve comme de véritables souvenirs. Comme le souligne Simone Grossman, selon Hirsch, les photos, « vestiges fragmentaires[14] » (Hirsch, 2012 : 37) du passé détruit, sont le medium de la postmémoire, tant familiale que par affiliation.
À l’instar de nombreuses créations artistiques qui portent sur les archives d’une mémoire juive disparue durant la Seconde Guerre mondiale (celle du Yiddishland), la traduction du yiddish s’inscrit dans un travail de « postmémoire » où, le plus souvent, l’individu se porte à la rencontre de son héritage intergénérationel. Or, Hirsch distingue deux formes de postmémoire, l’une familiale et l’autre, affiliative ; dans le cas des traducteurs non-juifs (goyim), ce travail relèverait plutôt d’un travail de postmémoire affiliative, la transmission de l’héritage juif étant d’ordre culturel plutôt que filial[15].
Rachel Korn et Kadia Molodowsky
Avant de discuter de quelques enjeux de traduction chez les poètes qui nous intéressent, il importe de rappeler brièvement les parcours respectifs des deux femmes poètes[16]. Née à Przemysl en Galicie en 1898, Rachel Korn grandit dans une famille isolée à la campagne, une situation qui l’incitera à écrire de la poésie, et elle reçoit une éducation en polonais. Au cours de la Première Guerre mondiale, sa famille fuit la zone de conflit en Galicie pour vivre à Vienne durant quatre ans, après quoi elle retourne dans son village natal de 1918 à 1941. Après avoir publié quelques textes dans des revues littéraires polonaises, Korn, confrontée à l’émergence de pogroms en Pologne, commence à écrire en yiddish, une langue qu’elle a apprise avec son mari, Hersh Korn.
Dans l’ensemble de sa carrière, Korn fait paraître huit ouvrages de poésie et deux recueils de nouvelles, en plus de nombreux textes dans des revues et des anthologies[17]. Parmi ses publications, il faut souligner quelques titres bien reçus par la critique Dorf [Village] (poésie) (1928) ; Erd [Terre] (nouvelles) (1936) ; Royter Mon [Coquelicots rouges] (poésie) (1937). En 1939, durant le pacte germano-soviétique, Korn devient une citoyenne soviétique. Après l’invasion allemande en 1941, elle quitte son village natal pour aller rejoindre sa fille à Lvov (Lviv) afin de s’enfuir vers l’Union soviétique. Les membres de sa famille (sa mère, ses frères et son mari) sont assassinés durant la Shoah. Après avoir traversé l’Ouzbékistan durant la guerre, Korn devient réfugiée en 1947 à Stockholm, où elle séjourne durant un an et où elle s’implique dans les activités du PEN International en Suède. En 1948, elle émigre à Montréal, où elle vivra durant plus de trente ans et où elle a participé au rayonnement de la vie culturelle en yiddish. Elle publie ensuite trois recueils importants : Heym un heymlozikayt [Avec et sans foyer] (poésie) (1948), Bashertkayt [Prédestination] (poésie) (1949) et Fun iener zayt lid [De l’autre côté du poème] (poésie) (1962). Dans les années 1970, son oeuvre est couronnée de prix importants : le prix H. Leivick (1972) et le prix Itsik Manger (1974).
Née dans un shtetl en Russie Blanche (Bélarus), Kadia Molodowsky reçoit quant à elle une riche éducation marquée par l’apprentissage du yiddish, de l’hébreu et du russe. Enseignante auprès de jeunes enfants, elle voit sa vie bouleversée en 1917, après la Révolution bolchévique, période où, voulant retourner chez ses parents à Bereza, elle est arrêtée à Kiev. Survivante au pogrome de Kiev, Molodowsky s’installe ensuite à Varsovie, où elle s’implique dans le milieu littéraire yiddish. Son premier ouvrage de poésie, Khvendike Nekht [Nuits de Heshvan], voit le jour en 1927 ; il sera suivi de nombreux recueils de poésie, d’ouvrages pour enfants et de textes de fiction. En 1935, elle et son mari émigrent à New York, où elle s’implique dans la presse écrite et publie en 1937 l’ouvrage In land fun mayn gebeyn [Au pays de mes os] (poésie). En 1946, en réponse à la Shoah, Molodowsky publie Der melekh David aleyn iz geblibn [Seul le roi David est resté], un recueil qui comprend l’un de ses poèmes les plus connus, « Eyl Khanun » (Merciful God). De 1948 à 1952, elle vit à Tel-Aviv avec son mari et fonde une revue pionnière pour les femmes intitulée Heym [Foyer]. De retour à New York, elle dirige la revue littéraire Svive [Milieu] durant plusieurs années. En 1971, elle a reçu le prix Itzik Manger pour l’ensemble de son oeuvre.
Pourquoi s’intéresser à ces deux femmes poètes et à la traduction de leurs oeuvres en particulier? Les raisons sont nombreuses : tout d’abord, elles représentent deux voix incontournables de la littérature yiddish de l’entre-deux guerres, période où les femmes émergent dans ce corpus. Si Korn est souvent considérée comme une « poétesse de la nature[18] », chose rare dans la littérature yiddish, Molodowsky restera quant à elle résolument une poète urbaine. De plus, leurs échanges et leur amitié rendent compte des liens soutenus qui se sont tissés dans le monde juif entre Montréal et New York, les deux grands foyers de la culture yiddish en Amérique du Nord. Par ailleurs, aborder la question des femmes et de la traduction du yiddish à travers leurs exemples nous amène à enrichir notre vision de la traduction littéraire des femmes et par les femmes au Québec, par l’ajout de cette langue qui a des racines profondes en Europe et qui s’est implantée dans la diaspora. Par conséquent, il est possible de revoir les paramètres dans lesquels l’acte de traduction évolue au Canada, en situant le Québec plutôt dans l’espace nord-américain, où se tissent des liens de solidarité entre femmes et à travers le temps[19].
La correspondance entre Korn et Molodowsky (1948-1972)
Fait important, en 1948, Rachel Korn et Kadia Molodowsky amorcent une correspondance qui durera vingt-quatre ans, jusqu’au décès de la dernière en 1972. Dans l’ensemble des lettres qu’elles échangent, elles discutent de plusieurs sujets associés à la littérature yiddish durant l’après-guerre : leur lectorat en déclin, l’urgence de lutter contre l’assimilation afin de poursuivre leurs carrières littéraires respectives en yiddish, et l’importance de la traduction pour en assurer la transmission auprès des autres cultures et des nouvelles générations. En filigrane, cela implique le fait de résister aux développements récents de l’histoire juive moderne depuis la Shoah. En tant qu’écrivaines yiddish reconnues en Europe, Korn et Molodowsky sont maintenant confrontées au problème général des lendemains de la guerre. Korn écrit d’un point de vue explicitement féminin, en intégrant le genre et la sensualité au coeur de la voix poétique. Par contraste, Molodowsky englobe le genre au point de l’effacer, une situation qui renvoie aux difficultés globales concernant la survie nationale et culturelle des Juifs et qui caractérise son style poétique après la Shoah.
Fait important, la correspondance entre Korn et Molodowsky n’appartient pas à la tradition établie des autobiographies juives nord-américaines, laquelle a privilégié les récits d’immigrants ouvriers qui ont fait leur chemin depuis le ghetto jusqu’à l’Amérique mainstream. Cependant, cette correspondance s’inscrit dans une mouvance importante de la littérature juive d’Europe de l’Est. Ainsi que le note Marcus Moseley dans son ouvrage Being For Myself Alone. Origins of Jewish Autobiography (2005), la grande majorité des récits biographiques (memoirs) et des autobiographies signés par des auteurs juifs issus de l’Europe de l’Est ont été rédigés en yiddish ; or il s’agit du plus grand corpus de littérature autobiographique qui ait jamais été écrit dans une langue juive. Ainsi, ces écrivains font partie de la dernière génération d’écrivains qui ont utilisé le yiddish en posant un « acte autobiographique » en Amérique du Nord. Cela nous renvoie à une dimension intéressante de la littérature yiddish, à savoir qu’elle se distingue des autres littératures juives d’Europe par un élément crucial, celui du genre ; en effet, aucune littérature écrite dans une langue juive avant l’émergence de l’hébreu moderne en Israël n’avait rassemblé une proportion si élevée de femmes.
L’acte autobiographique de Korn et de Molodowsky participe donc à la fois du processus d’américanisation après la Seconde Guerre et de l’émergence des femmes dans la littérature juive moderne. Leurs expériences respectives de l’émigration sont fort différentes, comme le sont leurs parcours dans leur pays d’adoption. Cette situation est illustrée, dans leur écriture, par une fluidité entre les genres littéraires (de la correspondance à la poésie et à la nouvelle, par exemple) qui participe de leur acte autobiographique. Pour cette raison, leur correspondance ne peut être isolée de leur poésie, le brouillage de frontières entre les genres littéraires étant inhérent à leur pratique d’écriture.
Comme plusieurs écrivains yiddish qui ont émigré en Amérique du Nord, Korn et Molodowsky partagent un désir, celui d’établir une continuité entre l’Europe de l’Est et l’Amérique[20]. Pour cette raison, elles expriment souvent dans leurs échanges leur déception à l’égard de leur lectorat en déclin et des jeunes Juifs qui ne parlent pas le yiddish. Par exemple, dans une lettre datant d’avril 1966, Korn écrit à Molodowsky : « Nous sommes coupées des jeunes générations. Les enfants ne comprennent pas un mot de yiddish. Ils parleront hébreu, français, anglais ; bref, n’importe quelle langue, sauf le yiddish[21]. » Avec le déclin massif du lectorat yiddish après la Seconde Guerre mondiale, les deux femmes réalisent que seule la traduction est en mesure de valoriser leurs textes et de participer au rayonnement de leurs oeuvres. Par conséquent, c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elles accueillent la traduction de leurs oeuvres vers l’hébreu et l’anglais, les deux langues majeures qu’ont adoptée les Juifs de leur génération.
Territoires imaginaires
Si leurs homologues masculins écrivent beaucoup sur leur ville d’adoption, y compris en affichant parfois un détachement singulier qui en fait des « flâneurs » (Jacob-Isaac Segal, Melech Ravitch, Moshe Kulbak), ce sujet attire moins les deux poétesses. Les territoires qu’elles évoquent sont plutôt imaginaires et intimes ; ils renvoient aux endroits qu’elles ont connus en Europe de l’Est avant la grande destruction et qui ont disparu pour la plupart (Korn) ou parfois à des lieux typiquement nord-américains (les gratte-ciels de New-York où travaillent les poètes juifs et les immigrants). Dans leurs textes sont ainsi dépeints des territoires imaginaires renvoyant à leur sensibilité et à leur sens de l’intime, où il est possible de recréer leur existence passée et de lui conférer une aura de poésie. Korn, par exemple, écrit plusieurs textes sur son shtetl de Galicie et sur la disparition des membres de sa famille. Notamment, dans sa poésie datant du début des années 1960, elle invite le lecteur à s’aventurer De l’autre côté du poème (Fun yener zayt lid), un endroit marqué par la perte d’ancrages temporels. À cet endroit se tient « quelqu’un perdu dans le temps / [qui] foule le sentier pieds nus / en silence » (Korn, 2014 : 37)[22]. Dans ce poème, il est aussi question d’une « heure blessée » et de la mère (assassinée), qui réapparaît, de sorte que le texte révèle le trauma de la Shoah et la rupture qui en découle chez la narratrice. Molodowsky, quant à elle, réinvente le paysage : dans l’un de ses recueils qui s’intitule Au pays de mes os [In land fun mayn gebeyn], tout se passe comme si, dans le Yiddishland entièrement détruit, les restes squelettiques d’humains pouvaient être transformés en pays ; comme si les os et l’ensemble qu’ils forment étaient le seul endroit susceptible d’offrir l’hospitalité à l’extérieur de la langue. Certes, Molodowsky inscrit également sa poésie dans des lieux précis ; dans son ouvrage In Yerushalayim kumen melakhim [Les anges arrivent à Jérusalem] (Korn, 2018 : 70), elle écrit à propos de la grande cité juive. Mais en ce lieu, le Babel des langues par excellence, le yiddish ne trouve pas sa place, et le paradoxe ne peut être résolu que par le biais de la traduction, acte essentiel qui permettra à leurs textes de voyager dans d’autres langues et, ainsi, de rejoindre un certain nombre de lecteurs.
Un point de vue féministe sur « les classiques »
Depuis les dernières décennies du XXe siècle, l’un des enjeux primordiaux associés à la traduction des écrivaines de langue yiddish consiste à développer une approche féministe. Comme dans plusieurs autres traditions littéraires occidentales, les femmes ont d’abord été marginalisées des courants dominants de la littérature yiddish sous le prétexte qu’elles abordaient surtout des sujets domestiques au lieu de s’intéresser à des sujets « importants » associés à la société et à la politique, à l’histoire et à la culture, ainsi qu’à la tradition. Comme nous pouvons en juger en examinant des anthologies de littérature yiddish publiées jusqu’aux années 1980 et 1990, qui portaient surtout sur des écrivains masculins, ce préjugé a duré longtemps. Bien qu’Ezra Korman, dans son essai intitulé « Yiddishe dikhterins » (Poétesses yiddish) (1928), développe le premier cadre pour examiner l’histoire des femmes poètes de langue yiddish, il aura fallu plusieurs décennies pour établir une tradition d’écrivaines de langue yiddish, comme le souligne Kathryn Hellerstein en 2014 dans son ouvrage A Question of Tradition. Women Poets in Yiddish (1586-1987). Toutefois, il s’agissait d’une idée fausse à l’égard des réalisations des femmes poètes de langue yiddish, car bon nombre d’entre elles exprimaient, en prose ou en poésie, une voix puissante qui était perçue comme « masculine » et qui n’abordait pas de considérations domestiques particulières. C’était le cas, en particulier, de Celia Dropkin, d’Anna Margolin et de Chava Rosenfarb, ainsi que de Kadia Molodowsky et de Rachel (Rokhl) Korn, dont les écrits sont perçus aujourd’hui comme des « classiques » de la littérature yiddish moderne. Pour cette raison, réhabiliter leurs voix respectives par le biais de la traduction littéraire est devenu une tâche urgente. Ainsi que le note Madeleine Cohen : « Les conséquences de longue durée qui découlent du fait d’exclure les femmes du canon littéraire peuvent être mesurées en partie à travers la disponibilité de leurs oeuvres en traduction » (2020) ; or celles-ci étaient rares, jusqu’à tout récemment, comparativement à celles de leurs homologues masculins.
Si l’une des difficultés majeures que rencontre la traductrice ou le traducteur de littérature yiddish est de rendre les composantes spécifiquement juives de la langue dans d’autres langues telles que le français ou l’anglais, la poésie yiddish renvoie parfois aussi le traducteur aux racines culturelles du texte. Cela peut inclure les traditions religieuses auxquels les poèmes opposent une voix dissidente. Pour cette raison, comme l’affirme Hellerstein, « le traducteur doit apprendre les traditions afin de comprendre la signification de la laïcisation de la culture yiddish au vingtième siècle et ainsi, d’être en mesure de traduire de la poésie » (2009 : 76). Dans cette perspective, le poème « Froyen-lider », qui a été publié dans un livre intitulé Kheshvandike nekht [Nuits de Heshvan] (Vilnius, 1927), demeure un excellent exemple de texte « classique », car il convoque la tension entre la tradition et la modernité, une situation illustrée par la résistance de la locutrice du poème aux pratiques particulières dérivant de la loi juive et incarnée dans l’usage de termes et d’expression hébraïques qui servent de métaphores.
Molodowsky : Froyen-lider ou Poèmes femmes
Un excellent exemple de texte yiddish qui puise dans diverses traditions et exprime la tension entre tradition et modernité est Froyen lider ou Poèmes femmes de Molodowsky[23], une suite poétique de huit textes dans lesquels une jeune femme se trouve déchirée entre la tradition et la modernité et où elle décrit ses visions nocturnes. Tout en illustrant le « pouvoir perturbateur d’une série de mots hébraïques » (Hellerstein, 1990 : 144), ce poème confronte la traductrice à deux niveaux de langue et de référence : le premier est associé aux récits traditionnels dans lesquels la locutrice se retrouve limitée en tant que femme qui ne peut exprimer sa propre subjectivité librement. Le deuxième s’ouvre sur le modernisme et l’expression de soi, ce qui est clairement sa propre voie. Ces deux registres demeurent distincts et sont illustrés par l’usage de plusieurs termes et expressions hébraïques dans le texte yiddish. S’il n’est pas inhabituel de retrouver des termes hébraïques dans un texte yiddish, Molodowsky les intègre comme s’il s’agissait de signes qui attirent l’attention, participant ainsi à construire un récit où « la langue elle-même devient une métaphore » (Hellerstein, 1990 : 144).
Froyen-lider I se divise en deux temps. La première partie du poème dépeint la vision d’une femme durant la nuit, et la deuxième raconte le refus d’accepter sa signification par la rêveuse. Ses ancêtres féminines viennent vers elle et l’exhortent à garder sa vertu. L’une de ces femmes est une agune, terme désignant une femme abandonnée par son mari sans que celui-ci ne lui ait accordé le divorce. Elle se retrouve dans une situation désespérée ; incapable de se remarier, elle est forcée de rester sans mari. À la fin, le poème demeure irrésolu et, sur le plan existentiel, il illustre le paradoxe et la situation éprouvante dans laquelle se retrouve cette femme. Comment, donc, traduire ce terme? Comme il n’en existe pas de traduction déterminée qui renvoie à la loi juive, et comme il n’a pas d’équivalent ni en français ni en anglais, la meilleure solution consiste à conserver l’original hébraïque dans la traduction anglaise ou française, en ajoutant un glossaire qui permettra d’en révéler la signification à un vaste public. De plus, le choix de conserver des termes et expressions originales en hébreu (et parfois en yiddish) présente un autre avantage, celui de mettre en contact le lecteur avec un vocabulaire chargé d’une profondeur à la fois émotive et historique. Autrement dit, ces mots, expressions et proverbes résonnent au-delà de ce que l’on peut appeler l’« intraduisibilité[24] ».
Ce poème dépeint une jeune femme déchirée entre tradition et modernité à un tournant historique de la littérature yiddish, la période de l’entre-deux-guerres, qui représente à la fois l’émergence de la voix des femmes et la fin de l’âge d’or de la littérature yiddish (qui s’est terminé de manière brutale avec les débuts de la Seconde Guerre mondiale et la destruction de la culture juive et des Juifs d’Europe). Son titre, « Femmes-poèmes », dépeint ce qui se tient au coeur des écrivaines de langue yiddish, la poésie étant une composante essentielle et organique d’une subjectivité littéraire et artistique parmi les femmes. Cette situation attire notre attention sur les questions décisives de genre et de gender, une distinction qui n’était pas encore opérante et qui traverse pourtant la littérature yiddish. En résumé, Froyen-lider est un poème déchirant qui invite à redéfinir les paramètres des « classiques » dans la littérature yiddish, un terme qui fait souvent référence aux ouvrages de fiction et qui, par conséquent, avait tendance à exclure les écrivaines de langue yiddish, davantage versées dans la poésie que dans le roman, jusqu’à tout récemment.
Rachel Korn : Bashertkayt ou Prédestination
Deux autres exemples de textes qui renvoient à la tradition tout en illustrant la place singulière qu’occupent les femmes poètes de la littérature yiddish moderne sont « Le premier vers d’un poème[25] » et « Prédestinations », tous deux tirés du recueil Bashertkayt [Prédestination] de Rachel Korn. Publié à Montréal en 1949, soit un an après l’émigration de la poète en Amérique du Nord, ce recueil comprend des textes rédigés entre 1928 et 1948, de sorte qu’il englobe des sujets et des motifs associés à la période faste de l’entre-deux-guerres en Europe et à celle, dévastatrice, de la Seconde Guerre et de ses suites. Ici, les deux pôles sémantiques qui structurent le recueil sont associés respectivement à l’avant et à l’après-Shoah, et puisent dans le texte biblique un socle dont jaillit le mouvement d’une parole qui poursuit son chemin (suit son cours) et ressent l’urgence d’être présente au monde. Ces textes confrontent le traducteur aux pôles de la présence et de la disparition, la « page blanche » de l’écriture renvoyant à l’anéantissement, tandis que la « chose grossière » (epes fremdn) tapie derrière la porte et « habillée d’un crépuscule gris » évoque invariablement le sentiment poignant que ressent Korn après la Seconde Guerre mondiale.
La traductrice est poussée dans ses derniers retranchements ; son travail repose également sur une fine connaissance de l’histoire juive et du récit biblique, qui s’entrelacent dans le texte. Souvent, les références bibliques sont illustrées par l’usage de l’hébreu qui s’immisce dans le yiddish, point de repère incontournable, sur le plan linguistique. Mais il y a plus. Par exemple, quand Korn écrit « chaque goutte de sang qui s’écoule déjà vers le sacrifice » [un s’flist shoyn ieder tropn blut tsu der ekeyde] (dans Ringuet, 2021b), il faut savoir que l’allusion au sacrifice est subtile : certes, il est question de la destruction de six millions de Juifs durant la Shoah, mais bien avant cette catastrophe de l’ère moderne, un « sacrifice » dont Dieu aurait permis l’avènement, il est question d’un autre sacrifice. De prime abord, l’on pourrait croire qu’il s’agit du sacrifice rituel dans le Temple de Jérusalem ; or, Korn n’utilise pas le terme hébreu korbn, qui renvoie justement au sacrifice rituel dans le Temple de Jérusalem, mais plutôt le terme ekeyde, qui fait référence, à l’origine, à la ligature d’Isaac. En ce sens, un travail d’érudition est parfois nécessaire pour que la traductrice soit en mesure de bien saisir les complexités et les nuances de certains choix précis de mots dans la poésie yiddish de Korn.
Le poème Prédestination va plus loin en ce sens. Korn devient ici l’orpheline d’un monde décimé par la Shoah, et la prédestination s’incarne dans la tradition juive ancrée à la fois dans la modernité et dans le texte biblique, « le texte germanique s’exprimant sur un arrière-fond biblique où scintillent quelques mots hébreux : “posek” (“décret”), “gzeyre” (“jugement”) » (Ringuet, 2021b), comme je l’ai écrit ailleurs. Ici encore, ce poème place la traductrice devant deux niveaux de langue, et ses connaissances bibliques sont mises à l’épreuve. Quand on lit que la mort a ignoré la locutrice et que « chaque pierre sur son chemin devient un oreiller, / chaque frontière devient une alliance qui la ramène vers [lui] » (référence), il faut comprendre que Korn a judicieusement intégré une métaphore faisant référence à Jacob, comme un éclat de lumière qui fait rayonner le texte. Dans un passage de la Genèse, on peut lire que : « Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là » (Genèse : 28.11). Le chemin de l’errance est une autre occasion de renouer avec la parole et avec le sacré, de sorte que le texte s’ouvre sur une note d’espoir grâce à la présence d'un sourire bienveillant qui accueille la vie nouvelle.
Un acte de traduction littéraire, culturelle et féministe
Que conclure sur les femmes et/en traduction dans la perspective d’un acte qui déroule le texte du yiddish vers le français dans ces cas précis? Comme le souligne Sherry Simon,
le yiddish impose des conditions de traductibilité spéciales. La langue d’une communauté tient pour référents compris toutes les évocations des traditions, des croyances et des pratiques du groupe. Une traduction de cette langue, opérée à l’extérieur de la communauté, signale un changement de lectorat : les nouveaux lecteurs, contrairement au public interne, ne sauraient comprendre sans explications les références et les allusions. La transposition du yiddish vers une autre langue impose un « abaissement de la température », selon une expression d’Irving Howe.
2008 : 144
En ce sens, le fait qu’un non-Juif traduise du yiddish vers le français représente la « valeur ajoutée de la traduction » (Simon, 2008 : 148), comme l’exprime Simon à propos des travaux d’Anctil. Agent de transmission culturelle, le traducteur inscrit donc l’histoire juive dans l’histoire globale de la ville, dont elle est une partie intégrante. Ainsi, tout en s’inscrivant dans la perspective d’une postmémoire affiliative, les traductions elles-mêmes témoignent des recoupements nouveaux entre l’histoire des Juifs et l’histoire des Québécois.
Mais il y a plus. Traduire la poésie yiddish de certaines femmes qui ont sombré dans l’oubli pour le plus grand nombre représente à mon sens à la fois un acte de traduction littéraire et culturelle et un geste féministe qui permet d’inscrire dans l’espace, mais aussi dans le temps, la voix d’une femme poète, de manière à prendre le relais d’une transmission qui a achoppé dans l’histoire. Car le travail de Korn et de Molodowsky, et les nombreux efforts qu’elles ont déployés pour faire vivre le yiddish tout en veillant à sa préservation, ne connaîtront pas de suite. C’est le grand drame de cette génération de femmes poètes de langue yiddish qui ont émigré à Montréal : Ida Maze, Chava Rosenfarb et Yudika, parmi d’autres, seront, elles aussi, acculées à ce phénomène. Par la suite, c’est par le biais des récits biographiques, dont celui de Miriam Waddington dans Apartment Seven (1989), que le monde juif survivra sous la plume des écrivaines anglophones de la génération suivante. En ce sens, la traduction du yiddish vers le français, tout en permettant de faire découvrir les textes de Korn et de Molodowsky aux lectrices et aux lecteurs dans l’espace francophone, réaffirme une vision féministe globale qui se situe au croisement de la prise de parole des femmes poètes yiddish et de l’évolution de la parole des femmes au Québec.
Appendices
Note biographique
Docteure en études littéraires, Chantal Ringuet est une écrivaine et traductrice littéraire vivant à Montréal. Elle est membre associée au CÉLAT-UQÀM et membre de l’ATTLC. Après un postdoctorat en études canadiennes à l’Université d’Ottawa (CRSH), elle a été boursière au YIVO, l’Institute for Jewish Research à New York (2015-2016), puis chercheuse en résidence au Hadassah-Brandeis Institute, MA (2016) pour un projet centré sur les poètes yiddish Rachel Korn et Kadia Molodowsky. Elle a été également traductrice en résidence au Centre international de traduction littéraire (CITL-BILTC) du Banff Centre for Arts and Creativity (2017). En octobre 2019, elle a inauguré la résidence en création littéraire à Reykjavik, ville de littérature de l’UNESCO. Elle a publié plusieurs articles et ouvrages sur la littérature et la culture juive et la traduction, dont l’anthologie Voix yiddish de Montréal (Moebius, no 139) et le dossier de poésie en traduction « Suite yiddish » (Les écrits, no 153, automne 2018). Avec Gérard Rabinovitch, elle a codirigé l’ouvrage collectif Les révolutions de Leonard Cohen (PUQ, 2016) qui a remporté en 2017 le Canadian Jewish Literary Award. Avec Pierre Anctil, elle a traduit à quatre mains l’autobiographie de jeunesse de Marc Chagall du yiddish vers le français (Chagall, Mon univers, Fides, 2017). Ses dernières publications sont « Leonard Cohen » (dans Chanteurs poètes, Plon, 2021), Alys Robi a été formidable (Québec Amérique, 2021) et Forêt en chambre (Noroît, 2022)
Notes
-
[1]
Par « langues minoritaires », j’entends les langues autres que le français et l’anglais qui ont été historiquement dévaluées, jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle, dans l’espace canadien.
-
[2]
Parmi ces traductrices, il faut mentionner Goldie Morgentaler, traductrice des oeuvres de sa propre mère, l’écrivaine de renom Chava Rosenfarb ; Shirley Kumove, traductrice de littérature yiddish et de folklore ; Vivian Felsen, traductrice des mémoires de son grand-père, le journaliste Israël Medresh ; et Faith Jones, traductrice de l’auteure moderniste Celia Dropkin et de l’écrivaine soviétique Shira Gorshman. À noter que toutes les traductions présentées dans cet article sont de moi, à moins d’indication contraire.
-
[3]
Depuis les années 1990, la majorité des ouvrages yiddish publiés à Montréal ou par des auteurs habitant Montréal ont été traduits en français par Pierre Anctil ; cependant, comme ceux-ci sont issus du début du XXe siècle, période où les femmes étaient encore peu présentes dans la littérature yiddish, on retrouve seulement quelques passages d’Ida Maze et Rachel Korn dans la biographie du poète qu’il a réalisée, Jacob-Isaac Segal.Un poète yiddish de Montréal et son milieu (2012). À part mes propres traductions d’Ida Maze, de Rokhl Korn et de Chava Rosenfarb, qui ont paru dans des anthologies, des articles scientifiques et des ouvrages spécialisés, les femmes poètes yiddish ont surtout été traduites vers l’anglais par Goldie Morgentaler (Chava Rosenfarb). Voir notamment Frieda Johles Forman (2013).
-
[4]
Dans cet article, j’utilise surtout le prénom francisé de Rokhl Korn, à savoir Rachel.
-
[5]
« the strategic use of translation as apparatus of cross-border dialogue to disseminate feminist ideas and build transnational feminist solidarities ».
-
[6]
Ce « projet d’écriture en français » qu’évoque Simon fait référence aux travaux de Pierre Anctil. « Ce mouvement du yiddish au français, sans passer par le pivot de l’anglais, crée donc un nouveau circuit de communication, activant un contact entre deux langues, quasi inexistant jusque-là. Or, de telles traductions confirment également un autre changement : elles signalent un réaménagement du territoire intellectuel. L’histoire du Montréal juif, tout comme l’histoire des autres groupes d’immigration, était considérée jusqu’aux années 1980 comme un domaine réservé aux seuls historiens anglophones. Les traductions d’Anctil, réalisées avec une grande finesse intellectuelle, s’ajoutent à un certain nombre d’autres traductions qui élargissent l’horizon de la culture québécoise francophone et rendent possibles des convergences entre des réalités juives et canadiennes-françaises. » (Simon, 2008 : 141-142)
-
[7]
« Yiddish readers fear that what is lost is not only culturally specific nuances, the tam (taste, flavor) of the original, but the history and culture of a people »
-
[8]
« the names for the constituent parts and rituals of the sabbath and the holidays, for this life and the life to come, for such religious functionaries as rabiners and rebeim and rabonim and tsaddikim »
-
[9]
À noter, l’ouvrage a été réédité à plusieurs reprises.
-
[10]
« Translators of Yiddish writers should retain both these aspects of their characters’ Jewish competence. This is not an easy task, because doing so can make the translated texts more resistant and unfamiliar to the un-comprehending Jewish or Gentile reader. But to do otherwise uproots and flattens the characters. »
-
[11]
Les propos de Carole Matheron-Ksiazenicer proviennent à l’origine d’un article publié en 1995 dans TransLittérature, no 10 : 61-63.
-
[12]
« I realized that women poets in Yiddish had been sparsely represented, received with prejudice, and only partially heard and understood by their contemporaries and mine. It seems necessary, even urgent, to bring to light — that is to read, write about and translate — as much Yiddish poetry by as many women as possible, in order to see what was there and to define and examine the traditions of writing in which women were engaged. »
-
[13]
Traduction de Simone Grossman. Voir à ce sujet Grossman (2018).
-
[14]
Traduction de Simone Grossman. Voir Grossman (2018).
-
[15]
Voir Grossman (2018).
-
[16]
Le choix de m’intéresser à ces deux poètes s’appuie sur les recherches que j’ai menées dans leur correspondance, à la fois à la Bibliothèque publique juive de Montréal, mais surtout au YIVO (Institute for Jewish Research, New York) où se trouve le fonds d’archives majeur abritant leur correspondance, et où j’ai été stagiaire postdoctorale en 2015-2016.
-
[17]
Pour consulter la bibliographie de Rachel (Rokhl) Korn, voir la page web que lui a dédiée le YIVO : https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Korn_Rokhl.
-
[18]
Voir notamment mon article « Au royaume des arbres. La forêt, tiers-espace dans la poésie yiddish de Rachel Korn » (2021).
-
[19]
Il est important de souligner que si Korn et Molodowsky ont été traduites en anglais, il n’existe que de rares traductions de leurs textes vers le français. En France, Charles Dobzynski a traduit quelques-uns de leurs poèmes dans l’Anthologie de la poésie yiddish. Le Miroir d’un peuple publiée chez Gallimard en 2001. Au Québec, mes propres traductions de Korn et de Molodowsky ont paru dans l’anthologie Voix yiddish de Montréal, Revue Moebius en 2014 ; dans le dossier « Suite yiddish » de Les écrits. Revue de l’Académie des lettres du Québec en 2018 ; dans la revue Possibles en 2019 ; et dans le projet Poésie postale en 2020. Elles ont également paru dans la revue de traduction littéraire Ellipse en 2021. Voir les références complètes en bibliographie.
-
[20]
Pour une excellente introduction à la littérature yiddish en Amérique du Nord, voir Ilan Stavans et Josh Lambert (2020).
-
[21]
Correspondance entre Rokhl Korn et Kadya Molodowsky, Archives du YIVO, New York.
-
[22]
Voir également mon recueil Forêt en chambre (2022 : 9).
-
[23]
Voir « Poèmes-femmes » de Kadia Molodowsky traduit du yiddish par Chantal Ringuet dans « Suite yiddish », dossier dirigé par Chantal Ringuet et Pierre Anctil (2018 : 68-69).
-
[24]
À propos de l’« intraduisible » et de l’« intraduisibilité », concepts qui ont fait couler beaucoup d’encre dans les études en traduction et en linguistique, voir notamment l’ouvrage collectif dirigé par Sabrina Baldo de Brébisson et Stéphanie Genty, L’intraduisible. Les méandres de la traduction (2019).
-
[25]
Fait intéressant, Korn dédie ce poème à Kadia Molodowsky, comme pour révéler le lien intime qui unissait les deux femmes à travers l’écriture.
Bibliographie
- ANCTIL, Pierre (2012), Jacob-Isaac Segal. Un poète yiddish de Montréal et son milieu, Québec, Presses de l’Université Laval.
- BALDO DE BRÉBISSON, Sabrina et Stéphanie GENTY (dir.) (2019), L’intraduisible. Les méandres de la traduction, Arras, Presses de l’Université d’Artois, coll. « Études linguistiques » [en ligne], 10.4000/books.apu.19488 (consulté le 18 juillet 2022).
- BASSNETT, Susan et André LEFEVERE (dir.) (1990), Translation, History, Culture, New York, Pinter.
- BAUMGARTEN, Jean (2002), Le yiddish. Histoire d’une langue errante, Paris, Albin Michel.
- COHEN, Madeleine (2020), « The Feminine Ending. On Women’s Writing in Yiddish, Now Available in English », Los Angeles Review of Books, 10 avril [en ligne], https://lareviewofbooks.org/article/the-feminine-ending-on-womens-writing-in-yiddish-now-available-in-english/ (consulté le 18 juillet 2022).
- Correspondance entre Rokhl Korn et Kadya Molodowsky, Archives du YIVO, New York [en ligne], http://yivoarchives.org/index.php?p=collections/controlcard&id=33054 (consulté le 18 juillet 2022).
- DOBZYNCSKY, Charles (2001), Anthologie de la poésie yiddish. Le Miroir d’un peuple, Paris, Gallimard.
- CASTRO, Olga et Emek ERGUN (2018), « Translation and Feminism », dans Jon Evans et Fruela Fernandez (dir.), The Routledge Handbook of Translation and Politics, Londres, Routledge : 125-143.
- ERTEL, Rachel (dir.) (2008), Royaumes juifs, Trésors de la littérature yiddish, vol. 1, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins ».
- ERTEL, Rachel (dir.) (2009), Royaumes juifs. Trésors de la littérature yiddish,vol. 2, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins ».
- JOHLES FORMAN, Frieda (dir.) (2013), The Exile Book for Yiddish Women Writers, Toronto, Exile Editions.
- GEPNER, Corinna (2012), Dossier « Traduire le yiddish », Translittératures, no 42, été : 35-56.
- GROSSMAN, Simone (2018), « La photographie, rituel de la postmémoire chez Marianne Rubinstein et Chantal Ringuet », Textimages, Revue d’étude du dialogue texte-image, automne [en ligne], http://revue-textimage.com/16_varia_6/grossman1.html (consulté le 18 juillet 2022).
- HARSHAV, Benjamin (1990), The Meaning of Yiddish, Berkeley, University of California Press.
- HELLERSTEIN, Kathryn (1990), « Hebraisms as Metaphor in Kadya Molodowsky’s Froyen-Lider I » dans Ellen Spolsky (dir.), The Uses of Adversity: Failure and Accommodation in Reader Response, Lewisburg, Bucknell University Press : 143-152.
- HELLERSTEIN, Kathryn (2000), « Translating as a Feminist. Reconceiving Anna Margolin », Prooftexts, vol. 20, nos 1-2, hiver-printemps : 191-208.
- HELLERSTEIN, Kathryn (2009), « Yiddish Poetry and Translation of Yiddish Poetry », dans Stephen Paul Miller et Dan Morris (dir.), Radical Poetics and Secular Jewish Culture, Tuscaloosa, University of Alabama Press : 70-78.
- HELLERSTEIN, Kathryn (2014), A Question of Tradition. Women Poets in Yiddish (1586-1987), Stanford, Stanford University Press, coll. « Stanford Studies in Jewish History and Culture ».
- HIRSCH, Marianne (1997), Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory, Cambridge, Massachusetts et Londres, Harvard University Press.
- HIRSCH, Marianne (2012), The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust, New York, Columbia University Press.
- KORN, Rachel (2014), « De l’autre côté du poème », trad. Chantal Ringuet dans Moebius, no 139, Voix yiddish de Montréal, anthologie préparée et présentée par Chantal Ringuet : 37.
- KORN, Rachel (2018), « Les anges arrivent à Jérusalem », trad. Chantal Ringuet, dans Chantal Ringuet et Pierre Anctil (dir.), Les écrits. Revue de l’Académie des lettres du Québec, no 153, dossier « Suite yiddish », automne : 70.
- KORN, Rachel (2020), « Brouillard bleu » (Bloe neplem), trad. Chantal Ringuet, Poésie postale, 6e édition, automne.
- LOTBINIÈRE-HARWOOD, Susanne de (1991), Re-belle et infidèle : la traduction comme pratique de réécriture au féminin/The body bilingual: Translation as a Re-writing in the Feminine, Montréal, Éditions du Remue-ménage.
- NORICH, Anita (2014), Writing in Tongues. Translating Yiddish in the twentieth century, Seattle, University of Washington Press.
- MATISOFF, James (2000), Blessings, Curses, Hopes and Fears: Psycho-Ostensive Expressions in Yiddish (Contraversions: Jews and Other Differences), Stanford, Stanford University Press.
- MOSELEY, Marcus (2005), Being for Myself Alone. Origins of Jewish Autobiography, Stanford, Stanford University Press, coll. « Stanford Studies in Jewish History and Culture » [en ligne], https://doi.org/10.1515/9780804763974 (consulté le 18 juillet 2022).
- RINGUET, Chantal (dir.) (2014), Voix yiddish de Montréal, Moebius, no 139, Triptyque, novembre.
- RINGUET, Chantal (2019), « Rachel Korn, Prédestinations / Bashertkayt (extraits) », Possibles, vol. 43, no 2 : 151-155.
- RINGUET, Chantal (2021), « Au royaume des arbres. La forêt, tiers-espace dans la poésie yiddish de Rachel Korn », Germanica, Presses de l’Université de Lille : 167-182 [en ligne], https://doi.org/10.4000/germanica.10101 (consulté le 18 juillet 2022).
- RINGUET, Chantal (2021b), « Rachel Korn », Ellipse, no 91 [en ligne], https://ellipsemag.ca/predestinations/ (consulté le 18 juillet 2022).
- RINGUET, Chantal (2022), Forêt en chambre, Montréal, Éditions du Noroît.
- RINGUET, Chantal et Pierre ANCTIL (dir.) (2018), Les écrits. Revue de l’Académie des lettres du Québec, no 153, dossier « Suite yiddish », automne.
- ROSENWALD, Larry (2002), « Four Thesis on Translating Yiddish Literature in the 21st Century », Pakn Treger, no 18, été [en ligne], https://www.yiddishbookcenter.org/language-literature-culture/pakn-treger/four-theses-translating-yiddish-literature-21st-century (consulté le 18 juillet 2022).
- SIMON, Sherry (1996), Gender in Translation, London, Routledge [en ligne], https://doi.org/10.4324/9780203202890 (consulté le 18 juillet 2022).
- SIMON, Sherry (2008), Traverser Montréal. Une histoire par la traduction, trad. Pierrot Lambert, Québec, Fides.
- STAVANS, Ilan et Josh LAMBERT (dir.) (2020), How Yiddish Changed America and How America Changed Yiddish, Brooklyn, Restless Books.
- VENUTI, Lawrence (2000), The Translation Studies Reader, New York, Routledge.
- VON FLOTOW, Luise (1991), « Feminist Translation: Contexts, Practices and Theories », TTR : traduction, terminologie, rédaction, vol. 4, no 2 : 69‑84.
- WADDINGTON, Miriam (1989), Apartment Seven. Essays Selected and New, Oxford, Oxford University Press.
- WEINREICH, Urile (1977), Yiddish-English Dictionnary, New York, Schocken.

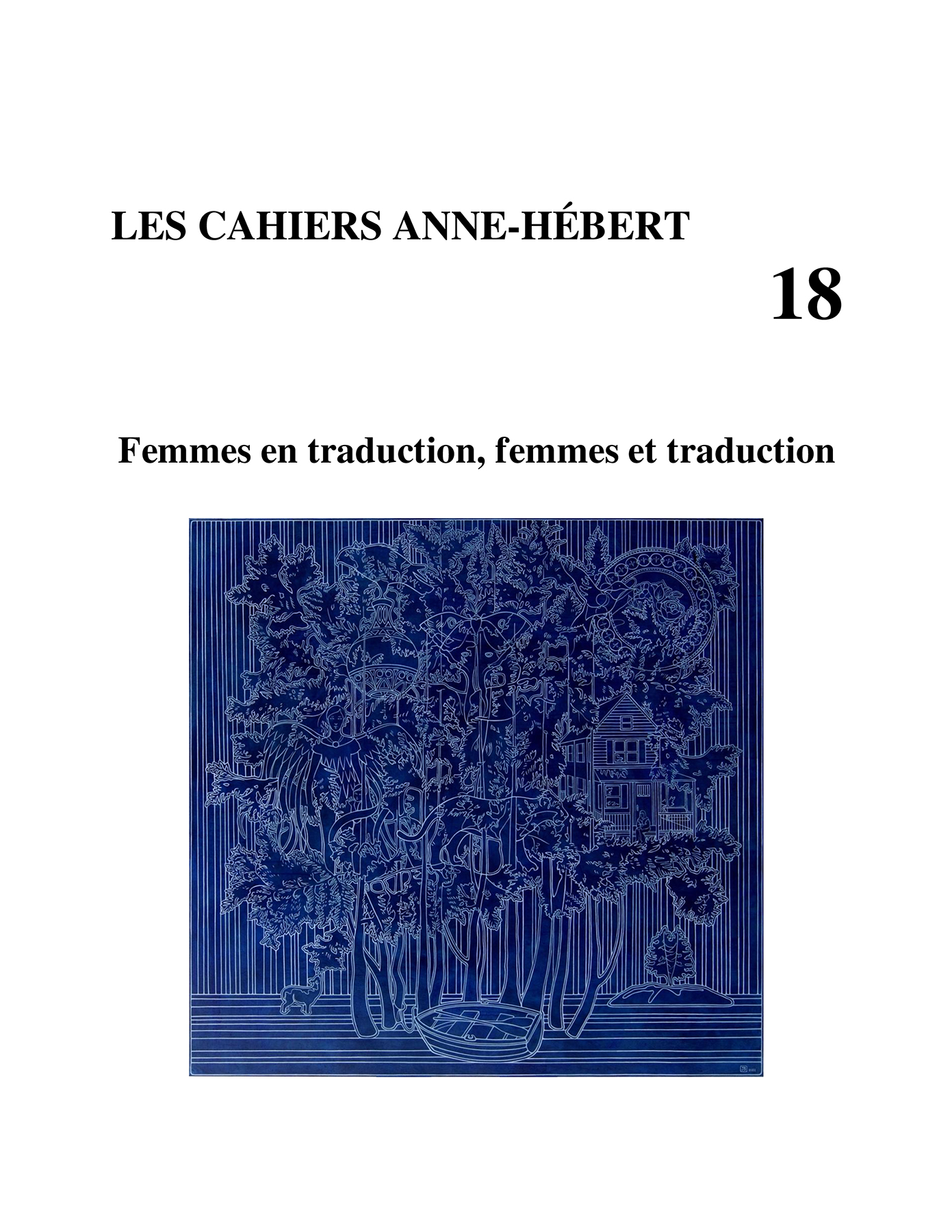

 10.7202/037094ar
10.7202/037094ar