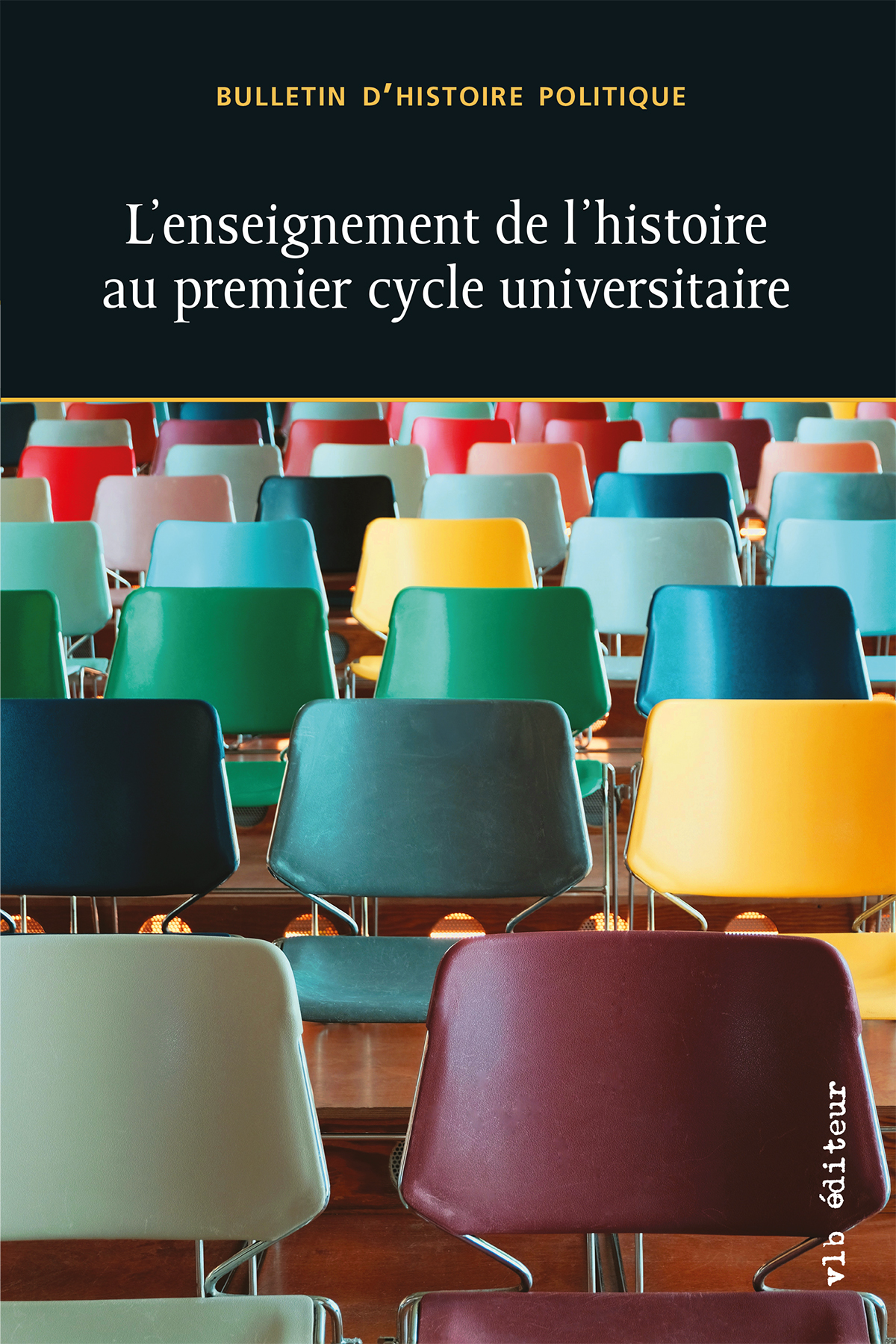Article body
Issu d’une série d’ouvrages sur l’histoire du droit de vote des femmes au Canada, l’essai Repenser la nation de Denyse Baillargeon postule que le discours nationaliste canadien-français est au coeur des débats sur le suffrage féminin, construisant la figure de la mère ménagère comme gardienne de la nation. Pour élaborer cette synthèse historique, la professeure émérite au département d’histoire de l’Université de Montréal se penche sur une multitude de sources et d’études en les soumettant aux outils analytiques développés dans les études féministes au courant des dernières décennies.
L’historienne démontre qu’au Québec, le nationalisme canadien-français est mis en opposition directe avec le suffrage féminin : pour les hommes d’Église comme ceux d’État, accorder le droit de vote aux femmes revient à mettre en péril la « race » canadienne-française et les mères qui la pérennisent au sein du foyer en produisant les futurs citoyens et en transmettant la culture nationale. Cette opposition bilatérale des élites politique et cléricale s’assoit sur la croyance que l’acquisition du suffrage féminin induirait un bouleversement des identités de genre normatives, émasculant les hommes d’un côté et virilisant les femmes de l’autre. Le nationalisme genré auquel adhèrent ces opposants se renforce d’autant plus au gré des victoires féministes dans le reste du pays. Dès lors, l’absence du droit de vote des femmes devient un gage de la particularité canadienne-française. Baillargeon soutient ainsi que, pour obtenir gain de cause, les féministes du Québec ne doivent pas tant exposer le bien-fondé du suffrage féminin que reconfigurer les discours autour de l’identité canadienne-française : elles doivent, pour ainsi dire, « repenser la nation ».
L’ouvrage est organisé de façon chronologique. La première partie (1791-1849) se penche sur l’Acte constitutionnel de 1791, qui confère, par omission, le droit de vote à certains pans de la population féminine. Seule colonie britannique où la Coutume de Paris est appliquée, le Bas-Canada offre une latitude économique aux femmes en permettant à plusieurs d’entre elles de se présenter aux urnes. Néanmoins, avec le raffermissement de l’idéologie des sphères séparées, ce droit devient de plus en plus décrié pour finalement être abrogé en 1849. Le deuxième chapitre (1880-1910) détaille plutôt la naissance du mouvement des femmes, qui, au tournant du siècle, se politise dans sa volonté de voir adopter des réformes gouvernementales. Le mouvement se formalise avec la création du Conseil local des femmes de Montréal (1893), multiconfessionnel, mais principalement anglo-protestant, et de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, franco-catholique (1907). Le premier réclame rapidement l’obtention du droit de vote aux élections montréalaises pour certains groupes de femmes et, à l’instar de la Fédération, légitime l’incursion féminine dans la sphère publique par une rhétorique maternaliste faisant valoir l’importance d’étendre une bienveillance toute maternelle à l’ensemble de la société. Dans le troisième chapitre (1910-1926), Baillargeon narre l’envol du mouvement suffragiste avec la fondation de la Montreal Suffrage Association (1913), orientée vers l’acquisition du suffrage à l’échelle fédérale, et du Comité provincial pour le suffrage féminin (1922), focalisé sur le vote dans la province. Avec le dépôt, en vain, d’un premier projet de loi en 1922, les féministes du Québec voient l’organisation d’une riposte cléricale antisuffragiste alors même que les urnes des élections fédérales leur sont déjà ouvertes depuis 1917 et 1918. Cette opposition, d’autant plus dissuasive que s’y joignent les Cercles des fermières, entraîne la mise en veilleuse des revendications, qui reprennent de plus belle en 1927, ce sur quoi se penche le quatrième chapitre (1926-1940). Celui-ci relate la distance que prennent les nouvelles associations suffragistes à l’égard du clergé. À une rhétorique maternaliste, ces groupes préfèrent l’obtention du suffrage féminin et l’acquisition de droits socio-économiques. Ils s’affairent en parallèle à rompre l’équation entre corruption de la féminité et droit de vote, une crainte qui bloque toujours le soutien de nombreuses femmes. Avec la reconfiguration des relations entre les genres qu’annonce la Deuxième Guerre mondiale, les suffragistes gagnent graduellement en popularité pour finalement obtenir gain de cause en 1940. Cependant, comme le chapitre 5 (1940 à aujourd’hui) le met en lumière, cette victoire n’en est pas une pour toutes, car les Premiers Peuples sont toujours privés du droit de vote aux élections provinciales jusqu’en 1969. L’ouvrage conclut en rappelant que, si ces combats sont remportés à force de temps, les élues et les candidates aux élections demeurent, encore aujourd’hui, sous-représentées.
L’historienne fait appel à diverses sources, dont les archives judiciaires, les archives d’institutions publiques, les archives d’associations suffragistes et la presse d’époque. Du côté des archives judiciaires, l’autrice met à profit divers textes de loi. En ce qui concerne celles institutionnelles, elle s’appuie sur les cahiers de scrutin des élections, les rapports de commissions d’enquête, les reconstitutions des débats parlementaires, les documents du Conseil du statut de la femme ainsi que les publications gouvernementales québécoises et canadiennes sur l’histoire du suffrage. Baillargeon puise également dans les archives des associations suffragistes. Quant à la presse, les journaux partisans et à grand tirage sont mis à profit, tout comme les périodiques des associations féministes et ouvrières et les revues féminines. C’est néanmoins aux études historiques et politiques réalisées entre les années 1950 et aujourd’hui que se réfère principalement l’historienne.
Baillargeon analyse cette variété de sources et d’études à travers une loupe féministe. Plutôt que de dresser une synthèse acritique des travaux déjà réalisés, elle cherche à les approcher à partir des outils analytiques développés dans les dernières décennies. L’historienne se penche sur ces écrits en s’attardant plus spécifiquement à l’idéologie des sphères séparées et au nationalisme canadien-français. En plus de porter une attention particulière à ces points phares, elle appréhende les sources en les intégrant à l’ensemble des luttes féministes, décloisonnant ainsi le suffrage pour l’insérer au sein d’un contexte élargi.
Cette minutie méthodologique n’est pas étrangère au riche foisonnement d’angles de vue que recueille Repenser la nation. Baillargeon ne manque pas de mentionner l’importance des femmes autochtones dans les gouvernances vernaculaires des Premiers Peuples et consacre le tiers du dernier chapitre aux luttes que celles-ci mènent depuis les années 1970. L’ouvrage aurait cependant gagné à intégrer les trajectoires des femmes incarcérées et vivant avec des in/capacités intellectuelles, qui, rappelons-le, n’acquerront respectivement le droit de vote aux élections provinciales qu’en 1985 et en 1989.
Somme toute, Baillargeon propose une synthèse historique complète et méticuleusement documentée. Couronné par le Prix du livre politique, Repenser la nation marque un ajout précieux à la production féministe qui nourrira assurément la réflexion tant à l’université que dans la rue. En posant les constructions genrées du nationalisme canadien-français comme pierre angulaire des débats sur le suffrage féminin, l’historienne jette un nouvel éclairage sur la manière dont le droit de vote des femmes s’est retrouvé au coeur de discours élargis sur la pérennisation de la « race » canadienne-française. Il va sans dire que l’ouvrage représente également une contribution majeure à l’histoire politique du Québec.