Abstracts
Résumé
Il existe un important argument en faveur des inégalités de richesse, à savoir « l’argument de l’incitation au travail ». Selon cet argument, les inégalités sont justes car elles motivent les riches à travailler davantage, ce qui augmente la richesse collective et améliore le sort des plus démunis – par l’investissement, l’épargne et la redistribution. Cet argument est problématique car il existe un argument parfaitement similaire qui peut être utilisé pour critiquer les inégalités. Il s’agit de « l’argument de l’envie ». Selon cet argument, les inégalités sont injustes car elles motivent les plus démunis à nuire aux intérêts des plus riches, ce qui détériore la situation économique collective. La similitude des deux arguments a pour conséquence que, si les partisans des inégalités veulent utiliser l’argument de l’incitation au travail en faveur de leur position, ils sont contraints d’admettre simultanément l’argument de l’envie à l’encontre de leur position. Pour sortir de cette situation difficile, les anti-égalitaristes avancent plusieurs arguments pour montrer que l’envie des pauvres et le besoin d’incitation au travail des riches doivent être traités différemment. Dans cet article, nous soutenons, contre les anti-égalitaristes, qu’il n’existe aucune raison de traiter différemment l’envie et le besoin d’incitation au travail.
Abstract
There is an important argument in favor of wealth inequalities, namely the “incentives argument”. According to this argument, inequalities are legitimate because they motivate advantaged people to work more, which in turn increases society’s wealth and improve the situation of the worst-off –through investment, saving, and redistribution. This argument faces a difficulty because there is a perfectly similar argument that can be used to criticize inequalities, namely the “envy argument”. According to this argument, big inequalities are unjust because they motivate the worst-off to harm the better-off, which in turn harms the economic situation of all. The similarity between the two arguments implies that, if advocates of inequality want to use the “incentives argument” to defend their position, they are forced to accept also the envy argument against their own position. To get out of this difficult situation, anti-equalitarians put forward various arguments to show that envy and motivation to work must be treated differently. In this article, we argue, against anti-equalitarians, that there is no good reason to treat envy and the need for incentives differently.
Article body
1. Les principes de justice
Une société est une entreprise collaborative dont le but est d’améliorer les conditions de vie de ses participants (Rawls, 2009, p. 159). En effet, la vie en société doit permettre d’obtenir des résultats mutuellement avantageux, c’est-à-dire des résultats meilleurs pour chacun que ce que permettrait une existence autarcique. Bien entendu, dès lors qu’est reconnu le caractère mutuellement avantageux de la vie en société, il devient nécessaire de déterminer, d’une part, la manière dont sont réparties les tâches et les charges et, d’autre part, la manière dont est redistribué le « surplus collaboratif » (Dietsch, 2008) résultant de l’organisation collective. Les « principes de justice » sont précisément les normes qui règlent la répartition des fonctions et des richesses au sein de la société. Ils fixent le contenu des objectifs sociaux et économiques et déterminent la répartition des charges et des bénéfices entre les citoyens.
La difficulté consiste alors à déterminer quels sont les « principes de justice » qui doivent régler la vie en société. Dans son ouvrage Théorie de la justice, John Rawls propose une conception de la justice selon laquelle des politiques sociales et économiques justes sont des politiques qui permettent d’améliorer la situation des personnes les plus défavorisées de la société. Le principe de justice qu’il propose consiste ainsi à « maximiser les attentes sur le long terme des plus démunis » (Rawls, 2009, p. 95-109). Cette théorie nous intéressera particulièrement dans cet article, car elle incarne parfaitement le type de théorie que nous visons par notre critique.
Selon la théorie de John Rawls, toute inégalité est a priori injuste, car aucune différence dans les capacités naturelles ou sociales (moralement arbitraire) ne peut justifier une différence dans les attentes sur le long terme des citoyens d’une même société. Il existe néanmoins, selon Rawls, une situation qui rend acceptables les inégalités dans les attentes sur le long terme ; de telles inégalités sont justes dans la mesure où elles servent d’incitations pour les plus riches à travailler davantage, ce qui permet d’augmenter la richesse collective – notamment par l’investissement, l’épargne et la redistribution.
[L]es attentes plus grandes permises aux entrepreneurs les encouragent à faire des choses qui augmentent les perspectives de la classe laborieuse[1].
Rawls, 2009, p. 109
D’après ce raisonnement, la perspective de conditions de vie supérieures à celles des moins bien lotis permet d’« inciter » les plus favorisés à déployer des efforts supplémentaires dans leur travail, ce qui est bénéfique à l’ensemble de la société. C’est pourquoi il faut les autoriser à s’enrichir davantage et à améliorer leur situation personnelle. Ces « inégalités incitatives » (Tomlin, 2008, p.110) sont donc considérées comme justes dans la perspective rawlsienne. Nommons cet argument « l’argument de l’incitation au travail ». En principe, cet argument autorise des inégalités illimitées, aussi longtemps qu’elles servent de motivation au travail[2].
Le présent article se propose de critiquer cet « argument de l’incitation au travail » avancé par Rawls – et par d’autres défenseurs des « inégalités incitatives[3] ». Pour ce faire, nous suivons la structure suivante : tout d’abord, nous montrerons qu’il existe un autre argument, ayant exactement la même structure que l’argument de l’incitation au travail, mais qui parvient à la conclusion opposée, selon laquelle de fortes inégalités sont injustes. Selon cet argument, il existe des limites à la taille des inégalités incitatives qui peuvent être considérées comme justes. Cet argument s’appelle « l’argument de l’envie », en référence à l’envie que les plus démunis éprouvent à l’égard des plus riches.
L’argument de l’incitation au travail et celui de l’envie étant parfaitement similaires, nous soutiendrons qu’ils devraient être traités de la même manière. Le premier sert de justification aux inégalités incitatives (potentiellement illimitées), le second sert à empêcher que ces inégalités (même incitatives) deviennent trop importantes, au point de générer de l’envie.
Dans un second temps, nous étudierons une objection à notre argument. Selon cette objection, l’envie et le besoin d’incitation au travail ne doivent pas être traités de la même manière, car la première est une attitude moralement condamnable, ce qui n’est pas le cas du second. Cette différence justifierait donc le fait de ne pas tenir compte de l’envie dans le choix des principes de justice, tout en tenant compte du besoin d’incitation au travail.
Dans un troisième temps nous répondrons à cette objection en argumentant que l’incitation au travail, tout comme l’envie, exprime un vice de caractère. En d’autres termes, nous soutiendrons que, si l’envie des pauvres est un vice, alors le besoin des riches d’être motivés au travail l’est aussi.
Nous envisagerons ensuite une dernière objection à notre argument, selon lequel l’envie et le besoin d’incitation au travail devraient être traités de la même manière. Selon cette critique, l’envie présente des caractéristiques (non morales) problématiques, que ne présente pas le besoin d’incitation au travail. Cette différence justifierait le choix de ne pas tenir compte de l’envie des pauvres dans nos théories politiques. Après avoir répondu à cette ultime objection, nous conclurons que les principales raisons avancées pour traiter différemment le besoin d’incitation au travail et l’envie ne sont pas concluantes. Cela implique donc que quiconque défend l’argument de l’incitation au travail pour autoriser les inégalités de richesse doit également accepter l’argument de l’envie pour imposer des limites à ces inégalités incitatives.
2. L’argument de l’incitation au travail en faveur des inégalités
Dans sa Théorie de la justice, Rawls défend l’idée que les inégalités servent de motivation pour les riches à investir leur fortune dans la société et pour les plus talentueux à déployer leurs efforts, ce qui permet simultanément d’améliorer les conditions de vie des plus démunis. La perspective d’un gain personnel, l’attente de meilleures perspectives individuelles, génère alors un accroissement du travail des plus avantagés, qui suscite une augmentation de la richesse collective, notamment par l’innovation, l’investissement, l’épargne et la redistribution, améliorant ce faisant la situation des plus démunis. Ce lien causal entre la motivation au travail des mieux lotis et l’amélioration de la situation des plus démunis implique ainsi que les inégalités (incitatives) sont favorables aux plus démunis.
Or, selon Rawls, une mesure ou une politique sociale est juste dans la mesure où elle favorise le sort des plus défavorisés (Rawls, 2009, p. 91). De ce fait, étant donné que les inégalités incitatives favorisent les plus défavorisés, en encourageant les mieux lotis au travail, le philosophe considère que ces inégalités sont justes. Le raisonnement de Rawls peut être résumé de la façon suivante :
Selon Rawls, le gouvernement doit donc autoriser les mieux lotis d’une société à augmenter leur fortune personnelle, même si cela augmente les inégalités, lorsque cette inégalité sert d’incitation au travail. En résumé, la thèse de « l’argument de l’incitation au travail » est la suivante :
L’argument de l’incitation au travail : |
Les inégalités incitatives sont justes, car elles favorisent les plus démunis, en offrant aux mieux lotis une motivation à travailler davantage. |
3. L’argument de l’envie contre les inégalités
L’argument de l’incitation au travail que nous avons exposé dans la section précédente sert de justification à certaines inégalités sociales et économiques. Cet argument rencontre toutefois une difficulté. Celle-ci provient du fait qu’il est possible de développer un argument ayant exactement la même structure, mais contre les fortes inégalités cette fois. Nous nommons cet argument « l’argument de l’envie ».
L’envie se caractérise par le fait d’éprouver des sentiments négatifs à l’égard d’une autre personne simplement parce que la situation de cette personne est meilleure que la nôtre, sans que cette inégalité ne change quoi que ce soit à notre propre situation. L’envie, sous sa forme la plus sombre, à savoir « l’envie noire », peut pousser une personne à sacrifier ses propres intérêts dans l’unique but de porter atteinte à la personne enviée (Miceli et Castelfranchi, 2005, p. 456).
Nous reprenons ainsi la définition proposée par John Rawls :
Nous pouvons […] définir l’envie comme la tendance à éprouver de l’hostilité à la vue du plus grand bien des autres, même si leur condition plus favorisée que la nôtre n’ôte rien à nos propres avantages. Nous envions ceux dont la situation est supérieure à la nôtre […] et nous voulons les priver de leurs plus grands avantages même s’il est nécessaire pour cela que nous renoncions nous-mêmes à quelque chose.
Rawls, 2009, p. 575
Dans une société très inégalitaire, le risque consiste dans le fait que les plus démunis de la société peuvent, motivés par l’envie, désirer réduire les inégalités en réduisant la fortune des riches, même si cela n’améliore pas leur propre situation, voire la détériore[5]. Autrement dit, les pauvres sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts pour réduire des inégalités[6]. On peut imaginer, par exemple, que l’envie pousse les pauvres à la révolte, suscitant ainsi des désordres sociaux désavantageux aussi pour eux-mêmes[7]. Or, à nouveau, la théorie de Rawls considère comme injuste toute règle de répartition des biens socioéconomique qui désavantage les plus démunis. De ce fait, les fortes inégalités devraient être considérées comme injustes dans sa théorie, car elles sont nuisibles aux intérêts des plus démunis eux-mêmes.
À nouveau, la structure générale d’un tel argument contre une forte inégalité pourrait être rendue de la manière suivante :
La conclusion normative de l’argument soutient que le gouvernement doit interdire des inégalités trop importantes, afin de ne pas susciter de l’envie auprès des plus défavorisés, ce qui risque d’être néfaste pour la société dans son ensemble. En résumé, « l’argument de l’envie » pourrait être exprimé comme suit :
L’argument de l’envie : |
Une forte inégalité est injuste, car elle suscite chez les plus démunis un désir de nuire aux mieux lotis, ce qui porte atteinte aux intérêts de tous les membres de la société. |
4. Une critique empirique de l’argument de l’envie
Dans cet article, nous nous demanderons si, étant admise la similarité entre l’argument de l’envie et celui de l’incitation au travail, il existe une raison de les traiter différemment. Il nous faut toutefois, au préalable, nous prémunir contre une potentielle critique empirique de l’argument de l’envie. En effet, quelqu’un pourrait arguer qu’il est tout simplement faux que de fortes inégalités, à cause de l’envie, soient néfastes pour les plus démunis. Selon cette critique, l’argument de l’envie ne fonctionne pas, car sa prémisse motivationnelle (3) est fausse ; de fortes inégalités ne créent pas d’envie et de désordres sociaux.
Cette contestation de la validité empirique de la prémisse (3) peut être développée de deux manières. La première approche affirme qu’il est faux que l’envie pousse les plus démunis à nuire aux intérêts des plus riches. Selon elle, même affectés par l’envie, les plus démunis ne répondraient pas par une révolte sociale, car ils craignent d’empirer encore leur sort[9]. Il est donc faux que les inégalités nuisent aux plus démunis, car il est faux que l’envie cause des désordres sociaux.
La seconde manière de contester la validité empirique de la prémisse (3) consiste à nier que les fortes inégalités causent de l’envie auprès des plus démunis. Au contraire, comme l’affirment certains auteurs, ce sont les faibles inégalités qui causent en réalité le plus d’envie (Ben-Ze’ev, 1992) et de perte d’estime de soi (Boudon, 1977) : les êtres humains ayant tendance à comparer leur sort avec celui de personnes qui possèdent un statut similaire, ils envient les personnes un peu mieux loties qu’eux-mêmes, mais ils n’envient pas les personnes fortement mieux loties. Il est donc faux que les fortes inégalités nuisent aux plus démunis, car il est faux que de fortes inégalités génèrent de l’envie.
Pour répondre à cette double critique empirique de l’argument de l’envie, nous avançons trois raisons de ne simplement pas en tenir compte pour la suite :
Tout d’abord, l’objection générale que nous développons dans la suite de l’article resterait valable contre Rawls et les critiques de l’égalité, même si la prémisse (3) de l’argument de l’envie était fausse. En effet, Rawls souscrit à l’idée que ce sont bien les fortes inégalités – et non les faibles inégalités – qui génèrent envie et instabilité sociale (Rawls, 2009, p. 576-579). De la même manière, lorsque les anti-égalitaristes critiquent les politiques égalitaires comme étant motivées par l’envie, leur propos porte également sur les grandes inégalités – et non sur les petites. Ainsi, les deux principales cibles du présent article, les anti-égalitaristes et Rawls, adhèrent à la prémisse empirique (3) de l’argument de l’envie. Le problème est simplement qu’ils refusent, ensuite, de considérer que cet argument peut justifier une réduction des inégalités. Or, il s’agit précisément du point que nous critiquerons par la suite : étant donné qu’ils admettent la prémisse (3), Rawls et les anti-égalitaristes n’ont pas de bonne raison de refuser l’argument de l’envie contre de fortes inégalités.
-
En second lieu, il est possible de formuler l’argument de l’envie sans référence à des désordres sociaux, sans référence au fait que l’envie pousse les pauvres à la révolte sociale. En effet, l’argument de l’envie pourrait s’accommoder d’autres relations causales entre l’envie et le sort des plus démunis.
Par exemple, au lieu de supposer que l’envie des pauvres les pousse à une agitation sociale nuisible à leurs propres intérêts, il est possible d’accepter une relation causale beaucoup plus directe; de grandes inégalités, en causant de l’envie, portent atteinte directement à la qualité de vie des plus démunis, qui font l’expérience d’une perte d’estime de soi[10]. Dans ce contexte, les fortes inégalités nuisent directement aux plus pauvres, en sapant les bases de l’estime de soi, qui est un bien essentiel à toute vie humaine réussie. Il reste donc vrai que de fortes inégalités portent atteinte aux intérêts des plus démunis, même en l’absence de troubles sociaux. L’argument de l’envie contre les fortes inégalités conserve toute sa validité.
L’argument de l’envie pourrait reposer sur encore une autre relation causale, plus indirecte, entre l’envie et le sort des plus démunis. Dans cette relation causale, l’expérience de l’inégalité amène les plus démunis, notamment au sein d’une démocratie, à nuire aux intérêts des plus riches par l’intermédiaire de leurs choix politiques – plutôt que par des troubles sociaux. Motivés par l’envie, les pauvres décident, par leurs décisions politiques, de nuire aux plus riches même si, ce faisant, ils portent atteinte également à leurs propres intérêts[11]. À nouveau, il reste donc vrai que de fortes inégalités portent atteinte aux intérêts des plus démunis, même en l’absence de troubles sociaux. L’argument de l’envie contre les fortes inégalités conserve toute sa validité.
-
Finalement, nous pourrions développer une critique empirique similaire contre l’argument de l’incitation au travail, en contestant le lien supposé entre l’augmentation des inégalités et l’augmentation de la richesse collective. En effet, certaines études empiriques montrent que, contrairement à ce qu’affirment les anti-égalitaristes, les fortes inégalités sont nuisibles à l’augmentation de la richesse collective, car elles influencent négativement la motivation des moins bien lotis à travailler (Ku et Salmon, 2012). Selon ces études, la croissance de la richesse collective diminue avec l’augmentation des inégalités, car l’effet de démotivation sur la majorité de la population présente des conséquences économiques négatives plus importantes que l’effet de démotivation sur les riches. Or, si tel est le cas, alors l’argument de l’incitation au travail se trouve complètement retourné; les personnes qu’il faut inciter au travail sont les moins bien loties, et les inégalités constituent des freins à leur motivation. Pour augmenter la richesse collective, il faudrait donc empêcher, plutôt qu’autoriser, la croissance des inégalités.
En ce sens, si nous voulions reconsidérer les bases empiriques de l’argument classique de l’envie, nous devrions également reconsidérer les bases empiriques de l’argument classique de l’incitation au travail. Dans le présent article, toutefois, nous nous intéressons à ces arguments dans leur forme classique et supposons que leurs prémisses motivationnelles respectives sont correctes.
En conclusion, même s’il était possible de contester la prémisse motivationnelle de l’argument de l’envie, il ne s’agit pas de l’élément qui nous intéresse dans cet article. Notre propos consiste simplement en ceci : une fois admise la structure de ces deux arguments, il n’existe pas de bonne raison de les traiter différemment : si l’argument de l’incitation au travail justifie de fortes inégalités, l’argument de l’envie justifie de son côté la réduction des inégalités.
5. La similarité des arguments
Nous avons vu que l’argument de l’incitation au travail sert à justifier les inégalités (incitatives). De son côté, l’argument de l’envie sert à critiquer les fortes inégalités – même incitatives. Leur étude respective montre, par ailleurs, que les deux arguments partagent exactement la même structure. En effet, tous les deux débutent avec la même prémisse normative : une politique économique ou sociale est juste si elle améliore le sort des plus défavorisés et une politique économique ou sociale est injuste si elle porte atteinte à la situation économique des plus défavorisés.
Les deux arguments accompagnent cette prémisse normative de deux prémisses descriptives. L’une concerne les effets d’un comportement particulier sur la situation matérielle des membres de la société. Dans l’argument de l’incitation au travail, il est admis que l’absence d’investissements, d’épargne et de redistribution nuit à la richesse collective. Dans l’argument de l’envie, il est admis que les désordres sociaux nuisent à la prospérité collective. La seconde prémisse descriptive concerne les motivations de certains membres de la société. Dans le premier argument, cette prémisse concerne le besoin des riches d’être motivés au travail par l’anticipation de fortes inégalités. Dans le second argument, cette prémisse motivationnelle concerne l’envie éprouvée par les pauvres, envie qui les pousse à la révolte sociale – ou qui les pousse à voter contre les intérêts des plus riches ou qui leur cause une perte du respect d’eux-mêmes. Enfin, sur la base de cette combinaison de prémisses normatives et descriptives, les deux arguments obtiennent une conclusion normative contraire : le premier soutient que les inégalités (incitatives), même importantes, sont justes, alors que le second soutient que les inégalités trop importantes sont injustes, même si elles servent d’incitation au travail. En conclusion, nous voyons que la référence à des faits au sujet des motivations humaines peut servir aussi bien à défendre qu’à critiquer les grandes inégalités sociales et économiques.
6. L’immoralité de l’envie
Étant donnée la similarité de structure entre les deux arguments, l’un en faveur et l’autre contre les fortes inégalités, accepter l’un semble contraindre à accepter l’autre. Il semble en effet difficile de justifier d’admettre l’un et de refuser l’autre, car les deux raisonnements (a) reposent sur la même prémisse normative, (b) s’appuient sur une prémisse descriptive au sujet des motivations humaines et (c) tirent une conclusion normative au sujet du caractère juste ou injuste de certaines inégalités. Pourtant, Rawls accepte de considérer le besoin d’incitation au travail des riches pour définir ce qui est juste ou injuste, mais refuse en revanche de considérer l’envie des plus démunis. En somme, John Rawls admet l’argument de l’incitation au travail mais refuse explicitement l’argument de l’envie. Comment justifie-t-il ce choix ?
La réponse de John Rawls est la suivante : l’envie est immorale alors que le besoin d’être motivé au travail n’est pas immoral. En effet, l’envie est une attitude moralement condamnable, parce qu’elle consiste à souhaiter le mal d’autrui. À l’inverse, le besoin d’être incité au travail n’est pas une attitude moralement condamnable, puisqu’elle n’implique aucun désir de nuire à autrui.
Or, selon Rawls et les critiques de l’égalité, les attitudes immorales de l’être humain ne doivent pas être prises en compte dans la définition des principes de justice. Autrement dit, les motivations moralement condamnables de l’être humain ne doivent pas influencer le choix des règles de la vie en communauté. Comme l’affirme Rawls :
[É]tant donné qu’on considère généralement l’envie comme quelque chose à éviter et à craindre […], il semble souhaitable que, dans la mesure du possible, le choix des principes ne soit pas influencé par ce trait de caractère[12].
Rawls, 2009, p. 573
Selon lui les motivations ou émotions moralement inappropriées ne doivent pas être prises en compte dans la formulation des principes de base de la vie en société. Seules les motivations et tendances humaines qui ne sont pas moralement problématiques doivent être prises en considération.
De prime abord, la position de Rawls semble intuitivement correcte. En effet, si nous considérons d’autres vices de la nature humaine, il parait indéfendable d’en tenir compte dans la formulation des principes de base de la vie en société. Imaginons, par exemple, que les êtres humains soient naturellement racistes, violents, machistes, spécistes. Doit-on, pour la seule raison que les êtres humains sont naturellement racistes, violents, machistes ou spécistes, favoriser un modèle de société autorisant le racisme, la violence, le machisme ou la maltraitance des animaux non humains ? Il semble que non. Pour toute motivation humaine, même si elle est partagée par l’ensemble des êtres humains, si cette motivation est l’expression d’un défaut moral de caractère, alors il ne faut pas en tenir compte dans le choix des principes de justice (Estlund, 2011).
En résumé, John Rawls fait une distinction entre, d’une part, les motivations humaines moralement condamnables et, d’autre part, les motivations humaines qui ne sont pas moralement condamnables. Cela lui permet de soutenir qu’il est approprié d’ignorer l’envie, mais qu’il n’est pas approprié d’ignorer le besoin d’incitation au travail dans la formulation des principes de justice. Ce faisant, il rejette l’argument de l’envie à l’encontre des inégalités et admet l’argument de l’incitation au travail en faveur des inégalités.
Une première manière de répondre à cet argument consisterait, à la suite de Tomlin (2008), à soutenir que, dès lors que nous considérons que les principes de justice doivent être adaptés à la nature humaine, alors cela ne fait aucune différence que les traits humains en question soient moralement appropriés ou non. Il s’agit dans les deux cas de faits généraux de psychologie humaine et la seule question ouverte consiste à décider si les principes de justice doivent être adaptés à de tels faits.
If we accept Rawls’s definition of envy as a fact of human psychology or society (as seems plausible), we must choose between fact-insensitive principles or envy-sensitive principles.
Tomlin, 2008, p. 102
Cependant, bien que nous rejoignions cet argument, nous développerons dans cet article une autre approche ; nous critiquerons la thèse selon laquelle l’asymétrie entre l’envie et le besoin d’incitation au travail provient d’une distinction dans leur qualité morale respective.
Nous soutiendrons ainsi que, tout comme l’envie, le besoin d’incitation au travail reflète également une attitude immorale, qu’il exprime également une disposition immorale de caractère. Il n’existe donc pas de distinction morale entre l’envie et le besoin d’incitation au travail qui justifierait de traiter différemment l’argument de l’envie et celui de l’incitation au travail.
Afin de nous prémunir contre un maximum de critiques, nous étudierons ensuite une dernière raison qui pourrait être utilisée pour justifier un traitement différent de l’envie et de l’incitation au travail. Elle consiste à montrer que l’envie, contrairement au besoin d’incitation au travail, représente mal son objet. L’envie reposerait, selon cette approche, sur une représentation erronée du réel. Comme nous le verrons, cette critique de notre thèse est infondée : elle repose sur une confusion entre deux significations du terme « approprié ».
Nous conclurons notre article par une question qui nous permettra d’élargir la portée de notre argument : une fois admis le caractère symétrique d’un appel à l’envie des pauvres et d’un appel au besoin d’incitation au travail des riches, faut-il ignorer ou intégrer ces faits psychologiques dans la définition des principes de justice ?
7. Le cas de John Rawls
Avant de continuer notre analyse, nous ouvrons une section pour traiter le cas particulier de John Rawls. En effet, bien que le philosophe refuse explicitement de tenir compte de l’envie dans la formulation des principes de justice, il accorde néanmoins à l’envie une place importante dans l’élaboration de son modèle de société idéale. Nous verrons toutefois que, parmi les stratégies adoptées par le philosophe, l’une contredit son intention de ne pas intégrer l’envie dans la définition des principes de justice, alors que l’autre rencontre le problème que nous soulevons dans cet article, à savoir le traitement asymétrique injustifié de l’envie et du besoin d’incitation au travail.
John Rawls se présente comme un partisan de l’égalité : non seulement il défend de manière inconditionnelle l’égalité des libertés et, dans un second temps, l’égalité des chances d’accès aux différentes positions sociales (Rawls, 2009, p. 91-93), mais il considère aussi comme moralement arbitraire toute inégalité de richesse fondée sur des distinctions individuelles liées à des contingences sociales ou naturelles (Rawls, 2009, p. 104-105 ; 93). Selon lui, toute inégalité dans les attentes sur le long terme est donc a priori injustifiée (Boyer, 2018, p. 142 ; Dupuy, 1988, p. 79). Le philosophe américain autorise toutefois une forme d’inégalité – celle qui améliore la situation des plus démunis. Nous l’avons vu, il s’agit de l’inégalité « incitative », qui est fondée sur la reconnaissance du besoin de l’être humain d’être « incité » à l’effort, au travail, au développement de ses talents, etc. (Rawls, 2009, p. 169)
La difficulté avec la position de Rawls au sujet de l’envie provient du fait que le philosophe traite non seulement le besoin d’incitation au travail, mais également l’envie comme une caractéristique universelle de la nature humaine (Rawls, 2009, p. 572-584 ; Tomlin, 2008, p. 106). En principe, il devrait donc également admettre explicitement que le fait de l’envie humaine justifie d’imposer des limites supérieures aux inégalités incitatives[13].
En réalité, Rawls admet une théorie de ce type-là, comme le montre Patrick Tomlin (2008, p. 112). En effet, Rawls soutient qu’il existe un seuil au-dessus duquel les inégalités incitatives, bien que permettant toujours d’améliorer la productivité des travailleurs les plus talentueux – et donc de servir les intérêts économiques des plus défavorisés – deviennent incompatibles avec une saine estime de soi (Rawls, 2009, p. 576-577). Or, l’estime ou respect de soi étant un « bien premier », il n’est jamais légitime de lui porter atteinte, même pour un accroissement de la richesse commune. En ce sens, aucune atteinte aux bases du respect de soi des pauvres n’est permise, même si cela permet d’augmenter la richesse collective. En conclusion, selon Rawls, si des inégalités incitatives importantes génèrent une envie excusable (car commune à tous les êtres humains), qui elle-même porte atteinte à l’estime de soi des plus démunis, alors ces inégalités ne sont plus légitimes.
Ainsi, Rawls admet indirectement des limites supérieures aux inégalités incitatives, limites fondées précisément sur l’envie excusable que les plus démunis éprouveraient dans une société où les grandes disparités de richesses seraient perceptibles. Toutefois, comme le fait remarquer Tomlin (2008), l’adoption de cette stratégie implique que la théorie de Rawls prête désormais le flanc à la critique des anti-égalitaristes, selon laquelle sa théorie (égalitariste) est motivée par l’envie (Walsh, 1992).
Rawls se trouve donc partagé entre deux stratégies contradictoires : d’un côté, il admet parfois que l’envie ressentie par les plus démunis – en tant qu’il s’agit d’une envie caractéristique de l’être humain – impose des limites supérieures aux inégalités incitatives, du fait de l’atteinte aux bases du respect de soi. Cette stratégie contrevient cependant à son ambition déclarée de ne pas tenir compte de l’envie dans la formulation de ses principes de justice (Ball, 1986, p. 231-232). De l’autre côté, Rawls rejette l’argument de l’envie – en arguant que l’envie exprime une déficience morale. Il doit alors reconnaitre que sa théorie ne permet pas en principe d’imposer des limites supérieures aux inégalités de richesse. Mais, surtout, il doit offrir une bonne raison de traiter différemment l’envie et l’incitation au travail ; pourquoi adapter ses principes de justice à celle-ci mais pas à celle-là ? Comme nous le verrons dans la prochaine section, l’appel à une distinction morale entre les deux attitudes est insuffisant[14].
8. L’immoralité du besoin d’incitation au travail
La critique de l’argument de l’envie, critique fondée sur le caractère moralement condamnable de l’envie, fait face à une difficulté. En effet, certains philosophes ont soutenu que, tout comme l’envie des pauvres, le besoin des riches d’être incités au travail est lui aussi moralement condamnable. En n’acceptant pas de travailler pour augmenter la richesse collective, si cela n’améliore pas suffisamment[15] leur situation personnelle, les mieux lotis commettent une faute morale.
[C]eux qui réduisent l’usage productif de leurs talents parce qu’ils ne perçoivent pas une rémunération excédant suffisamment la simple compensation de leur effort, se comportent en preneurs d’otage.
Arnsperger et Van Parijs, 2000, p. 106
Cet argument reprend un raisonnement classique développé par Gerald A. Cohen tout au long de sa carrière contre la justification rawlsienne des inégalités incitatives (Cohen, 1992; 1999; 2008). Selon Cohen, l’absence de motivation des mieux lotis à travailler pour améliorer le sort des plus démunis, sauf si cela leur permet d’améliorer suffisamment leur propre situation, met au jour le caractère vicieux des membres de cette classe sociale. Selon Cohen, en menaçant de réduire leur travail si, par exemple, les impôts sont augmentés de 40 à 60% (pour le bénéfice des plus démunis), les riches dissimulent en fait une stratégie de preneurs d’otages (Cohen, 2008, p. 59). Selon Cohen, en exigeant, en échange de leur effort supplémentaire pour améliorer le sort des plus démunis, que leurs propres conditions de vie soient augmentées d’autant plus, les plus talentueux font usage d’un chantage moralement condamnable.
Or, si le manque de motivation des mieux lotis est considéré, lui aussi, comme moralement condamnable, alors il faudrait le traiter de la même manière que l’envie. Cela impliquerait, soit de ne tenir compte ni de l’un ni de l’autre dans la formulation des principes de justice, soit de tenir compte des deux. Or, Rawls et les partisans des inégalités incitatives tiennent compte du besoin d’être motivés au travail par l’augmentation des inégalités, mais ils ne tiennent pas compte de l’envie. Cette différence de considération n’est pas justifiée.
Nous avons critiqué les auteurs qui opèrent une distinction morale entre l’envie et le besoin d’incitation au travail. En suivant Cohen, nous affirmons que le besoin d’incitation au travail est également moralement condamnable. Néanmoins, il est possible de contester notre critique de deux manières : selon la première, on contesterait simplement l’idée que le besoin d’incitation au travail des mieux lotis soit un vice. Selon la seconde, on affirmerait que l’envie possède des caractéristiques problématiques (non morales) que ne possède pas le besoin d’incitation au travail. Selon nous, ces deux réponses échouent. De ce fait, nous considérons que le besoin d’incitation au travail doit être considéré de la même manière que l’envie ; si le premier justifie certaines inégalités, la seconde justifie d’imposer des limites à ces mêmes inégalités.
8.1. L’absence de motivation au travail n’est pas immorale
Nous avons affirmé que le besoin d’incitation au travail des mieux lotis devait être traité de la même manière que l’envie, car il exprime aussi une disposition immorale. Plus précisément, il est immoral de refuser de travailler pour améliorer le sort des plus démunis si cela ne sert pas (suffisamment) nos propres intérêts, de la même manière qu’il est immoral de vouloir nuire à quelqu’un simplement parce que nous ne supportons pas la vue de sa supériorité. L’envie des pauvres et le besoin d’incitation au travail des riches sont deux attitudes immorales.
Un anti-égalitariste pourrait alors objecter que nous commettons une erreur : le besoin d’incitation au travail n’est pas immoral, contrairement à l’envie. En effet, l’envie consiste à désirer faire du tort à autrui, alors que le manque de motivation au travail n’implique aucun désir de nuisance. Une personne qui refuse de travailler si cela n’augmente pas suffisamment les inégalités n’a pas le désir malveillant de causer un tort à autrui. L’envie est ainsi une disposition malveillante alors que le besoin de motivation au travail ne l’est pas. N’étant pas immoral, le besoin de motivation au travail doit donc être pris en compte dans le choix de nos principes d’organisation sociale. En conséquence, les inégalités incitatives doivent être autorisées (sans limite) afin de motiver les riches à travailler (indirectement) dans l’intérêt commun.
Pour répondre, nous allons procéder en trois étapes : en premier lieu, nous soutiendrons qu’il n’est pas possible de départager les traits de caractère moralement problématiques de ceux qui ne sont pas moralement problématiques avant de posséder un critère de justice. Dans la définition des principes de vie collective, le critère de justice est antérieur aux distinctions morales pertinentes pour l’organisation sociale. Ces dernières ne peuvent donc pas servir de base à la définition du critère de justice, dont elles dépendent. En second lieu, nous préciserons, avec Cohen, ce qui pose problème dans l’attitude des plus riches. Pour finir, nous montrerons qu’il n’existe pas de limites au type de chantage que les riches peuvent utiliser envers les pauvres et que Rawls ne possède pas d’argument pour différencier, d’un point de vue moral, les attitudes distinctement immorales et les attitudes dont le caractère immoral apparait moins directement.
8.2. L’antériorité du critère de justice
L’objection potentielle que nous étudions affirme que l’envie est moralement problématique parce qu’elle consiste à vouloir faire du tort à autrui – quitte à nuire à ses propres intérêts – alors que le besoin d’incitation au travail n’est pas moralement problématique, car il n’implique pas d’intention de nuire. Toutefois, une telle réponse induit un changement de cadre normatif : nous passons du critère rawlsien, selon lequel la justice requiert de contribuer à l’amélioration du sort des plus démunis, à un simple critère de non-nuisance, selon lequel la justice requiert de ne pas porter atteinte au bien d’autrui. Nous avons donc changé de critère de justice.
Pourquoi ? Pourquoi le fait d’identifier l’immoralité d’une attitude par le critère de l’intention de nuire implique-t-il un changement de cadre normatif ? Pour le voir, il faut déjà reconnaitre que le sens de la justice est un sentiment proprement moral (Boyer, 2018, p. 251, 306) et que, parmi les sentiments moraux, il représente certainement le plus important pour la réalisation d’une société juste[16].
Il suffit ensuite de se demander comment nous jugerions l’envie et le besoin d’incitation au travail si nous restions dans le cadre normatif de Rawls[17]. Si nous utilisons le critère de justice proposé par John Rawls, le refus des riches de travailler davantage (en l’absence de récompenses suffisantes) et la volonté des pauvres de nuire aux intérêts des riches expriment tous deux une forme d’incapacité morale. En effet, l’envieux accepte de porter atteinte au sort des plus démunis alors que l’individu qui abaisse son effort refuse de contribuer à améliorer le sort des plus défavorisés. Dans ces deux cas, l’individu agit à l’encontre de son sens (rawlsien) de la justice. Ainsi, même s’il est possible de considérer que la faute morale est de gravité différente, il reste que les deux attitudes, l’envie et le besoin d’incitation au travail, expriment tous deux une forme de déficience morale dans la théorie de Rawls.
Par contre, si nous adoptions le critère de non-nuisance, alors nous jugerions différemment l’envie et le besoin d’incitation au travail, car la première disposition serait contraire au sens de la justice (comme non-nuisance) alors que la seconde ne le serait pas.
En résumé, si nous acceptons le cadre normatif proposé par John Rawls, alors aussi bien l’envie que le besoin d’incitation au travail représentent des attitudes moralement problématiques. En ce sens, lorsque notre objecteur soutient que nous commettons une erreur en traitant le besoin d’incitation au travail comme immoral, il change en fait de cadre normatif. En d’autres termes, il refuse le cadre normatif proposé par John Rawls. Le problème provient alors du fait que, en changeant de cadre normatif, notre objecteur modifie entièrement la discussion. En effet, cette dernière repose sur la supposition que l’argument de l’incitation au travail et l’argument de l’envie partagent la même prémisse normative. La question soulevée concerne alors le rôle de la prémisse motivationnelle dans les deux raisonnements, étant admis qu’ils partagent la même prémisse normative. En proposant de modifier la prémisse normative, notre objecteur sort du débat qui nous intéresse.
8.3. La demande de rançon
Malgré notre raisonnement précédent, il peut toujours paraître difficile de cerner la caractéristique qui rend l’attitude des riches moralement condamnable. Le problème provient du fait que l’immoralité de l’attitude des mieux lotis ne devient visible que lorsque l’argument en faveur des inégalités incitatives est formulé à la première personne, par les riches envers les pauvres. En effet, comme le souligne Cohen (2008, p. 34), lorsque l’argument en faveur des inégalités est formulé à la troisième personne, l’immoralité de l’attitude des riches n’apparait pas immédiatement.
Les inégalités économiques sont justifiées lorsqu’elles améliorent la situation matérielle des plus démunis.
Si le taux d’imposition est fixé à 40%, (a) les riches talentueux produisent davantage que lorsque le taux d’imposition est de 60% et (b) la situation des plus démunis est meilleure sur le plan matériel
Donc, la taxation des plus riches ne doit pas passer de 40% à 60%.
Dans ce raisonnement, le lien entre l’absence de récompenses suffisantes et le refus de travailler est présenté comme une loi physique indépendante de la volonté des riches. Or, il ne fait pas sens de qualifier d’immorale une loi physique.
Par contre, lorsque l’argument est formulé à la première personne, il devient évident que le lien causal entre les récompenses et la motivation au travail dépend de la volonté des mieux lotis.
Les inégalités économiques sont justifiées lorsqu’elles améliorent la situation matérielle des plus démunis.
Si le taux d’imposition est fixé à 60% au lieu de 40%, (a) nous – les riches talentueux – travaillerons moins et (b) votre situation (aux pauvres) sera détériorée.
Donc, l’imposition de notre revenu ne doit pas être augmentée à 60%.
Dans cette situation, les riches décident de ne plus contribuer au bien commun s’ils ne reçoivent pas une récompense suffisante, de la même manière qu’un preneur d’otage décide de sacrifier l’otage s’il ne reçoit pas la récompense exigée. L’application de critères moraux à l’attitude se justifie donc dans ce contexte[18]. Les plus avantageux menacent d’agir d’une manière défavorable à la société dans son ensemble si les inégalités ne sont pas suffisamment grandes, si leurs avantages ne dépassent pas suffisamment les avantages des autres citoyens.
Remarquons encore que Cohen admet tout à fait qu’il existe des situations dans lesquelles certains membres de la société ont le pouvoir de mener un tel chantage à la collectivité et aux plus démunis. Dans un tel cas, pour des raisons pragmatiques, il peut être raisonnable de « payer la rançon » et de renoncer au prélèvement d’un impôt supplémentaire. Toutefois, cela ne signifie pas du tout que cette augmentation de l’inégalité soit juste ou moralement acceptable. Au contraire, ce n’est que dans une société profondément injuste, dans laquelle les parties ne possèdent pas des pouvoirs politiques équivalents, dans laquelle des classes sociales vivent des vies séparées, qu’un tel chantage peut avoir lieu (Cohen, 2008, p. 83). Or, le fait que quelque chose soit nécessaire dans une société profondément injuste ne présente aucune implication pour définir ce qu’est une société juste.
8.4. L’absence de limites au chantage
Nous avons envisagé jusqu’à présent des individus riches et/ou talentueux qui menacent de réduire leur effort personnel dans le cas où les règles de vie commune seraient modifiées en vue de donner une part plus grande du surplus de production aux individus les plus démunis. Toutefois, rien n’exclut que nos individus bien lotis fassent usage de menaces différentes : au lieu de menacer de réduire leur temps de travail, leurs investissements ou l’usage de leurs talents entrepreneuriaux, ils peuvent menacer de tout simplement quitter le pays, ou même de dissimuler leur revenu.
C’est d’ailleurs en réponse à ces menaces que les théories économiques de la taxation optimale se sont complexifiées : il ne suffisait plus de tenir compte des effets désincitatifs de l’impôt sur la quantité de travail fourni et sur la création de richesses, il fallait désormais tenir compte des risques de fraude et de déménagement fiscal. Le fait que les riches ou talentueux pourraient décider, non seulement de baisser leur effort, mais aussi de quitter le lieu d’imposition et de dissimuler leur revenu joue ainsi un rôle déterminant, dans ces théories, pour définir un taux approprié d’imposition.
Puisque l’État souhaite retenir les hauts revenus, il doit leur offrir une compensation pour la perte d’utilité qu’ils connaissent en raison de la hausse d’impôt. […] Le coût pour les finances publiques [de la perte fiscale] s’élève au nombre de citoyens menaçant de quitter le pays multiplié par le taux d’imposition. [Cet effet négatif a pour conséquence sociale] d’accroître le poids social des agents menaçant d’émigrer : leur accorder un degré de priorité plus élevé est en effet la seule façon de leur offrir une compensation.
Trannoy et Simula, 2007
Il n’existe pas de limites à de telles pressions : toute imposition du revenu peut constituer une raison de réduire son investissement, de quitter le lieu d’imposition, de dissimuler son revenu. La prise en considération de telles menaces peut même déboucher sur une taxation supérieure des faibles revenus par rapport aux hauts revenus (Trannoy et Simula, 2007). Ces menaces ne sont pas motivées par l’idée que le taux d’imposition est injuste[19]. Il s’agit simplement de réclamer un taux d’enrichissement personnel maximal, en menaçant d’adopter un comportement nuisible à la collectivité dans son ensemble si l’on ne l’obtient pas.
Rawls pourrait tenter de répondre que les menaces de déplacement de richesse et de dissimulation de revenus ne comptent pas dans la définition des principes de justice, contrairement au besoin d’être incité au travail. En effet, selon le philosophe, nous devons définir la justice dans un contexte idéal, dans lequel les individus sont motivés à agir d’après les principes de justice (Rawls, 2009, p. 34-35). Or, les contextes de l’évasion fiscale et de déplacement de la richesse feraient partie de contextes non idéaux, dans lesquels les individus ne sont pas motivés à agir selon les principes de justice (Arnsperger et Van Parijs, 2000, p. 107).
Néanmoins, comme il devrait être désormais évident, après notre argument, des individus idéaux dans la théorie de Rawls ne décideraient pas non plus, motivés par l’idée de justice, de réduire leur temps de travail en l’absence de récompense suffisante. Dans le contexte idéal de la théorie de la justice, dans lequel les individus reconnaissent le principe de différence et agissent en fonction de lui, les riches ne choisiraient ni de réduire leur effort, ni de dissimuler leurs ressources, ni de changer de lieu d’imposition tout en sachant que cela porterait atteinte non seulement à leurs propres intérêts, mais surtout aux intérêts des plus démunis.
8.5 Le cas des dividendes
Un exemple politique récent offre l’occasion d’illustrer notre propos. En 2020, les parlementaires suisses ont eu de vifs débats, durant la crise du coronavirus, concernant le droit des entreprises de verser des dividendes à leurs actionnaires, alors que ces mêmes entreprises recevaient des aides de l’État par le biais du chômage partiel (Beauté, 2020).
Les critiques du versement de dividendes ont soutenu qu’il était immoral pour une entreprise de faire usage du chômage partiel, coûteux à la collectivité et défavorables aux travailleurs, tout en distribuant des bénéfices aux actionnaires. Mais l’argument intéressant provient surtout des défenseurs du versement des dividendes. Ils ont soutenu qu’il ne fallait pas interdire la distribution des dividendes car l’effet risquait d’être l’inverse de celui escompté : les entreprises ne renonceraient pas à la distribution de dividendes, mais renonceraient plutôt aux mesures de réduction de l’horaire de travail (RHT) et à leurs employés. Selon cet argument :
Il serait contre-productif de forcer les entreprises à choisir entre le chômage partiel et le versement de dividendes, a résumé le conseiller fédéral Guy Parmelin. […] En d’autres termes, le risque principal serait que les sociétés préfèrent licencier que de priver leurs actionnaires de rétribution.
Beauté, 2020, p. 39
À nouveau, sous prétexte d’éviter une détérioration de la situation des personnes déjà vulnérables (les employés), les parlementaires ont décidé d’autoriser un creusement des inégalités, en augmentant la rémunération du capital et en réduisant la rémunération du travail. Or, l’argument des parlementaires, qui présente le choix des entreprises comme une donnée empirique, est précisément le type d’argument condamné par Cohen. En effet, le raisonnement peut être formalisé de la même manière que les raisonnements précédents :
L’État doit protéger les plus vulnérables de la société.
Si les entreprises au bénéfice de RHT ont l’interdiction de distribuer des dividendes, alors cela nuira aux plus vulnérables de la société.
DONC l’État ne doit pas interdire la distribution de dividendes aux entreprises bénéficiant de RHT.
L’argument présente le lien entre l’interdiction des dividendes et l’effet sur la situation des plus démunis comme étant un lien causal empirique. En réalité, la relation dépend d’une décision moralement problématique, fondée sur une forme de chantage.
Si un tel creusement des inégalités est autorisé sous prétexte que « les entreprises choisiront de licencier plutôt que de verser les dividendes », ce qui nuira aux plus démunis, cela montre que les principes de répartition des charges et des avantages sont adaptés pour convenir à des attitudes injustes et immorales des mieux lotis. Dans un tel contexte, il semble difficile de justifier l’exclusion de l’envie des plus démunis dans la formulation de ces mêmes principes, en avançant pour seule raison que l’envie est immorale.
9. L’envie représente mal son objet
Pour rappel, notre thèse soutient que le besoin d’incitation au travail doit être traité de la même manière que l’envie. Dans la section précédente, nous avons nié qu’il existe une différence morale entre les deux attitudes. Une seconde critique de notre thèse consisterait à identifier une caractéristique (non morale) de l’envie, qui la rend problématique et que ne possède pas le besoin d’incitation au travail. Marc Fleurbaey avance une objection de ce type. Selon lui,
des sentiments subjectifs volatiles et malléables comme l’envie, ayant une propension à se fixer sur des objets futiles ou au contraire trop intimes, ne peuvent sérieusement inspirer l’élaboration d’institutions justes.
Fleurbaey, 1994, p. 16
Toutefois, cette caractérisation de l’envie, comme nécessairement inappropriée, c’est-à-dire comme ne représentant pas adéquatement son objet, parce qu’elle porte sur des choses « futiles et trop intimes », nous semble reposer sur le « sophisme moraliste » révélé par d’Arms et Jacobson (2000)[20].
9.1. Le sophisme moraliste
Justin d’Arms et Daniel Jacobson observent que plusieurs philosophes, partant du constat qu’il est toujours moralement inapproprié de ressentir de l’envie, concluent qu’il n’est jamais correct ou adapté de ressentir de l’envie. Un autre exemple est celui des blagues racistes : du fait que les blagues racistes sont immorales, de nombreux auteurs concluent que les blagues racistes ne sont jamais drôles. Cependant, selon d’Arms et Jacobson, ces philosophes confondent deux sens du terme « approprié » ; dans le premier sens, une émotion peut être adaptée (fitting) à son objet, dans le sens qu’elle le représente adéquatement (D’arms et Jacobson, 2000, p. 66). Ainsi, il peut être adapté ou correct (fitting) d’être amusé par une blague raciste du seul fait que la blague en question possède les caractéristiques d’une blague drôle. Il peut être adapté (fitting) d’éprouver de l’envie lorsqu’un objet est effectivement enviable, notamment lorsqu’un concurrent possède des caractéristiques favorables qui nous font défaut.
Dans un second sens, les termes approprié et inapproprié sont utilisés avec une signification proprement morale : il ne s’agit plus de savoir si l’émotion représente adéquatement l’objet, mais s’il est moralement acceptable ou inacceptable pour une personne d’éprouver cette émotion. Par exemple, il est possible qu’il soit toujours immoral (wrong) d’être amusé par une blague raciste et qu’il soit toujours immoral d’éprouver de l’envie. Cependant, le fait que rire à une blague raciste et qu’éprouver de l’envie soient toujours moralement condamnables ne permet pas de déduire que les blagues racistes ne sont jamais drôles et que nos concurrents privilégiés ne sont pas véritablement enviables. Au contraire, il est tout à fait possible que la situation d’autrui soit enviable et qu’une blague raciste soit effectivement drôle, même s’il est immoral d’envier son concurrent et d’être amusé par une blague raciste. Conclure qu’il n’existe rien d’enviable et qu’aucune blague raciste n’est drôle du fait que l’envie et l’amusement à l’égard des blagues racistes sont des émotions immorales revient à commettre un « sophisme moraliste ».
[To] commit [a] moralistic fallacy is to infer, from the claim that it would be wrong or vicious to feel an emotion, that it is therefore unfitting. We shall contend, to the contrary, that an emotion can be fitting despite being wrong (or inexpedient) to feel.
D’arms et Jacobson, 2000, p. 69
Pour mieux comprendre ce « sophisme moraliste », nous étudierons, dans la prochaine section, deux exemples proposés par d’Arms et Jacobson. En comparant un exemple où le caractère fallacieux du raisonnement est peu visible avec un exemple où le caractère fallacieux est évident, nous prouverons que la condamnation de l’envie comme représentant mal son objet n’est pas justifiée: elle repose sur un « sophisme moraliste ».
9.2 Illustrations du sophisme moraliste
Voici deux autres exemples de « sophisme moraliste » proposés par d’Arms et Jacobson qui illustrent le glissement fallacieux entre le jugement qu’une attitude est moralement condamnable au jugement que cette attitude est inappropriée, dans le sens qu’elle représenterait faussement son objet, par exemple en attribuant à cet objet des caractéristiques qu’il ne possède pas en vérité.
L’exemple de la jalousie
(P1) |
Il est moralement inapproprié de ressentir de la jalousie à l’égard de l’être aimé. |
(C) |
Par conséquent, la jalousie n’est jamais appropriée (fitting). Elle représente l’être aimé de manière inadaptée, c’est-à-dire d’une manière qui ne correspond pas à la réalité. Ainsi, dans la jalousie, l’être aimé est représenté comme étant une possession, alors que les êtres humains ne sont jamais la possession de personne. |
L’exemple du chagrin
(P1) |
Il est moralement inapproprié, pour une jeune femme devenue veuve récemment, de ressentir trop de chagrin, car elle doit s’assurer que ses enfants continuent de vivre, sans trop de traumatisme. |
(C) |
Par conséquent, il n’est pas triste de perdre son époux. La tristesse n’est pas une réponse appropriée à la perte de son conjoint |
Dans l’exemple de la jalousie, le caractère fallacieux de l’argument n’apparait pas immédiatement. Au contraire, il peut être tentant de considérer que, étant donné que la jalousie est moralement condamnable, alors la jalousie est une émotion qui est toujours incorrecte ou inadaptée : elle attribue à l’objet jalousé une propriété que l’objet, en fait, ne possède pas.
[W]hen an emotion seems morally incorrigible, philosophers are tempted to convict it of some gross error […]. For example, some philosophers have attributed to jealousy the claim that the beloved is a thing capable of being possessed; or that any amount of the beloved’s affection given to another diminishes the lover’s share. Although these are contrary interpretive mistakes, we think that they betray a common impulse. The temptation to pretty up some emotions and to dumb down others are both symptoms of a psychological tendency which we will call moralism.
D’arms et Jacobson, 2000, p. 75
En revanche, dans l’exemple du chagrin, il apparait immédiatement que la conclusion ne suit pas la prémisse : les raisons morales de ressentir ou non une émotion telle que le chagrin ne permettent pas d’évaluer si l’émotion est adaptée à son objet. La perte d’un être aimé est effectivement un événement triste, c’est-à-dire un événement à l’égard duquel il est adapté de ressentir de la tristesse. Le fait que, dans certaines circonstances, nous avons le devoir moral de ne pas nous laisser aller à notre chagrin n’affecte en rien le fait que notre chagrin représente adéquatement l’objet.
Selon nous, l’argument de Fleurbaey contre l’envie constitue un cas de sophisme moraliste. En effet, il soutient que les personnes envieuses ont toujours une conception erronée de l’objet de leur envie. Mais du fait que l’envie est une émotion moralement condamnable, il ne s’ensuit pas, nous l’avons vu, qu’elle est une émotion qui représente faussement son objet. Lorsque les plus démunis éprouvent de l’envie envers les plus riches, leur émotion peut bien être moralement condamnable, mais il reste vrai que leur émotion représente adéquatement son objet : les riches possèdent des avantages qui manquent aux pauvres.
En conclusion, le seul reproche légitime à l’encontre de l’envie est qu’elle est immorale. Or, le même reproche peut être formulé à l’encontre du besoin d’incitation au travail. De ce fait, nous devons traiter ces deux attitudes de la même manière dans nos théories politiques.
10. Conclusion
Jusqu’à présent, nous avons vu qu’il existe deux arguments de même structure, fondés tous les deux sur une prémisse normative, une prémisse descriptive et une prémisse motivationnelle, qui parviennent à des conclusions normatives contraires concernant les inégalités. Nous avons soutenu qu’il n’existe pas de raisons de traiter ces deux arguments différemment. Nous avons vu ensuite qu’il est possible de contester notre thèse, soit en montrant que l’envie possède des caractéristiques non morales problématiques, soit en montrant que le besoin d’incitation au travail n’est pas moralement condamnable. Nous avons répondu à ces objections et nous soutenons donc toujours la thèse selon laquelle l’argument de l’envie et l’argument de l’incitation au travail sont équivalents. Si nous tenons compte du besoin d’incitation au travail dans le choix des principes de justice, alors il faut tenir compte aussi de l’envie.
Nous avons fait porter notre critique principalement sur la théorie de John Rawls, du fait que l’auteur admet explicitement la thèse que nous critiquons, à savoir l’acceptation de l’argument de l’incitation au travail et le rejet de l’argument de l’envie. Toutefois, notre propos porte plus largement sur toute théorie qui ferait appel à l’argument de l’incitation au travail pour justifier des inégalités : une telle théorie devrait simultanément faire appel à l’argument de l’envie pour imposer des limites aux inégalités. Par exemple, un utilitariste qui justifie les inégalités par l’augmentation des richesses collectives qu’elles permettent devrait aussi intégrer les effets négatifs des inégalités sur le bien-être des plus démunis (envieux). De la même manière, un théoricien qui condamne les théories égalitaires comme étant motivées par l’envie ne peut pas, simultanément, justifier les inégalités par leurs effets incitatifs sur le travail.
Nous sommes ainsi parvenus, au terme de notre analyse, à une conclusion conditionnelle : si le besoin d’incitation au travail des plus talentueux justifie une augmentation des inégalités (incitatives), alors l’envie des plus démunis justifie qu’il existe des seuils à ces inégalités. La question qui reste ouverte est alors la suivante : faut-il ou non intégrer l’incitation au travail et l’envie dans la définition des principes de justice ? En termes plus généraux, faut-il tenir compte des motivations humaines générales dans la définition des règles de vie en société ?
Il existe une raison générale de vouloir tenir compte des tendances naturelles de l’être humain dans l’élaboration de modèles sociaux : le fait qu’un modèle de société doit être humainement réalisable, c’est-à-dire qu’il doit être possible sans trop de difficulté, pour un être humain normal, de se conformer aux règles générales de la vie en société (Estlund, 2011; Nurock, 2011; Scheffler, 1992).
S’il est trop difficile, pour un être humain, de vivre selon les règles d’un modèle social donné, alors ce modèle est considéré soit comme irréalisable, soit comme inhumain. Dans le premier cas, le modèle est considéré comme utopiste, dans le sens qu’il ne pourra jamais être réalisé dans les conditions physiques, économiques et psychologiques que nous connaissons. Dans le second cas, il est considéré comme cruel et inhumain, dans le sens qu’il n’est réalisable qu’au prix de grands sacrifices et de grandes souffrances de la part des citoyens. Dans les deux cas, un modèle politique qui ignore les tendances fondamentales de la nature humaine est considéré comme déficient. Il ne respecte pas la « contrainte humaniste », selon laquelle tout système normatif doit tenir compte des tendances fondamentales de la nature humaine (Ogien, 2001).
La contrainte humaniste |
Une théorie politique normative est défectueuse et donc fausse si elle impose des standards ou exigences qui ignorent la nature humaine (Estlund, 2011, p. 208). |
Nous avons admis que l’envie fait partie des tendances fondamentales de la nature humaine. Selon la « contrainte humaniste », il s’ensuit que seuls les systèmes politiques qui tiennent compte de cette tendance naturelle sont humainement réalisables. De ce fait, les systèmes politiques qui ignorent la tendance des pauvres à envier les riches sont des systèmes sociaux, au mieux, irréalistes, au pire, inhumains. C’est pourquoi les modèles (trop) inégalitaires de la vie en société doivent être rejetés.
Nous avons également admis que le besoin d’incitation au travail fait partie des tendances fondamentales de la nature humaine. Selon la « contrainte humaniste », il s’ensuit que seuls les systèmes politiques qui tiennent compte de cette tendance naturelle sont humainement réalisables. De ce fait, les systèmes politiques qui ignorent la tendance des êtres humains à réduire leur effort en l’absence de récompense individuelle suffisante sont des systèmes sociaux irréalistes, voire inhumains. C’est pourquoi les modèles égalitaires de la vie en société doivent être rejetés.
Dans le même ordre d’idée, les systèmes politiques collectivistes ont été critiqués pour ignorer le fait que l’être humain est incapable de renoncer complètement à son intérêt personnel.
Les théoriciens du socialisme soviétique avaient primitivement supposé que leur système pouvait se passer des stimulants qui se font valoir dans une économie libre et dont la plupart tiennent à l’égoïsme de l’individu. Ils avaient cru pouvoir les remplacer par l’enthousiasme et la conscience socialistes. Cette conception s’est bientôt heurtée aux données réelles de la nature humaine qui est loin d’être guidée par une abnégation sublime.
Kende, 1959
La « contrainte humaniste » peut être utilisée pour critiquer encore d’autres modèles de société, en faisant appel à d’autres tendances de la nature humaine que l’envie et le besoin d’incitation au travail. Par exemple, l’utilitarisme peut être rejeté comme infaisable ou inhumain du fait qu’il requiert des êtres humains d’accorder la même valeur à leurs proches qu’à des étrangers, ce que les êtres humains sont incapables de faire. De la même manière, l’ascétisme peut être critiqué comme infaisable ou inhumain du fait que cette éthique exige de renoncer à tout plaisir, ce qui est contraire à la nature humaine (Bentham, 1996). La théorie politique de Platon peut, elle aussi, être condamnée comme irréaliste ou inhumaine, du fait qu’elle exige des parents d’abandonner leurs enfants au soin de l’État, ce qui s’oppose à l’amour particulier que les parents éprouvent à l’égard de leurs propres enfants[21]. La « contrainte humaniste » peut ainsi être utilisée pour critiquer une grande variété de théories morales et politiques.
Pour décider, finalement, si le choix d’un modèle de société doit tenir compte de l’envie et du besoin d’incitation au travail, il faudra déterminer si la « contrainte humaniste » est valide ou non. Il existe, selon nous, de bonnes raisons de penser que la contrainte humaniste n’est pas valide, lorsqu’elle porte sur les motivations humaines. Mais nous ne pouvons pas défendre cette position dans le présent article. Pour le moment, il nous suffit d’avoir tracé la direction à suivre pour répondre à la question fondamentale : l’envie des pauvres justifie-t-elle de réduire les inégalités ?
Appendices
Notes
-
[1]
Cet argument trouve dans la littérature différentes formulations. Par exemple : « Du fait [des] différences de productivité, il arrive un moment où une politique de transfert des plus productifs vers les autres décourage les premiers de produire, réduit donc ce qui est transférable, et finit par nuire aux plus défavorisés, la recherche de plus de justice se retournant contre elle-même. » (Dupuy, 1988, p. 82)
-
[2]
L’argument de l’incitation au travail sert à justifier les inégalités dans la théorie de Rawls, mais il peut également servir à justifier les inégalités dans d’autres théories. Par exemple, dans la doctrine utilitariste, si « l’anticipation d’inégalités substantielles incite les membres de la société à travailler, épargner ou investir davantage au bénéfice du bien-être global accessibles aux générations présentes et futures » (Arnsperger et Van Parijs, 2000, p. 25), alors ces inégalités sont justifiées (Ball, 1993, p. 179). La thèse de notre article concerne donc les doctrines politiques au-delà de Rawls.
-
[3]
La justification des inégalités comme « incitation au travail » constituait un argument important de la théorie de l’économie de Friedrich Hayek (Hayek, 2006 (1960)) et du programme politique anti-égalitariste de Margareth Thatcher (Cohen, 2008, p. 28-29)
-
[4]
Sous condition que l’égalité des libertés et l’égalité des chances soient réalisées au préalable.
-
[5]
Les pauvres, motivés par l’envie, préfèrent vivre dans une société pauvre plutôt que dans une société où les richesses sont inégalement partagées (Schoeck, 2006; Schwarz, 2004). Selon de nombreux auteurs, l’envie est même l’unique motivation des défenseurs de l’égalité (sur ce sujet voir (Tomlin, 2008). Dans l’histoire de la philosophie politique, la charge contre l’égalité, comme étant basée sur l’envie, a été soutenue de manière plus ou moins explicite par Aristote (2014), Nietzsche (1908), Freud (1921) ou Nozick (1974). Pour d’autres références, voir l’article de Robert Young (1987) (1987) et celui de Florent Guénard (2008).
-
[6]
L’envie est problématique car elle incite au « nivellement vers le bas » de l’économie en général. Dans la littérature philosophique, Derek Parfit a lancé une importante discussion au sujet de l’objection du « nivellement vers le bas » associé à l’égalitarisme (Parfit, 1997).
-
[7]
Comme le soutien Tomlin (2008, p. 103), l’envie soulève un problème de stabilité lorsque, comme dans la théorie de Rawls, il n’existe pas de limites de principe à la dimension des inégalités. S. Ball soutient aussi que la théorie de John Rawls n’admet pas de limites de principe aux inégalités incitatives : « The difference principle by itself contains no permanent, theoretical boundaries for monitoring the extent of inequality that may satisfy this general formula ; just as long as the poor would be poorer if the rich were not so rich, there has been no violation of Rawls’s criterion regardless of how much, or how little, economic stratification results. » (Ball, 1986, p. 277)
-
[8]
Nous admettons que les désordres sociaux empêchent l’investissement, le travail salarié, portent atteinte à la propriété, etc., ce qui rend impossibles les bénéfices collectifs censés provenir de l’investissement, du salariat, de l’épargne, etc.
-
[9]
Comme le remarque Stephen W. Ball, l’histoire montre plutôt que les plus démunis ne cesseront pas de collaborer avec les mieux lotis, même s’ils jugent leur propre situation injuste et qu’ils éprouvent du ressentiment – sentiment hostile qui, contrairement à l’envie, est un sentiment propre moral (Rawls, 2009, p. 576) : « On the other hand, as an empirical matter, there appears to be much evidence that the less favoured will in fact cooperate in socioeconomic systems they find less than just, or perhaps even entirely ‘unreasonable’. Historically, […] it seems that the least advantaged socioeconomic classes may easily be, and often are, induced to cooperate in unreasonable (unfair, and certainly unRawlsian) circumstances, if only because they think (whether or not it is true) that things could get still more unreasonable for them if they do not cooperate. » (Ball, 1993, p.172)
-
[10]
Nous verrons que Rawls lui-même étudie cette relation causale directe (Rawls, 2009, p. 576-577), ce que son rejet de l’envie lui interdirait en toute cohérence de faire (Tomlin, 2008).
-
[11]
Les critiques des sentiments égalitaristes (motivés par l’envie) font souvent référence à des réformes politiques pour illustrer les effets néfastes de l’envie : « En Europe, dans un passé certes lointain, les villes indépendantes de Bâle, Berne et Zurich légiféraient pour limiter les dépenses luxueuses, tant sur les vêtements et les festins que sur les enterrements et les mariages, rappelle l’auteur. Il a fallu « l’esprit de Voltaire » pour associer la foi dans le progrès à une réflexion sur le luxe, et notamment l’idée que le luxe de quelques-uns pouvait fournir du travail à un grand nombre. » (Temps, 2013).
-
[12]
Ou encore : « [Les] vices sont des traits dont on ne veut pas, la malveillance et l’envie en étant des exemples clairs car nuisibles à tous » (Rawls, 2009, p. 576).
-
[13]
Rawls pourrait bien sûr invoquer d’autres considérations pour placer des limites supérieures à la taille des inégalités légitimes. Par exemple, si de fortes inégalités permettent aux mieux lotis d’acquérir un pouvoir politique de fait supérieur au reste des citoyens, cela violerait le premier principe de justice, selon lequel les libertés politiques doivent être également partagées (Boyer, 2018, p. 33; Green, 2013, p. 133). Notre questionnement se concentre toutefois sur l’argument de l’envie et critique le choix de Rawls de ne pas tenir compte de cet argument précisément en faveur des restrictions des inégalités.
-
[14]
Les rawlsiens soutiennent que, dans la Théorie de la justice, même s’il n’existe pas en droit de limite supérieure à la dimension que peuvent prendre les inégalités incitatives, les inégalités incitatives ne seront jamais en fait trop importantes. En effet, la priorité des principes d’égalité des chances et d’égale liberté garantit que personne n’aura la capacité de s’enrichir d’une manière qui soit nuisible à la cohésion sociale (Boyer, 2018, p. 144; Rawls, 2009, p. 188-189). Par ailleurs, même si de grandes inégalités existaient, la liberté d’association garantirait que ces inégalités ne soient jamais « visibles » pour les plus démunis, et qu’ainsi elles ne nuisent pas à leur estime d’eux-mêmes (Tomlin, 2008, p. 105; Rawls, 2009, p. 579). Pour finir, dans la société rawlsienne, chacun possède un statut égal et une importance égale, ce qui empêche les individus d’éprouver le mépris de soi qui est à l’origine de l’envie (Boyer, 2018, p. 282; Rawls, 2009, p. 578).
-
[15]
« Suffisamment » signifie ici, en accord avec la littérature sur ce thème : « au-delà de la compensation pour l’effort, qui elle sert uniquement à égaliser les situations ».
-
[16]
La description de l’attitude des mieux lotis comme consistant en un « besoin », en une nécessité, proche du besoin physique ou physiologique ne correspond pas aux situations qui constituent notre terreau d’analyse. En effet, comme le remarque Cohen (2008, p. 49), il est possible que le plein développement des talents des mieux lotis exige que ceux-ci aient accès à des loisirs plus onéreux. Toutefois, l’accès à de tels loisirs ne requiert pas les (fortes) inégalités dont nous discutons dans ces lignes. En effet, nous nous intéressons dans ces lignes à des inégalités d’une ampleur qui dépasse la simple compensation de l’effort ou de l’investissement. Mieux qu’un besoin d’incitation, le concept de « désir d’inégalité », symétrique à la « haine des inégalités » caractéristique de l’envie, représente mieux la situation, comme nous le verrons plus loin. Dans le même sens, dans le domaine des inégalités de rémunérations, Robichaud et Turmel soutiennent que « l’effet de la rémunération sur la motivation permet de justifier certaines inégalités salariales, mais certainement pas de l’ampleur de celles que nous connaissons aujourd’hui » (Robichaud et Turmel, 2014).
-
[17]
D’ailleurs, John Rawls lui-même définit les vices moraux comme les attitudes que nous ne souhaiterions pas trouver chez nos partenaires de société. De ce point de vue, il est à notre avis peu clair pourquoi le refus des riches à oeuvrer pour le bien commun (en l’absence d’une augmentation suffisante des inégalités) ne pourrait pas appartenir à la catégorie des vices. En effet, ce refus de travailler n’est pas une caractéristique qu’il est souhaitable de vouloir trouver chez ses partenaires de travail (Rawls, 2009, p. 477).
-
[18]
Sigwick aussi perçoit une attitude moralement condamnable chez les riches, lorsque ceux-ci exigent de recevoir « une plus grande part que tout le monde » pour contribuer au bien commun: « The argument is, I think, decisive from a political point of view, as a defence of a social order that allows great inequalities in the distribution of wealth for consumption. [But] . . . when we have decided that the toleration of luxury as a social fact is indispensable to the full development of human energy, the ethical question still remains for each individual, whether it is indispensable for him; whether, in order to get himself to do his duty, he requires to bribe himself by a larger share of consumable wealth than falls to the common lot. (Sidgwick 1998, p. 108-9) » Citation de Sigwick dans (Thomas, 2011, p. 1113).
-
[19]
Si la menace était motivée par un sentiment d’injustice, nous ne discuterions plus de la justification des inégalités par leur seule contribution à la motivation à travailler, mais nous discuterions d’autres justifications des inégalités.
-
[20]
Notons que John Rawls ne pourrait pas recourir à un argument du type avancé par Fleurbaey pour justifier son traitement différencié de l’envie et de la motivation au travail. En effet, Rawls aborde uniquement le cas de l’envie générale, qui concerne « le genre de biens que [les plus avantagés] possèdent et non […] des objets particuliers » (Rawls, 2009, p. 174). Selon Rawls, l’envie particulière étant, précisément, spécifique à des individus particuliers, elle ne peut pas jouer de rôle dans la définition des principes de justice. Seules les caractéristiques générales – non particulières – des êtres humains constituent des raisons d’adapter les principes de justice (Rawls, 2009, p. 169). L’argument de Fleurbaey doit donc être analysé indépendamment de la théorie de John Rawls.
-
[21]
« It would be supremely difficult for many parents to surrender their infant children to be raised by the state. […] [H]umans cannot bring themselves to surrender their children and so, for that reason, [many consider that] justice does not require it. » (Estlund, 2011, p. 221).
Bibliographie
- Aristote, Éthique à Nicomaque, Traduit par Richard Bodéüs, Paris, Vrin, 2014.
- Arnsperger, Christian, et Philippe Van Parijs, Ethique économique et sociale, Paris, La Découverte, 2000.
- Ball, Stephen W., « Economic Equality: Rawls Versus Utilitarianism, » Economics and Philosophy, 1986, p. 225-244.
- Ball, Stephen W., « Maximin Justice, Sacrifice, and the Reciprocity Argument: A Pragmatic Reassessment of the Rawls/Nozick Debate, » Utilitas, vol. 5, no. 2, 1993, p. 157-184.
- Beauté, Bertrand, « Dividendes: le geste qui passe mal, » Swissquote, Décembre 2020, p. 38-39.
- Bentham, Jeremy, The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Moraly and Legislation, Oxford, Clarendon Press, 1996.
- Ben-Ze’ev, Aaron, « Envy and inequality, » The Journal of Philosophy, 1992, p. 551–581.
- Boudon, Raymond, « The Logic of Relative Frustration, » in Raymond Boudon (dir.), The Unintended Consequences of Social Action, London, Palmgrave Macmillan, 1977.
- Boyer, Alain, Apologie de John Rawls, Paris, PUF, 2018.
- Cohen, Gerald A., If You Are An Egalitarian, How Come You Are So Rich?, Cambridge, Harvard University Press, 1999.
- Cohen, Gerald A., Incentives, Inequality and Community, The Tanner Lectures on Human Values, Salt Lake City, 1992, p. 261-329.
- Cohen, Gerald. A., Rescuing Justice and Equality. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2008.
- D’arms, Justin, et Daniel Jacobson, « The Moralistic Fallacy: On the Appropriateness of Emotions, » Philosophy and Phenomenological Research, 2000, p. 65-90.
- Dietsch, Peter, « Distributive Lessons from Division of Labour, » Journal of Moral Philosophy, 2008, p. 96-117.
- Dupuy, Jean-Pierre, « Les paradoxes de la “Théorie de la justice”: Introduction à l’oeuvre de John Rawls, » Esprit, 1988, p. 72-84.
- Estlund, David, « Human Nature and the Limits (If Any) of Political Philosophy, » Philosophy and Public Affairs, vol. 39, no. 3, 2011 p. 207-237.
- Fleurbaey, M., « L’absence d’envie dans une problématique “post-welfariste”, » Recherches économiques de Louvain, vol. 60, no. 1, 1994, p. 9-41.
- Freud, Sigmund, Massenpsychologie und Ich-Analyse, Leipzig, Wien, Zürich, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1921.
- Green, Jeffrey E., « Rawls and the Forgotten Figure of the Most Advantaged in Defense of Reasonable Envy, » American Political Science Review, 2013, p. 123-138.
- Guénard, Florent, « L’égalité ou l’envie: les passions dans la politique selon Walzer, » Cahiers philosophiques, 2008, p. 81-94.
- Hayek, Friedrich, The Constitution of Liberty, London, Routledge, 2006 (1960).
- Kende, Pierre, « L’intérêt personnel dans le système d’économie socialiste, » Revue économique, 1959.
- Ku, Hyejin, et Timothy C. Salmon, « The Incentive Effects of Inequalities: An Experimental Investigation, » Southern Economic Journal, vol. 79, no. 1, 2012, p. 46-70.
- Le Temps, « L’envie, la jalousie, l’égalité, » Le Temps, 2013.
- Miceli, Maria, et Christiano Castelfranchi, « The Envious Mind, » Cognition and Emotion, 2005, p. 449-479.
- Nietzsche, Friedrich, La généralogie de la morale, Paris, Société du Mercure de France, 1908.
- Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia, Oxford, B. Blackwell, 1974.
- Nurock, Vanessa, Sommes-nous naturellement moraux?, Paris, Vrin, 2011.
- Ogien, Ruwen, « Le Rasoir de Kant, » Philosophiques, 2001, p. 9-25.
- Parfit, Derek, « Equality or Priority, » Ratio, 1997, p. 202-221.
- Rawls, John, Théorie de la justice. Traduit par Catherine Audard. Paris, Seuil, 2009.
- Robichaud, David, et Patrick Turmel, « Les hauts revenus des chefs d’entreprise sont-ils justifiés ?, » Éthique publique, vol. 16, no. 2, 2014.
- Scheffler, Samuel, Human Morality, New-York, Oxford University Press, 1992.
- Schoeck, Helmut, L’envie. Une histoire du mal, Paris, Les Belles Lettres, 2006.
- Schwarz Gerhard et Robert Nef, Die Neidökonomie. Wirtschaftspolitische Aspekte eines Lasters, Zürich, NZZ-Verlag, 2004.
- Thomas, Alan, « Cohen’s Critique of Rawls: A Double Counting Objection, » Mind, vol. 120, no. 480, 2011, p. 1099-1141.
- Tomlin, Patrick, « Envy, Facts and Justice: A Critique of the Treatment of Envy in Justice as Fairness, » Res Publica, 2008, p. 101-116.
- Trannoy, Alain et Laurent Simula, « Imposition optimale sur le revenu et théorie des incitations: un chassé-croisé, » Regards croisés sur l’économie, 2007, p. 182-199.
- Wade, Robert H., « Should We Worry about Income Inequality? » International Journal of Health Services, 2006, p. 271-294.
- Walsh, George V., « Rawls and Envy, » Reason Papers, 1992, p. 3-27.
- Young, Robert, « Egalitarianism and Envy, » Philosophical Studies, 1987, p. 261-276.

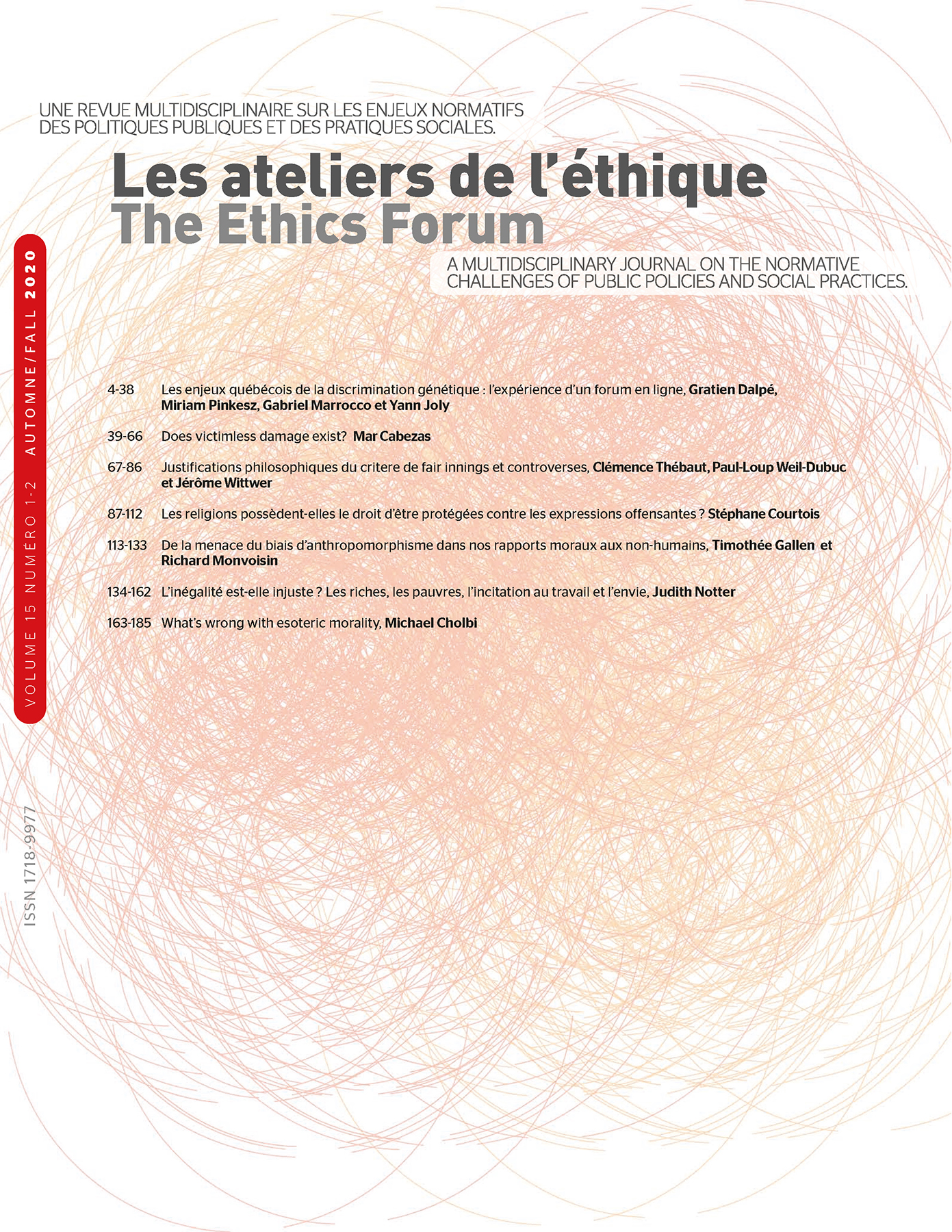



 10.7202/004963ar
10.7202/004963ar