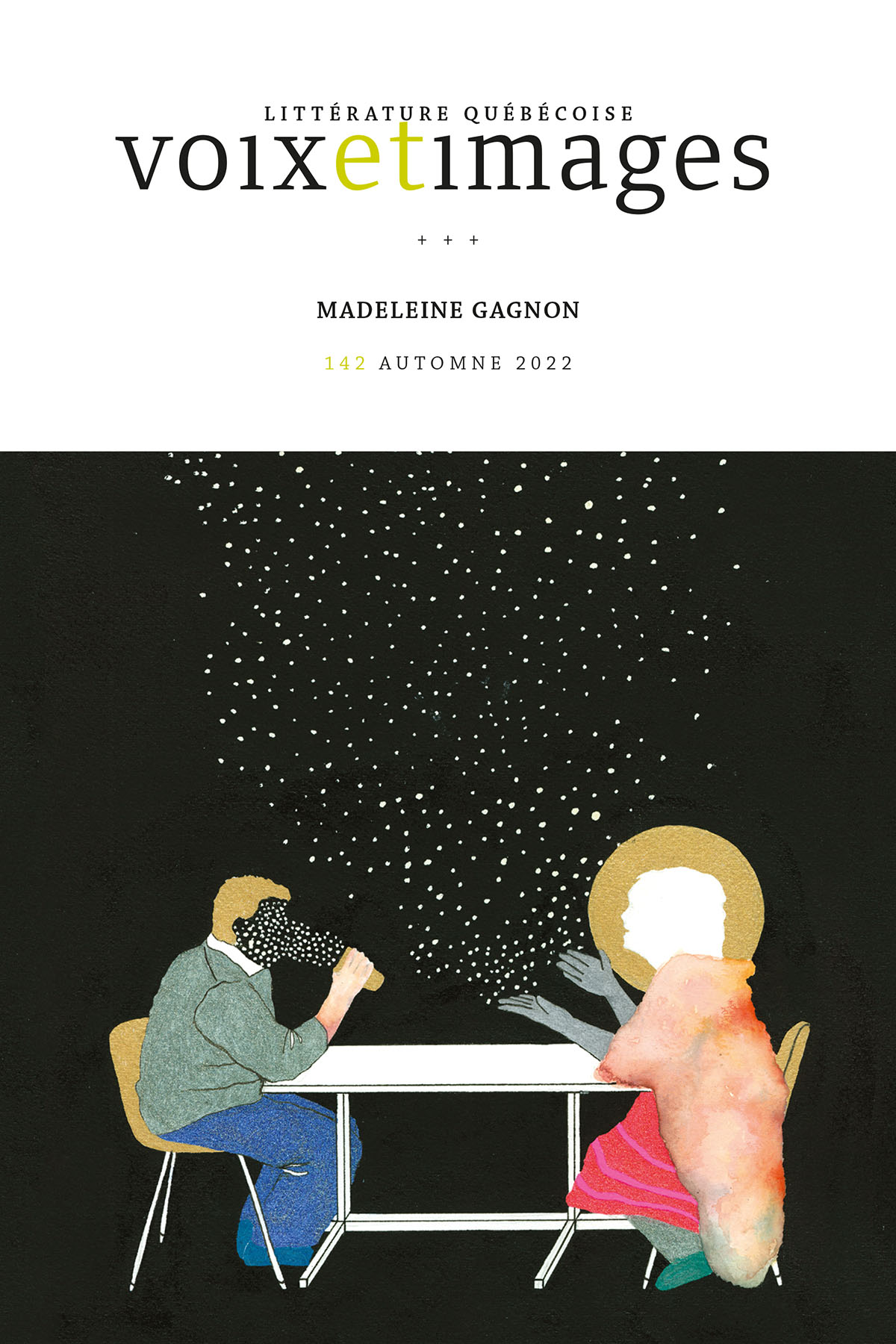Article body
« La première fois que j’ai fait l’amour avec une femme, écrit Julie Delporte, je n’avais pour références que des dessins et des films réalisés par des hommes[1]. » Ainsi s’ouvre Corps vivante, roman graphique qui retrace le passage de l’hétérosexualité à l’homosexualité de son autrice. Chez Delporte, ce manque d’images produites par des femmes, qui correspond à un manque de points de repère, ne signifie pas seulement qu’un savoir-faire lui échappe, mais qu’une forme d’identification à des « modèles », qui l’accompagneraient et compenseraient son arrivée tardive à la sexualité entre femmes, lui est interdite. Sa première partenaire ne ressemble « à aucune des lesbiennes fantasmées par les hommes » (18). L’imaginaire de l’amour lesbien, parce qu’il est en partie capturé par les hommes, laisse une sensation de vide et d’inadéquation à ses protagonistes réelles.
Delporte remédie à ce vide en fréquentant des oeuvres produites par des femmes, qui viennent nourrir sa démarche, mais aussi en produisant elle-même des dessins qui évoquent la forme de l’herbier, en tant que collection de spécimens végétaux (plantes, roches, fleurs) et culturels (tissus à motifs, images de films, icônes féministes), où domine le motif de la vulve, et qui lui permettent de reconstituer la trame narrative de sa sexualité : « Un jour, je suis tombée amoureuse d’une femme, mais mon histoire ne commence pas là. » (33)
Les films de Chantal Akerman servent d’abord de médiations entre la narratrice et la mise en récit de son rapport au désir et à la jouissance, à travers une série d’illustrations de corps féminins enlacés. Delporte regarde à trois reprises Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, pour finalement comprendre le sens du meurtre commis par Jeanne à la fin du film. C’est la trahison du corps qui jouit malgré soi, à l’encontre du désir, qui constitue le point de départ de sa réflexion : « Penser au nombre de fois où j’ai fait l’amour sans le vouloir me fait peur. » (49) Le récit de la venue à l’homosexualité est donc inséparable d’une histoire ponctuée d’agressions, mais aussi, plus « ordinairement », de pratiques hétérosexuelles conditionnées, imposées, où le désir de l’autre annule la possibilité même de voir surgir un désir à soi. L’histoire sexuelle de la narratrice est marquée par les abus, mais aussi les malentendus : « [Le garçon] avait pris ma gentillesse pour du désir. […] J’en ai conclu que j’avais été violée par mégarde. » (70) Au-delà du sarcasme émanant de cette tournure de phrase, où l’on peut observer un exemple de plus des problèmes de consentement qui grèvent les relations intimes, Delporte me semble cerner quelque chose de plus troublant et de plus subtil : cette inattention aux manifestations du désir chez l’autre, qui s’apparente en fait à une incapacité à décoder ces manifestations, une forme d’analphabétisme interpersonnel peut-être lié à ce manque d’images, d’une culture visuelle « au féminin », laquelle permettrait à tous et à toutes de savoir lire le désir des femmes – de toutes celles qui s’identifient comme femme, s’entend.
Delporte cherche elle-même à échapper à ce brouillage, qui affecte sa propre réception des signaux que lui envoie son corps, et nous fait entendre en filigrane le discours autoritaire du psychologue, du professeur de cinéma, qui trouble l’interprétation, sème des fausses pistes, jusqu’à ce que « quelque chose chang[e] dans [son] regard » (93) et qu’elle se réapproprie sa quête de sens.
« Ce que j’avais raté de la féminité n’avait plus d’importance. J’étais soudain libérée de mes obligations » (106), confie la narratrice. L’obligation d’être belle, de séduire, de se montrer enthousiaste envers le sexe semble à première vue disparaître grâce au passage à l’homosexualité. Mais cette préoccupation est rapidement remplacée par une autre, celle de trouver sa place dans l’univers lesbien sans être perçue comme une « fraudeuse », une hétéro qui expérimente et cherche des émotions fortes : « J’étais fière de ma nouvelle orientation, mais je mourais de honte qu’elle m’arrive si tard. » (11) L’étiquette de « lesbienne tardive », qui revient très souvent au fil du texte, sert de marqueur à cette inquiétude. Ainsi apparaît le fil conducteur de cette histoire d’une vie sexuelle : une série d’adaptations au désir des autres, pour mériter leur amour et leur acceptation. Tout n’est donc pas résolu par le changement d’orientation sexuelle. Si l’obsession des lesbiennes pour l’authenticité est probablement liée à « [leur] effacement historique et à [leur] invisibilité qui perdure » (164), Delporte revendique malgré tout une identité impure et se déclare finalement « lesbienne bancale » (166).
La dissonance grammaticale du titre, Corps vivante, dans lequel on entend bien sûr « encore vivante », traduit à mon sens une réflexion très singulière sur la traditionnelle rupture entre corps et esprit, ici pensée comme un décalage. Le corps est parfois en retard, parfois en avance sur la façon dont nous comprenons ce qui nous arrive, sur notre appréhension du monde ; il se trouve parfois en « rattrapage », pressé de désapprendre des codes et des automatismes : « Les habitudes sont longues à changer. Mais déjà, j’ai un peu perdu celle de me forcer. » (217) Delporte s’intéresse à la manière dont nous apprenons dès l’enfance à plier nos attitudes corporelles, voire nos sensations, nos réponses physiologiques à certains stimuli, aux attentes et aux demandes des autres. Elle défend le projet de se « reconnecter » à un corps « parasité », « affecté » (203), et de tenir compte de ces failles dans ses relations avec les autres, sans les cacher, sans tenter de les corriger. « Je n’ai jamais vu de film dans lequel les amants discutent de leurs blessures, essaient de se comprendre, physiquement » (218), écrit-elle. Encore une image qu’il nous manque pour nous aider à lire les signes que nous envoie notre corps et à composer une histoire intime qui en tienne compte.
+
Le collectif Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec[2], dirigé par Julie Ravary-Pilon et Ersy Contogouris, constitue un précieux rappel que les images qu’il nous manque sont parfois enfouies dans une histoire méconnue, dans des objets d’art passés inaperçus auprès du grand public autant qu’ignorés, voire méprisés, par les connaisseurs, car associés à des pratiques marginales et dénuées de capital symbolique. Premier ouvrage à retracer cinquante ans d’engagement des femmes dans la production audiovisuelle, du cinéma aux jeux vidéo, en passant par la télévision, la vidéo, l’animation et l’archivage, cette traversée des médiums de l’image est soutenue par des paroles fortes qu’il nous faut entendre aujourd’hui.
La première section est constituée d’essais personnels, dont celui de Martine Delvaux, seule représentante de la pratique critique, qui décrit le sceau d’illégitimité dont est frappé le regard féministe dans le monde du cinéma, et d’entretiens avec des cinéastes. Il en ressort de différentes manières les aléas d’une lutte contre la minorisation et l’effacement. Dans un échange mené par Mélissa Gélinas, Kim Obomsawin affirme sa volonté de faire des films qui s’éloignent des clichés misérabilistes véhiculés à propos des communautés autochtones du Canada, et particulièrement des femmes qui y vivent. Bien qu’elle se considère chanceuse de pratiquer son métier à une époque où se manifeste un intérêt certain pour le cinéma autochtone, milieu où les femmes sont majoritaires, contrairement au cinéma allochtone, elle raconte une anecdote révélatrice concernant le tournage d’un film à Vancouver, où elle était entourée d’une équipe exclusivement féminine. Curieux, des passants s’approchaient régulièrement pour leur demander si elles tournaient un film étudiant : « Je ne sais pas s’ils nous demandaient ça parce que nous étions une petite équipe ou parce que nous étions des femmes. Je me suis beaucoup posé la question. » (63) Ce vernis d’amateurisme qui semble coller au cinéma produit par les femmes, la cinéaste Mireille Dansereau en témoigne également dans un entretien avec Julie Ravary-Pilon. Celle dont la carrière s’est déroulée en grande partie en marge des institutions revient sur le premier prix de cinéma qu’elle a reçu, à Londres, pour Compromise en 1968, prix annoncé dans un journal par le titre : « Girl Gets First Prize » (42). Cette manchette, qui la condamne ironiquement à l’anonymat, met l’accent sur son statut de « fille », voire de « petite fille », et la surprise – on le devine – que cet accomplissement suscite à l’époque. Dansereau le confie candidement : « Le monde du cinéma, c’était un monde d’hommes. J’avais un désir profond d’être reconnue par les hommes, et d’être vue par eux. » (43)
Mais cette reconnaissance se fera attendre et, sur ses propres plateaux, elle se fait expliquer comment tourner par ses collègues masculins : « Ma blonde ne rêve pas comme ça », lui dira-t-on à propos d’une scène d’un de ses films (44). Encore aujourd’hui, Dansereau reçoit des organismes de financement les mêmes reproches qu’il y a 50 ans à propos du manque d’« aboutissement » de ses scénarios, ou du fait que « ses personnages masculins ne sont pas assez développés » (45). Le fait que ceux-ci restent en périphérie des personnages féminins inquiète. Que leur perspective sur l’histoire ne soit pas présentée apparaît comme une faiblesse narrative et un manque de maîtrise, et non comme un choix artistique délibéré et valable.
Le voisinage des témoignages de Dansereau et d’Obomsawin crée des échos intéressants, malgré tout ce qui sépare leurs pratiques et les contextes dans lesquels elles évoluent, notamment sur la place que prend l’implication personnelle dans leur démarche. L’apparition d’Obomsawin dans ses films documentaires est décrite comme accidentelle, ou du moins circonstancielle – il ne s’agit pas d’une impulsion première dans son parcours, mais la cinéaste découvre à l’usage que sa présence à l’écran arrive à susciter l’empathie du public, car elle sert de relais entre celui-ci et ses sujets. Pour Dansereau, au contraire, le désir d’exprimer son expérience de jeune fille issue de la bourgeoisie canadienne-française lui donnera l’élan nécessaire pour se jeter dans le cinéma. Animée par l’urgence de dépeindre l’étouffement et l’aveuglement de son milieu, de faire la critique « des belles images que [sa] mère aimait » (46), elle place son propre point de vue au coeur de son écriture cinématographique, mais se fait reprocher ses « sujets de femmes » (43), lesquels lui attirent un certain dédain. Sans jamais rien céder, Dansereau s’en tiendra à cette approche intimiste. « Les films m’aident à me reconstruire » (49), résume-t-elle simplement dans une formule qui arrive à saisir l’esprit d’un grand nombre de productions évoquées au fil de l’ouvrage.
Les articles de Karine Boulanger et de Marie-Josée Saint-Pierre, par exemple, poursuivent cette réflexion en s’intéressant à des oeuvres très peu vues aujourd’hui et qui témoignent autant d’une volonté d’introspection et d’affirmation que d’un besoin de communion hors de l’espace privé. La première documente le rôle des vidéastes femmes au centre Vidéographe dans les années 1970, projet d’exploration du médium vidéo initié par l’ONF en 1971. Dans cette décennie, « 30 % des bandes figurant au catalogue de Vidéographe […] ont été réalisées par des femmes ou par des collectifs comportant des femmes » (235-236). À une époque où la vidéo est perçue comme une « source d’information alternative » (237), plusieurs femmes qui soumettent des projets à Vidéographe empruntent d’abord une approche analytique et critique pour décrire différentes réalités qui les touchent (le divorce, l’avortement, la représentation du corps), mais leur travail prend vite une tournure plus intime. Leurs productions « participent d’un travail de valorisation de l’expérience vécue, personnelle, des femmes et de leur parole » (238). Boulanger remarque que la liberté que les vidéastes se donnent dans le traitement de leur sujet est beaucoup plus grande qu’au cinéma à la même période. Cette « technologie destinée à un usage domestique » (244) permet paradoxalement aux femmes qui la choisissent de s’extraire de l’espace domestique pour mieux le penser et, ce faisant, de créer de nouveaux « modes de sociabilité » (244).
Saint-Pierre analyse quant à elle le film d’animation La ménagère (The Housewife) de Kathy Bennett, réalisé en 1975 et produit par l’ONF. Bennett travaillait alors comme coloriste et animatrice à l’ONF, mais ce film de six minutes est le seul qu’elle ait signé. Saint-Pierre utilise le concept de « sexage », provenant du féminisme matérialiste, pour nous faire voir comment le film de Bennett dépeint l’esclavage dans lequel sont plongées les ménagères de l’époque, leur travail domestique exploité et invisibilisé. Mais c’est quand l’autrice décrit le film plan par plan que l’analyse se fait la plus riche, car elle nous donne ainsi accès à l’objet et à ses particularités : la ménagère sans visage, ses mouvements répétitifs et las, « le manque et le vide » (258), l’isolement traduits par le dessin animé. Saint-Pierre termine toutefois son article en reprochant au film son absence de transgression et son acceptation des diktats sociaux, une conclusion un peu simpliste, à mon avis, qui aurait mérité d’être nuancée par une remise en contexte de la figure de la ménagère « désespérée », dominante dans la littérature anglo-saxonne à la même époque[3].
Les deux sections traitant de la télévision et des jeux vidéo, en raison de la nature même des médiums en question, analysent des productions destinées à un public plus large et dont l’aspect subversif n’est pas toujours évident à première vue. Deux articles s’intéressent à des séries télé signées par des réalisatrices autochtones, dont Mohawk Girls de Tracey Deer, dans lesquelles s’incarne le projet d’une « représentation plurielle des femmes autochtones » (104). Leurs autrices, Karine Bertrand et Marie-Ève Bradette, renvoient toutes les deux au concept de « souveraineté visuelle » (99, 116) promu par Michelle H. Raheja, spécialiste des études autochtones à l’Université de Californie, selon laquelle l’autoreprésentation est essentielle pour arriver à construire un répertoire d’images et de scripts qui rendent compte de la complexité des expériences vécues par ces communautés. Par le fait même, l’autoreprésentation permet aussi de déconstruire ou de se réapproprier les stéréotypes de la culture coloniale dominante (comme celui de la « princesse autochtone » à la Pocahontas, ou celui, opposé, de la martyre, de la victime perpétuelle) et de développer un imaginaire propre, plus riche, plus souple, tout en jouant sur des codes et des types bien connus du grand public, comme le fait Mohawk Girls à partir de l’« esthétique girly » (106) de la série états-unienne Sex and the City.
Les articles portant sur les séries La Galère, écrite par Renée-Claude Brazeau, et Féminin/Féminin, réalisée par Chloé Robichaud, arrivent à un constat plus partagé. Si La Galère arrive parfois à s’éloigner des « scripts hétérosexuels traditionnels » (121) véhiculés par la télévision, où les femmes sont généralement représentées dans une posture de séduction passive, par exemple, elle produit malgré tout des « discours contradictoires sur la sexualité » (130), selon les quatre signataires de l’article. Bien qu’elle valorise le désir sexuel des personnages féminins, qui constitue souvent un moteur narratif, la série présente de manière négative le plaisir sexuel qui s’inscrit en dehors du couple ou de la relation amoureuse. Étonnamment, l’analyse très nuancée que fait Anne Martine Parent de la websérie Féminin/Féminin, qui cherche à mettre de l’avant une diversité de couples lesbiens, montre que le modèle de la sexualité conjugale y est tout aussi dominant. La finale de la deuxième saison participe par ailleurs à réactualiser « deux importantes institutions patriarcales et hétérosexuelles : le mariage et la famille » (148), tout en les soumettant à un processus de « queerisation » (149), qui met de l’avant la famille « choisie » plutôt que la famille biologique. Ainsi, le médium de la télévision permet de faire travailler les stéréotypes et les discours hégémoniques qui circulent dans la société sans toutefois les faire tomber complètement ou les remplacer par des modèles inédits.
Enfin, la section sur les jeux vidéo s’intéresse de manière très concrète et documentée aux problèmes structurels qui empêchent une plus grande contribution des femmes à ce type de production audiovisuelle. L’article de Gabrielle Trépanier-Jobin et d’Élodie Simard aborde entre autres les questions des conditions de travail, des relations entre collègues, de l’ambiance cool qui semble favoriser la tolérance au harcèlement, et plus généralement aux comportements non professionnels. Celui de Pascale Thériault et de Roxanne Chartrand aborde quant à lui la « tradition militaire » (214) dans laquelle s’ancre la culture des jeux vidéo ainsi que l’idéal de masculinité et les « fantasmes de puissance » (217) qui en découlent. Le lien entre ce manque de diversité chronique du côté de la production et celui qu’on peut observer du côté des représentations, des thématiques et des mécanismes de jeu est aussi mis en évidence.
Les deux articles brossent ainsi le portrait d’une industrie dont l’organisation du travail et la culture doivent complètement être repensées si l’on veut faire davantage de place aux femmes et aux autres groupes minorisés, non seulement pour répondre à des exigences d’inclusion du côté de la production, mais aussi pour irriguer la création de nouvelles idées, de nouvelles visions du monde qui assureront le renouvellement de cet art médiatique. Les cas de certains studios et jeux québécois plus marginaux analysés par Thériault et Chartrand en deuxième moitié d’article donnent espoir qu’un tel renouvellement est possible.
Lire Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec nous donne accès à un panorama de pratiques et de formes qui, sans arriver à résorber complètement la sensation d’un « manque » d’images, de récits qui échappent au regard masculin dominant[4], nous fait au moins rencontrer une quantité impressionnante d’artistes qui ont cherché, et cherchent encore, à exprimer une vision singulière malgré les obstacles, que ceux-ci soient de nature sociale ou institutionnelle, et à doter les femmes de différents horizons d’une culture visuelle qui leur soit propre. Certains articles du collectif nous rappellent toutefois que les images produites par des femmes ont leurs propres angles morts, reconduisent aussi des absences et des silences. Chloé Savoie-Bernard, dans son texte sur le film Les terribles vivantes (1986) de Dorothy Todd Hénaut, fait par exemple de l’absence de Jovette Marchessault, dont les racines autochtones (innues) ont été remises de l’avant ces dernières années[5], auprès de ses amies écrivaines dans une scène de repas présentée dans le film une « omission politique », comme si Marchessault était ainsi exclue d’« une grande chaîne de femmes » (271). Encore une fois, l’autoreprésentation apparaît comme un enjeu central ici : « Si c’était Jovette Marchessault qui avait réalisé Les terribles vivantes, y aurait-il eu des images la montrant en train de manger et de discuter à la même table que ses collègues? Sa place, à l’écran, aurait-elle été la même? » (272)
Ce n’est pas pour rien qu’un des fils conducteurs de cet ouvrage est l’investissement personnel des créatrices dans la conception des oeuvres, que celui-ci prenne la forme d’une visibilité à l’écran ou de la mobilisation d’un matériau intime dans l’écriture. L’engagement des femmes dans les productions audiovisuelles ne se résume pas au fait d’y être représentée – position passive et peu satisfaisante –, mais concerne plutôt le contrôle des manières de montrer et de faire entendre leur présence. « Je ne prenais plus de photos depuis des années. J’ai ressorti mon vieil argentique, comme si la vie valait à nouveau la peine d’être capturée », écrit Julie Delporte dans Corps vivante. Les désirs de capturer le réel et d’y figurer s’alimentent et se relancent sans cesse. Les images qu’il nous manque sont peut-être celles qu’il nous revient de créer.
Appendices
Note biographique
MARIE PARENT enseigne la littérature au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle a publié des articles dans divers collectifs et revues, et a été membre du comité de rédaction de Liberté de 2014 à 2020.
Notes
-
[1]
Julie Delporte, Corps vivante, Montréal, Pow Pow, 2022, p. 7.
-
[2]
Julie Ravary-Pilon et Ersy Contogouris (dir.), Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec. Confluences et divergences, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Vigilant·e·s », 2022, 378 p.
-
[3]
À ce sujet, voir entre autres Gayle Greene, « Mad Housewives and Closed Circles », Changing the Story. Feminist Fiction and the Tradition, Bloomington, Indiana University Press, 1991, p. 58-85.
-
[4]
Plusieurs articles font référence au fameux concept du « male gaze », théorisé par Laura Mulvey en 1975, renvoyant au regard masculin et hétérosexuel dominant dans l’histoire de l’art (et du cinéma) qui objective le corps des femmes et s’embarrasse peu de leur perspective sur le monde.
-
[5]
Voir par exemple Élise Couture-Grondin, « La réécriture féministe et anticoloniale de l’histoire à partir du récit de soi dans Le crachat solaire (1975) de Jovette Marchessault », Arborescences, no 11, décembre 2021, p. 71-90.