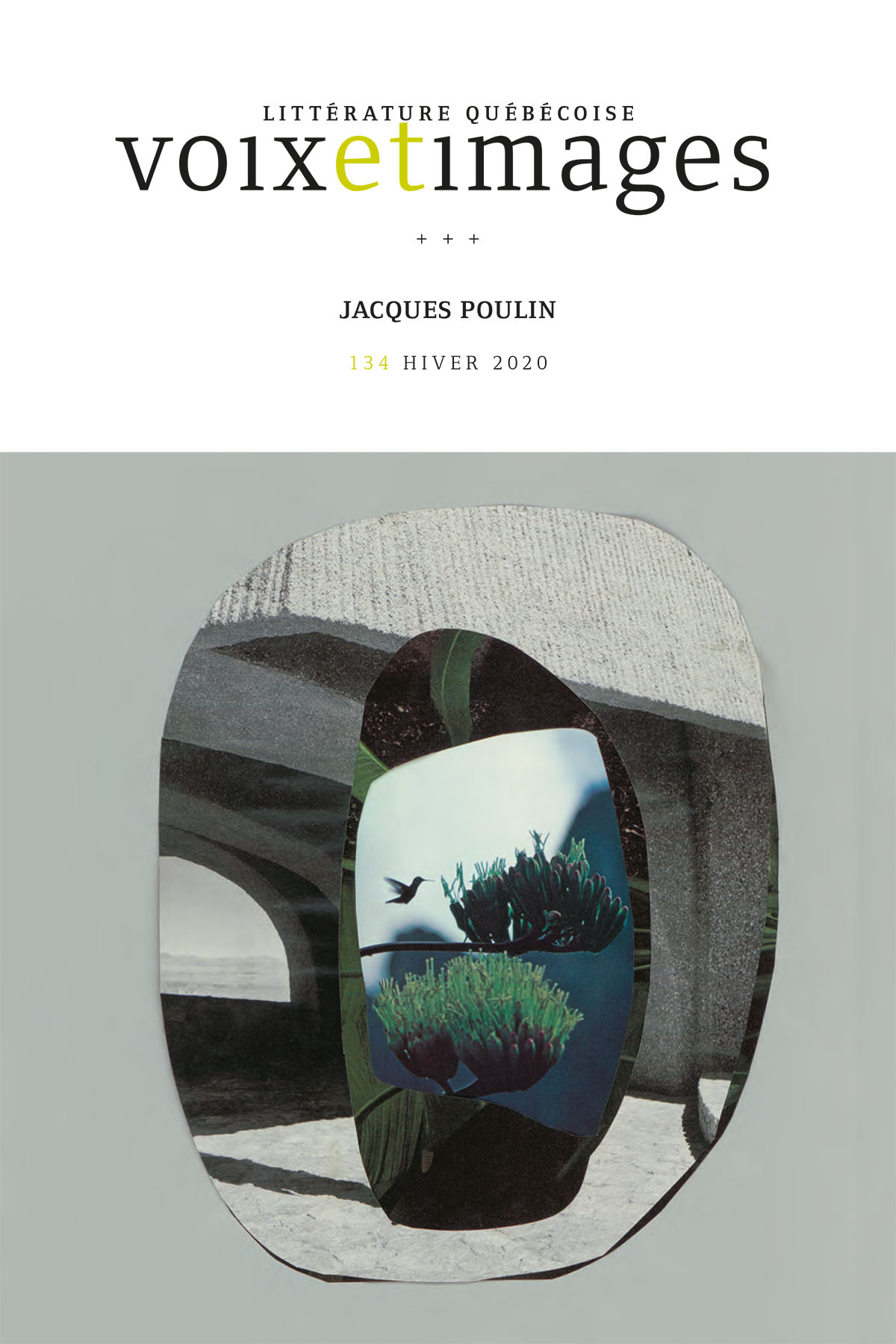Abstracts
Résumé
Si on reconnaît mieux aujourd’hui l’indéniable contribution d’Arthur Buies à la littérature québécoise, jusqu’à le considérer comme « le meilleur écrivain du xixe siècle », il n’en a pas toujours été ainsi, son oeuvre ayant suscité toutes sortes de réactions négatives jusque dans les années soixante. Dissimulée derrière le personnage de l’anticlérical et du pamphlétaire, s’y révèle — en particulier dams les Lettres sur le Canada et La Lanterne — une pensée sur la nature et la condition humaines qui mérite d’être étudiée précisément dans l’angle qui a fait de Buies un maudit. En travaillant sans relâche à circonscrire un certain symptôme collectif, Buies engage le lecteur à reconnaître les effets d’un « mal » qui déborde le cadre de son époque et, comme le font d’autres écrivains et penseurs avec lesquels il dialogue, à considérer la littérature comme le lieu de la transmission d’un savoir à la fois dérangeant et essentiel.
Abstract
There is now greater recognition of Arthur Buies’s undeniable contribution to Québécois literature—he is even said to be “the best writer of the 19th century”. However, this has not always been the case, with a wide range of negative reactions to his work persisting into the 1960s. Concealed behind his anticlericalism and pamphleteering, he offers—especially in Lettres sur le Canada and La Lanterne—a way of thinking about human nature and the human condition that deserves to be studied precisely from the perspective that made Buies into a rejected “écrivain maudit”. Working tirelessly to define a collective symptom, Buies asks the reader to recognize the effects of an “evil” that goes beyond the framework of his time, and, like other thinkers and writers with whom he is in dialogue, to view literature as the place where a certain kind of knowledge, both disturbing and essential, can be transmitted.
Resumen
Si se reconoce mejor hoy en día la innegable contribución de Arthur Buies a la literatura quebequense, hasta el punto de considerarlo como «el mejor escritor del siglo XIX», no siempre ha sido así, ya que, hasta los años sesenta, su obra suscitó toda clase de reacciones negativas. Disimulado detrás del personaje de lo anticlerical y lo panfletario, se revela –en particular con Lettres sur le Canada (Cartas sobre Canadá) y La Lanterne (La Linterna)– un pensamiento sobre la naturaleza y condición humanas que merece estudiarse precisamente bajo el ángulo que hizo de Buies un maldito. Trabajando sin descanso para circunscribir cierto síntoma colectivo, Buies incita al lector a reconocer los efectos de un ‘mal’ que desborda el marco de su época y, al igual que hacen otros escritores y pensadores con los cuales dialoga, a considerar la literatura como el lugar de transmisión de un saber a la vez inoportuno y esencial.
Article body
Maintenant, qu’un homme s’élève, suffoquant de dégoût ou de honte ; qu’il se dresse en face de ce dieu des ombres, et, avec la conscience de la vérité, ose la dire au troupeau d’hommes qu’il tient asservis, aussitôt les anathèmes pleuvent ; son nom est livré à l’horreur, à la haine, sa vie entière à la rage du fanatisme, et son foyer, seule retraite où il cherche l’oubli des persécutions, retentit encore du bruit des imprécations qui le suivent partout[1].
Pleuvez sur moi, malédictions, calomnies, infamies, injures./Je souris voluptueusement à l’outrage, et je vous nargue… troupeau[2] !
L’oeuvre éclectique et hétérogène d’Arthur Buies est un incontournable de la littérature du Québec, suffisamment d’ailleurs pour qu’on ose aujourd’hui présenter l’auteur comme étant « le meilleur écrivain du xixe siècle québécois[3] ». Or, il n’en a pas toujours été ainsi, ses textes — en particulier les Lettres sur le Canada et La lanterne — ayant suscité toutes sortes de réactions, souvent très vives et allant parfois jusqu’aux critiques les plus acerbes, et qui auront constitué pour l’écrivain un « purgatoire long et pénible », selon la formulation de Jonathan Livernois[4]. Si les études actuelles accordent à Buies une place plus significative dans le panthéon des lettres québécoises, la hargne qu’on a pu nourrir à son égard — doublée d’une admiration manifeste chez certains contemporains — mérite qu’on réexamine son discours afin de saisir ce qui pourrait en être l’origine et qui n’a pas encore été mis en lumière[5].
Car, dissimulée derrière le personnage de l’anticlérical presque converti à l’époque du curé Labelle, du pamphlétaire « écervelé » et « scélérat » de La lanterne qui n’a pu se « résoudre à être un honnête homme en laissant faire le mal » (LL, 153), se révèle une pensée sur la nature et la condition humaines qui déborde les cadres culturel et contextuel à partir desquels on a le plus souvent lu l’oeuvre[6]. Ainsi, un des rares esprits sulfureux du xixe siècle ayant vécu dans un Canada français où le peuple se retrouve plus que jamais dominé par le clergé depuis la défaite des patriotes, le même qui a tenté sa chance en Europe, fait état d’une réflexion où se dévoilent certaines zones d’ombre de la nature humaine, saisissables sous la forme d’un symptôme révélateur des « maladies sociales » (LC, 63), comme il se plaît à les nommer lui-même. En s’entêtant à circonscrire ce symptôme, sur la scène politique canadienne-française d’abord, Buies en vient à cette réflexion qui l’amène à dialoguer avec d’autres qui se sont interrogés — à travers des époques et des discours souvent fort différents — sur les origines d’un certain malaise dans la culture[7]. C’est cette part encore trop méconnue de l’oeuvre où se révèle un savoir à la fois éclairant et exigeant que nous souhaiterions ici étudier, afin de tenter de saisir le phénomène ayant pu faire de lui ce qu’il convient d’appeler un « maudit[8] ».
ALLER À LA SOURCE DU MAL EN S’ATTAQUANT À L’HÉGÉMONIE CLÉRICALE
Les Lettres sur le Canada, une « étude sociale » que Buies fait paraître avant sa Lanterne, est le lieu privilégié pour saisir la vérité d’un symptôme collectif qui, manifestement, étouffe l’écrivain. Dans ces lettres où l’univers de la fiction littéraire côtoie la pensée à la fois philosophique, sociale et politique, Buies utilise des stratégies d’énonciation qui rappellent les Lumières, et en particulier les Lettres persanes de Montesquieu. En effet, il s’amuse à adopter le point de vue d’un Français en voyage au Canada, M. Langevin, qui découvre la situation sociale et rédige ses observations sous la forme de missives qu’il adresse à un « ami », M. d’Hautefeuille. Ce cadre imaginaire devient ainsi la voie privilégiée pour désigner sans relâche et par l’hyperbole typique du pamphlétaire un « mal […] trop grand et trop profond » qui afflige le Canada et oblige celui qui souhaiterait soulager le peuple de sa souffrance à « aller jusqu’aux racines de la plaie[9] » (LC, 58). C’est le même « mal » qui sera dénoncé dans les publications qui vont suivre, et en particulier dans La lanterne.
Dans la « deuxième lettre[10] » (1864), le discours révèle l’origine de ce « mal », par l’entremise de M. d’Estremont (l’interlocuteur canadien du Français, personnage passant pour « sombre et misanthrope » [LC, 27]). L’auteur dévoile pas à pas ce qu’il dépeint au Français comme un « pouvoir occulte que personne ne peut définir, mais que l’on sent partout, et qui pèse sur toutes les têtes, comme ces despotes de l’Asie qui font courber tous les fronts dans la poussière » (LC, 30). D’ailleurs, il ne prend pas de détours lorsqu’il laisse entendre la nature insidieuse de ce qu’il finira par nommer le « despotisme clérical » (LC, 34) :
[C]e pouvoir, qui est pour vous [Français] une énigme, est pour nous une épouvantable réalité. Vous le cherchez, et il est devant vous, il est derrière vous, il est à côté de vous ; il a comme une oreille dans tous les murs, il ne craint pas même d’envahir votre maison… hélas ! souvent nous n’avons même pas le bonheur de nous réfugier dans le sein de notre famille contre la haine et le fanatisme dont il poursuit partout ceux qui, comme moi, veulent penser et agir librement.
LC, 31
De manière fort imagée et forçant le trait jusqu’au sarcasme, Buies décrit une attitude jugée détestable, exposant là son caractère profondément anticlérical pour lequel on l’a reconnu, encensé ou haï. Ainsi, le premier responsable de la maladie sociale qui ronge le Canada français serait le clergé, « qui absorbe tout, politique, éducation, presse, gouffre immense et si profond que le désespoir s’empare des penseurs patriotiques » (LC, 56-57), tels Jean-Baptiste-Éric Dorion, « un des premiers membres de l’Institut canadien » et « fondateur du journal L’Avenir » (LC, 66-67), « brisé [aux dires de Buies] par les fatigues de la vie, par les émotions d’une lutte sans trêve qu’il soutenait seul » (LC, 65). Sous les traits de son épistolier fictif, il nous révèle que c’est ce même clergé qui fait régner une sournoise « inquisition » en exerçant « une pression ténébreuse qui étouffe le germe de la pensée comme la liberté d’écrire ce qu’on pense » (LC, 53) et qui possède « [l]’occulte puissance » de « [répandre] toujours une terreur indomptable » (LC, 63), ce qui l’amène à faire le parallèle entre son époque et le Moyen Âge (LC, 29, 58-59).
Les propos particulièrement abrasifs et souvent irrévérencieux de l’hebdomadaire publié de 1868 à 1869 ne laissent d’ailleurs aucun répit aux membres de l’Église, que Buies désignait comme responsable d’une situation qualifiée de « profonde abjection » (LC, 59) dans les Lettres. Un des passages les plus virulents est sans aucun doute celui où il reproduit pour le commenter un procès se déroulant au tribunal correctionnel de Bordeaux. Il y est question des violences commises par des jésuites à l’égard de jeunes pensionnaires, violences qui permettent au journaliste de faire le parallèle avec l’éducation donnée au Canada. Il résume ainsi cette éducation :
On vous fait mettre à genoux, on vous fait baiser la terre, on vous soumet à toutes sortes de pratiques humiliantes, on vous fouette, afin que vous deveniez une docile créature, pâte malléable à discrétion, et c’est ainsi qu’on jette sur l’arène du monde des générations désossées, une jeunesse tellement habituée à suivre l’oeil du maître qu’elle est incapable de rien faire par elle-même et rampe aux pieds du clergé pour avoir un appui.
LL, 216 ; je souligne
En peignant ce tableau du comportement des jésuites, qui apparaissent comme de véritables sadiques, Buies illustre de manière caricaturale l’attitude du clergé au pouvoir, pouvoir qui passe d’abord par l’éducation, afin de transmettre son indignation face à ce qui expliquerait la soumission du peuple canadien-français. Un peu plus tôt, il fait état des effets de cette éducation :
LL, 227-228Notre peuple est profondément abaissé et humilié, parce que ce sont ces hommes-là qui ont fait son éducation. Ils lui apprennent à être faux, craintif, oblique, à employer toute espèce de petits moyens, de sorte qu’il ne peut employer les grands, quand il le faut, et qu’il se voit d’un grand bout dominé par les autres races.
[L’éducation cléricale est le poison des peuples[11].]
Nous sommes des moutons et, qui le veut, peut nous tondre.
On ne nous prêche que deux choses, l’obéissance et l’humilité, l’obéissance surtout, dont on fait la première des vertus.
Mais l’obéissance n’est que l’école du commandement et non pas une vertu en soi.
Et l’humilité, telle qu’on nous l’enseigne, n’est autre chose que l’humiliation.
LES MANIFESTATIONS DU SYMPTÔME ET SON ORIGINE
En dénonçant la situation à la fois dans les Lettres et La lanterne, et donc en évoquant le sort de la jeunesse éduquée par les Jésuites, Buies se trouve d’un même souffle à dresser un portrait affligeant du peuple canadien-français, pris dans une grande fatigue, non loin du trépas[12] :
Je regarde autour de moi, je vois des visages froids qui s’observent, qui s’épient, qui se masquent, physionomies déprimées où règne l’empreinte d’une lassitude précoce, où se lisent les convulsions de la pensée qui cherche à se faire jour et qui meurt dans l’impuissance.
LC, 58 ; je souligne
Nos jeunes gens ont perdu l’ambition de l’aplatissement ; il en est qui sont restés avec vous ; ceux-là n’ont plus la force de se relever ; captifs, endormis, ils regardent leurs chaînes d’un air hébété, ne sachant même plus qu’ils sont esclaves. D’autres s’agitent, mais ils retombent, vaincus par le poison que vous avez versé dans leur intelligence.
LL, 267-268 ; je souligne
Cependant, si cet état déplorable s’explique en partie par l’éducation cléricale, il semblerait que l’écrivain ne se satisfasse pas de ce simple constat, cherchant plutôt à mettre en lumière une vérité sous-jacente qui ne peut qu’agacer, voire indisposer — ou encore contenter et même ravir, chez ses contempteurs — ses lecteurs. À l’origine de ces soubresauts qui finissent toujours par s’évanouir, il y aurait selon Buies une forme de résistance à ce que le peuple canadien-français sorte d’un état léthargique et d’un aveuglement qui apparaissent tous deux réconfortants pour le peuple et alarmant pour l’écrivain :
Les hommes naissent, vivent, meurent, inconscients de ce qui les entoure, heureux de leur repos, incrédules ou rebelles à toute idée nouvelle qui vient frapper leur somnolence. […] Ce calme est plus effrayant que les échafauds où ruisselle le sang des patriotes, car il n’est pas d’état plus affreux que d’ignorer le mal dont on est atteint, et, par suite, de n’en pas chercher le remède.
LC, 55
Cette abstraction de nous-mêmes a été poussée si loin qu’aujourd’hui elle est devenue notre nature d’être, que nous n’en concevons pas d’autre, que nos yeux sont fermés à l’évidence, que nous n’apercevons même pas le niveau d’abaissement où nous sommes descendus, et que nous considérons comme une bonne fortune unique de n’avoir plus la charge de nos destinées.
LL, 803
Dans certains passages-clés de La lanterne auxquels appartient le dernier extrait, Buies cherche à briser ce confortable repos et à ouvrir les yeux de la nation sur ce qui agit sur elle, mais surtout en elle comme une véritable force obscure, ne serait-ce que par une ironie mordante qui frôle encore ici le sarcasme, ce qu’induit « la bonne fortune unique ». Il en va de même lorsqu’il souligne que si « une occasion se présente, les Canadiens n’oseront se faire valoir, mais […] brailleront pendant un mois si on le leur reproche » (LL, 732), ce qui l’amène d’ailleurs à considérer que la nation canadienne-française « n’est guère qu’une dérision » (LL, 733)[13]. Dans cette perspective, la responsabilité semble reposer tout autant — sinon davantage — sur la nation que sur le clergé, ce que révèlent le verbe éloquent et le choix de la première personne du pluriel dont il se sert plus loin dans le même ordre d’idées : « Nous ne sommes plus un peuple, parce que depuis un quart de siècle nous avons abdiqué entre les mains des prêtres toute volonté, toute conduite de nos affaires, toute idée personnelle, toute impulsion collective. » (LL, 803 ; je souligne)
JOUIR DE LA DOMINATION DE L’AUTRE… EN SOI
Ainsi, Buies n’y va pas de main morte pour nommer avec consternation ce qu’il considère ailleurs comme dégoûtant et honteux (LC, 53) jusqu’au dernier degré, c’est-à-dire cette posture où le peuple est certes dominé par « une petite minorité d’hommes venus de l’extérieur » (LL, 731), anglaise, et par le pouvoir ecclésiastique, mais aussi déterminé par cette tendance viscérale à se condamner lui-même « à l’absorption et à une déchéance qui équivaut à l’anéantissement » (LL, 732), sans pour autant faire partie de ces « nations opprimées et décimées par une poignée de conquérants, réduites au dernier degré d’abjection » (LL, 731) sur la scène de l’Histoire. À lire son discours, on en vient à conclure qu’il y aurait dans cette situation un gain à tirer prenant la forme d’un certain confort, mais pointant vers quelque chose de plus insidieux à l’oeuvre qui expliquerait l’aveuglement aussi bien que « les chutes », les « abaissements successifs », les « déchéances de plus en plus profondes » qui font que le « nous » désignant les Canadiens français en est venu « à ne plus compter sur [son] propre sol, à n’être plus rien, même à [ses] propres yeux » (LL, 802). Dans cette optique, on comprend que le « gain » en question consiste en une jouissance provenant de l’abnégation et de la soumission face à la violence de la domination de l’Autre, ce dont Buies cherche à tout prix (au sens fort du terme) à se faire le porte-voix ; c’est ce que le passage sur le comportement sadique des jésuites cité plus haut illustrait, tout comme celui-ci, où l’écrivain commente encore une fois la situation déplorable des Canadiens français : « Quand je descends dans cet abîme, je reste épouvanté. Mais je ne craindrai pas d’y descendre encore davantage, parce que je veux vous le montrer dans sa nudité béante, je veux te le faire voir, à toi, jeunesse endormie du Canada, à toi, peuple, qui jouis de ta servitude. » (LL, 393-394 ; je souligne)
Ce que nous apprennent les textes de manière métaphorique, hyperbolique et parfois scabreuse, c’est cette vérité selon laquelle, même si — et peut-être parce que — elle suppose une violence, la jouissance de l’aliénation au pouvoir de l’Autre suppose un bénéfice auquel il n’est pas aisé de renoncer. Façon de dire que c’est dans et par ce rapport à l’Autre que le peuple québécois qui indispose Buies jouit, dirait-on, un peu trop de sa domination sur la scène de l’Histoire, ce qui est sans aucun doute le lieu le plus irrécupérable de son discours, ayant le pouvoir d’indisposer bien davantage que certains travers qu’on a pu lui reprocher. Cette passivité poussée jusqu’au confort de l’irresponsabilité devenue une « nature d’être » comporte une dimension masochiste qui révolte au plus haut point l’écrivain, ce qui l’amène à s’écrier, après en avoir tiré certaines conclusions dans les Lettres : « Homme ! il vous faut des jougs à bénir, et des oppressions que votre aveuglement consacre. Vous aimez l’autorité qu’on appelle sainte ; et quand la liberté vient à vous, c’est toujours avec des bras ensanglantés, et comme une furie plutôt qu’une libératrice[14]. » (LC, 52) Plus qu’une simple peur de s’opposer à l’oppression, c’est cette jouissance souveraine de la « servitude » (LL, 394) qui éclairerait alors l’impossibilité d’en finir avec le symptôme de la fatigue culturelle. Devant son peuple qu’il découvre galvanisé par son rapport déréalisant à l’Autre, le journaliste se sent dans la nécessité, dirait-on, de dénoncer haut et fort, à travers l’image du servage allant jusqu’à l’anéantissement, un état grave dont il faudrait collectivement sortir, incarnant « la conscience humaine chargée d’infamies » qui les « vomi[t] avec horreur » (LC, 34) qu’annonçait à son interlocuteur le personnage de la « deuxième lettre », M. d’Estremont.
Ajoutons à ce propos que si l’Autre, ce « dieu des ombres » (LC, 53), a un tel pouvoir sur le peuple aux yeux de Buies, c’est qu’il ne se présente pas simplement comme une instance antérieure et extérieure, mais bien comme une partie constituante de la collectivité à laquelle il appartient. Cette idée émerge lorsque l’écrivain précise, par l’entremise du même personnage s’adressant au Français, où loge, selon lui, le pouvoir occulte de l’Autre :
[V]ous chercheriez en vain de quelles forces [ce pouvoir] dispose ; il n’a aucune action directe ou apparente, il conduit tout par l’ascendant secret d’une pression morale irrésistible. Voulez-vous savoir où est le siège de cette puissance souveraine ? Ouvrez le coeur et le cerveau de tous les Canadiens, et vous l’y verrez établie comme un culte, servie comme une divinité.
LC, 32
L’ennemi à abattre sur la scène de l’Histoire (l’Anglais, mais en premier lieu le clergé, les deux éternelles figures du discours historique et politique) pourrait donc être une représentation de ce qui, en fin de compte, définit en partie le peuple canadien-français et l’entraîne à s’assujettir, lui qui est nourri par ce « poison », comme le dit Buies dans La lanterne (LL, 271). Cela montre que l’Autre est en quelque sorte introjecté d’une manière qui fait violence et qui entraîne le Canadien français à jouir de sa position passive, ce qui apparaît comme le principal problème à l’origine du symptôme.
PENSER LE MALAISE DANS LA CULTURE
De cette façon, on pourrait aller jusqu’à dire que, ce que Buies dénonce à une époque où son discours ne peut qu’être marginalisé — sans qu’il soit pour autant plus facile à recevoir aujourd’hui, dans ses effets de vérité et sa contemporanéité —, c’est l’emprise de la jouissance et d’une certaine violence qui en résulte, ce que Freud a reconnu comme le résultat de la pulsion d’auto-anéantissement, dont il tente de comprendre l’origine dans Le malaise dans la culture[15]. Le peuple canadien-français, qui est à la fois le sujet et le destinataire des oeuvres de Buies, devient le représentant exemplaire de ce destin possible des pulsions à l’échelle collective et des complications qui peuvent s’ensuivre. L’écrivain met cette réalité en lumière dans des passages où il s’écarte de sa critique strictement anticléricale et nationale pour devenir ce penseur qui cherche les origines profondes du problème de la violence qu’il perçoit sur la scène de l’Histoire :
L’histoire ne donne pas de détail des moeurs intimes ; elle raconte à grands traits la vie des peuples ; elle raconte leurs luttes, leurs souffrances, leurs triomphes : elle déroule leur histoire politique, leurs phases successives de gouvernement et de condition sociale. Mais entraînée par ce vaste tableau des choses extérieures et frappantes, elle oublie souvent ce qui éclaire et ce qui touche vraiment les aspirations et les pensées secrètes du peuple. […] Tous les peuples naissent, puis s’éteignent d’après les mêmes lois, et presque toujours d’après le même ordre de faits ; et jusqu’à ce que la guerre ait disparu du code des nations, que la politique soit devenue l’art de rendre les hommes heureux et unis, au lieu de les asservir à l’ambition de leurs chefs, nous aurons éternellement le même spectacle de calamités, de haines fratricides, de nations détruites les unes par les autres, et de préjugés étouffant les plus simples notions d’humanité et de justice. Les hommes n’ont pas encore appris à s’aimer malgré la grande parole du Christ. Toutes les mauvaises passions ont continué d’être les idoles auxquelles la raison et le sentiment viennent tour à tour sacrifier : l’égoïsme a poussé à la fausse gloire, et il n’est presque pas de héros d’un peuple qui ne soient en même temps les bourreaux d’un autre. C’est ainsi que tous les grands noms de rois, de conquérants, ont reçu le baptême du sang, c’est-à-dire qu’ils ont été les persécuteurs de l’humanité qui leur élève des autels. (LC, 13-14)
C’est un fait reconnu partout que la tyrannie morale engendre tous les vices. On ne peut comprimer les intelligences et les coeurs sans les rendre propres à recevoir les plus fatales empreintes. Quand les hommes éclairés acceptent un pareil joug, c’est qu’ils ont perdu toute vertu ; quant à ceux qui s’y soumettent par ignorance et par incapacité de s’élever jusqu’à la conception de la destinée humaine, il n’y a pas à compter avec eux. Ils ne représentent qu’une force passive et inerte, jusqu’au jour où cette force se traduit en un déchaînement aveugle et violent de toutes les aspirations trop longtemps étouffées[16].
La part sombre de l’homme qui se profile derrière les propos du Canadien français ici rappelle « [l]a question décisive pour le destin de l’espèce humaine » que posait Freud, « à savoir si et dans quelle mesure son développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l’humaine pulsion d’agression et d’auto-anéantissement[17] ». Buies s’interroge en effet de façon semblable lorsqu’il parle des « violences qui s’agitent en lui-même » de l’être humain ignorant, et de ce fait dominé par ses pulsions :
Exister sans se rendre compte, c’est comme le néant. Voilà pourquoi la pensée est divine ; voilà pourquoi l’intelligence est le souffle de Dieu./Mais quelles horribles profanations l’homme ne fait-il sans cesse de cet attribut divin ? Il n’y a pas une chose, quoi ! il n’y a pas un seul aspect des choses qu’il ne défigure, qu’il ne rende méconnaissable, auquel il ne prête, pour le dénaturer, toutes les violences qui s’agitent en lui-même […]./L’homme est son pire ennemi parce qu’il veut constamment être celui de son semblable. Cette vérité, éclatante s’il en est, simple et nette, est la plus difficile à faire comprendre. De l’envie viennent tous les maux, toutes animosités ; les luttes pour le droit et pour le progrès elles-mêmes gardent à peine leur caractère transcendant au sein des rivalités et des ambitions de ceux qui s’en font les défenseurs, et c’est ainsi que même les plus grandes conquêtes de l’esprit sont souvent abaissées par l’égoïsme des mobiles[18].
Ainsi, la « vérité » ici désignée se présente comme un savoir qui traverse l’oeuvre et qui prend — en particulier dans sa Lanterne et ses Lettres sur le Canada — des voies discursives par moments empreintes d’une colère certaine, laquelle a pu contribuer à nourrir les détracteurs de Buies, à la fois en tant qu’homme et écrivain[19]. En ce sens, si ce dernier s’est attaqué aux causes concrètes à l’origine du symptôme qui accable le peuple canadien-français de son époque afin de contribuer à son possible éveil, on pourrait penser que c’est également dans une visée plus large qui cherche à embrasser la connaissance qu’il a de l’homme et qu’on pourrait qualifier d’« anthropologique », mais qui est aussi celle-là même que met au jour la psychanalyse. Les textes de « jeunesse » de celui qui se tournera finalement vers la chronique sont en effet révélateurs d’un désir de s’élever contre une violence insidieuse (en tentant de la comprendre et en la dénonçant) avec laquelle certains — sujets ou collectivités — peuvent être aux prises. La teneur du lexique, les images fortes et le ton qui peut aisément devenir incendiaire révèlent aussi que le discours de Buies porte les stigmates de la jouissance mortifère dont il se fait à la fois le témoin lucide et le porte-voix, peut-être en sachant qu’il en est malgré lui dépositaire, cherchant à faire avec, ce que semblent indiquer les passages plus « sages » (sans les interjections, exclamations et autres stratégies rhétoriques transmettant son indignation). Ce sont ces stigmates qui deviennent le moteur et la raison d’être de cette réplique où l’art du discours attaque et contre-attaque parfois, devenant en même temps la courroie de transmission d’une pensée qui est rarement tranquille dans les textes étudiés. C’est aussi précisément là où on peut lire chez lui une forme de nécessité de dire le mal — mal qui concerne certes le peuple québécois, mais qui, comme on l’a proposé au départ, éclaire les constats de bien d’autres penseurs et écrivains sur la nature et la condition humaines[20], notamment dans le sillage de la réflexion freudienne du Malaise qui fut « aussi, en un sens, une réinvention de la psychanalyse, qui s’ouvre sur la vérité du collectif, autour de laquelle tournent les sciences du social, sans en affronter “l’unique point obscur” que le savoir de l’inconscient [et de la jouissance] localise[21] ».
ASSUMER LA MALÉDICTION DE SA PAROLE
Pour l’écrivain de La lanterne, dire ce que l’on pense envers et contre tous, et surtout hors des discours préétablis, semble avoir été une incontournable nécessité, qui ne relève pas seulement d’un « droit », mais aussi d’un « devoir », ce qui explique qu’il s’y soit soumis malgré les conséquences tout aussi inévitables qu’amène ce choix :
J’accepte d’être un scélérat, ne pouvant me résoudre à être un honnête homme en laissant faire le mal./Toute vérité n’est pas bonne à dire. C’est là une maxime de poltrons. Dès qu’une chose est vraie, elle est bonne à dire, et doit être dite. C’est l’avantage qu’elle a sur le mensonge, qui n’est jamais bon à dire, même pour la plus grande gloire de Dieu.
LL, 153 ; Buies souligne
Or, choisir de révéler la souveraineté de la jouissance et la violence qui lui est associée par une parole forte implique forcément d’embrasser une forme de malédiction, malédiction qui ne peut se résumer à une posture où certains écrivains font du malheur une fonctionnalité « dans les processus de légitimation culturelle[22] ». Il ne s’agit pas non plus de l’expression d’une souffrance, d’un mal de vivre qui serait à la source inconsciente de l’écriture, voire du génie comme le reconnaît toute une tradition depuis Aristote, ni de ce qui pourrait faire du rejet, de la marginalité le signe d’une élection, les « maudits » suscitant bien souvent autant l’adulation que la détestation. La malédiction au sens où on l’entend pourrait correspondre davantage à une manière viscérale et donc nécessaire d’endosser la posture du « personnage liminaire », tel que le définit l’ethnocritique :
L’individu en position liminale — l’analyse concerne aussi bien les sociétés contemporaines — se trouve dans une situation d’entre-deux et c’est l’ambivalence qui le caractérise d’une certaine manière le mieux […]. La construction de l’identité se fait dans l’exploration des limites, des frontières (toujours labiles, en fonction des contextes et des moments de la vie, mais toujours aussi culturellement réglées) sur lesquelles se fonde la cosmologie d’un groupe social, d’une communauté […]. Dans la mesure où notre personnage liminaire, faisant le détour par l’autre comme tout un chacun, ne parvient pas à revenir de cette altérité ; qu’il est, selon les circonstances et les contextes, un non-initié, un mal-initié ou un sur-initié (voire le tout en même temps), il est placé souvent, dans le système des normes culturelles, du côté le moins positif ou le plus problématique[23].
Ainsi apparaît Buies sur la scène culturelle et sociale, non pas comme un non — ou un mal-initié, mais plutôt comme un « sur-initié » par une lucidité accrue qui le place de ce côté « le plus problématique ». Remettant en cause les fondements de la culture dominante, Buies dialogue avec elle de manière conflictuelle, « transgresse les règles et les frontières, viole les interdits[24] », et sa parole se présente par le fait même comme une véritable manifestation de l’« inquiétant familier » au « double caractère d’une expérience — horreur et fascination, attrait et répulsion — qui nous la fait appréhender simultanément comme familière et comme étrangère, comme désirable et repoussante, et qui conjugue, telle Méduse, la laideur et la beauté[25] ». Figure intenable, le penseur de La lanterne, comme tout maudit, se place ainsi dans une position difficile parce qu’animé par un besoin pressant de dire le « mal » qui ronge les collectivités — en commençant par la sienne — où la violence finit par être montrée comme inéluctable[26] :
Si c’est une condition fatale pour l’humanité de ne pouvoir atteindre à ses destins que par des crises, eh bien, acceptons-en la salutaire horreur, les barbaries nécessaires, moins odieuses que ces despotismes prolongés d’âge en âge qui font bien plus de victimes, quoique dans l’ombre, et qui ne servent qu’à perpétuer le règne de toutes les impostures.
LC, 52
On comprend dès lors que, selon cette logique, dire le « mal » pensé jusqu’à l’obsession n’est pas sans risque pour l’écrivain qui sent qu’« [i]l faut y descendre, [qu’]il faut plonger la main dans l’abîme, et non pas s’arrêter sur ses bords » (LC, 57), situation qui peut se retourner contre lui, tel un serpent qui se mord la queue, ce que Buies a bien connu.
Après lui, sur la scène québécoise, ce destin « maudit » sera notamment partagé par Paul-Émile Borduas, qui reconnaît à juste titre l’importance de
ces hommes qui, sans être des monstres, osent exprimer haut et net ce que les plus malheureux d’entre nous étouffent tout bas dans la honte de soi et de la terreur d’être engloutis vivants. Un peu de lumière se fait à l’exemple de ces hommes qui acceptent les premiers les inquiétudes présentes, si douloureuses, si filles perdues. Les réponses qu’ils apportent ont une autre valeur de trouble, de précision, de fraîcheur que les sempiternelles rengaines proposées au pays du Québec et dans tous les séminaires du globe[27].
Ce sera aussi tout particulièrement le cas d’Hubert Aquin, qui décrit l’écrivain maudit comme étant celui qui « manque de courtoisie, celui que toute bénédiction hérisse » et qui incarne la « vocation ambiguë du peuple québécois — lui aussi maudit et bienvenu à la fois, maléfique et bienfaisant, dangereux et récompensant, terrible et accepté[28] ». Que ce soit Aquin, Borduas ou d’autres penseurs phares du xxe siècle au Québec, ceux-ci semblent hériter — que ce soit voulu ou non — de ce qu’Arthur Buies annonçait déjà, c’est-à-dire de l’importance des écrivains maudits, qui contribuent toujours en marge à éveiller les consciences, à bousculer la vision commune et rassurante de la collectivité, et qui font ainsi partie, un peu à rebrousse-poil, d’une culture, sinon de la culture. En tant que « mémorialiste lucide de la scène politique » qui a fini par devenir un « philosophe méditant sur la condition humaine[29] », mais d’abord et avant tout en tant qu’écrivain, celui que l’on a cherché à réduire au silence a fait de son oeuvre un objet de transmission conviant son lecteur à une réflexion qui mérite d’être réévaluée précisément à partir de cet angle. Les réactions que l’oeuvre de Buies a suscitées, particulièrement celles où on lit le mépris et la condescendance, constituent les points d’ancrage qui permettent de lire les effets d’un discours empreint du désir de faire la lumière sur une vérité dérangeante, « [l]a recherche de la vérité [étant d’ailleurs] le fondement » de son « esthétique[30] ».
Appendices
Note biographique
CAROLINE PROULX est chargée de cours au Département d’études littéraires à l’Université du Québec à Montréal et elle occupe également un poste au Collège Ahuntsic où elle enseigne les littératures française, québécoise et étrangères. Spécialiste des rapports entre littérature et psychanalyse, les conclusions de sa thèse, Violence du réel et fragmentation chez Hubert Aquin et Marguerite Duras (en cours de publication), ont orienté ses recherches actuelles qui portent sur le savoir de l’oeuvre comme malédiction chez des écrivains de la modernité et de la période contemporaine. Dans cette optique, elle s’intéresse d’ailleurs aux croisements entre psychanalyse, politique et anthropologie. Son dernier ouvrage publié en collaboration avec Sylvano Santini, Le cinéma de Marguerite Duras : l’autre scène du littéraire, est paru chez P.I.E. Peter Lang en 2015.
Notes
-
[1]
Arthur Buies, Lettres sur le Canada. Étude sociale, texte intégral, Montréal, Lux Éditeur, coll. « Mémoire des Amériques », [1864 et 1867] 2015, p. 53-54. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LC suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[2]
Arthur Buies, La lanterne, nouvelle édition, avec préface, annexe et « article posthume », Montréal, [s. é.], 1884, p. 32. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LL suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[3]
Francis Parmentier, « Introduction à la nouvelle édition. Arthur Buies, écrivain », Arthur Buies, Correspondance, édition préparée, présentée et annotée par Francis Parmentier, Montréal, Lux Éditeur, coll. « Mémoire des Amériques », 2017, p. 11. J’en profite au passage pour saluer les efforts qui sont faits actuellement chez Lux Éditeur afin de rééditer des pans importants de l’oeuvre qui permettent de saisir la pensée qui naît indéniablement chez Buies d’un rapport essentiel à l’écriture.
-
[4]
Jonathan Livernois, « Le pouvoir démiurgique d’un critique : Arthur Buies, personnage de Claude-Henri Grignon », Analyses, vol. VI, no 1, hiver 2011, p. 362. Concernant la réception de l’oeuvre avant 1980, voir notamment les « impressions et jugements sur Arthur Buies » que Laurent Mailhot a répertoriés dans son Anthologie d’Arthur Buies (Montréal, Hurtubise HMH, coll. « Cahiers du Québec. Textes et documents littéraires », 1978, p. 27-34), qui en donnent un aperçu. Dans le spectre des commentaires peu heureux qu’on retrouve même dans les années soixante, notons ceux de Roger Duhamel et de Marcel A.-Gagnon à titre d’exemples : « Parce qu’il a fait beaucoup de tapage à son époque, parce qu’il a pratiqué l’anticonformisme comme un art d’agrément, parce qu’il lui a échappé quelques idées pertinentes au milieu d’un fouillis d’élucubrations puériles, Arthur Buies s’est assuré une place enviable dans nos manuels de littérature. Il bénéficiait du privilège fragile de notre ignorance. […] Buies n’a jamais existé. » (Roger Duhamel, « Un revenant », cité par Mailhot, ibid., p. 34) ; « Buies se voulait révolutionnaire. Il n’était cependant, comme nombre de jeunes gens d’aujourd’hui et de toutes les époques, révolté que contre lui-même et contre la société dont il se croyait victime. […] Certains traits de son caractère, hostilité et agressivité, masochisme et narcissisme, instabilité et soif de liberté, mélancolie et mépris, découlent de son éducation sans parents. […] Il lui manquait la présence masculine de son père et la douce affection de sa mère. » (Marcel-Aimé Gagnon [textes choisis et commentés par], La lanterne d’Arthur Buies. Propos révolutionnaires et chroniques scandaleuses. Confessions publiques, Montréal, Éditions de l’Homme, 1964, p. 12-14 ; l’auteur souligne.)
-
[5]
Jean-François Nadeau résume : « Arthur Buies est une lumière trop forte. Il estime trop la liberté pour ne pas être jugé dangereux par toutes les sociétés, celle de son temps comme celle d’aujourd’hui. » (« Note de l’éditeur », LC, 9) Bien qu’il existe des études récentes jetant un éclairage intéressant sur des morceaux moins travaillés de l’oeuvre (voir notamment Jeanne Boucher Lauzon, La lanterne d’Arthur Buies : analyse du discours pamphlétaire et de sa réception dans le milieu journalistique, mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2015, 91 f.), un certain savoir présent dans son discours ne semble pas encore avoir fait l’objet d’une analyse.
-
[6]
Francis Parmentier est un de ceux qui mettent en évidence cette dimension philosophique (voir entre autres son « Introduction » à l’édition critique qu’il a préparée d’Arthur Buies, Chroniques, t. I, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Bibliothèque du Nouveau Monde », 1986, p. 30), dimension que révèlent des passages comme celui-ci : « Pourquoi voit-on tant de bassesses tous les jours et qui peut rabaisser ainsi le caractère des hommes ? C’est la faiblesse de penser que les autres sont meilleurs que nous-mêmes et de croire leur estime au-dessus de notre mérite. C’est la lâcheté de vouloir paraître non pas ce que nous sommes, mais ce que d’autres veulent que nous soyons, nous effaçant ainsi sans cesse au point de nous croire indignes du bien même que nous faisons. » (Arthur Buies, « Quelques pensées », Chroniques, t. II, édition critique établie par Francis Parmentier, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Bibliothèque du Nouveau Monde », 1991, p. 281.) Ce genre de réflexion a valu à Buies la comparaison avec Montaigne, comparaison qu’a nuancée Léopold Lamontagne, en se référant lui-même au propos des Chroniques (voir Léopold Lamontagne, Arthur Buies, homme de lettres, Québec, Presses de l’Université Laval, 1957, p. 127).
-
[7]
Je réfère bien entendu ici à l’ouvrage qui traite de la question par les voies de la psychanalyse en 1929. Dans cet essai, Freud définit la notion de culture — entendue au sens de « civilisation » — comme « la somme totale des réalisations et des dispositifs par lesquels notre vie s’éloigne de celle de nos ancêtres animaux et qui servent à deux fins : la protection de l’homme contre la nature et la réglementation des relations des hommes entre eux », tout en mettant en lumière le principal problème qu’elle engendre : « [I]l est impossible de ne pas voir dans quelle mesure la culture est édifiée sur du renoncement pulsionnel, à quel point elle présuppose précisément la non-satisfaction (répression, refoulement et quoi d’autre encore ?) de puissantes pulsions. » (Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 1995 [1930], p. 32-33 et p. 41.) J’y reviens plus loin.
-
[8]
Maudit, Buies l’a été au sens premier du terme, ne serait-ce que par le clergé, dont il dénonce l’attitude dans les Lettres : « Au lieu de l’amour et de la fraternité, vertus du christianisme, venez entendre prêcher du haut des chaires le fanatisme, la malédiction, et la haine contre tout ce qui n’est pas propre à asservir l’intelligence. » (LC, 42) Dans La lanterne, il soulignera que Voltaire — qu’il tenait en haute estime — l’était également dans le Canada français du xixe en s’exclamant : « Oh ! Les philosophes ! on n’en connaît qu’un, Voltaire ; il est vrai qu’on ne le connaît que de nom, mais c’est assez pour le maudire. » (LL, 393) On verra que Buies a pu l’être pour d’autres raisons que sa critique anticléricale, ce qui en fait un écrivain très près des idées de Voltaire, qui s’est plu à dénoncer des réalités humaines similaires.
-
[9]
Buies cherche de cette manière à incarner le « radicalisme » reconnu comme la seule « chose qui puisse sauver le Canada » (LC, 57).
-
[10]
Cette lettre sera intégrée en annexe à la nouvelle édition de La lanterne en 1884, puisque Buies la considérait, dit-il, comme « un appendice naturel » de celle-ci. Il ajoute : « Elle fera voir de quelle conviction absolue j’ai été pénétré dès le premier jour, conviction que j’ai toujours défendue et que j’ai essayé de faire triompher à diverses époques de ma vie à jamais mémorables pour moi. » (LL, 906-907)
-
[11]
Ce segment — qui n’est pas sans rappeler l’aphorisme de Marx, « La religion est l’opium du peuple » (Karl Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843) — apparaît dans la nouvelle édition partielle de La lanterne (Arthur Buies, La lanterne. L’ennemi instinctif des sottises, des ridicules, des vices et des défauts des hommes, Montréal, Lux Éditeur, coll. « Mémoire des Amériques », 2018, p. 91), mais non dans l’édition complète de 1884. Rappelons d’ailleurs que la critique de Buies à ce sujet, loin de disparaître après lui, trouvera un écho certain en 1948, dans le Refus global, où Borduas dénoncera à son tour l’incidence de l’éducation donnée par les « soutanes restées les seules dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale » dans des « maisons d’enseignement [qui] ont dès lors les moyens d’organiser en monopole le règne de la mémoire oublieuse, de la raison immobile, de l’intention néfaste » et qui tiennent le peuple à « l’écart de l’évolution universelle de la pensée pleine de risques et de dangers, […] dans le faux jugement des grands faits de l’histoire quand l’ignorance complète est impraticable » (Paul-Émile Borduas, Refus global et autres écrits, édition préparée par André-G. Bourassa et Gilles Lapointe, Montréal, Typo, coll. « Essai », 2010, p. 13-14). L’ignorance est un des grands problèmes que Buies n’a lui-même cessé de signaler, une ignorance devenue à ses yeux un véritable culte au Canada, « ignorance systématique dans laquelle le clergé » a maintenu les Canadiens français et qui en fait « un peuple sans caractère, sans opinions, sans idées, sourd et rebelle à l’enseignement » (LL, 270 ; l’auteur souligne), raison d’être de « tant de crimes » comme la « misère » (LL, 105).
-
[12]
Il s’agit du symptôme — persistant, manifestement — du conquis ou du colonisé auquel s’attaqueront les penseurs de la Révolution tranquille, et en particulier Hubert Aquin, qui y fait d’ailleurs référence par le biais des mêmes images dans « La fatigue culturelle du Canada français », texte bien connu où il répond à « La nouvelle trahison des clercs » de Pierre Elliot Trudeau, publié dans la revue Cité libre (no 46, avril 1962, p. 3-16) : « Le Canada français, culture fatiguée et lasse, traverse depuis longtemps un hiver interminable ; chaque fois que le soleil perce le toit de nuages qui lui tient lieu de ciel, ce malade affaibli et désabusé se met à espérer de nouveau le printemps. La culture canadienne-française, longtemps agonisante, renaît souvent, puis agonise de nouveau et vit ainsi une existence faite de sursauts et d’affaissements. » Hubert Aquin, « La fatigue culturelle du Canada français », Mélanges littéraires, t. II : Comprendre dangereusement, édition critique établie par Jacinthe Martel avec la collaboration de Claude Lamy, Montréal, Bibliothèque québécoise, coll. « Littérature », 1995, p. 103 ; je souligne.
-
[13]
Pourtant, il arrive que Buies adopte une attitude plus conciliante à l’égard des Canadiens français, tel qu’on le voit dans un passage de La lanterne publié beaucoup plus tôt, ce qui permet de constater que ses sentiments sont à ce propos changeants, que le locuteur se sent aussi intimement concerné par le destin de ce peuple : « Je viens plaider aujourd’hui, devant l’histoire et devant la civilisation, la cause du peuple canadien, peuple vigoureux et intelligent, dont on essaie en vain de faire un troupeau stupide. Je la plaide devant les Anglais qui en sont venus à nous mépriser, ne pouvant s’expliquer comment nous aimons à ce point la soumission. » (LL, 394)
-
[14]
Ces conclusions ouvrent en quelque sorte le propos de la « troisième lettre » : « Est-ce donc là l’histoire des peuples depuis que les peuples existent ? Les hommes ne se sont-ils réunis en société que pour s’exploiter les uns les autres ? Donc, toujours le privilège. Au peuple, à la grande masse, l’asservissement moral après que les insurrections et le progrès ont détruit l’asservissement des corps ; à quelques-uns la domination, la domination par le préjugé, par le fanatisme, par la misère, par l’ignorance, à défaut de pouvoir politique. » (LC, 51-52)
-
[15]
« L’agression est introjectée, intériorisée, mais à vrai dire renvoyée là d’où elle est venue, donc retournée sur le moi propre. Là, elle est prise en charge par une partie du moi qui s’oppose au reste du moi comme sur-moi, et qui, comme conscience morale, exerce contre le moi cette même sévère propension à l’agression que le moi aurait volontiers satisfaite sur d’autres individus, étrangers. La tension entre le sur-moi sévère et le moi qui lui est soumis, nous l’appellerons conscience de culpabilité ; elle se manifeste comme besoin de punition. La culture maîtrise donc le dangereux plaisir-désir d’agression de l’individu en affaiblissant ce dernier, en le désarmant et en le faisant surveiller par une instance située à l’intérieur de lui-même, comme par une garnison occupant une ville conquise. » (Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, p. 66 ; je souligne.) Avec beaucoup de précautions, Freud se permet en ce sens l’analogie entre « le progrès culturel et la voie de développement de l’individu » : « On est en droit d’affirmer en effet que la communauté, elle aussi, produit un sur-moi, sous l’influence duquel s’effectue le développement de la culture », avec toutes les conséquences complexes que cela suppose, « [l]e sur-moi-de-la-culture [produisant] et [élevant] ses exigences » (ibid., p. 84-85), qui peuvent être extrêmement fortes dans certains cas de figure, comme on le voit avec l’exemple de la culture canadienne-française telle que la décrit Buies.
-
[16]
Arthur Buies, « Interdictions et censures », Canada-Revue, vol. IV, no 6, 11 février 1893, reproduit par Laurent Mailhot, Anthologie d’Arthur Buies, p. 158.
-
[17]
Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, p. 89. Un peu plus tôt, il explique : « La part de réalité effective cachée derrière tout cela et volontiers déniée, c’est que l’homme n’est pas un être doux, en besoin d’amour, qui serait tout au plus en mesure de se défendre quand il est attaqué, mais qu’au contraire il compte aussi à juste titre parmi ses aptitudes pulsionnelles une très forte part de penchant à l’agression. […] L’existence de ce penchant à l’agression que nous pouvons ressentir en nous-mêmes, et présupposons à bon droit chez l’autre, est le facteur qui perturbe notre rapport au prochain et oblige la culture à la dépense qui est la sienne. Par suite de cette hostilité primaire des hommes les uns envers les autres, la société de la culture est constamment menacée de désagrégation. L’intérêt de la communauté de travail n’assurerait pas sa cohésion, les passions pulsionnelles sont plus fortes que les intérêts rationnels. » Ibid., p. 53-54.
-
[18]
Arthur Buies, « L’Homme [Petites chroniques pour 1877] », Chroniques, t. II, p. 423-424. Peut-être est-ce pour cette raison et parce qu’il en était conscient que Buies se réclame sans cesse de la pensée qu’il considère comme « la seule chose grande qu’il y ait en nous ». (« Le dernier mot », Chroniques, t. II, p. 286.)
-
[19]
« [P]endant près de quarante ans, son unique passion aura été de comprendre, d’expliquer, de convaincre. L’unité de sa vie — et de son oeuvre, car les deux sont indissociables —, c’est ce pragmatisme fondamental, assorti d’un didactisme naturel : littérature et action ne font qu’un. » Francis Parmentier, « Introduction », Arthur Buies, Chroniques, t. I, p. 28.
-
[20]
J’ai déjà traité la question chez Duras dans un article intitulé « La malédiction comme posture de vérité. Là où ça passe, ça traverse, ça respire » (Olivier Ammour-Mayeur, Florence de Chalonge, Yann Mével, Catherine Rodgers [dir.], Marguerite Duras. Passages, croisements, rencontres, Paris, Classiques Garnier, coll. « Colloques de Cerisy. Littérature », 2019, p. 171-183), en montrant en quoi sa posture à ce propos fait écho à celles d’Aquin, de Baudelaire et de Bataille, par exemple, mais aussi à celles de Freud, de Nietzsche, de Camus, de Kant, de Voltaire et, bien entendu, de Sade, qui se sont interrogés chacun à leur manière sur la nature du « mal ». L’étude de l’oeuvre de Buies s’ajoute ainsi à un vaste chantier en cours qui me permet de travailler en parallèle des corpus qui a priori ne semblent pas liés.
-
[21]
Paul-Laurent Assoun, Freud et les sciences sociales. Psychanalyse et théorie de la culture, Paris, Armand Colin, coll. « U. Psychologie », 2008, p. 4. Il ajoute plus loin : « Loin d’être l’annexe de la théorie des névroses, la théorie de la Culture en est l’aboutissement en quelque sorte, déjouant toute “pathologisation” de l’humain en donnant au “symptôme” sa vraie dimension anthropologique. » (Ibid., p. 39)
-
[22]
Pascal Brissette, La malédiction littéraire. Du poète crotté au génie malheureux, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2005, p. 18. Je reprends ici des précisions que j’ai déjà faites dans de précédents travaux, dont, en premier lieu, les conclusions auxquelles je suis parvenue au terme de ma thèse (Violence du réel et fragmentation chez Hubert Aquin et Marguerite Duras, thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2013, f. 386).
-
[23]
Marie Scarpa, « Le personnage liminaire », Véronique Cnockaert, Jean-Marie Privat et Marie Scarpa (dir.), L’ethnocritique de la littérature. Anthologie, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Approches de l’imaginaire », 2011, p. 180-181.
-
[24]
Ibid., p. 187.
-
[25]
Simone Korff-Sausse, « Préface. Freud, Hoffmann et les yeux », Sigmund Freud, L’inquiétant familier, suivi de Le marchand de sable de E.T.A. Hoffmann, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Paris, Payot, coll. « Petite bibliothèque Payot », 2011, p. 25-26.
-
[26]
On pourrait penser que cela correspond à la posture du pamphlétaire dont discute Marc Angenot, utilisée par Jeanne Boucher Lauzon dans son mémoire : « [L]e pamphlétaire est porteur d’une vérité à ses yeux aveuglante, telle qu’elle devrait de toute évidence imprégner le champ où il prétend agir — et pourtant se trouve le seul à la défendre et refoulé sur les marges par un inexplicable scandale. » (Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, Paris, Payot, coll. « Langages et sociétés », 1982, p. 38.) Or, comme c’est le cas des écrivains et des penseurs que je qualifie de « maudits », le phénomène me semble plus complexe chez Buies, même en ce qui concerne La lanterne elle-même. Si le discours buiéen correspond à plusieurs moments à celui du pamphlétaire, l’y résumer m’apparaît réducteur.
-
[27]
Paul-Émile Borduas, Refus global et autres écrits, p. 16-17.
-
[28]
Hubert Aquin, « La mort de l’écrivain maudit », Mélanges littéraires, t. I : Profession, écrivain, édition critique établie par Claude Lamy avec la collaboration de Claude Sabourin, Montréal, Bibliothèque québécoise, coll. « Littérature », 1995, p. 207 et p. 204. D’ailleurs, sans faire mention des écrivains qui précèdent la Grande Noirceur, Aquin parle pour sa part d’une parenté ou d’une filiation en mentionnant l’importance du Refus global : « Il y a déjà une tradition révolutionnaire, dans l’art et la littérature québécois, qui remonte à la publication en 1948, à Saint-Hilaire, d’un petit livre intitulé Refus global. […] Ces pages incendiaires ont déclenché chez les artistes québécois une volonté de libération qu’on retrouve, encore toute chaude, dans les poèmes les plus récents de Chamberland ou de Miron, ainsi que dans les romans de Godbout ou dans les livres violents de Marie-Claire Blais. Il serait difficile de parler ici d’influence au sens strict du mot, […] il faudrait plutôt parler de parenté secrète ou de filiation inconsciente. […] Maintenant que Borduas est mort, le cri de libération qu’il avait lancé en 1948 s’est amplifié. » (Hubert Aquin, « Littérature et aliénation », Mélanges littéraires, t. II, p. 261-263.) Cette filiation — qu’elle soit secrète, inconsciente ou non — à laquelle on pourrait ajouter, entre autres, Pierre Vadeboncoeur, est un des enjeux sur lesquels se porte ma réflexion actuelle, même s’il a été impossible d’en rendre compte ici. Dans cette optique, et malgré l’oubli relatif dans lequel ses écrits les plus éloquents sont tombés — dont, en particulier, sa Lanterne (voir Jonathan Livernois et Jean-François Nadeau, « Lire Buies », Arthur Buies, La lanterne. L’ennemi instinctif des sottises, des ridicules, des vices et des défauts des hommes, 2018, p. 7), Buies a sans aucun doute été un des premiers de cette « lignée » de penseurs maudits au Québec.
-
[29]
Francis Parmentier, « Introduction », Arthur Buies, Chroniques, t. I, p. 30.
-
[30]
Ibid., p. 28-29.