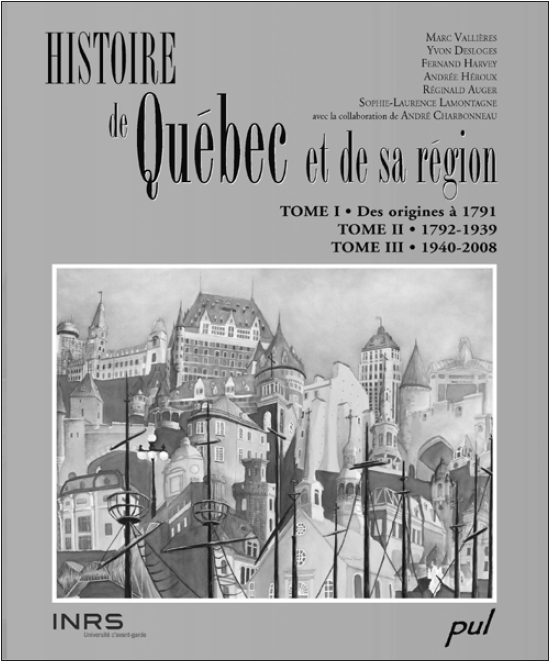Article body
Avec la parution de Histoire de Québec et de sa région, la collection « Les régions du Québec » vient de s’enrichir d’un 18e titre. Planifiée en 1995, cette recherche a démarré dès l’année suivante sous la direction de Marc Vallières, professeur d’histoire à l’Université Laval. Cette monumentale synthèse a donc nécessité 17 ans de travail pour une équipe qui réunissait des chercheurs autonomes tels Andrée Héroux ou des historiens provenant de Parcs Canada (Yvon Desloges et André Charbonneau) ou de l’IQRC et l’INRS (Fernand Harvey et Sophie-Laurence Lamontagne). L’archéologue Réginald Auger de l’Université Laval complète l’équipe qui a pu compter en outre sur la collaboration d’un nombre considérable de personnes de divers milieux.
Contrairement aux autres ouvrages de la collection, celui-ci porte non pas sur une région mais sur une ville et sa région immédiate, soit 13 000 km2. Grosso modo, celle-ci longe la rive nord du Saint-Laurent, tout en incluant l’île d’Orléans, depuis le Sault-au-Cochon jusqu’à Grondines et, au nord, englobe la réserve faunique des Laurentides en épousant les limites des anciens comtés électoraux. Cette région, faiblement peuplée, s’articule autour de la ville de Québec dont le coeur se situe entre le fleuve Saint-Laurent et le lit de la rivière Saint-Charles. Entre les deux s’étire, dans l’axe est-ouest, une plate-forme oblongue sur une distance de 13 kilomètres qui va de la basse-ville à Cap Rouge, lieu probable d’hivernement des Français de 1541 à 1543. Depuis sa fondation en 1608 à l’embouchure de la rivière Saint-Charles, la ville de Québec n’a cessé d’annexer d’abord ses faubourgs, puis les villes voisines pour prendre finalement les limites de la Communauté urbaine de Québec (CUQ) créée en 1969 et qui comprenait, en 2001, Sainte-Foy, Beauport, Charlesbourg, Sillery, Loretteville, Val-Bélair, Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures, L’Ancienne-Lorette, Saint-Émile, Vanier et Lac-Saint-Charles. En 2004, Saint-Augustin et L’Ancienne-Lorette profitaient d’une loi sur les défusions pour quitter la nouvelle ville. Dans ces deux cas, l’opposition aux fusions réalisées avait atteint plus de 61 % des voix exprimées, lesquelles représentaient respectivement 38,4 % et 40,94 % des personnes inscrites sur les listes référendaires. Cette partie sur les institutions (chapitre 19) est certes l’une des plus utiles. Elle permet de suivre l’évolution des dernières années et dissimule derrière des chiffres les lacunes des politiques d’aménagement. Pour l’étape finale, celle de 2000–2001, on se réfère au Rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales (Rapport Bédard, 1999) tout en laissant au lecteur le soin de réaliser que le législateur s’est servi de ce rapport pour imposer un type de fusion qui ne figurait dans aucun programme électoral ni dans le rapport Bédard lui-même. En outre, Marc Vallières évite de signaler les mises en garde formulées par les auteurs du rapport Bédard. Après avoir évoqué « la très vive opposition des municipalités de banlieue devant une fusion forcée », Vallières ajoute : « Faisant preuve d’un courage politique indéniable, le gouvernement maintient le cap » (p. 1751) ce qui « contribuera certainement à sa défaite électorale de 2003 ». Ce rappel des fusions municipales réalisées, alors que se terminait la rédaction de cette synthèse, permet de souligner le flegme des auteurs. Ils évitent les jugements personnels mais acceptent de rendre compte, sans s’attarder sur la perte de précieux repères toponymiques, avant tout milieux de vie et d’authenticité.
Face à l’étalement urbain qui transforme le Québec et son économie, le présent ouvrage est extrêmement instructif et montre bien l’érosion dont furent victimes les villes-centres au cours du dernier demi-siècle. La population de Québec n’a cessé de diminuer au profit des villes voisines et rien n’indique que les récentes fusions vont arrêter ce phénomène. Outre les banlieues immédiates, la rive sud a également reçu un apport démographique important, principalement à la suite de l’ouverture d’un deuxième pont sur le fleuve Saint-Laurent en 1970. Le pont ferroviaire déjà existant, appelé le pont de Québec, avait reçu une voie carrossable en 1929. Toutefois, un péage de 50 cents par voiture et de 10 cents par passager servait de frein jusqu’à son abolition en 1942. Ce fut alors une première ruée vers la rive sud, laquelle se déchaîna littéralement après 1970, les deux ponts étant gratuits. En un sens, cette réalité soudait les deux rives. Aussi les responsables de la collection ont eu à prendre une difficile décision en limitant la région de la Capitale nationale à la rive nord.
Une autre importante décision a trait à la périodisation retenue : le tome I couvre « des origines à 1791 », année de l’Acte constitutionnel qui sépare en deux la Province of Quebec créée en 1763. Vallières est bien conscient du scepticisme que provoquera cette périodisation. « Le choix de 1791, écrit-il en introduction [ . . . ], se substitue au choix peut-être plus évident de 1760 comme date charnière pour les raisons suivantes. Le changement de métropole constitue certes un événement majeur dans l’histoire de la Nouvelle-France, mais sa portée a été nettement plus marquée à Québec que dans les campagnes, en raison des fonctions militaires, administratives et portuaires de Québec » (p. 17). Plus loin, il ajoute : « Mal documentée et peu étudiée, la période 1760–1791 aurait pu passer dans l’ombre si elle avait été rattachée à la suivante, alors que son inclusion avec la Nouvelle-France permet de cerner plus directement les suites et conséquences de la Conquête qui se poursuivent plus intensément dans ces quelques décennies ». Vallières saura-t-il convaincre ? Dans le découpage général de sa synthèse, il opte pour la longue durée. Sa thématique se veut plutôt économique et sociale, mais il ne peut ignorer les étapes politiques qui restent bien commodes ; ainsi il choisit 1791, au lieu de 1763, et 1867, au lieu de 1840. En ce sens, il reste fidèle à la tradition qui caractérise la démarche de la plupart des historiens de l’Université Laval.
Tome II : 1792 à 1939 (chapitres 8 à 17)
Vallières ne nie pas la Conquête pour autant. Elle est même omniprésente, tout particulièrement pour Fernand Harvey dans son excellent chapitre 11 sur la vie culturelle (1792–1867). Même si la période étudiée démarre avec 1792, pour chaque sous-thème (théâtre, musique, arts visuels, littérature, architecture, institutions et associations), la référence à la Conquête est constante. Évidemment, quand il aborde la présence de la presse, Harvey n’a pas le choix et, à vrai dire, avec les sports non plus (p. 1004). En conclusion, Harvey, fidèle à son mandat, écrit : « Entre 1791 et 1867 la vie culturelle à Québec s’est complètement transformée », mais la réalité historique le rattrape et il ajoute : « Après la Conquête anglaise, Québec est affaiblie et ruinée, ses élites françaises disparues, sa vie culturelle réduite au minimum. De nouvelles pratiques culturelles sont progressivement introduites par les Britanniques » (p. 1008).
En mettant l’accent sur la vie économique dominée par une immigration en progression et par le florissant commerce du bois complété par une forte construction navale, Vallières s’en tire bien (chapitres 8, 9 et 10). Au chapitre 8, « Québec : port d’entrée de l’Amérique du Nord britannique », il place solidement ses balises et se situe nettement à la rencontre d’une histoire qui se veut structurelle mais qui ne répugne pas à faire de la place à une histoire événementielle. Le chapitre suivant s’arrête aux institutions et, cette fois, son découpage le sert bien. L’attention est sur Québec, ville militaire et parlementaire. Il peut filer allègrement de 1792 à 1867 (ou 1870). L’Acte d’Union de 1840 enlève à Québec son statut de capitale politique, mais Vallières ne s’en émeut pas. Il faut croire que l’Union des deux Canadas, cette nouvelle conquête, mérite encore moins d’attention que celle de 1760. Mais ce sont des choix d’auteur tout à fait légitimes.
Le tome II est divisé en deux parties de cinq chapitres. Après un solide survol de la vie économique (commerce, industrie, banques) dans le chapitre 13 qui lui permet d’amorcer la période 1868 à 1939, Vallières retrouve sa capitale au chapitre 14 et montre bien la curieuse cohabitation du gouvernement provincial avec le gouvernement fédéral. Son regard sur les institutions l’amène à suivre le quotidien des gens (chapitre 15) qu’il avait amorcé brillamment au chapitre 10 : naître, vivre, mourir ou encore famille, travail, pauvreté sont des thèmes qui retiennent son attention et la nôtre. Conflagrations, choléra, typhus, pauvreté, chômage, conflits de travail, pressions de toutes sortes favorisent l’exode urbain. Les gens fuient vers les faubourgs, en attendant d’être rattrapés par des annexions ou des fusions.
Québec est aussi française et Vallières ne l’oublie pas avant de passer la plume à Fernand Harvey qui renoue avec la vie culturelle au chapitre 16 pour couvrir cette nouvelle période (1868–1939). Il le fait avec le même degré d’érudition et d’objectivité qui avait caractérisé son chapitre 11.
Avant de clore ce tome II, Vallières sent le besoin de s’arrêter à la région proprement dite de Québec. Le chapitre 17 axé sur le secteur agro-forestier réserve plein de surprises : l’agriculture traditionnelle compose avec le virage vers l’industrie laitière, l’exploitation forestière débouche sur des grandes et petites scieries, puis sur les papetières. Des moulins à farine, à carder, à fouler voisinent avec des carrières, les activités touristiques se déploient lentement et les grandes révolutions liées aux communications font leur apparition : chemin de fer (sujet longuement présenté au chapitre 13), téléphone, électricité, dont les vrais artisans sont hélas ignorés. Pourtant les prouesses de Sigismund Mohr, immigrant à l’esprit inventif, auraient bien justifié quelques lignes, tout comme l’arrivée de l’électricité dans le quotidien des urbains puis dans celui des ruraux. Les expériences réalisées aux chutes Montmorency et sur la rivière Jacques-Cartier ne sont pas banales. Par ailleurs, la complexité du réseau ferroviaire est éloquente et bien soulignée. Les conséquences de la Conquête durent encore. La ville de Québec est victime de décisions qui se prennent au Canada anglais. Au moment de choisir une capitale, qui voudra d’une ville séparée de sa gare par un fleuve de glace ? À propos de ce tracé invraisemblable qui relie Winnipeg à Québec (ou plutôt à Lévis), Vallières le dit « inspiré essentiellement par des considérations politiques et économiques à long terme » (p. 1119). Partout dans le monde, le chemin de fer dessert des populations et a des effets structurants. Au Québec, le train passe dans le champ et il faut atteler la grise pour se rendre à la gare. Un autre trajet qui devait relier Québec à Montréal « évite les rives du fleuve (Neuville, Les Écureuils, Cap Santé, Deschambault et Grondines). Il les dessert à une distance de quelques kilomètres [ . . . ] donnant naissance à des petites communautés distinctes identifiées par le vocable station » (p. 1561). Ainsi, comme par hasard, au Québec, le chemin de fer traverse « des régions de colonisation à faible croissance et partant peu rentables » (p. 1119). Mais le chemin de fer finit quand même par atteindre des populations et inonder les communautés rurales de produits manufacturés. La vente par catalogue fait des ravages et sonne le glas de petites manufactures de meubles et de produits de toute sorte. De rares entreprises québécoises émergent toutefois et Vallières souligne à juste titre la réussite de Georges-Élie Amyot, cofondateur de la Dominion Corset (p. 1161), ou les succès d’un homme d’affaires comme Zéphirin Paquet qui, avec l’aide de sa femme, fonde un grand magasin, Paquet, qui sera un modèle et une référence dans Québec (p. 1188) C’est l’occasion aussi de présenter cette fameuse rue Saint-Joseph qui ne cédera qu’avec l’arrivée des centres commerciaux de la périphérie : Place Ste-Foy en 1958, Place Laurier en 1961 (p. 1665–1666) et les Galeries de la Capitale (1981), qui s’installent « en plein champ » forçant progressivement les pouvoirs publics à étirer ses boulevards et autoroutes de même que son réseau de transport en commun.
Tome III : 1940 à 2008 (chapitres 18 à 22)
Dans la foulée de ces centres commerciaux où les locaux, c’est-à-dire les gens de la place, sont des commis ou, au mieux, des locataires, surgissent, selon le modèle établi, les magasins de grande surface ou les magasins de type entrepôt. Le commerce de détail passe sous le contrôle des chaînes de magasins de toute nature et le commerce de gros se déplace vers Toronto. L’essentiel de la production qui avait déjà déserté avec la « vente par catalogue » s’éloigne encore davantage avec le phénomène des « grandes surfaces ». Miraculeusement, le tissu commercial de la ville-centre, gravement malmené, a survécu, mais il a fallu des greffes successives qui ont atteint un sommet avec les fusions forcées de 2001.
Cette analyse de l’évolution du commerce de détail, qualifiée habilement par Vallières d’économie de services, nous entraîne vers le tome III et le chapitre 18. Heureusement que certaines institutions financières viennent sauver la situation avec la complicité d’une industrie touristique, un port qui a connu ses hauts et ses bas, une base militaire—le Camp de Valcartier—qui deviendra le lieu d’une énorme production de munitions militaires (p. 1571) et surtout des établissements de recherche et d’enseignement (chapitre 20) fièrement présentées par Vallières, lesquelles sont doublées d’équipements culturels de grande qualité (chapitre 21) que Harvey décrit avec un plaisir et un enthousiasme évidents. Dans chaque cas, le défi était de taille.
Tout au long des trois tomes, la zone rurale est souvent difficile à rattraper et c’est particulièrement le cas dans le tome III où la Capitale nationale, dite ville industrielle et ville moderne, accapare toute l’attention avec, en prime, la Communauté urbaine de Québec (CUQ). Avant de « fermer les livres », Vallières se sait obligé de prendre le pouls de la région qu’on lui a confiée. Il est bien inspiré en choisissant de la dire « envahie par la modernité ». Cette évolution est rapide et profonde. Les structures politiques n’y échappent pas et les conseils de comté font place aux municipalités régionales de comté (Portneuf, La Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré et L’Île-d’Orléans). Il n’y aura pas de grandes révolutions sur le plan de l’aménagement du territoire, mais au moins il y a des lieux de rencontres et de réflexion. Vallières jette aussi un coup d’oeil aux petites municipalités, aux paroisses, à la vie religieuse, au système scolaire et aux services médicaux.
Tome I : des origines à 1791(chapitres 1 à 8)
L’examen de la périodisation choisie par Marc Vallières et son équipe nous a conduit directement aux tomes II et III. Avant de conclure cette note critique, il faut voir le sort fait à la période de colonisation française et aux années qui ont immédiatement suivi le changement de métropole. Puisqu’il s’agit ici de la capitale de la Nouvelle-France et de sa région immédiate, cette période est particulièrement importante.
Fidèle au modèle de la collection, l’ouvrage s’ouvre avec une présentation du milieu physique, signée de la géographe Andrée Héroux qui se charge également du chapitre 7 complètant le tome I. Ce chapitre intitulé « Au temps des seigneuries » démystifie ce fameux régime seigneurial sous ses divers aspects. Son approche est très instructive et ce chapitre est vraiment intéressant. Tous les aspects de l’occupation du territoire sont examinés : ressources, défrichements, activités économiques extrêmement diversifiées (carrières, construction navale, tanneries). L’auteure s’intéresse aussi aux gens, à leur quotidien et profite du contexte pour présenter les Hurons de Lorette tout en signalant au passage certaines traditions amérindiennes, comme la pêche à l’anguille (p. 611).
Toutefois, les Amérindiens ont droit à une présentation distincte qui enchaîne dès le début sur cette « terre de beauté » (chapitre 1) pour déboucher sur « l’espace amérindien avant l’arrivée des Européens » (chapitre 2). Après une rapide présentation du cadre physiographique de la région immédiate de Québec qui fait bien le lien avec le texte précédent, l’archéologue Réginald Auger fait le point sur les plus récentes théories du peuplement humain de l’Amérique du Nord. C’est intéressant, mais trop bref. Qu’une présence humaine en Béringie puisse être aussi ancienne que 17 000 ans av. J.-C. n’exclut pas la thèse du corridor à l’est des montagnes Rocheuses et si un certain peuplement a pu se faire par la côte ouest, ce qui me semble une théorie très ancienne, il faut quand même amener ces gens à gagner le coeur du continent, c’est-à-dire à passer à l’est. Quel parcours suivent-ils ? Remontent-ils à partir de l’Amérique centrale ? Et qui sont ceux qui prolongent ce mouvement migratoire ? Qu’il y ait eu des stocks génétiques différents, c’est plus que probable. Pour étudier et cerner ces migrations, la diversité linguistique est en effet à retenir tout comme la présence de certaines plantes. Autrement dit, les recherches sont loin d’être terminées et elles appellent beaucoup de prudence.
Auger pose aussi l’énigme de la disparition des Iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent entre les voyages de Jacques Cartier et celui de Champlain et Pont-Gravé en 1603. « Certains chercheurs ont évoqué le génocide ou l’épidémie » comme cause principale. L’emploi du mot génocide n’est pas approprié, tandis que les épidémies semblent être largement en cause. Tous les observateurs des débuts de la colonisation espagnole ou anglaise signalent les ravages invraisemblables de la maladie. Entre 1580 et 1610, il se produit sur la côte atlantique le même phénomène que sur le Saint-Laurent : les autochtones disparaissent. On sait aujourd’hui qu’un seul cas de variole suffit pour déclencher un immense désastre. L’épidémie de 1837 a UN responsable qui a été identifié.
Les guerres intertribales sont évoquées. La cause : le précieux rôle d’intermédiaire pour traiter avec les Européens. Si ceux-ci sont alors concernés, ils peuvent l’être tout autant pour expliquer les épidémies. On sait mieux aujourd’hui que le Saint-Laurent a été passablement fréquenté par des Européens entre 1580 et 1600. À cet égard, François Gravé, sieur du Pont, aurait justifié un peu d’attention. Il est derrière la tentative de 1600 et celle de 1603. Il conduit à la fondation de Québec. Compte tenu du sujet de cet ouvrage, ce n’est pas rien.
Après avoir consacré plusieurs pages à « l’espace amérindien avant l’arrivée des Européens à Québec » et avoir scruté avec soin cette évolution, il semble y avoir un certain déséquilibre dans la présentation de l’arrivée des Européens eux-mêmes. Il flotte dans les diverses références à la fondation de Québec, un flou regrettable (p. 103, 113–116, 135, 544 alors qu’on suggère que Champlain a remonté le Saint-Laurent en 1604). Lancé à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de Québec, cet ouvrage a été confronté à de curieux débats, plusieurs fort instructifs mais sans doute trop tardifs pour être pris en compte. Tandis que certains tenaient à faire jouer un rôle à Dugua de Mons, il est apparu à plusieurs que c’est plutôt François Gravé, sieur du Pont, qui tire les ficelles pour les successifs détenteurs du monopole de la traite sur le Saint-Laurent. Passionné par le pays, il assure la liaison jusqu’en 1629 et entraîne dans son sillage son fils, son gendre et son petit-fils, lequel sera à ses côtés au moment de la capitulation de Québec en 1629. Celui que Champlain nomme Pont-Gravé a été l’inspirateur des alliances franco-indiennes sans lesquelles il n’y aurait pas eu de Nouvelle-France.
Ces remarques n’enlèvent rien à l’originalité de la présentation que fait Yvon Desloges, historien qui a fait carrière à Parcs Canada. Passionné par la culturelle matérielle, il entraîne le lecteur dans un survol économique original qui va de 1608 à 1791. C’est la commande qu’il a reçue. On peut bien sûr suivre les exportations de divers produits, faites depuis Québec, sur l’ensemble de cette période, même si l’auteur doit parfois faire une coupure vers 1760 comme sur « les exportations de castor sur La Rochelle, 1718–1761 » (p. 137) ou le « bois exportés de Québec, 1727–1752 » (p. 147). Il est parfois à la merci des études existantes pour montrer les « valeurs des exportations et importations du Canada, 1729–1745 » ou des « valeurs des exportations aux Antilles, 1729–1757 » (p. 132–133). Mais la Conquête de 1760 n’a pas changé la nature du pays qui a toujours des fourrures, du bois ou du poisson à exporter. Est-ce que la demande diffère ? Desloges le suggère pour certains « produits naturels » (p. 155) tout en exprimant une certaine prudence. La question est plus claire pour la construction navale qui « se résume quantitativement à peu » au lendemain de 1760 (p. 161). Mais ce n’est pas le propos de Desloges et il s’intéresse avant tout aux activités économiques pour elles-mêmes : la construction résidentielle, les tanneries, cordonneries, selleries, brasseries, distilleries, pêcheries, boulangeries, la tonnellerie et la briqueterie, etc. Les dépenses administratives et militaires retiennent son attention et il tente, à l’aide des travaux de Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, de suivre « L’indice du coût de la vie à Québec, 1663–1799 » (p. 190). Sans surprise, on observe que lors des périodes de conflits (c. 1713 ou 1758–1759), de dangereux sommets sont atteints.
Après avoir relevé le défi de ce chapitre 3 au titre évocateur « Au rythme des marées », Desloges traite de « Québec, capitale coloniale française », et ce même après 1760. Au caractère français s’ajoute alors la dimension religieuse. Progressivement, la religion anglicane cherche à s’implanter avant de devoir composer avec plusieurs autres religions protestantes. L’auteur va à l’essentiel, aborde l’univers de la justice, présente la mise en place d’institutions parlementaires en insistant surtout sur les modes de gouvernement qui ont précédé.
Avec la collaboration de son collègue André Charbonneau, également de Parcs Canada, Desloges fait ensuite naître la ville physique. Ils sont tous deux en terrain familier. Québec prend forme sous les yeux du lecteur. Il y a derrière ce chapitre une trentaine d’années de patients travaux historiques et archéologiques. Il est possible que ces deux fonctionnaires fédéraux connaissent mieux la capitale québécoise que leurs homologues provinciaux ou municipaux. On dira que c’est normal puisque le gouvernement fédéral est de loin le plus important propriétaire foncier de la ville de Québec et de sa région immédiate. La dernière acquisition ayant donné naissance à la Réserve nationale de faune de cap Tourmente (1978). C’est d’ailleurs avec une fierté à peine dissimulée que Desloges et Charbonneau font état des nombreuses activités de Parcs Canada et des importants travaux réalisés par les chercheurs de cet organisme sur Québec et sa région.
Une ville, c’est avant tout une population dont la présentation constitue la deuxième partie du chapitre 5. Toutes les couches de la petite société sont présentées : les élites, les religieux, les marchands, les artisans, les militaires, etc. Les auteurs ont même choisi de faire une place aux « personnes vulnérables » : veuves, domestiques, esclaves et vieillards. En fait, ce chapitre est d’une richesse vraiment exceptionnelle. Chaque pierre a été remuée, chaque porte entrouverte.
Desloges ne s’arrête pas là. Tout l’intéresse et le chapitre 6 intitulé « Culture et loisirs, sciences et alimentation, 1663–1791 » lui permet de nous offrir un petit festin. Le mot est approprié puisque les arts et spectacles correspondent non seulement à la musique, au théâtre ou à la peinture, mais aussi à la table du manant, celle du palais et celle de l’Anglais, dit John Bull.
Cette fois, les liens entre la fin du régime français et le début du régime anglais servent bien les attentes du lecteur ; Desloges est en parfaite maîtrise de son sujet et lui sert un vrai régal. La petite société canadienne d’avant la Conquête n’est pas celle qu’ont imaginé bien des auteurs en mal d’exotisme. On vit plutôt bien en Nouvelle-France, où l’homme de science et l’artiste côtoient le coureur des bois.
Des sujets jadis peu étudiés, comme l’immigration ou les épidémies, sont bien présentés (et plus loin par Vallière aussi). À lui seul, le tableau 6.6 sur les épidémies à Québec et en Nouvelle-France de 1639 à 1799 (p. 493) fait frémir. Cet exemple est l’occasion de souligner les mérites de la plupart des tableaux, graphiques et cartes qui accompagnent le texte. Ils sont pertinents et s’appuient sur des sources qui sont clairement présentées. C’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble des références et des notes, lesquelles viennent souvent avec des commentaires fort pertinents. Ceux-ci sont toutefois rares pour accompagner les illustrations présentées en petit format, selon le style adopté pour la collection. Bien choisies, la plupart auraient justifié une vraie légende.
Conclusion
En vérité, cette Histoire de Québec et de sa région est d’une richesse inépuisable. L’équipe qui l’a réalisée est solide et honnête. Elle ne s’arroge pas tous les mérites et rend justice aux multiples travaux consultés. La meilleure façon de le faire n’est-elle pas, non seulement de les citer, mais aussi de bien les utiliser. Cela dit, Vallières, Auger, Desloges, Charbonneau, Harvey, Lamontagne et Héroux sont des chefs de file dans leurs champs respectifs et ils ont livré, dans ce remarquable ouvrage, de belles synthèses de leurs propres recherches et productions.
Ce chantier des histoires régionales de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) est une entreprise colossale qui a su rallier de nombreux chercheurs qui ont dû faire preuve de beaucoup d’abnégation et de ténacité. Le public, souvent généreux au moment des collectes de fonds, et les experts constamment sollicités peuvent aujourd’hui profiter d’une collection qui prend place fièrement aux côtés du Dictionnaire biographique du Canada. Ces deux indéniables réussites montrent le long chemin parcouru depuis la création des premiers départements de sciences humaines. La prochaine étape est sans doute de rendre le plus accessible possible cet ensemble de synthèses régionales. Le Québec, c’est Montréal dit-on souvent, mais c’est aussi un bel éventail de régions dont on n’a pas fini d’apprécier les multiples facettes et de découvrir les inépuisables richesses.