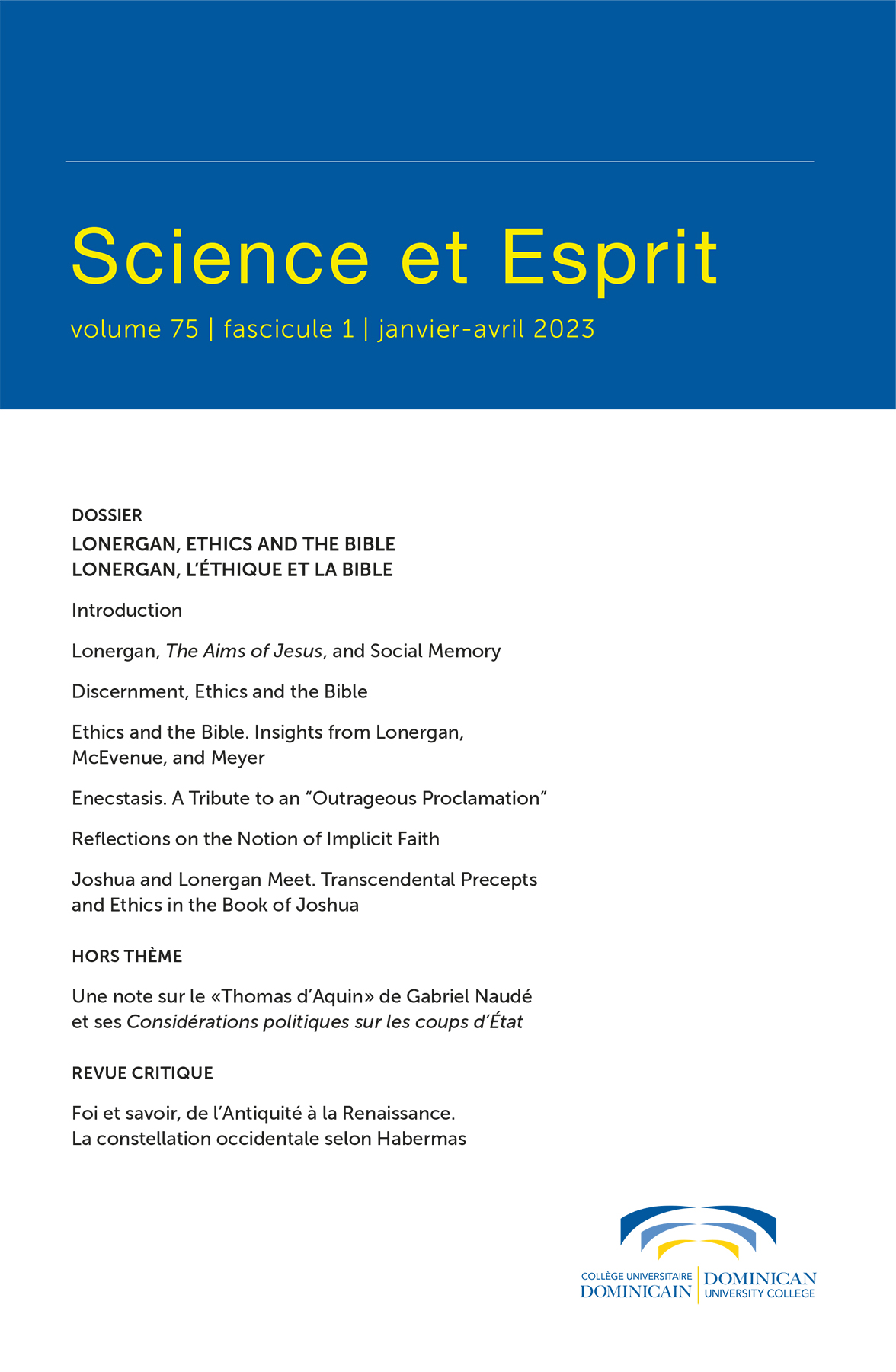Ce livre, qui comprend sept chapitres, une trop brève conclusion de deux pages, une bibliographie (p. 199-222) et trois index – auteurs, références bibliques et sources anciennes – (p. 223-238), est le fruit d’une thèse de doctorat présentée à l’Université de Durham en 2016, sous la supervision de Stuart Weeks, Robert Hayward et Walter Moberly (p. vii). Dans le premier chapitre (« Introduction », p. 1-11), Kumiko Takeuchi présente ses objectifs, rappelle brièvement quelques interprétations de l’épilogue du livre de Qohélet et aborde la question de la datation du livre. Selon lui, le livre de Qohélet aurait été rédigé à Jérusalem (p. 85), entre la fin du 4e siècle et le début du 3e siècle, au moment de la transition entre la période perse et la période hellénistique (p. 11). Pour justifier cette date, il évoque la présence de mots d’origine perse (p. 6) et suppose que Ben Sira, qui a rédigé son livre entre 200 et 175, connaissait le livre de Qohélet (p. 7). Il estime aussi que l’absence de trace d’une conscience nationale et le ton individualiste du livre indiquent que celui-ci aurait été rédigé à un moment où le peuple a perdu son identité nationale (p. 9-10). En outre, tout en refusant de voir dans certains passages du livre des allusions à des circonstances historiques propres à un moment particulier de l’histoire, Takeuchi affirme que le livre a été rédigé à une époque instable du point de vue politique et économique, alors qu’émerge une nouvelle idéologie philosophico-religieuse (p. 7-8). Cependant, il est d’avis que rien dans le livre de Qohélet, du point de vue aussi bien de la langue que de la culture, ne témoigne d’une influence grecque (p. 145). Par ailleurs, il justifie sa datation par le fait que Qohélet et la littérature démotique partagent, d’une part, le même scepticisme à propos du destin et de la vie dans l’au-delà et, d’autre part, le même avis à propos du caractère inscrutable de l’activité divine (p. 59). Bien sûr, maints exégètes estimeront que ces arguments ne permettent pas de dater le livre de Qohélet avec précision. Intitulé « Contexte historique », le chapitre 2 vise à présenter une synthèse des diverses conceptions de la mort, de la vie post-mortem et du jugement divin dans le Proche-Orient ancien, plus précisément l’Égypte (p. 13-22), la Mésopotamie (p. 22-29), le monde syro-palestinien (p. 29-31), la Grèce (p. 32-39) et Israël (p. 39-59). Malheureusement, cette synthèse est superficielle et n’a guère de lien avec les thèses défendues dans les chapitres suivants. En outre, l’auteur ignore quelques travaux incontournables sur le livre de Qohélet et les traditions anciennes du Proche-Orient. Par exemple, en ce qui concerne l’Égypte, il aurait eu intérêt à lire Stefan Fischer, Die Aufforderung zur Lebensfreude im Buch Kohelet und seine Rezeption der ägyptischen Harfnerlieder (Wiener Altestamentliche Studien 2), Frankfurt am Main, Peter Lang, 1999. Pour la Mésopotamie et le monde syro-palestinien, l’article de Christoph Uehlinger, « Qohelet im Horizont mesopotamischer, levantinischer und ägyptischer Weisheitsliteratur der persischen und hellenistischen Zeit », dans Ludger Schwienhorst-Schönberger (Hrsg.), Das Buch Kohelet : Studien zur Struktur, Geschichte, Rezeption und Theologie, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1997, p. 155-257, pour ne nommer que celui-ci, lui aurait permis d’être un peu plus critique. Quant aux pages consacrées au monde grec, elles sont trop brèves pour rendre compte de la complexité et de la richesse des nombreuses conceptions de la mort, de l’au-delà et du jugement divin chez des auteurs comme Homère, Xénophane, Pythagore, Platon et Épicure. La synthèse portant sur la Bible hébraïque est classique, sauf en ce qui a trait à …
Kumiko Takeuchi, Death and Divine Judgment in Ecclesiastes (Bulletin for Biblical Research Supplement, 26). University Park PA, Eisenbrauns, 2019, 15,2 × 22,8 cm, xv-238 p., ISBN 978-1-57506-991-3[Record]
…more information
Jean-Jacques Lavoie
Département de sciences des religions, Université du Québec à Montréal