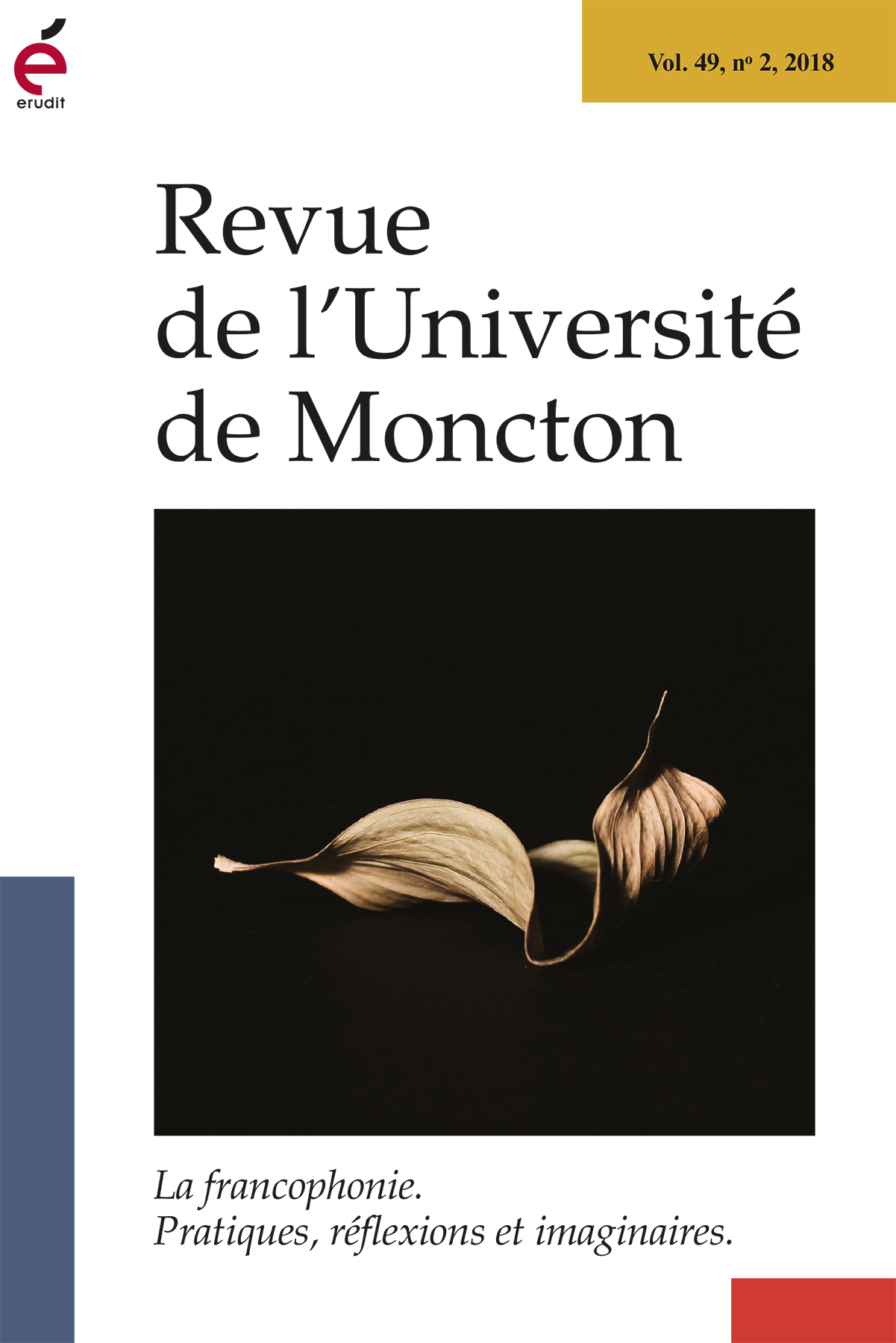Article body
Le programme de La littérature malgré tout est rendu explicite dès les premières pages; l’unité du livre ‒ et ce malgré son aspect disparate, les différents essais le composant ayant été écrits au fil des ans ‒ résiderait non pas dans une pensée sur la littérature, mais bien dans une sensibilité à la littérature. L’ouvrage ne s’adresserait donc pas aux spécialistes du fait littéraire et aurait plutôt pour public cible « un individu [...] pour qui les oeuvres littéraires ne sont pas un objet d’étude mais un art de vivre, une manière de préserver et d’approfondir en nous le petit espace dʼhumanité et de liberté qui nous reste » (pp. 7-8). Même si la littérature comme art de vivre est posée comme le fil conducteur du recueil, il demeure que le principal objet de son propos semble être ailleurs. Sitôt annoncée, cette prémisse paraît remplacée par ce qui préoccupe réellement l’auteur : la fin de la littérature ou, plus particulièrement, sa normalisation.
Cette normalisation de la littérature, c’est, pour Ricard, la perte des grands courants rassembleurs, l’éclatement de la forme, la désuétude de la notion d’école ou de mouvement littéraire. Pis encore, la plus grande facilité de lʼécriture qui caractérise notre époque contemporaine ‒ les apprenti.e.s écrivain.e.s seraient désinhibé.e.s et ne frémiraient plus devant la tâche de l’oeuvre à écrire ‒ ainsi que son explosion provoqueraient, irrémédiablement, un appauvrissement de la littérature. Cette post-littérature aurait perdu sa fonction de médium pour parvenir à une forme de connaissance, de même que son pouvoir d’ébranlement; bref, l’art de vivre de la littérature serait à trouver dans ses vestiges. Malgré l’invitation à la lectrice et au lecteur de considérer la littérature comme un art de vivre formulée dans la préface intitulée « Avertissement », il est difficile d’adopter cette posture comme critique, puisque l’auteur lui-même ne reste pas sur ce terrain.
En fait, dans les différentes parties de son ouvrage, Ricard s’applique à montrer ce qui est et ce qui n’est pas de la littérature. La littérature que l’essayiste privilégie est celle qu’il connaît et à laquelle il a participé sous différents chapeaux. Il partage lʼhabitus de nombreu.x.ses écrivain.e.s de sa génération, étant un produit du collège classique où il s’est formé comme lecteur : la littérature est au coeur de son identité depuis son adolescence. Ricard mentionne également sa participation à lʼéquipe de la revue Liberté pendant les années 1970 :
[…] le passé de la revue avait quelque chose dʼintimidant. Que voulez-vous, on ne se retrouve pas sans trembler un peu, quand on a à peine trente ans, en compagnie de Fernand Ouellette, Jacques Godbout, Jean-Guy Pilon ou Jacques Brault, dans une revue ayant publié Hubert Aquin, Gaston Miron, Jacques Ferron, Michèle Lalonde, Paul-Marie Lapointe et tant dʼautres.
p. 9
L’auteur souligne sa présence parmi les grand.e.s de Liberté, qui sont aussi les grand.e.s de la littérature québécoise. En prenant en considération la formation classique de Ricard ainsi que son rôle de témoin auprès du panthéon des lettres québécoises, de ceux et celles qui ont « fait » la littérature québécoise, on devine son goût pour la valeur canonique de la littérature. Comme le note avec beaucoup d’à-propos Patrick Guay dans son commentaire de lecture sur La littérature malgré tout, c’est « une vision crépusculaire et nostalgique »[1] de la littérature que propose Ricard. Il est nostalgique de la production littéraire québécoise des décennies 1960 et 1970, qui « se voulait aussi moderne que possible, en ce sens qu’elle privilégiait l’expérimentation, la nouveauté, mais aussi la critique et la contestation (sociale, politique, idéologique, morale, esthétique) » (p. 111). Notons au passage que ces propos sont contradictoires, en connaissant la « méfiance instinctive [de l’auteur] à l’égard de la littérature dite engagée ou militante » (p. 44). Il y aurait donc une bonne et une mauvaise littérature engagée, des bons (la Révolution tranquille et ses épiphénomènes) et des mauvais contextes de contestation.
Ricard affirme que les frontières de la littérature québécoise seraient de moins en moins perceptibles :
[l]es anciennes définitions de la « québécitude » (ruralité, neige, grands espaces, canots d’écorce, esprit familial ou pauvreté naïve) étant devenues intenables, on a assisté à partir des années 1980 à une nouvelle tentative pour sauver la spécificité québécoise, en l’apprêtant cette fois à la sauce contemporaine. Il s’agit de lʼ« américanité ».
p. 112
Difficile de ne pas voir dans ce passage une prescription de lecture, voire un règlement de comptes. L’extrait précédent laisse également transparaître l’opinion que nourrit l’essayiste à l’endroit des théories et des méthodologies, qui ne feraient que retarder la rencontre, la confrontation avec l’oeuvre. Nombreuses sont les cibles de l’essayiste : lʼaltérité, quʼil lie à un « multiculturalisme jovialiste et mondialisé », lʼautofiction comme « forme dégradée du Bildungsroman » et le roman jeunesse comme sous-groupe de la littérature « niaiseuse » (p. 118). Lʼauteur fait fi de la recherche actuelle en littérature québécoise qui propose des pistes sur lʼimaginaire du Nord ‒ qui nʼest pas chose du passé ‒ et un nouveau régionalisme, qui a peu à voir avec le signe surconnoté quʼest le terroir. Aussi, il réduit les études sur lʼaméricanité québécoise à une simple stratégie pour ne pas assumer le nouvel âge de la littérature québécoise, qui serait devenue post. Néanmoins, lʼessayiste propose une piste particulièrement intéressante et originale pour appréhender les tendances de la littérature québécoise contemporaine : lʼétude des très nombreux manuscrits refusés par les éditeurs.trice.s pour débusquer « les codes et les attentes littéraires » (p. 115).
Pour Ricard, la littérature légitime ‒ cʼest bien ce dont il est question ‒ se doit dʼêtre universelle et dʼavoir pour fin la beauté. Les concepts dʼUniversel et de Beauté sont présentés comme des donnés, et non pas comme des constructions chargées idéologiquement. La littérature serait lʼexercice de la pensée la plus exigeante et la plus universelle et la trajectoire de toute oeuvre serait de sʼextirper de son carcan national (ou autre) pour atteindre l’universel. Sans que l’auteur n’explicite ce qu’il entend par universel, on comprend que celui-ci est blanc et surtout mâle, comme en fait foi l’utilisation récurrente du mot « homme » pour parler de l’être humain. Cet emploi est non seulement fautif, le terme « homme » n’étant ni générique, ni neutre, mais il s’inscrit également à contre-courant de la tendance actuelle d’une écriture de plus en plus inclusive. Ce choix informe sur la vision de la littérature de Ricard, qui nʼest pas inclusive. La section intitulée « Lectures au grand air » en est particulièrement évocatrice. Cette partie de l’ouvrage est consacrée à des auteur.e.s dont l’oeuvre n’est pas suffisamment lue ou fait l’objet de lectures erronées. Cette entreprise de réhabilitation est réalisée à partir du cas de huit auteurs blancs et de deux autrices blanches. Bien qu’un tri était inévitable, le continent européen est surreprésenté et Gabrielle Roy figure comme seule représentante des Amériques. Où sont les écrivain.e.s des Caraïbes, des pays africains et sud-américains, les auteur.e.s autochtones qui ont été négligé.e.s par la critique? Cette sélection non-inclusive est très certainement voulue, le genre, la race et lʼautochtonie ne relevant pas de lʼUniversel. Selon Ricard, qui prend pour exemple la « canadianité » et la « féminité » de lʼoeuvre de Gabrielle Roy, ces particularismes seraient sclérosants sur le plan littéraire. En somme, cʼest dans un art de vivre blanc et mâle permis par la littérature que lʼhumanité est censée se reconnaître, qu’elle serait alors prise d’admiration et plongée dans une méditation. Une oeuvre féministe ou encore un texte mettant en scène la race ne peuvent-ils pas ébranler et ne donnent-ils pas accès à une forme de connaissance?
Ricard est dʼavis que la littérature ne relève pas du domaine de la politique, ni de celui de l’idéologie : elle se situe sur le terrain de l’art. Et pourtant, tout est idéologique et tout est politique, on ne s’en sort pas. L’ouvrage de Ricard n’y échappe pas, il est le produit de son époque, il représente une vision quelque peu élitiste de la littérature, bercée par l’illusion d’une condition humaine universelle (européenne, blanche et mâle) et le culte du canon quʼil a reçue au cours de ses études classiques. Ma critique, elle non plus, n’échappe pas à l’idéologie; j’ai débuté ma formation en lettres à la fin de la décennie 2000 et je m’intéresse aux minorités culturelles, à tous leurs particularismes : j’ai, moi aussi, mes partis pris. Plus que de la fin de la littérature, il me semble qu’il s’agit plutôt de la fin du quasi monopole blanc, masculin et européen de la littérature (l’auteur utilise dʼailleurs les propos d’Antoine Compagnon et de Julien Gracq pour parler de la fin de la littérature). Je dois donner raison à Ricard, la littérature comme « don des morts » (p. 121) est bel et bien sur le déclin, mais la littérature n’est pas morte pour autant : ses significations et ses valeurs sont à chercher ailleurs que dans lʼUniversel.
Appendices
Note
-
[1]
Patrick Guay, « La littérature malgré tout », Nuit blanche, no 153, hiver 2019, p. 47.