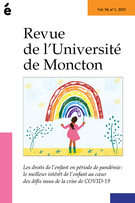
Revue de l'Université de Moncton
Volume 38, Number 1, 2007 Gérald Leblanc, multipiste Guest-edited by Raoul Boudreau and Jean Morency
Table of contents (14 articles)
Articles
-
Visions de Gérald
Herménégilde Chiasson
pp. 7–31
AbstractFR:
L’auteur livre un témoignage sur la relation amicale et littéraire qui l’a lié durant plus de trente ans à Gérald Leblanc. Il s’agit d’un regard d’écrivain avec de fréquentes allusions à des situations et des débats qui dépassent l’Acadie. Cette époque se voit évoquée sous son aspect nostalgique, mais également avec la consistance d’une proximité et d’une volonté commune d’inscrire l’Acadie dans le paysage littéraire. On y retrouve des commentaires sur leurs parcours communs en tant qu’auteurs mais aussi en tant que témoins et participants à une vision interne, à l’activisme social et à l’affirmation d’une Acadie du discours. Le texte est aussi parsemé d’anecdotes, de références et de réflexions sur le processus créatif de Leblanc dans sa volonté de transmuer sa vie en création littéraire.
EN:
The author provides a testimonial of his friendship and literary relationship with Gérald Leblanc that extended over a period of more than thirty years. He offers us a writer’s perspective with frequent allusions to situations and issues that go well beyond Acadie. The author’s portrayal of the era is nostalgic, but also attests to the consistent proximity and common will to inscribe Acadie in the literary landscape. We find comments on their shared experiences as authors but also as witnesses to and participants in an internal vision, in social activism and in the affirmation of a discourse from Acadie. The text is also interspersed with anecdotes, references and reflections on Leblanc’s creative process and his desire to transform his life into literary creation.
-
La création de Moncton comme « capitale culturelle » dans l’oeuvre de Gérald Leblanc
Raoul Boudreau
pp. 33–56
AbstractFR:
Un des legs important de l’oeuvre de Gérald Leblanc est d’avoir créé le mythe très improbable de Moncton comme capitale culturelle de l’Acadie. Il y parvient en utilisant des stratégies éprouvées ailleurs, comme l’intégration à son oeuvre d’un récit sur Moncton comme centre fébrile de création artistique et la mise en scène des oppositions parallèles tradition/modernité et ruralité/urbanité. Les handicaps de Moncton à une vocation culturelle en langue française deviennent pour Leblanc des stimulants qui relancent son écriture. La construction symbolique de Leblanc autour de Moncton s’avère très efficace dans le cercle des artistes acadiens et de leur public qui adhèrent à la croyance au mythe et en font une réalité. Au delà de l’Acadie, le pouvoir du mythe est plus aléatoire et si certains y adhèrent, d’autres soulignent le décalage entre le Moncton rêvé par Leblanc et la réalité.
EN:
One of Gérald Leblanc’s most important legacies is the unlikely creation of the myth of Moncton as the cultural capital of Acadie. He succeeds in doing so by using proven strategies, such as the introduction into his works of a narrative describing Moncton as an ebullient centre for arts and culture as well as through the construction of parallel oppositions, both temporal and spatial, such as the traditional versus the modern and the rural versus the urban. Moncton’s shortcomings as a capital for a francophone culture become, in the eyes of Leblanc, occasions for literary possibility. Leblanc’s symbolic re-construction of Moncton is deemed very compelling by the inner circle of Acadian artists and their public, who believe in the myth and, in so doing, make it a reality. Beyond Acadie, the power of the myth is more uncertain; while some accept it, others point to what they perceive as being the gap between Moncton in the poetic dream of Leblanc and Moncton in its reality.
-
Les vagabondages de Gérald Leblanc en terre poétique
Fabienne Claire Caland
pp. 57–74
AbstractFR:
Dans chaque recueil poétique (Les matins habitables,Je n’en connais pas la fin, Le plus clair du temps et Techgnose, par exemple) et dans sa prose romanesque (Moncton mantra), Gérald Leblanc marque de sa présence désirante et jouissante les territoires géographiques, réels ou imaginaires. Ce sont des vagabondages en terre poétique, rythmés par des intertextes qui exsudent la corporalité de la langue (française et anglaise). Ce sont autant de compagnons de route nommés Arthur Rimbaud, dont Leblanc emprunte les semelles de vent pour aller grand-erre avec Jack Kerouac, Bob Dylan ou Tim Buckley, dont les répertoires servent de cadre à des poèmes nourris par ailleurs de jazz et teintés de spiritualité bouddhique. Les intertextes, nombreux et variés, font partie d’un voyage fulgurant. À bord des « textes-taxis », selon l’expression de Leblanc, le paysage, essentiellement urbain, se recompose sans cesse pour engendrer une succession ininterrompue d’inouïssances. Seul demeure le bleu – couleur, note, etc. – qui fonctionne comme un invariant dans ce paysage toujours à naître et une terre acadienne à rêver.
EN:
In both his poetry (Les matins habitables,Je n’en connais pas la fin, Le plus clair du temps, Techgnose) and fiction (Moncton mantra), Gérald Leblanc made his imprint on the territories, real and imaginary, that he went through. A wanderer in poetic ground, his works are punctuated by various forms of intertextuality, all of which radiate the physical dimension of language, French and English. On his travels, his imaginary companions are Arthur Rimbaud, whose “soles of wind” he borrowed to go roaming high and low, Jack Kerouac, Bob Dylan and Tim Buckley. Their songs provide a framework for Leblanc’s poems, also nurtured by jazz and tinged with Buddhist spirituality. The numerous intertexts being re-organized are all part of a voyage where images and references collide. In his textes-taxis, to quote his own phrase, cityscapes are perpetually being re-organized setting off a continuous series of inouïssances. The color blue, which is both visual and acoustic when the blue note is mentioned, is the only element that never changes in Leblanc’s inchoate landscapes and his dreamed-of Acadian land.
-
Leblanc, Ginsberg, Hakim Bey et autres visionnaires
François Paré
pp. 75–92
AbstractFR:
Dès le milieu des années 70, lors de voyages à New York et en Nouvelle-Angleterre, Gérald Leblanc fait la découverte cruciale de certains poètes américains de la contre-culture. Le poète acadien est fasciné par les vives discussions suscitées au sein de la société américaine par des écrivains militants comme Allen Ginsberg et Lawrence Ferlinghetti. Cette lecture de toute une époque de contestation deviendra l’une des assises de l’oeuvre poétique de Leblanc. Notre étude porte d’abord sur la figure centrale de Ginsberg, chez qui Leblanc emprunte certaines pratiques formelles et de nombreux éléments thématiques, tels les renvois onomas-tiques à la communauté des poètes, le lexique spiritualiste d’inspiration bouddhiste et la construction même de la mission du poète militant au sein de sa société. Ensuite, une lecture plus tardive, celle du poète contestataire Hakim Bey, attirera notre attention, car elle est à l’origine de la notion de « cartographie » si chère à Leblanc.
EN:
While travelling to New York City and New England in the mid-70’s, Gérald Leblanc discovered the writings of a number of American poets of the counter-cultural movement. Leblanc was fascinated by the intense discussions surrounding the works of militant poets such as Allen Ginsberg and Lawrence Ferlinghetti. His discovery of a generation of social protest writers would become the foundation for most of Leblanc’s poetic works. In this study, I first examine the influence of Ginsberg, a central figure from whom Leblanc borrowed numerous formal and thematic elements, including onomastic allusions to the community of poets, a spiritualist lexicon inspired by Ginsberg’s Buddhist references and a strong sense of the poet’s militancy among his peers. The second part of this paper is devoted to the later reading of American protest poet Hakim Bey, whose notion of cartography became so important in Leblanc’s work.
-
Gérald Leblanc, écrivain du village planétaire
Jean Morency
pp. 93–105
AbstractFR:
Ce texte propose une lecture de l’oeuvre poétique de Gérald Leblanc à la lumière du concept de village planétaire forgé par Marshall MacLuhan. En observant le mouvement de dérive qui conduit le poète de la ville imaginée jusqu’au village globalisé, via ses déambulations dans les rues de Moncton et ses méditations dans les espaces du quotidien, l’auteur en arrive au constat que la polyphonie des poèmes de Leblanc est liée avant tout à la situation du poète dans l’espace communicationnel nord-américain. Moncton cesse ainsi de s’offrir comme un pur espace urbain pour devenir une réalité concrète, un chapelet de lieux et de visages familiers. Véritable réceptacle des pratiques issues de la contre-culture, l’oeuvre de Leblanc s’avère symptomatique de la condition postmoderne, qui a modifié sensiblement les paramètres régissant la position de l’écrivain dans le champ culturel. Dans cette perspective, il est possible de relire cette oeuvre comme étant l’expression de la mise en place d’une gigantesque machine cybernétique, carburant à la musique, à la voix et aux images visuelles.
EN:
This paper offers a reading of Gérald Leblanc’s poetic works based on Marshall MacLuhan’s concept of the global village. From Leblanc’s invented city to the global village, uncovered through his daily strolls around the streets of Moncton and his meditations in the spaces of his everyday life, the polyphonic elements found in his poems are linked primarily to the North American media space. Moncton ceases to be a purely urban area and is transformed into a concrete reality, a display of familiar scenes and faces. By conflating artistic practices found in the counterculture, Leblanc’s work is symptomatic of post-modernism, which has greatly modified the writer’s position in the cultural domain from this perspective; his work can be re-interpreted as the expression of the foundation of a gigantic cybermachine that fuels music voices and visual images.
-
Langues et traduction en équilibre : de Moncton mantra à Moncton Mantra
Catherine Leclerc
pp. 107–138
AbstractFR:
Moncton mantra de Gérald Leblanc (1997) est un roman qui porte sur la naissance à l’écriture, mais aussi sur la difficulté d’écrire en contexte minoritaire. Comme dans plusieurs autres écrits minoritaires, on y trouve maints exemples d’« effets de traduction » (Simon, 1994). Cette part traductionnelle est redoublée dans la traduction anglaise de Jo-Anne Elder (2001). Comme l’original, la traduction est en quête d’une langue d’écriture. Et comme l’original oscillait entre des stratégies d’assimilation et de différenciation, la traduction recourt tantôt à l’ethnographie et tantôt à l’assimilation. Cet article explore l’équilibre précaire auquel arrivent l’auteur et sa traductrice. D’un côté, les difficultés que rencontre le roman dans la transmission de son récit s’intensifient dans la traduction. De l’autre, cette affinité entre stratégies d’écriture et de traduction fait du texte d’Elder un lieu de complicité et d’échos particulièrement puissant avec celui de Leblanc.
EN:
Gérald Leblanc’s novel, Moncton mantra (1997), is about the birth of a writer, but it also about how difficult it is to write in a minority context. As in many literary texts written by linguistic minorities, it is full of “translation effects” (Simon, 1994). In turn, the English version doubles these effects. Like the original, Jo-Anne Elder’s translation (Moncton Mantra, 2001) tries to find the right language to tell Leblanc’s story. Whereas Leblanc’s text oscillates between assimilation and differentiation, Elder’s translation navigates between assimilation and ethnography. This article explores the precarious linguistic balance achieved by both Leblanc and his translator. On the one hand, the challenge of conveying the experience related in the novel is intensified in the translation. On the other hand, the affinity between Leblanc’s writing strategies and Elder’s translation strategies makes her work resonant and complicit with Leblanc’s.
-
La construction du poète
Alain Masson
pp. 139–150
AbstractFR:
Comment Gérald Leblanc s’est-il fait poète? La réponse peut se trouver dans son oeuvre poétique. Deux explications peuvent s’avérer utiles. Dans son enfance, le poète découvrit un accès à une sorte d’équivalence universelle, qu’il devait appeler plus tard « Acadie », c’est-à-dire sans doute poésie. Cela entraînait une vision nouvelle de la langue, clé de l’analogie plutôt que système de différences. Cette expérience s’était donnée dans une coïncidence avec l’espace et le temps. Il arrive donc que le poème soit rencontré, étant, dans sa forme idéale, éternel. Une histoire concurrente fait du poète un travailleur patient à l’écoute des bredouillements de la ville, bâtissant son autoportrait avec des choses trouvées en chemin. Il réclame un sens politique, et vit dans un monde de prose commune, mais ne peut être compris que dans une lecture poétique. Les deux tableaux sont également vrais.
EN:
How did Gérald Leblanc become a poet? The answer can be found in his poetic works. Two accounts might prove helpful. During his childhood, the poet gained access to a kind of universal equivalence which he later called “Acadie” clearly another name for poetry. This led to a fresh view of language as a key to analogy rather than a system of differences. This experience was provided by an intimate encounter with time and space. Thus the poem is encountered its ideal form, as being eternal. An alternative story shows the poet as a worker, listening patiently to the mumblings of the town, constructing his self-portrait out of things found along the way. He claims a political meaning and lives in a world of ordinary prose, but can only be understood through a poetic reading. Both pictures are equally true.
-
Intimité et acadianité : le fonds Gérald Leblanc, un gisement à exploiter
Monique Ostiguy
pp. 151–168
AbstractFR:
Cet article met en valeur le potentiel de recherche du fonds Gérald Leblanc. Les manuscrits de Gérald Leblanc témoignent de l’ensemble de sa production littéraire et rendent compte de ses méthodes de travail, des mécanismes de production de ses écrits, des processus qui ont mené à l’émergence de son oeuvre. Son journal intime et sa correspondance constituent un corpus de choix pour plusieurs champs d’études littéraires, anthropologiques et historiques dont les études sur le genre autobiographique, sur la mise en scène du soi, ou les travaux portant sur l’histoire de la correspondance et les réseaux de sociabilité. Le fonds témoigne particulièrement du courant littéraire qui a émergé dans les années 70 en Acadie tout en rappelant le rôle de Leblanc dans l’évolution de la culture acadienne en milieu urbain.
EN:
This article highlights the research potential of the Gérald Leblanc fonds. Gérald Leblanc’s papers provide evidence of his overall literary contribution and reveal his methods, the creative evolution of his writing, and the processes which led to the emergence of his oeuvre. His personal diary and correspondence are a rich source for many aspects of literary, anthropological and historical scholarship, including studies of autobiography, self-identity, as well as research on the history of correspondence and social networks. The fonds is particularly representative of the literary movement that emerged in the 70’s in Acadie, as well as recalling Leblanc’s role in the evolution of urban Acadian culture up until the end of the twentieth century.
-
Identité(s) : poème inédit de Gérald Leblanc
-
Bibliographie de Gérald Leblanc
-
Chronologie de Gérald Leblanc



