L’éducation est une voie privilégiée de transmission et d’épanouissement de la culture d’un peuple comme d’un individu, et l’école demeure la première institution sociale dont la mission est l’éducation. L’éducation, en favorisant notamment le dialogue entre quête de sens et construction des savoirs, se doit de procurer à l’élève des outils et des langages pour comprendre le monde et se comprendre dans le monde (Simard, 2002a, p. 72). C’est cette perspective culturelle qui anime l’actuelle réforme en éducation au Québec. Réaffirmer l’école dans sa finalité culturelle (en plus de ses finalités utilitaire et cognitive), comme l’affirmait le Rapport Inchauspé (1997), à la suite des États généraux sur l’éducation de 1996, est devenu une priorité en cette époque où déferlent sur notre monde la pensée unique et la généralisation de la culture MacDo ou MacWorld à la vitesse de la mondialisation du système de marché (Aktouf, 1999). S’appuyant sur ce rapport, le ministère de l’Éducation du Québec, dans son document L’école tout un programme : énoncé de politique éducative (ministère de l’Éducation du Québec – MÉQ, 1997), statuait sur l’extrême urgence de rehausser la dimension culturelle des programmes de formation, principalement dans les disciplines, et de favoriser une approche culturelle pour enseigner ces disciplines. Les orientations du Programme de formation de l’école québécoise, tant à l’ordre du primaire que du secondaire (MÉQ, 2001a et 2003), préconisent l’ancrage culturel dans les apprentissages réalisés par l’élève afin d’élargir sa vision du monde, de structurer son identité et de développer son pouvoir d’action. La volonté ministérielle de renforcer les liens entre éducation et culture, de réhabiliter le rôle des savoirs, voire des diverses disciplines dans une perspective culturelle, est tout à fait pertinente. L’élève, dans son parcours de formation, sera convié aux grands univers de la connaissance et de la culture ; ces savoirs essentiels que sont les langues, le champ de la technologie, de la science et des mathématiques, l’univers social, les arts et le développement personnel, constituent un ensemble de connaissances et de pratiques, formant le noyau de la culture. Rappelons-le, la perspective culturelle conçoit la formation d’abord, comme l’appropriation, par les nouvelles générations, des savoirs de la culture, qui constituent le propre de l’être humain et qui sont l’essence du monde où il faut vivre, monde qui n’est plus naturel mais culturel (Rapport Inchauspé, 1997, p. 25). Cela semble primordial dans une société où la jeunesse, privée de son passé et en mal d’avenir a tendance, comme dans la plupart des sociétés occidentales, à vivre au présent. À la lumière de plusieurs auteurs (Bruner, 1991, 1996 ; Dumont, 1968 ; Simard, 2002a), avoir une approche culturelle de l’enseignement signifierait se préoccuper d’une appropriation personnelle et significative des savoirs par l’élève, situer les savoirs dans le contexte historique, social et culturel de leur élaboration tout en instaurant des liens avec la culture première de l’élève – avec la diversité, voire la disparité qu’on connaît, tant du point de vue du profil culturel des jeunes que de la profusion des lieux de savoir et de la puissance des technologies de communication –, provoquer chez l’élève une prise de conscience de sa propre culture tout en prenant du recul pour mieux la comprendre et s’ouvrir à soi, aux autres et au monde. Il en résultera une évolution de ses propres représentations et de ses savoirs, ferments d’une culture en devenir. Un des mandats de l’éducation se dessine donc ainsi : mettre en oeuvre des conditions qui permettent aux élèves de s’approprier, d’intégrer et d’organiser les connaissances en un tout cohérent, original et personnel, de se situer au sein des problèmes et des réalités …
Appendices
Références
- Aktouf, O. (1999). L’analphabétisme, paradoxe de nos sociétés néo-libérales. Dans M. Ebrahimi (Dir.) : Éducation et démocratie. Entre individu et société. Montréal : Isabelle Quentin Éditeur.
- Boucher, A.-M. et Pilote, A. (2006). La culture en classe de français. Guide du passeur culturel. Québec : Publications Québec français.
- Bruner, J. (1991). …Car la culture donne forme à l’esprit. De la révolution cognitive à la psychologie culturelle (Trad. Y. Bonin). Paris : Eshel.
- Bruner, J. (1996). L’éducation, entrée dans la culture (Trad. Y. Bonin). Paris : Retz.
- Charlot, B. (1997). Du rapport au savoir. Éléments d’une théorie. Paris : Anthropos.
- Chartrand, S. (2005). Pour une culture de la langue à l’école. Dans D. Simard et M. Mellouki (Dir.) : L’enseignement. Profession intellectuelle. Québec : Presses de l’Université Laval.
- Demougin, P. et Massol, J.-F. (1999). Lecture privée, lecture scolaire. Grenoble : Centre régional de documentation pédagogique.
- Derrida, J. (1996). Le monolinguisme de l’autre. Paris : Galilée.
- Dufays, J.-L., Gemenne, L. et Ledur, D. (2005). Pour une lecture littéraire. 2e édition. Histoire, théories, pistes pour la classe. Bruxelles : De Boeck-Duculot.
- Dumont, F. (1968). Le lieu de l’homme. La culture comme distance et mémoire. Montréal : HMH.
- Falardeau, E. (2003). Compréhension et interprétation : deux composantes complémentaires de la lecture littéraire. Revue des sciences de l’éducation, 29(3), 673-694.
- Gohier, C. (2002). La polyphonie des registres culturels, une question de rapports à la culture. L’enseignant comme passeur, médiateur et lieur. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 215-238.
- Lahire, B. (2004). La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi. Paris : La Découverte.
- Lebrun, M. (2006). Un nouveau contenu d’enseignement, la littérature à l’école primaire : analyse de pratiques. Dans É. Falardeau, C. Fisher, C. Simard et N. Sorin (Dir.) : Le français : discipline singulière, plurielle ou transversale ? Québec : Université Laval (support CD-Rom).
- Ministère de l’Éducation du Québec (1997). L’école tout un programme : énoncé de politique éducative. Québec : Gouvernement du Québec.
- Ministère de l’Éducation du Québec (2001a). Programme de formation de l’école québécoise. Éducation préscolaire. Enseignement primaire. Québec : Gouvernement du Québec.
- Ministère de l’Éducation du Québec (2001b). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. Québec : Gouvernement du Québec.
- Ministère de l’Éducation du Québec (2003). Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Québec : Gouvernement du Québec.
- Ministère de l’Éducation et ministère de la Culture et des Communications [MCC] (2003). L’intégration de la dimension culturelle à l’école. Québec : Gouvernement du Québec.
- Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2006). Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006.
- [En ligne]Disponible : http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
- Poslaniec, C. (2002). Réception de la littérature de jeunesse par les jeunes. Paris : INRP.
- Rapport Corbo (1994). Préparer les jeunes au 21e siècle. Rapport du Groupe de travail sur les profils de formation au primaire et au secondaire. Québec : ministère de l’Éducation.
- Rapport Inchauspé (1997). Réaffirmer l’école. Rapport du Groupe de travail sur la réforme du curriculum. Québec : ministère de l’Éducation.
- Rouxel, A. et Langlade, G. (2004). Le sujet lecteur : lecture subjective et enseignement de la littérature. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- Saint-Jacques, D., Chené, A., Lessard, C. et Riopel, M.-C. (2002). Les représentations que se font les enseignants du primaire de la dimension culturelle du curriculum. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 39-62.
- Simard, D. (2001). L’approche par compétences marque-t-elle le naufrage de l’approche culturelle dans l’enseignement ? Vie pédagogique, 118, 19-23.
- Simard, D. (2002a). Contribution de l’herméneutique à la clarification d’une approche culturelle de l’enseignement. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 63-82.
- Simard, D. (2002b). Comment favoriser une approche culturelle de l’enseignement ? Vie pédagogique, 124, 5-8.
- Simard, D. (2004). Une approche culturelle dans l’enseignement du français, langue première. L’Écho du R.É.S.E.A.U, 4(1), 10-20.
- Simard, D. (2005). Comment penser aujourd’hui la nature et le rôle de l’école à l’égard de la formation culturelle des élèves ? Dans D. Simard et M. Mellouki (Dir.) : L’enseignement. Profession intellectuelle. Québec : Presses de l’Université Laval.
- Simard, D. et Côté, H. (2005). L’approche culturelle dans l’enseignement du français. Dimensions et pistes pédagogiques. Québec français, 139, 72-74.
- Simard, D. et M. Mellouki (2005). L’enseignement. Profession intellectuelle. Québec : Presses de l’Université Laval.
- Sorin, N. (2003). Le récit de vie en classe de littérature : regards sur l’autre et images de soi. Tangence, 71, 93-106.
- Sorin, N. (2004). Le récit et la construction de l’identité personnelle. Dans R. Toussaint et C. Xypas (Dir.) : La notion de compétence en éducation et en formation. Fonctions et enjeux. Paris : L’Harmattan.
- Sorin, N. et Lafortune L. (2006). La perspective culturelle en formation à l’enseignement : compétence culturelle et culture pédagogique. Dans J. Loiselle, L. Lafortune et N. Rousseau (Dir.) : L’innovation en formation à l’enseignement. Québec : Presses de l’Université du Québec.
- Tardif, M. et Mujawamariya, D. (2002). Introduction. Dimensions et enjeux culturels de l’enseignement en milieu scolaire. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 3-20.
- Tauveron, C. (Dir.) (2001). Comprendre et interpréter le littéraire à l’école et au-delà. Paris : INRP.
- Tauveron, C. (2004). La lecture comme jeu, à l’école aussi. Dans C. Tauveron (Dir.) : La lecture et la culture littéraires au cycle des approfondissements. Paris : ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. [En ligne. Disponible : http://eduscol.education.fr/D0126/lecture_litteraire_tauveron.htm, dernière consultation le 3 janvier 2006.
- Tauveron, C. et Reuter, Y. (1996). Lecture et écriture littéraires à l’école. Paris : INRP.
- Zakhartchouk, J.-M. (1999). L’enseignant, un passeur culturel. Paris : ESF éditeur.

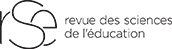
 10.7202/011409ar
10.7202/011409ar