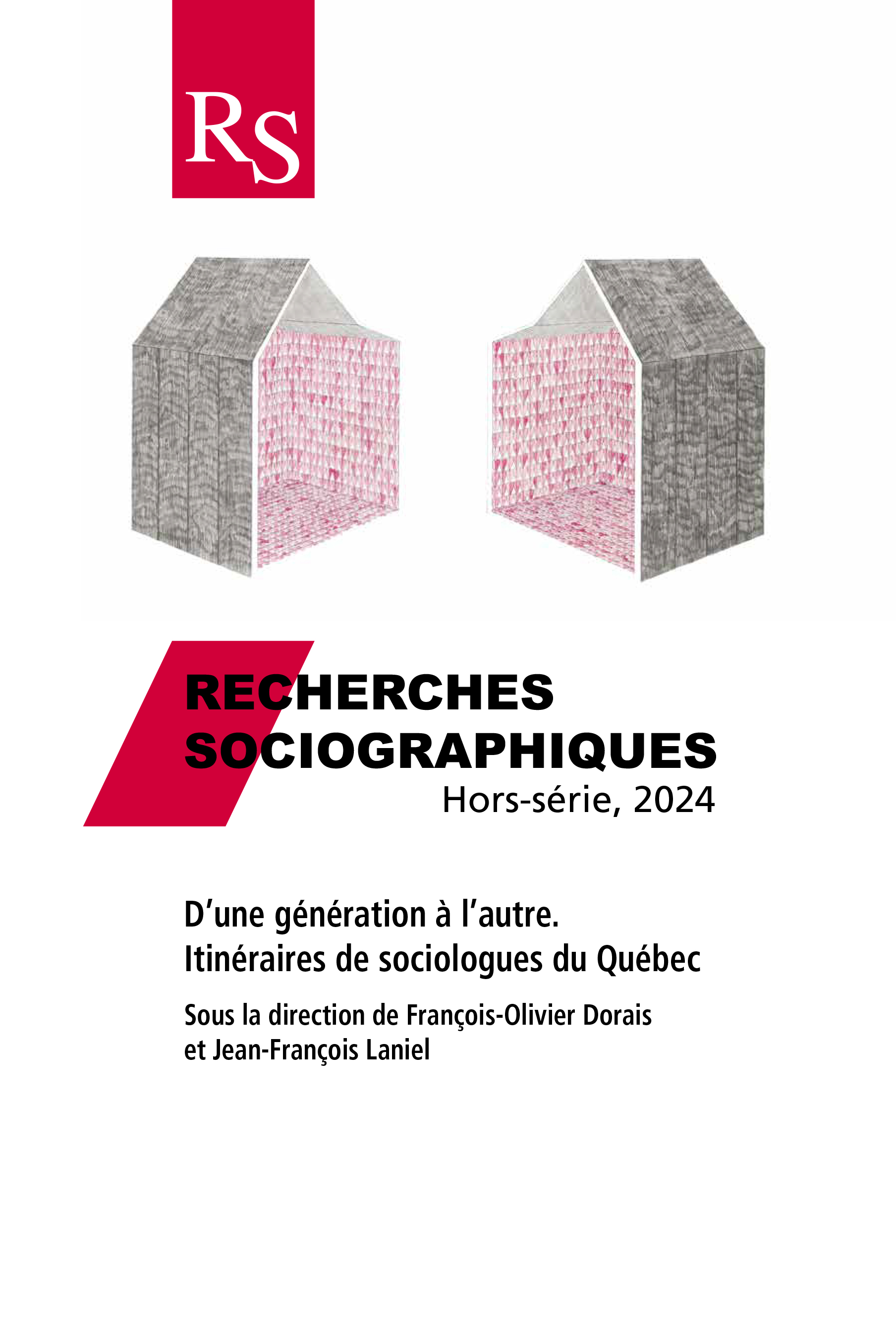Je suis venue bien tardivement à la sociologie. En fait, rien ne m’y prédestinait. Mon parcours scolaire a été influencé par la commission Parent, mise sur pied par le gouvernement Lesage en 1961. En 1957, je suis entrée en première année à l’école Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Montréal, une école réservée aux filles et gérée par les soeurs de la Congrégation Notre-Dame. C’était bien avant que le rapport Parent ne recommande la création d’un ministère de l’Éducation, qui vit le jour en 1964 et donna à l’État la responsabilité de l’éducation jusque-là placée sous l’égide du clergé. On était en plein baby-boom et les écoles manquaient cruellement d’espace. J’allais donc à l’école seulement le matin ou l’après-midi. Comme j’avais de bonnes notes lorsque je terminai la septième année que comptait alors le primaire, je fus inscrite au cours classique au couvent des Soeurs de Sainte-Anne à Saint-Jérôme. Les collèges classiques étaient « des établissements privés (…) contrôlés par le clergé » et « constituaient alors la seule porte d’entrée à l’université » (Bienvenue, citée par Gauvreau, 2019). Le rapport Parent en recommanda l’abolition, et préconisa plutôt l’ajout d’une cinquième année au secondaire et la mise sur pied des cégeps, comme nouvelle voie assurant la gratuité des études et pouvant mener à l’université. Mes études classiques furent ainsi interrompues après la onzième année, communément appelée « versification ». J’aimais beaucoup les mathématiques, une matière dans laquelle j’excellais. On m’orienta donc vers les sciences pures pour ma 12e année (ou 5e secondaire). Ce fut une année extrêmement difficile, que je terminai de peine et de misère. Je n’avais reçu à peu près aucun enseignement en science, hormis quelque vague introduction en chimie, et je me retrouvais soudain entourée d’élèves issus du « scientifique » et férus de chimie, de physique et de biologie. Je poursuivis en sciences pures au cégep, question de « ne pas me fermer de portes », comme on a encore tendance à le conseiller aux jeunes aujourd’hui (Carrier, 2023). Au tournant des années 1970, les avenues professionnelles ouvertes aux femmes étaient passablement restreintes. À mes yeux, mes choix se réduisaient aux carrières suivantes : secrétaire, infirmière, hôtesse de l’air ou institutrice. J’optai pour la dernière avenue. Les postes d’enseignement ouverts en mathématiques étant rares, j’entrepris un programme en éducation physique. C’est là que je suivis mon premier cours d’introduction à la sociologie. Je détestai farouchement ce cours obligatoire donné à un grand groupe en amphithéâtre. C’était bien mal parti pour la sociologie… Ma carrière comme professeure d’éducation fut brève. Après avoir enseigné un an au niveau secondaire cette matière obligatoire mais non prise en compte dans le calcul de la moyenne scolaire des élèves, je décidai de retourner aux études. J’entrepris un deuxième baccalauréat en mathématiques alors que mon conjoint d’alors entamait des études en sociologie. Je me revois encore lui dire : « Vous, les sociologues, avez la tête dans les nuages; nous, les mathématiciens, sommes concrets ». Pourtant, la première année du programme en mathématiques était essentiellement constituée de cours théoriques axés vers la démonstration de théorèmes. Il m’était bien difficile, lors de nos réunions de famille, de parler de la beauté d’une preuve mathématique, ou encore d’expliquer une preuve par l’absurde, alors que mon conjoint pouvait discuter aisément des problèmes d’inégalité ou des conflits traversant la société. Comme je terminais ma première année, un ami d’un ami de mon conjoint évoqua la démographie, une discipline dont je n’avais jamais entendu parler. On me dit que si j’aimais les mathématiques appliquées, j’aimerais le programme en démographie offert à l’Université de Montréal. …
Appendices
Bibliographie
- Assemblée nationale du Québec, 2024 Projet de loi no 56, Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, Éditeur du Québec.
- Carrier, Léa, 2023 « Plaidoyer pour les sciences “molles” », La Presse, Montréal, 5 mars. [https://www.lapresse.ca/contexte/2023-03-05/education/plaidoyer-pour-les-sciences-molles.php#], consulté le 9 mars 2023.
- Comité consultatif sur le droit de la famille, 2015 Alain Roy (prés.), Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Montréal, Éditions Thémis.
- Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille, 2002 Rapport fédéral-provincial-territorial final sur les droits de garde et de visite et les pensions alimentaires pour enfants, ministère de la Justice du Canada.
- Dion, Léon, 1974 « Itinéraires sociologiques », Recherches sociographiques, vol. 15, no 2-3 : 229-231.
- Falardeau, Jean-Charles, 1974 « Itinéraires sociologiques », Recherches sociographiques, vol. 15, no 2-3 : 219-227.
- Gauvreau, Claude, 2013 (mis à jour en 2019) « Le rapport Parent : un document fondateur », Actualités UQAM, Série Cinquante ans d’histoire, Montréal, 13 novembre. [https://actualites.uqam.ca/2013/le-rapport-parent-un-document-fondateur/], consulté le 21 mars 2023.
- Laplante, Benoît, 2006 « The Rise of Cohabitation in Quebec. Power of Religion and Power Over Religion », Canadian Journal of Sociology, vol. 3, no 1 : 1-24
- Paetsch, Joanne J. et al., 2005 Stratégie de justice familiale axée sur l’enfant, ministère de la Justice du Canada.
- Rioux, Marcel, 1974 « Itinéraires sociologiques », Recherches sociographiques, vol. 15, no 2-3 : 311-312.