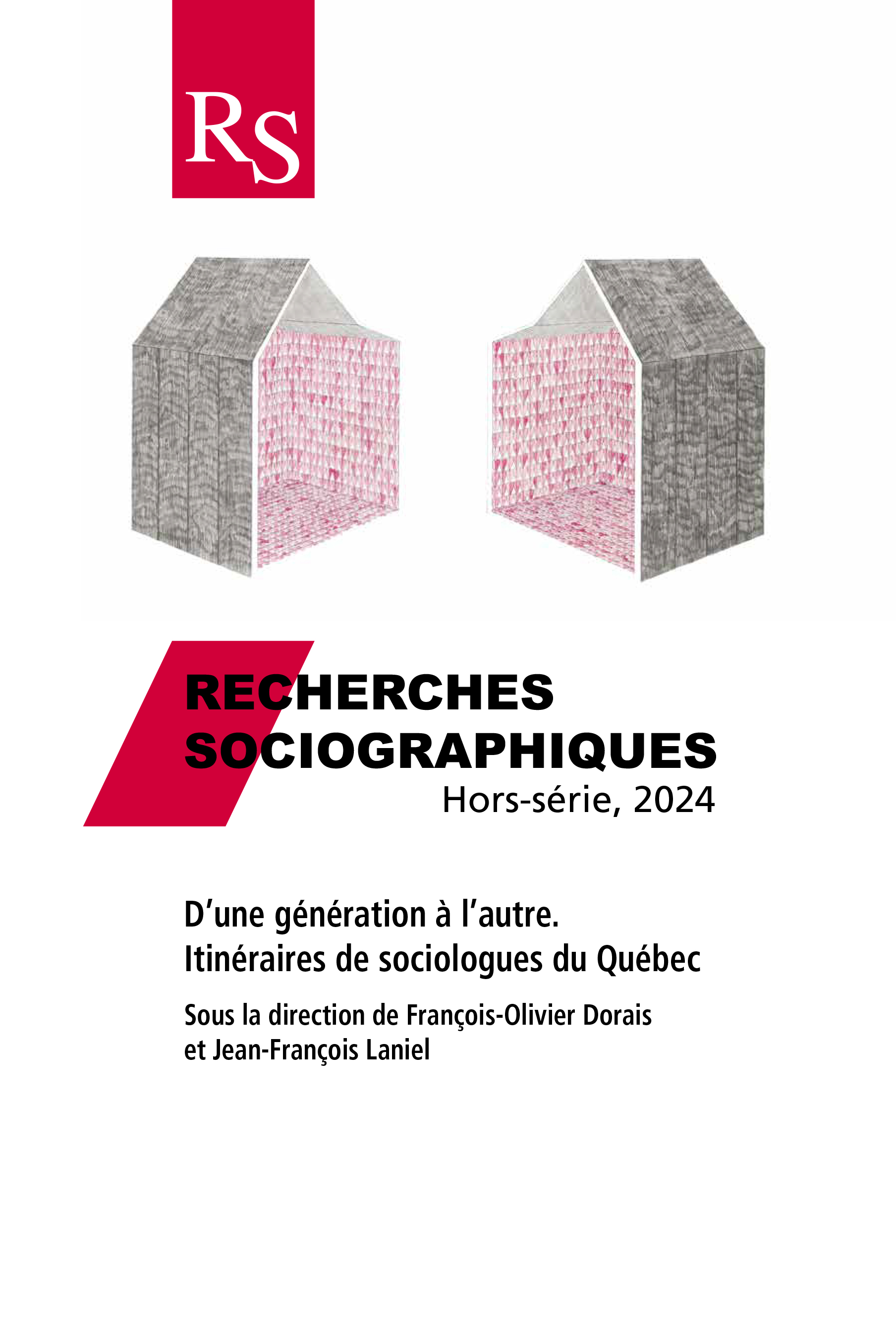Mon intérêt pour l’histoire sociale m’a amené à la sociologie après un long parcours académique. Je suis de la génération lyrique, ainsi qualifiée par François Ricard; une connotation que je préfère à la dénotation démographique de baby-boomer. Né à Montréal en 1943 dans le quartier de la Petite-Patrie, j’appartiens à cette génération qui a connu une fulgurante mobilité sociale en comparaison du niveau d’instruction de celle de ses parents. Ce fut, du reste, le cas de nombreuses familles canadiennes-françaises de l’après-guerre. Mon père et ma mère croyaient à la nécessité de l’instruction pour leurs trois enfants. C’était le seul héritage qu’ils pouvaient nous transmettre, disaient-ils. En septembre de 1956, j’ai entrepris mon cours classique au Collège Sainte-Croix, aujourd’hui le Cégep Maisonneuve. Cet externat classique qui recrutait ses élèves au sein des familles ouvrières et de classes moyennes inférieures de l’Est de Montréal a formé plusieurs personnalités connues au Québec. Les clercs et les laïques qui y enseignaient m’ont ouvert au monde de la culture savante, incluant la littérature française, la musique classique, la philosophie et l’histoire. Les activités parascolaires offertes par le Collège ont beaucoup contribué à élargir mes horizons, particulièrement le scoutisme pour sa dimension pédagogique et le journalisme étudiant comme banc d’essai pour interpréter la société. À l’intérieur du programme scolaire, l’histoire du Canada a retenu mon attention au moment où Jean-Paul Bernard enseignait cette matière en classes de belles-lettres et de rhétorique. Bernard qui était un fervent partisan de l’interdisciplinarité entre l’histoire et la sociologie allait poursuivre une carrière universitaire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) par la suite. Mon inscription à la licence en histoire à l’Université de Montréal en 1965 devenait alors une voie tout indiquée. L’École de Montréal en histoire du Canada dominait au département d’histoire avec le duo Maurice Séguin /Michel Brunet, auxquels s’ajoutaient Jean Blain, Jean-Pierre Wallot et Pierre Tousignant. René Durocher, pionnier de l’histoire du Québec après la Confédération, complétait l’équipe des québécistes et s’inspirait des écrits que les sociologues de l’Université Laval avaient consacrés aux transformations de la société canadienne-française. Maurice Séguin, le maître à penser de l’école néonationaliste de Montréal, s’intéressait pour sa part au régime anglais et au Rapport Durham, moment qu’il qualifiait de décisif pour la mise en minorité des Canadiens français. Selon lui, la Confédération de 1867 se réduisait alors à une sorte d’épilogue de l’Union de 1840. Au cours de mes années de formation en histoire, de 1965 à 1968, d’autres courants de pensée m’ont aussi influencé. À titre de président du Cercle d’histoire, j’avais invité des universitaires connus à présenter une conférence devant les étudiants du Département. Nous avons reçu à tour de rôle les historiens Fernand Ouellet et Cameron Nish, le sociologue Guy Rocher et le démographe Jacques Henripin. À la même époque, j’ai participé avec Paul-André Linteau et un groupe d’étudiants à la chronique bibliographique que nous avions introduite dans la Revue d’histoire de l’Amérique française. Par ailleurs, puisque le programme nous permettait de suivre des cours optionnels dans d’autres disciplines, je me suis inscrit au cours « Introduction à la sociologie générale » de Guy Rocher. J’ai ajouté à ma liste le cours « Société traditionnelle et société technique » de Fernand Dumont, alors invité à la Faculté de philosophie de l’Université de Montréal. Rocher et Dumont m’ont ainsi fait découvrir l’approche conceptuelle et typologique des sociologues. Position épistémologique bien différente de celle des historiens de l’époque axée sur l’étude des sources et s’inscrivant dans une analyse chronologique des faits. Pourtant, ces deux approches différentes pour l’étude de la société, loin de renvoyer dos à dos l’histoire …
Appendices
Bibliographie
- Dumont, Fernand, 1969 Le lieu de l’homme. La culture comme distance et mémoire, Montréal, Éditions HMH (Coll. H).
- Dumont, Fernand, 2008 Oeuvres complètes de Fernand Dumont, 5 tomes, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Fournier, Marcel, 1994 Marcel Mauss, Paris, Fayard.
- Fournier, Marcel, 2006 Marcel Mauss: A Biography, Princeton University Press.
- Fournier, Marcel, 2007 Émile Durkheim (1958-1917), Paris, Fayard.
- Harvey, Fernand, 1975 Mémoire du GRIDEQ à la Commission Healy sur les études supérieures en sciences humaines au Canada, Rimouski, UQAR (GRIDEQ, Documents généraux 1).
- Harvey, Fernand, 1978 Révolution industrielle et travailleurs. Une enquête sur les rapports entre le capital et le travail au Québec à la fin du 19e siècle, Montréal, Boréal Express.
- Harvey, Fernand, 1980 « Les Chevaliers du travail, les États-Unis et la société québécoise, 1882-1902 », dans : Fernand Harvey (dir.), Le mouvement ouvrier au Québec, Montréal, Boréal Express, p. 69-130.
- Harvey, Fernand, 2012 La vision culturelle d’Athanase David, Montréal, Del Busso Éditeur.
- Harvey, Fernand, 2018 « La recherche culturelle en héritage », dans : Pierre Doray, Edmond-Louis Dussault, Yvan Rousseau et Lyne Sauvageau (dir.), L’Université du Québec, 1968-2018, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 325-339.
- Harvey, Fernand, 2019 « Le patrimoine de proximité dans les régions du Québec : une perspective historique », dans : Joanne Burgess et Paul-André Linteau (dir.), Histoire et patrimoine. Pistes de recherche et de mise en valeur, Québec, PUL (Coll. Chaire Fernand-Dumont sur la culture), p. 77-115.
- Harvey, Fernand, 2022 Histoire des politiques culturelles au Québec, 1855-1976, Québec, Septentrion.
- Harvey, Fernand et Andrée Fortin (dir.), 1995 La nouvelle culture régionale, Québec, Éditions de l’IQRC.
- Harvey, Fernand et Normand Perron, 2018 Le chantier sur l’histoire des régions du Québec : genèse et réalisations, 1980-2013, Montréal, Institut national de la recherche scientifique Centre Urbanisation Culture Société. [http://espace.inrs.ca/7794/1/Rapport%20HarveyPerron.pdf]
- Leroux, Robert, 2011 Gabriel Tarde, Paris, Ellipse.
- Rocher, Guy, 1969 Introduction à la sociologie générale, 3 tomes, Montréal, Hurtubise HMH.
- Rocher, Guy, 1972 Talcott Parsons et la sociologie américaine, Paris, Presses universitaires de France.
- Thériault, Joseph Yvon, 1997 « La société globale est morte… vive la société globale! », Cahiers de recherche sociologique, no 28 : 9-35.