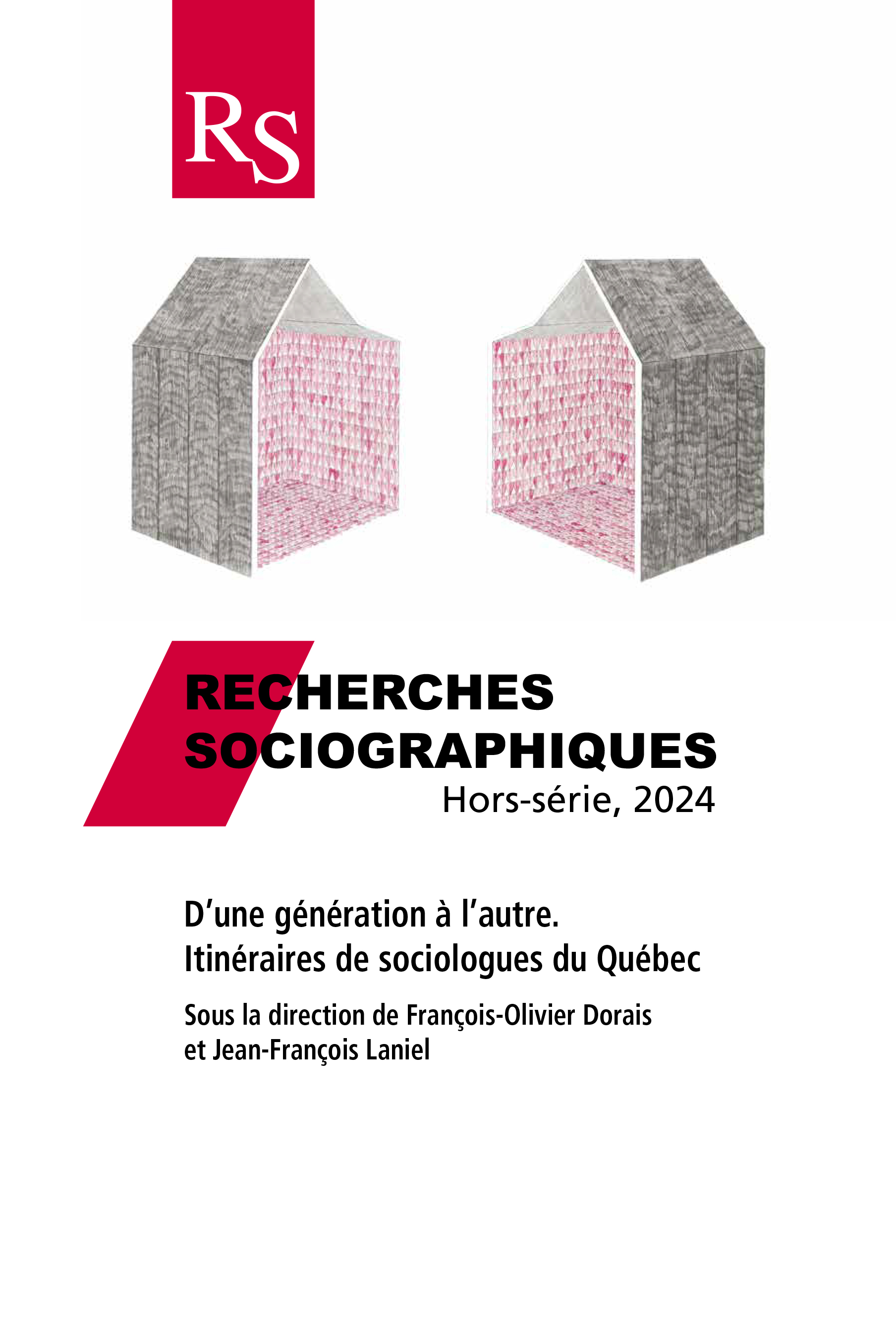Mon parcours intellectuel, marqué par de nombreuses bifurcations, débute dans ma ville natale, Bruxelles, où je découvre très tôt la sociologie lors de mes études de candidature en sciences économiques et sociales aux Facultés Universitaires Saint-Louis, suivies d’une licence en sociologie à l’Université catholique de Louvain. Pendant ma licence, j’ai la chance de travailler comme assistante au Centre d’analyse pour le changement social, dirigé alors par Maurice Chaumont, très inspiré par la pensée d’Alain Touraine. Et comme plusieurs assistants du Centre, je fais quelques séjours à Paris pour suivre les séminaires de celui-ci à l’École Pratique des Hautes Études. À la fin de ma licence, désirant poursuivre mes études, je décroche une bourse du Conseil des arts du Canada (distribuée alors à une dizaine d’étudiants belges) pour faire un doctorat, précédé d’une maîtrise, à l’Université de Montréal. Malheureusement les débuts des années 1970 sont décevants pour la jeune étudiante étrangère que j’étais, car les grèves étaient nombreuses dans les départements de sciences humaines en cette période troublée. Un ami me conseille alors de suivre un cours à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal, où, me dit-il, ces futurs professionnels évitent les grèves autant que possible. Je découvre alors un nouvel univers, étant peu familière avec les questions urbaines et d’aménagement. Et par chance, le titulaire du cours m’engage comme assistante pour corriger les copies des étudiants le semestre suivant, lorsqu’il redonne le cours… à l’École polytechnique! Or, très vite, insatisfait du sérieux de ses élèves (qui dormaient dans le fond de la classe), il me les confiera contre rémunération pour que je leur enseigne la matière, une offre que je ne peux refuser, car à cette époque (déjà!) les bourses du futur CRSH sont bien modestes pour les étudiants étrangers. Je ne refuserai pas non plus l’offre de répéter le cours à l’Institut d’urbanisme de la Faculté d’aménagement en 1976. J’y serai bien accueillie par mes nouveaux collègues et obtiendrai rapidement un demi-poste de chargée d’enseignement. Cela me permettra de finir ma thèse que j’aurai entretemps réorientée vers l’histoire des mouvements de réforme urbaine à Montréal au début du 20e siècle, sous la direction de Louis Maheu. J’étais en effet intriguée par le retard pris au Québec et particulièrement à Montréal par la mise en place d’un processus de planification urbaine, alors qu’un peu partout en Amérique du Nord se développaient des mouvements de réforme urbaine ciblant des questions aussi variées que les problèmes d’hygiène, le rôle des femmes dans la ville, la corruption des administrations municipales, le logement ouvrier, l’embellissement civique, etc. À Montréal, ces mouvements émanant largement de la bourgeoisie anglophone se heurteront bien vite au « bossisme » incarné par des maires canadiens-français portés au pouvoir par l’exode rural. J’analyserai ces transformations en m’inspirant des travaux d’Alain Touraine et de Frederico Henrique Cardoso, passés maîtres dans l’art d’analyser des situations concrètes dans des sociétés dépendantes, et notamment les médiations politiques. J’examinerai notamment l’importance des couches sociales intermédiaires sur la scène politique montréalaise. L’institution municipale deviendra en effet le bastion des classes moyennes traditionnelles (Germain, 1985). Ma carrière académique va donc se poursuivre à l’Institut d’urbanisme pendant une bonne dizaine d’années. J’y donnerai notamment des cours sur l’histoire de l’urbanisme et animerai des ateliers sur des analyses de quartier, dont celui de Côte-des-Neiges que nous parcourons, les collègues et moi, avec les étudiants. Ce quartier multiethnique entre tous s’avère un laboratoire passionnant pour une sociologue. Mais je poursuis en même temps mes nouveaux intérêts pour l’histoire urbaine ainsi que pour le patrimoine, qui commence à faire couler beaucoup d’encre à l’époque dans le sillage de …
Appendices
Bibliographie
- Authier, Jean-Yves, Alain Bourdin, Annick Germain et Marie-Pierre Lefeuvre, 2016 « Penser l’espace en sociologie. Introduction au dossier ». SociologieS, 16 juin. [https://sociologies.revues.org/5434]
- Bourdin, Alain, 2005 La métropole des individus, La Tour-d’Aigues, L’Aube.
- Bourdin, Alain, Annick Germain et Marie-Pierre Lefeuvre (dir.), 2005 La proximité; construction politique et expérience sociale, Paris, L’Harmattan.
- Charbonneau, Johanne, Annick Germain et Marc Molgat (dir.), 2009 Habiter seul, un nouveau mode de vie? Québec, PUL.
- Dejean, Frédéric et Annick Germain (dir.), 2022 Se faire une place dans la cité. La participation des groupes religieux à la vie urbaine, Montréal, PUM.
- Dubet, François, 2023 « Peut-on se passer de théories de la société? Discussion du grand résumé de l’ouvrage de Michel Grossetti, Matière sociale. Esquisse d’une ontologie pour les sciences sociales, Paris, Éditions Hermann (Coll. « Métaphysique et Sciences »), 2022 », SociologieS, 1er mai. [http://journals.openedition.org/sociologies/19994]
- Germain, Annick, 1985 Les mouvements de réforme urbaine à Montréal au tournant du siècle, CIDAR, Université de Montréal.
- Germain, Annick, 2006 « Le municipal à l’épreuve de la multiethnicité : aménagement des lieux de culte dits ethniques et crise du zonage à Montréal », dans : André Bourdin, Marie-Pierre Lefeuvre et Patrice Melé (dir.), Les règles du jeu urbain. Entre droit et confiance, Paris, Descartes &cie, p. 177-195.
- Germain, Annick, 2012 « La sociologie urbaine francophone au Québec : discrète mais contagieuse », SociologieS, Dossiers, 15 novembre. [https://sociologies.revues.org/4174]
- Germain, Annick, 2013 « The Montréal School: Urban Social Mix in a Reflexive City », Anthropologica, 55, no 1 : 29-39.
- Germain, Annick, 2019 « Publier en français…sans périr », Pourquoi publier en langue française quand on est sociologue? SociologieS, 17 janvier. [http://journals.openedition.org/sociologies/9453]
- Germain, Annick, Valérie Amiraux et Julie-Anne Boudreau (dir.), 2017 Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et convivialités, Montréal, Atelier 10.
- Germain, Annick, Julie Archambault, Bernadette Blanc, Johanne Charbonneau, Francine Dansereau et Damaris Rose, 1995 « Cohabitation interethnique et vie de quartier », Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des Communautés culturelles, Études et Recherches, no 12.
- Germain, Annick et Julie Elizabeth Gagnon, 2004 « L’évolution des attitudes des municipalités dans les dossiers d’aménagement des lieux de culte de minorités ethniques : durcissement discriminatoire ou crise d’adaptation? », dans : Jean Renaud, Annick Germain et Xavier Leloup (dir.), Racisme et discrimination. Permanence ou résurgence d’un phénomène inavouable, Presses de l’Université Laval, p. 109-128.
- Germain, Annick, Sandrine Jean et Myriam Richard, 2015 « Cohabitation interethnique et sociabilité publique dans les quartiers de classes moyennes », dans : Sébastien Arcand et Annick Germain (dir.), Travailler et cohabiter. L’immigration au-delà de l’inclusion, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 167-188.
- Germain, Annick et Damaris Rose, 2000 The Quest for a Metropolis, Chichester and London, Montréal, John Wiley & Sons.
- Germain, Annick et Damaris Rose, 2020 « Montréal », Encyclopediae Universalis. [www.universalis.fr/encylopedie/montreal/]
- Goudet, Anna et Annick Germain, 2022 « L’accueil des immigrants : la dynamique des quartiers à Montréal », dans : Mireille Paquet (dir.), Nouvelles dynamiques de l’immigration au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 107-122.
- Leloup, Xavier et Annick Germain, 2018 « La cohabitation interethnique dans quatre quartiers de classes moyennes à Montréal : une approche pragmatiste inspirée par la lecture de Jean Remy », dans : Emmanuelle Lenel (dir.) L’espace des sociologues. Recherches contemporaines en compagnie de Jean Remy, Paris, ERES, p. 39-62.
- Meintel, Deirdre, Annick Germain, Danielle Juteau, Victor Piché, et Jean Renaud, 2018 L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
- Melé, Patrice, Antonio Azuella, Annick Germain, Hélène Bertheleu, Claudia Cirelli, Geneviève Cloutier, Emilio Duhau, Angela Giglia, Laurence Rocher et José Serrano, 2013 « Analyser la productivité sociale des conflits de proximité », dans : Patrice Melé (dir.), Conflits de proximité et dynamiques urbaines, Rennes, PUR, p. 389-428.
- Vultur, Mircea et Annick Germain, 2018 « Les carrières migratoires des étudiants internationaux dans une université de recherche au Québec. Repenser la mobilité et l’ancrage », Revue canadienne d’études ethniques 50, no 1 : 107-127.
- Wise, Amanda et Selvoraj Velayutham, 2009 Everyday Multiculturalism, Londres, Palgrave Macmillan.