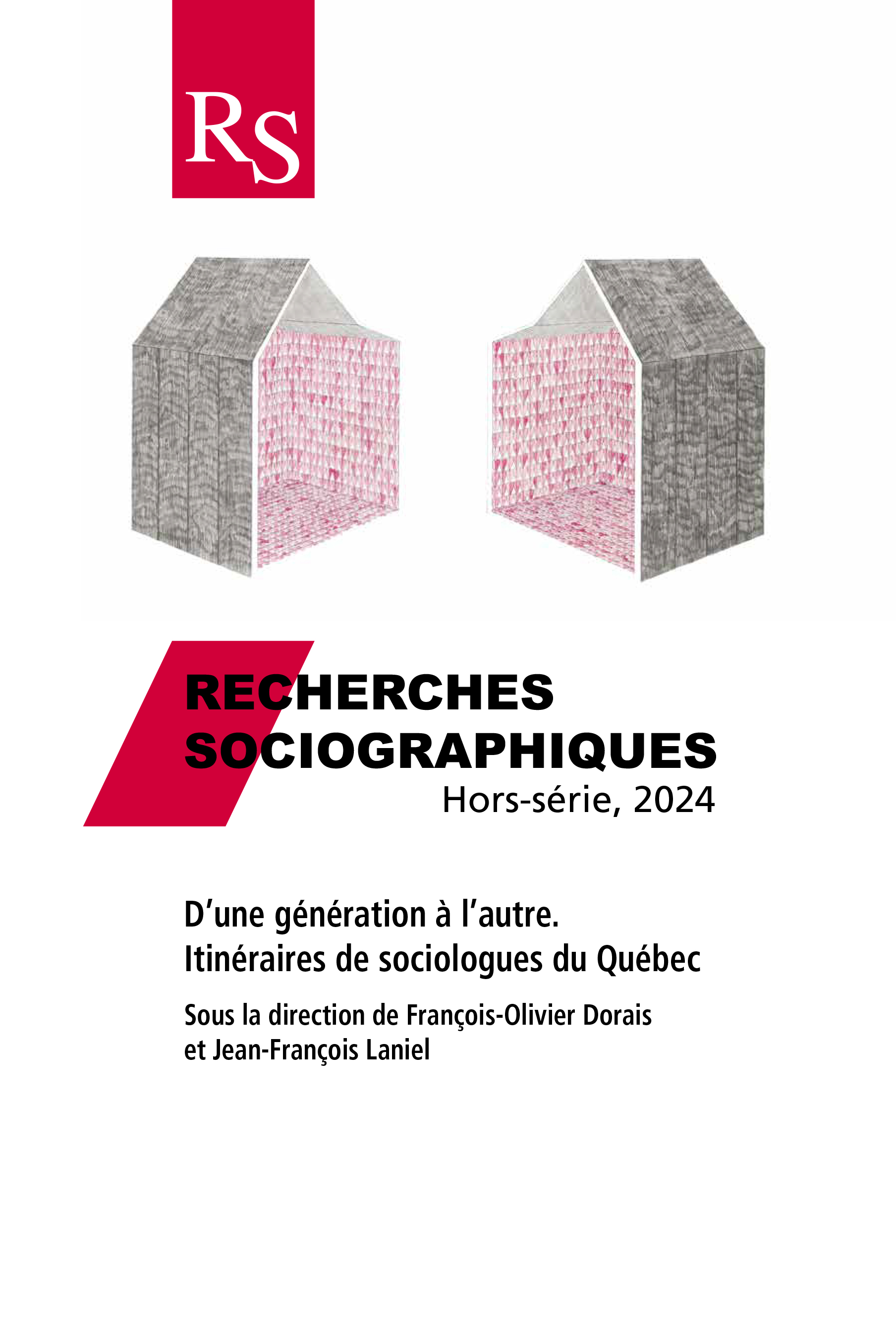« Qui je suis? » Je ne me suis guère posé la question. Je suis sortie des études classiques avec une tête bien faite, tournée vers les idées claires et distinctes, mais sans projet ni perspective d’avenir. Je me suis inscrite en philosophie et en sciences sociales, puis option sociologie qui ne menait justement à rien. J’ai acquis une identité professionnelle à vingt-neuf ans : professeur au Département de sociologie de l’Université Laval. Au bout de mon âge, il m’est venu une image d’identité substantive : garde-chasse sur un territoire dans le domaine de la raison. (La formule est dumontienne, comme je l’ai constaté a posteriori. Je ne l’ai pas adoptée en lisant jadis « je garde le territoire de la parole »; elle a dû mijoter longuement aux tréfonds de ma mémoire avant de ressurgir singularisée et appropriée en bout de piste.) Je suis venue à la sociologie sur les traces de mon frère aîné et j’y suis restée grâce à Gérald Fortin, qui m’a d’abord embauchée comme professionnel de recherche et plus tard recrutée prématurément comme professeur, dans une conjoncture de pénurie de têtes d’oeuvre savantes, pour enseigner les méthodes quantitatives, dont je n’étais pas spécialiste. « Tu l’apprendras », ce que j’ai fait. J’ai ainsi été libérée de la corvée de la thèse (sur la famille ouvrière, en l’occurrence), dont un court article de synthèse a tenu lieu (Gagnon, 1968). J’ai été formée surtout dans l’enseignement de Fernand Dumont, qui assumait à l’époque à peu près la moitié des cours, dispensés sur un cycle de deux ans, notamment les deux gros cours de base sur l’histoire de la pensée sociologique et sur la théorie. Je me considère de sa descendance, ni disciple ni spécialiste, plutôt lecteur autorisé comme il me l’a signifié à quelques reprises. Dès les premières années, j’ai eu un coup de foudre pour La Somme et le reste du marxiste dissident Henri Lefebvre (Lefebvre, 1959), que m’avait offert une précieuse copine. J’en ai retenu l’idée d’aliénation, que j’ai prise comme sujet de mémoire en philosophie. Je n’ai par la suite mis en oeuvre le concept que pour une critique fouillée d’une recherche collective sur le sujet (Gagnon, 1974) et récemment (Gagnon, 2022) dans un compte rendu sur « l’authenticité », qui en est le contraire. Je me suis arrêtée un moment sur le structuralisme, je n’ai pas gardé mémoire d’un autre auteur qui m’aurait particulièrement marquée. J’ai cependant eu plus tard un autre coup de foudre, pour l’immense Jacques Ferron, dont l’imaginaire mythologique repose sur un oeil sociologique pénétrant (Gagnon, 2005). « Le Fernand Dumont de la littérature », y a bien compris une étudiante. La seule évolution que je puisse me voir, c’est d’avoir assumé par moment, à l’âge de haute maturité, la fonction d’intellectuel, à savoir critique, outre de travaux savants, des idéologies régnantes : L’Antiféministe (Gagnon, 1998), « Comment peut-on être Québécois » (Gagnon, 2000), « Libérez-nous des pédagogues » (Gagnon, 2006-2007), « De l’interculturalisme » (Gagnon, 2008). Je suis généraliste plutôt que spécialiste en questions de culture : idéologies, savoirs savants, identité, religion, langue, éducation. J’étais aussi généraliste en méthodologie : techniques quantitatives, modes d’entrevues et récits de vie, logique structurale, compréhension herméneutique, comparaison idéaltypique, temporalité historienne. Si ma production n’est pas très abondante, elle n’est pas répétitive. Comme elle n’a pas eu grand écho, je ne suis pas en mesure de juger en quoi elle peut avoir quelque importance. Je considère seulement que ce que j’ai publié depuis soixante ans est encore valable et …
Appendices
Bibliographie
- Gagnon, Nicole, 1968 « Un nouveau type de relations familiales », Recherches sociographiques, IX, 1-2 : 59-66.
- Gagnon, Nicole, 1974 « À propos d’une recherche collective », Recherches sociographiques, XV, 2-3 : 335-347.
- Gagnon, Nicole, 1998 L’antiféminisme, Montréal, Stanké, 105 p.
- Gagnon, Nicole, 2000 « Comment peut-on être Québécois? », Recherches sociographiques, XLI, 3 : 545-566.
- Gagnon, Nicole, 2005 « À connaître le pays, on le modifie », Jacques Ferron, le « grand inannexable », Possibles, 29, 3-4 : 166-172.
- Gagnon, Nicole, 2006-2007 « Libérez-nous des pédagogues », Argument. Politique, société et histoire, 9, 1 : 11-17.
- Gagnon, Nicole, 2008 « De l’interculturalisme », Recherches sociographiques, XLIX, 3 : 523-535.
- Gagnon, Nicole, 2022 « Note de lecture – Gilles Lipovetsky, Le Sacre de l’authenticité », Égards, 65, Automne : 79-82.
- Lefebvre, Henri, 1959 La Somme et le reste, Paris, La Nef de Paris éditions.