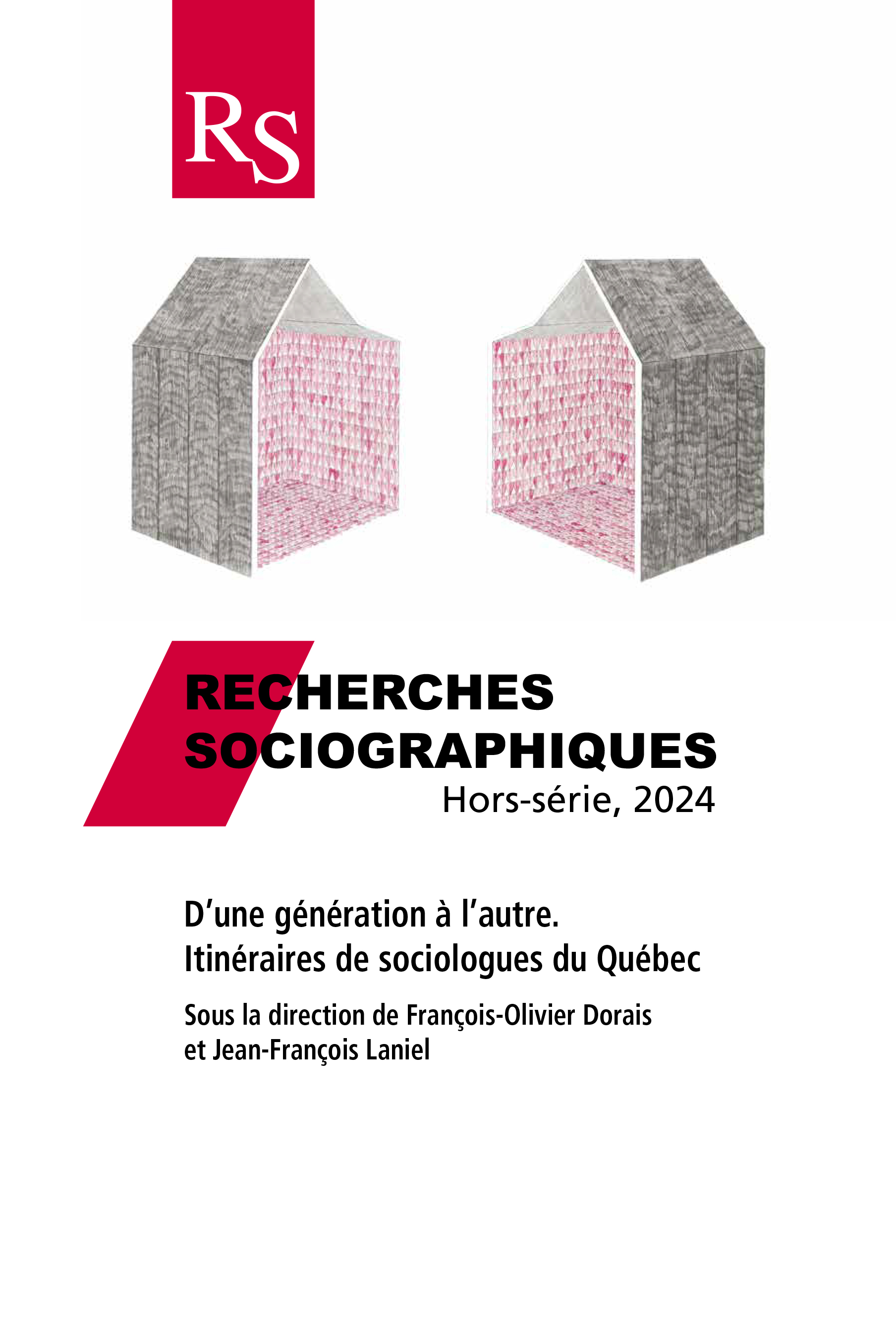Tout comme il y a une « illusion biographique », n’y a-t-il pas aussi une « illusion autobiographique »? Bourdieu a lui-même, à la fin de sa vie, esquissé sa propre auto-analyse (Bourdieu, 2004), donnant aux chercheurs le conseil de faire le même exercice. Il s’agit d’un exercice difficile, voire risqué. Bourdieu s’est engagé dans une double mise à l’épreuve : celle de la validité des concepts de sa propre théorie et celle de sa capacité d’objectivation. Comment réaliser une telle entreprise? Il s’agit de parler de soi, parmi les siens avec les autres, dans son milieu, à son époque. Une telle mise en contexte implique, pour le sociologue, une reconnaissance des contraintes qui jouent sur lui, mais aussi des conditions qui lui permettent, en tant qu’acteur, d’y échapper, plus ou moins facilement, plus ou moins complètement. Une tâche quasi impossible. Tout au plus ne peut-il s’agir que d’une esquisse. Prendre la décision de devenir sociologue au tournant des années 1960-1970 ne fut pas une démarche évidente. Pour le jeune homme que j’étais, issu d’une famille bourgeoise de province relativement aisée, le destin était alors de suivre les traces de mon père, Joseph-Eudore, et de mon grand-père, Eudore, tous deux industriels dans la tannerie et la chaussure à Plessisville. Cette industrie au Québec a, pendant ces deux décennies, périclité, entraînant la fermeture de nombreuses petites entreprises. Mon père a dû fermer sa manufacture de chaussures pour dames au milieu des années 1970. Il a alors tenté de s’orienter vers les valeurs mobilières, mais sans succès : c’était au mauvais moment (trop tôt) et dans un mauvais endroit (en région). Seule une éducation supérieure pouvait permettre à ses enfants d’effectuer une « reconversion » du capital économique en capital culturel, selon la formulation de Pierre Bourdieu et d’éviter le déclassement social. La position sociale (de notables) que la famille avait acquise s’ébranlait, surtout pour les plus jeunes de la famille. Notre père, qui avait fait de courtes études commerciales, souhaitait que ses cinq fils fassent des études classiques et s’orientent vers des professions dites libérales ou la prêtrise. La « reconversion » ne fut pas, pour notre génération de babyboomers, si évidente : seul l’un d’entre nous est devenu prêtre, puis élevé au rang d’évêque; mon frère jumeau (dizygote) a d’abord choisi la littérature à l’Université Laval puis s’est tourné vers les Beaux-Arts, se spécialisant dans la lithographie, l’aquarelle et l’icône religieuse; mon frère cadet a fait des études en anthropologie pour ensuite s’installer sur une terre et devenir prêtre laïc. Quant aux filles, leur destin était tracé : elles devaient s’orienter vers les sciences infirmières et faire un « beau mariage » avec un médecin ou un ingénieur. Trois de mes quatre soeurs sont devenues infirmières. Comme dans le passé de nos propres sociétés, l’oncle maternel jouait un rôle semblable à celui que les anthropologues ont mis en évidence dans les sociétés sans écriture. Ce fut le cas pour moi : l’influence de deux oncles, l’un, curé cultivé, et l’autre, diplômé en relations industrielles, fut grande, car ils ont su convaincre mes parents qu’en sociologie, il y avait un « avenir ». Par ailleurs, mon père s’est intéressé à la politique : au niveau municipal, il a été élu conseiller municipal puis maire. Jeune, j’ai participé à sa dernière campagne électorale qu’il a perdue, distribuant des tracts et allant « faire la claque » aux assemblées. Puis au niveau provincial : admirateur de Maurice Duplessis et fort actif au sein de l’Union nationale, il aurait aimé se présenter comme candidat dans le comté (très libéral) de Mégantic, mais …
Appendices
Bibliographie
- Bourdieu, Pierre, 2004 Esquisse pour une socio-analyse, Paris, Raisons d’agir.
- Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron, 1968 Le métier de sociologue, Paris, Mouton.
- Durkheim, Émile, 1998 Lettres à Marcel Mauss, édition et présentation par Philippe Besnard et Marcel Fournier, Paris, Presses Universitaires de France.
- Groulx, Lionel, 1924 Notre maître, le passé, Montréal, Bibliothèque de l’Action française.
- Fournier, Marcel, 1971 « Réflexions théoriques et méthodologiques à propos de l'ethnoscience », Revue française de sociologie, vol. 12, n° 4 : 459-482.
- Fournier, Marcel, 1972 « Influence de la sociologie française au Québec », Revue française de sociologie, vol. 12, supplément : 630-665.
- Fournier, Marcel, 1979 Communisme et anticommunisme au Québec (1920-1950), Montréal, Les Éditions coopératives Albert Saint-Martin.
- Fournier, Marcel, 1986a L’Entrée dans la Modernité. Science, culture et société au Québec, Montréal, Albert Saint-Martin.
- Fournier, Marcel, 1986b Les générations d’artistes, suivi d’entretiens avec Robert Roussil et Roland Giguère, Québec, L’Institut québécois de recherche sur la culture. (Coll. La pratique de l’art au Québec)
- Fournier, Marcel, 1987 « Durkheim, L’Année sociologique et l’art », Études Durkheimiennes, Bulletin d’informations, n°2 : 1-10.
- Fournier, Marcel, 1990 « La construction de l’Université de Montréal sur le mont Royal », dans : Isabelle Gournay, Ernest Cormier et l’Université de Montréal, Montréal, Centre canadien d’architecture, Éditions du Méridien.
- Fournier, Marcel, 1994 Marcel Mauss, Paris, Fayard.
- Fournier, Marcel, 2007 Émile Durkheim, Paris, Fayard.
- Fournier, Marcel, 2011 Profession sociologue, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- Fournier, Marcel, 2021 « Dan Hanganu et l’École des HEC », Cahiers de recherche sociologique, no 71, automne : 235-259.
- Fournier, Marcel, 2023 La Maison des sciences de l’homme de Paris. Une utopie braudélienne réalisée, Paris, Éditions de la MSH.
- Fournier, Marcel et Dan Antonat, 2014 « Université nouvelle et architecture : L’UQAM », dans : Lise Roy (dir.), Les Universités nouvelles, Montréal, PUQ, p. 40-61.
- Fournier, Marcel et Robert Laplante, 1978 « Borduas et l’automatisme : les paradoxes de l’art vivant », dans : Paul-Émile Borduas, Refus global et Projections libérantes, Montréal, Les Éditions Parti pris, p. 101-145.
- Fournier, Marcel et Louis Maheu, 1975 « Science et structures sociales », numéro spécial, Sociologie et Sociétés, vol. 7, no 1 : 3-154.
- Mauss, Marcel, 1997 Écrits politiques, édition et présentation de Marcel Fournier, Paris, Fayard.
- Mauss, Marcel, 2013 La nation ou le sens du social, édition et présentation de Jean Terrier et Marcel Fournier, Paris, Presses universitaires de France.
- Rioux, Marcel, Robert Sévigny et Yves Lamarche, 1973 Aliénation et idéologie dans la vie quotidienne des Montréalais francophones, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.