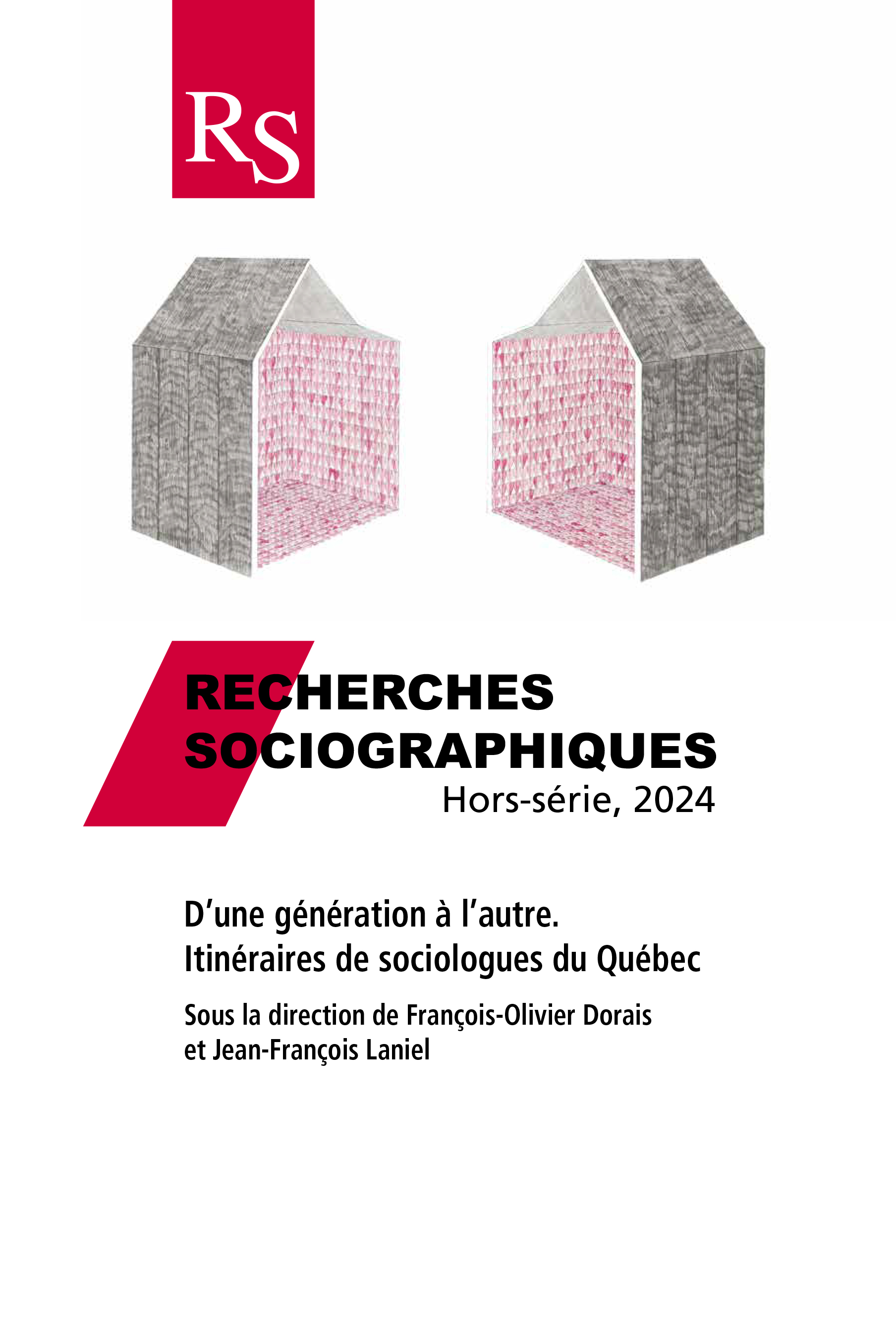Née à Montréal dans les années 1940 d’une mère collaboratrice de son mari, relativement frustrée d’en être « la doublure » et d’un père pianiste compositeur, j’ai dû abandonner tout projet d’études à l’âge de 16 ans à la mort de ce dernier et faire mon entrée sur le marché du travail en tant que secrétaire afin de permettre à mon frère, fort talentueux par ailleurs, de poursuivre des études en médecine. Si cette situation venait saper dans l’immédiat toute ambition professionnelle, la différence de traitement subie en raison de mon sexe n’a pas suscité en moi une révolte d’une amplitude suffisante pour que je conteste le bien-fondé de la décision familiale ou que s’éveille ma conscience féministe. Entre 1959 et 1967, le secrétariat dans une firme d’avocats anglophones, puis le travail dans une agence de voyages comme conseillère ont été mes emplois permanents. Bien que les six années passées à l’emploi d’une agence de voyages m’aient permis de faire le tour du monde – ce qui n’était pas coutume pour une jeune femme au début de la vingtaine – je savais bien qu’un retour aux études s’imposait si je voulais prendre une part active à l’effervescence sociale d’alors et me réaliser à travers un projet de vie professionnelle. Cette ambition a possiblement toujours été présente chez moi en dépit de l’omniprésence du modèle de la « bonne mère » qui constituait encore la norme. Mais je ne réalisais pas, à l’époque, que ce désir s’inscrivait dans la mouvance féministe en émergence au Québec et qu’elle pourrait se concrétiser grâce à l’ouverture, en septembre 1967, des collèges d’enseignement général et professionnel (cégep) qui en offrant un enseignement public, laïc et novateur, ouvraient la porte de l’éducation postsecondaire à un plus grand nombre de femmes et, notamment, des femmes adultes. C’est donc trois semaines après la naissance de ma deuxième fille en août 1969, que j’effectue un retour aux études au Cégep Édouard-Montpetit avec l’intention de m’orienter vers la sociologie. La lecture du petit livre de Marcel Rioux, Les Québécois (1980), avait été un élément déclencheur pour moi. Rioux me parlait de mon identité et de mon histoire, il me fournissait une explication de ma société. Je réalisai alors que l’univers des connaissances et les possibilités d’action sociale qu’offrait la sociologie non seulement m’ouvriraient des perspectives d’observation et de compréhension de divers faits sociaux qui m’étaient étrangères jusqu’alors, mais surtout apporteraient des pistes de réponse à mes interrogations naissantes en tant que jeune femme québécoise dans une société lourdement marquée par sa dimension patriarcale. Notion que je n’avais pas encore à mon vocabulaire par ailleurs, bien que les occasions pour en acquérir la conscience n’aient pas manqué. Ainsi, lors de mon inscription au Cégep en qualité d’étudiante adulte, le conseiller pédagogique tenta de me décourager de m’inscrire en sociologie, car le programme exigeait quatre cours de mathématiques et qu’il doutait fort qu’une « femme de mon âge » – à noter que j’avais 27 ans – puisse réussir en la matière. Entreprendre des études postsecondaires à l’âge adulte était une expérience que je n’étais pas la seule à vivre à ce moment-là. À Montréal notamment, à l’initiative du Y des femmes de Montréal, le programme Nouveau départ a été mis sur pied en 1972 afin de soutenir les femmes et surtout les mères de famille désireuses de retourner sur le marché du travail. Comme moi, ces femmes se disaient sans doute, « j’ai des habiletés, j’ai des capacités, ce n’est pas vrai que je vais rester dépendante économiquement et que je vais m’abstraire ou que je vais demeurer à l’écart …
Appendices
Bibliographie
- Belotti, Elena Gianini, 1973 Du côté des petites filles, Milan, Feltrinelli.
- Bersianik, Louky, 1976 L’Euguélionne, Montréal, La Presse.
- Boucher, Denise, 1978 Les fées ont soif, Montréal, Intermède.
- Collin, Solange, Denise Fortier, Carole Fréchette, Véronique O’Leary et Pierrette Savard, 1975 Môman ne travaille pas, elle a trop d’ouvrage, Montréal, le Théâtre des cuisines.
- Commission Bird, 1970 Rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, Ottawa, Commission Bird.
- De Beauvoir, Simone, 1949 Le deuxième sexe, Paris, Éditions Gallimard.
- Descarries, Francine, 1980 L’école rose... et les cols roses. La reproduction de la division sociale des sexes, Montréal, Éditions Albert Saint-Martin et CEQ Québec.
- Descarries, Francine, 1998 « Le projet féministe à l’aube du 21e siècle : un projet de libération et de solidarité qui fait toujours sens », Cahiers de recherche sociologique, n° 30 : 179-210.
- Descarries, Francine, 2003 « The Hegemony of the English Language in the Academy: the Damaging Impact of the Socio-Cultural and Linguistic Barriers on the Development of Feminist Sociological Knowledge, Theories and Strategies », Current Sociology, vol. 51, n° 6, novembre : 625-636.
- Descarries, Francine et Christine Corbeil (dir.), 2002 Espaces et temps de la maternité, Montréal, Remue-ménage.
- Descarries, Francine et Richard Poulin, 2010 « Socialisme, féminisme et émancipation humaine », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 4, automne : 6-21.
- Descarries, Francine et Shirley Roy, 1988 Le mouvement des femmes et ses courants de pensée : essai de typologie, série « Documents », n° 19, Ottawa, Institut canadien de recherches sur les femmes.
- Friedan, Betty, 1964 La femme mystifiée, Paris, Denoël-Gonthier. (Parution anglaise février 1963)
- Gagnon, Mona Josée, 1974 Les femmes vues par le Québec des hommes, Montréal, Éditions du Jour. (Coll. Les idées du jour)
- Groult, Benoîte, 1975 Ainsi soit-elle, Paris, Grasset.
- Guilbeault, Élise (dir.), 1976 La nef des sorcières, Montréal, Quinze.
- Jean, Michèle, 1974 Québécoises du 20e siècle, Montréal, Éditions du Jour.
- Millet, Kate, 1971 La politique du mâle, Paris, Éditions Stock.
- RéQEF (Francine Descarries, dir.) et le Conseil du statut de la femme, 2015 La ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec, RéQEF en collaboration avec le Conseil du statut de la femme. [https://histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html]
- Rioux, Marcel, 1980 Les Québécois, Paris, Les Éditions du Seuil.
- Smith, Dorothy, 1981 « Le parti pris des femmes », dans : Yolande Cohen (dir.), Femme et politique, Montréal, Le Jour, p. 139-144.