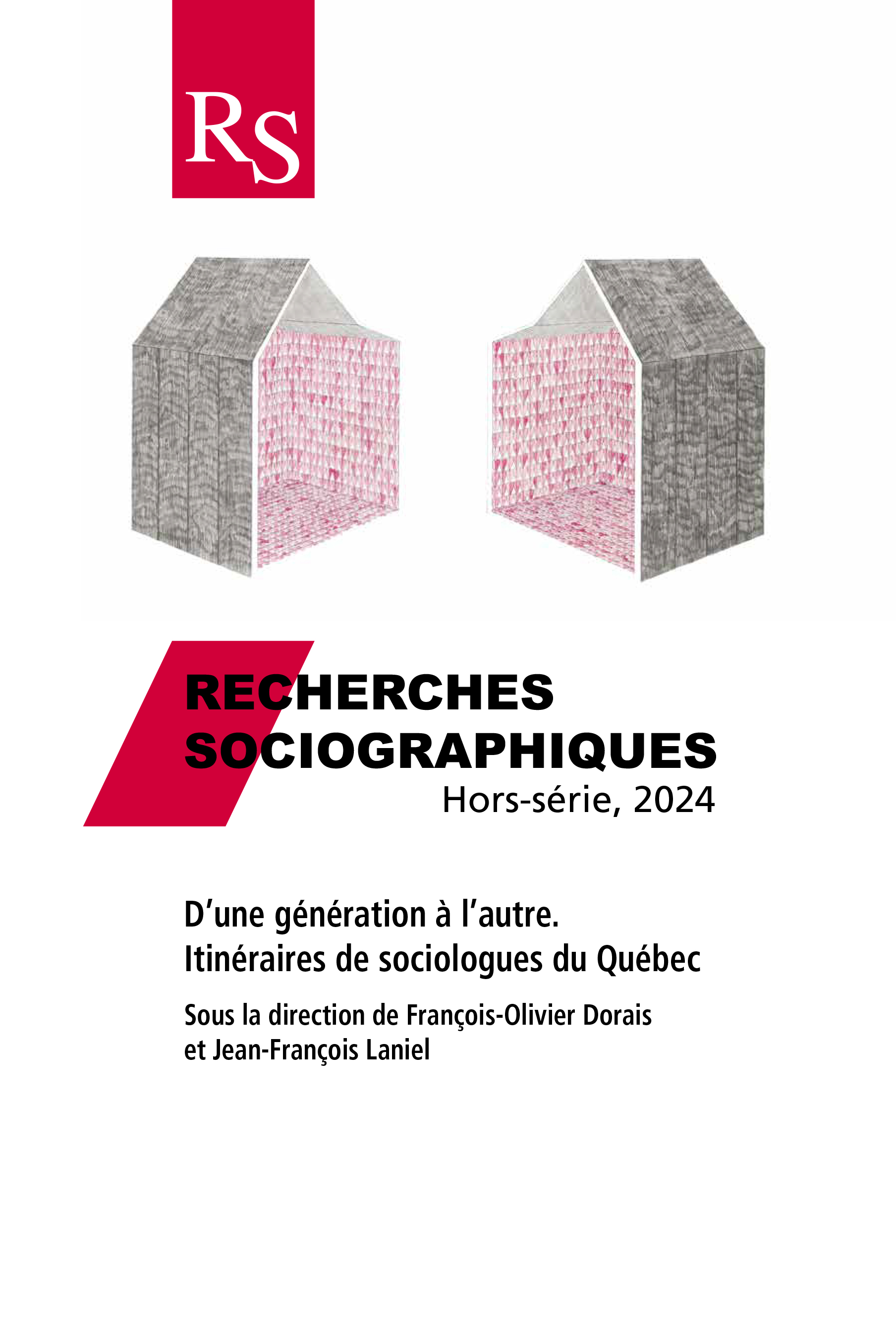En 1969, la décision de créer un réseau public francophone qui devint l’Université du Québec répond à l’urgence de la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. Après la création des polyvalentes et des cégeps, la formation de l’Université du Québec marqua l’aboutissement, dans le domaine de l’éducation, d’un processus beaucoup plus large d’implantation des institutions caractéristiques de l’État-providence. On connaît l’essentiel de l’histoire de la reconstruction instituée sous l’égide de l’État-providence durant les années 60 et 70. Je n’insisterai que sur le discours politique dominant la période. Le providentialisme québécois s’imposa à partir d’une critique radicale du duplessisme (Bourque, 2018). Il proposa un idéal d’émancipation sociale et nationale dans la foulée d’une ouverture à la politisation des rapports de pouvoir. La prépondérance de la sphère publique rendit dès lors possible le dévoilement potentiellement extensif des rapports d’inégalité et de domination. L’Université du Québec à Montréal (UQAM), où j'enseignai durant toute ma carrière, fut créée dans l’urgence et dans un contexte élargi de contestation : mai 68 en France, octobre 68 dans les cégeps, décolonisation, opposition à la guerre du Vietnam et lutte pour les droits civiques aux États-Unis. On nous confia la tâche d’ouvrir un département et de participer à la création d’une Université, alors que nous étions en majorité de très jeunes intellectuels, dotés le plus souvent d’une seule maîtrise. Nous reçûmes en quelque sorte un cadeau à moitié empoisonné. L’aventure fut passionnante, mais en même temps stressante et turbulente. Durant les années 60, j’obtins une licence en Lettres options français et histoire et une maîtrise en Sociologie de l’Université de Montréal. Pendant ma formation universitaire, je fus membre des comités de rédaction du Quartier latin et de la revue Parti pris. Je militai en même temps au Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), avant de participer à la formation du Comité indépendance-socialisme qui fit long feu. Bref, mes études universitaires ont été liées à une forme ou à une autre d’action militante qu’on appela par la suite à l’UQAM les services à la collectivité. Comme plusieurs de mes collègues, je poursuivis cette pratique durant ma carrière : participation à des revues comme Socialisme québécois et Les Cahiers du socialisme, militance syndicale au Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ), intervention régulière sous plusieurs formes auprès de la Centrale de l’enseignement du Québec/Centrale des syndicats du Québec (CEQ-CSQ) et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), engagement au Mouvement socialiste dirigé par Marcel Pepin, participation au Centre de formation populaire. Durant mes études, je fus surtout marqué par les enseignements de Maurice Séguin, Marcel Rioux et Guy Rocher. Maurice Séguin avait rompu avec Lionel Groulx. Il développa une théorie de la domination nationale débarrassée de toute référence clériconationaliste. Marcel Rioux contribua à notre connaissance du marxisme et voulut toujours relier le métier de sociologue à la pratique sociale. Guy Rocher, enfin, demeurera toujours pour moi l’exemple d’un intellectuel engagé et d’un communicateur de haut vol. Mon premier article, rédigé avec Luc Racine, et mon mémoire de maîtrise portèrent sur le débat entre les historiens Maurice Séguin et Fernand Ouellet (Bourque et Racine, 1967). Ce mémoire fut publié en 1970 aux Éditions Parti pris sous le titre Classes sociales et question nationale 1760-1840 (Bourque, 1970). L’ouvrage proposait une synthèse entre les positions radicalement opposées des deux historiens. Pour faire très court, Maurice Séguin considérait la Conquête comme le point de départ d’un processus d’oppression nationale. Il faut noter que la nation canadienne-française est ici pensée comme un bloc homogène. Fernand Ouellet qui analysa la même période lui opposa …
Appendices
Bibliographie
- Anderson, Benedict, 1983 Imagined Communities, London, Verso.
- Bourque, Gilles, 1970 Classes sociales et question nationale au Québec, 1760-1840, Montréal, Éditions Parti Pris.
- Bourque, Gilles, 1972 « Social classes and nationalist ideologies in Quebec, 1760-1970 », dans : Gary Teeple (dir.), Capitalism and the National Question in Canada, Toronto, University of Toronto Press, p. 185-210.
- Bourque, Gilles, 1977 L’État capitaliste et la question nationale, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
- Bourque, Gilles, 1989 « Traditional society, political society and Quebec sociology: 1845-1980 », Revue Canadienne de sociologie, vol. 26, n° 3 : 45-83.
- Bourque, Gilles, 1993 « Société traditionnelle, sociologie politique et sociologie québécoise, 1945-1980 », Cahiers de recherche sociologique, n° 20 : 45-83.
- Bourque, Gilles, 2003 « La souveraineté-partenariat, le Québec, la démocratie », dans : Raphaël Canet et Jules Duchastel, La nation en débat, Montréal, Athéna, p. 29-46.
- Bourque, Gilles, 2008 « Bouchard Taylor : un Québec ethnique et inquiet », Le Devoir, Montréal, 30-31 juillet. [https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/199693/bouchard-taylor-un-quebec-ethnique-et-inquiet].
- Bourque, Gilles, 2009 « Les classes sociales d’hier à aujourd’hui », Nouveau Cahier du Socialisme, no 1 : 93-101.
- Bourque, Gilles, 2018 « La Grande noirceur encore et toujours », Mens, vol. XVIII, n° 2 : 39-65.
- Bourque, Gilles et Gilles Dostaler, 1980 Socialisme et indépendance, Montréal, Éditions du Boréal Express.
- Bourque, Gilles, Jules Duchastel, Jacques Beauchemin et Pierre Plante, 1988 Restons traditionnels et progressifs. Pour une nouvelle analyse du discours politique. Le cas du régime Duplessis au Québec, Montréal, Les Éditions du Boréal.
- Bourque, Gilles, Jules Duchastel et Jacques Beauchemin, 1994 La société libérale duplessiste, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal. (Coll. Politique et économie)
- Bourque, Gilles et Jules Duchastel, 1995 « Texte, discours et idéologie », Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 3, no 73 : 605-619.
- Bourque, Gilles et Jules Duchastel, 2014 « Montée et déclin de l’idéologie au Québec », Les Cahiers Fernand Dumont pour la mémoire, n° 3 : 15-34.
- Bourque, Gilles, Jules Duchastel et Victor Armony, 1996 L’identité fragmentée. Nation et citoyenneté dans les débats constitutionnels canadiens, 1941-1992, Montréal, Fides.
- Bourque, Gilles et Nicole Laurin-Frenette, 1970 « Classes sociales et idéologies nationalistes au Québec », Socialisme québécois, vol. 20, n° 16 :13-55.
- Bourque, Gilles et Nicole Laurin-Frenette, 1972 « Classes sociales et question nationale au Québec, 1760-1840 », L’Homme et la société, n° 24-25, avril-décembre : 221-247.
- Bourque, Gilles et Anne Légaré, 1979 Le Québec. La question nationale, Paris, Librairie François Maspero. (Coll. Petite collection Maspero, n° 223)
- Bourque, Gilles et Luc Racine, 1967 « Histoire et idéologie », Parti pris, vol. 4, no 5-6 : 33-51.
- Cardinal, Linda et Martin Normand, 2022 Le Canada français : Écrits de Philippe Garigue, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Duchastel, Jules, 2018 « La sociologie en péril », dans : Marc-Henri Soulet (dir.), Société en mouvement, sociologie en changement, Québec, PUL, p. 59-83.
- Fraser, Nancy, 2017 « The End of Progressive Neoliberalism », Dissent spring, New York, 2 janvier. [https://www.dissentmagazine.org/online_articles/progressive-neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser/].
- Freitag, Michel, 2002 L’oubli de la société, Québec, Presses de l'Université Laval.
- Gellner, Ernest, 1983 Nation and Nationalism, Oxford, Basil Blackwell.
- Polanyi, Karl, 2009 La Grande transformation, Paris, Gallimard.
- Poulantzas, Nicos, 1974 Les Classes sociales dans le capitalisme d’aujourd’hui, Paris, Seuil.
- Rioux, Marcel et Jacques Dofny, 1962 « Les classes sociales au Canada français », Revue française de sociologie, vol. III, no 3 : 290-300.
- Rioux, Marcel et Yves Martin, 1964 French-Canadian society, Volume 1, Toronto, McClelland and Stewart. (Coll. The Carleton library, no 18)
- Rioux, Marcel et Yves Martin, 1971 La société canadienne-française. Études choisies et présentées par Marcel Rioux et Yves Martin, Montréal, Les Éditions Hurtubise HMH.