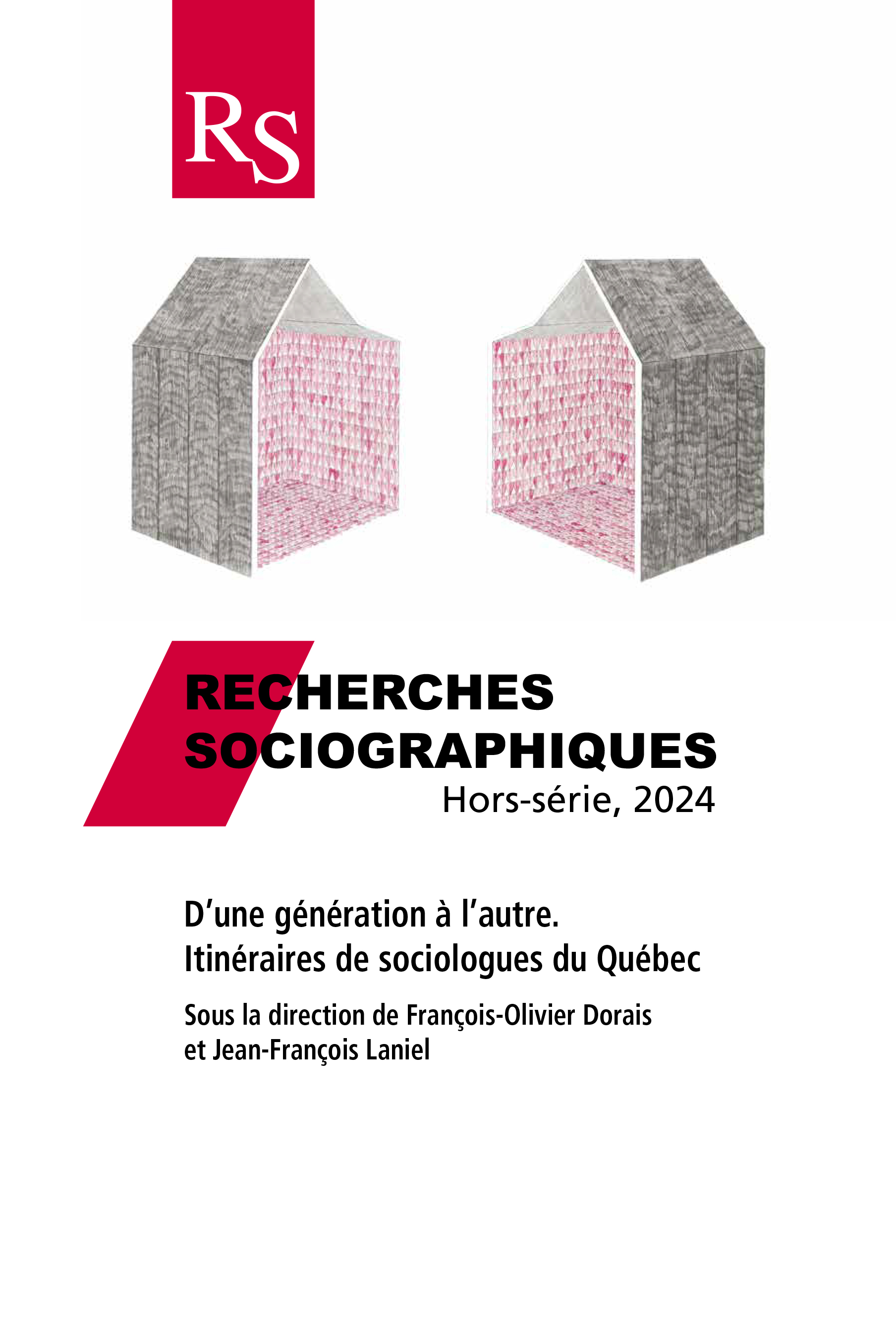J’ai la chance que peu de gens de mon âge ont eue d’avoir su très tôt dans ma vie que je voulais devenir sociologue. Je me souviens par exemple d’avoir lu, encore adolescent, Le choc du futur d’Alvin Toffler à sa sortie en 1970, et La foule solitaire de David Riesman (Riesman, Glazer et Denney, 1950). J’étais loin de tout comprendre, mais j’étais attiré par ce genre d’analyses de la société dont j’allais découvrir bientôt qu’elles relevaient de la sociologie. Ma route était tracée. Déjà j’avais l’intuition, qui ne m’a jamais quitté depuis, que la société obéit à des lois qui la posent en réalité autonome, c’est-à-dire étrangère au cumul des actions humaines, des volontés individuelles ou aux calculs stratégiques visant à infléchir le cours des choses. Y a-t-il pour autant des lois universelles organisant l’existence sociale, comme le pensait Auguste Comte au 19e siècle, un peu à l’image des lois de la physique? Je me méfiais de ce genre de scientisme bien que je fusse très tenté, à l’aube de la vingtaine, par toutes les méta-compréhensions de la société qui s’offraient à mon jeune esprit à la recherche d’une matrice d’interprétation d’ensemble des sociétés. Cette tentation était puissante. J’étais à la recherche d’un maître à penser et d’une théorie générale au pouvoir explicatif illimité et sans failles. Comme plusieurs de ma génération, j’ai trouvé tout cela au cours des années 70 chez Marx et dans le matérialisme historique. Ma découverte enthousiaste du Capital (1867) répondait à une double aspiration. La recherche des lois régissant la société et un fond religieux que je croyais disparu de ma vie mais qui m’avait suffisamment marqué pour que je sois inconsciemment à la recherche d’une explication totalisante de la condition humaine et d’une définition morale de l’existence sociale. La lutte des classes est le moteur de l’histoire, comme l’avait montré Marx. Cette thèse répondait à mon désir d’une explication sans appel des lois de l’histoire et de la structuration des sociétés. Elle laissait cependant entière la question morale de ce qu’il fallait faire dans l’immédiat afin de rendre le monde habitable à l’aune d’un projet de justice et d’égalité. La lutte des classes débouchant sur une société sans classes proposait une utopie à laquelle je m’efforçais de croire, mais en même temps, elle me semblait trop lointaine pour pouvoir proposer les tâches concrètes et immédiates qui devaient être celles des citoyens engagés, statut auquel plusieurs de ma génération aspiraient. C’est pour cela, bien que cette inclination puisse sembler paradoxale, que le personnalisme a exercé un certain attrait sur moi, même si lorsque je l’ai découvert il avait perdu depuis longtemps l’aura qui avait été la sienne au cours des années 50. Le matérialisme historique m’offrait ainsi une lecture des lois de l’histoire à laquelle j’adhérais et qui me fournissait la clé d’une compréhension d’ensemble du monde, alors que le personnalisme et la pastorale laïcisante que j’avais connue au cours des années 60 me posaient inlassablement la question de mon rôle dans la société dans la mesure où la révolution prolétarienne me semblait inatteignable dans un avenir prévisible. Emmanuel Mounier et la revue Esprit posaient la primauté de la personne face aux systèmes déshumanisants et oublieux des principes au nom desquels ils avaient été créés. Mounier affirme ainsi en 1932 dans le premier numéro d’Esprit que le spirituel doit dominer le politique et l’économique. Cette idée m’attirait parce qu’elle me semblait rétablir l’équilibre que menaçaient les approches matérialistes qui continuaient néanmoins de me fasciner. Je me suis également intéressé à la notion de bien commun telle que l’a développée Jacques Maritain dans …
Appendices
Bibliographie
- Arendt, Hannah, 1951 Origines du totalitarisme, New York, Harcourt Brace & Co.
- Arendt, Hannah, 1958 Condition de l’homme moderne, Chicago, Presses de l’Université de Chicago.
- Beauchemin, Jacques, 2002 L’histoire en trop. La mauvaise conscience des souverainistes québécois, Montréal, VLB. (Coll. « Études québécoises »)
- Beauchemin, Jacques, 2004 La société des identités. Éthique et politique dans le monde contemporain, Montréal, Athéna.
- Beauchemin, Jacques, 2007 La société des identités. Éthique et politique dans le monde contemporain, Montréal, Athéna.
- Beauchemin, Jacques, 2015 La souveraineté en héritage, Montréal, Boréal. (Coll. Essais et documents)
- Beauchemin, Jacques, 2020 Une démission tranquille. La dépolitisation de l’identité québécoise, Montréal, Boréal.
- Bourque, Gilles, Jules Duchastel et Jacques Beauchemin, 1994 La société libérale duplessiste, Montréal, Presses de l’Université Montréal. (Coll. Politique et économie, série : études canadiennes)
- Dumont, Fernand, 1968 Le lieu de l’homme. La culture comme distance et mémoire, Montréal, Éditions HMH. (Coll. Constantes, vol. 14)
- Maritain, Jacques, 1942 Les droits de l’homme et la loi naturelle, New York, Éditions de la Maison française Incorporated.
- Marx, Karl, 1867 Le Capital. Critique de l’économie politique, Hamburg, Verlag von Otto Meisner.
- Mounier, Emmanuel, 1932 « Refaire la renaissance », Esprit, vol. 1, no 1 : 5-51.
- Ricoeur, Paul, 1990 Soi-même comme un autre, Paris, Seuil. (Coll. Points Essais)
- Riesman, David, Nathan Glazer et Reuel Denney, 1950 La foule solitaire, New Haven, Yale University Press.
- Toffler, Alvin, 1970 Le choc du futur, New York, Random House.