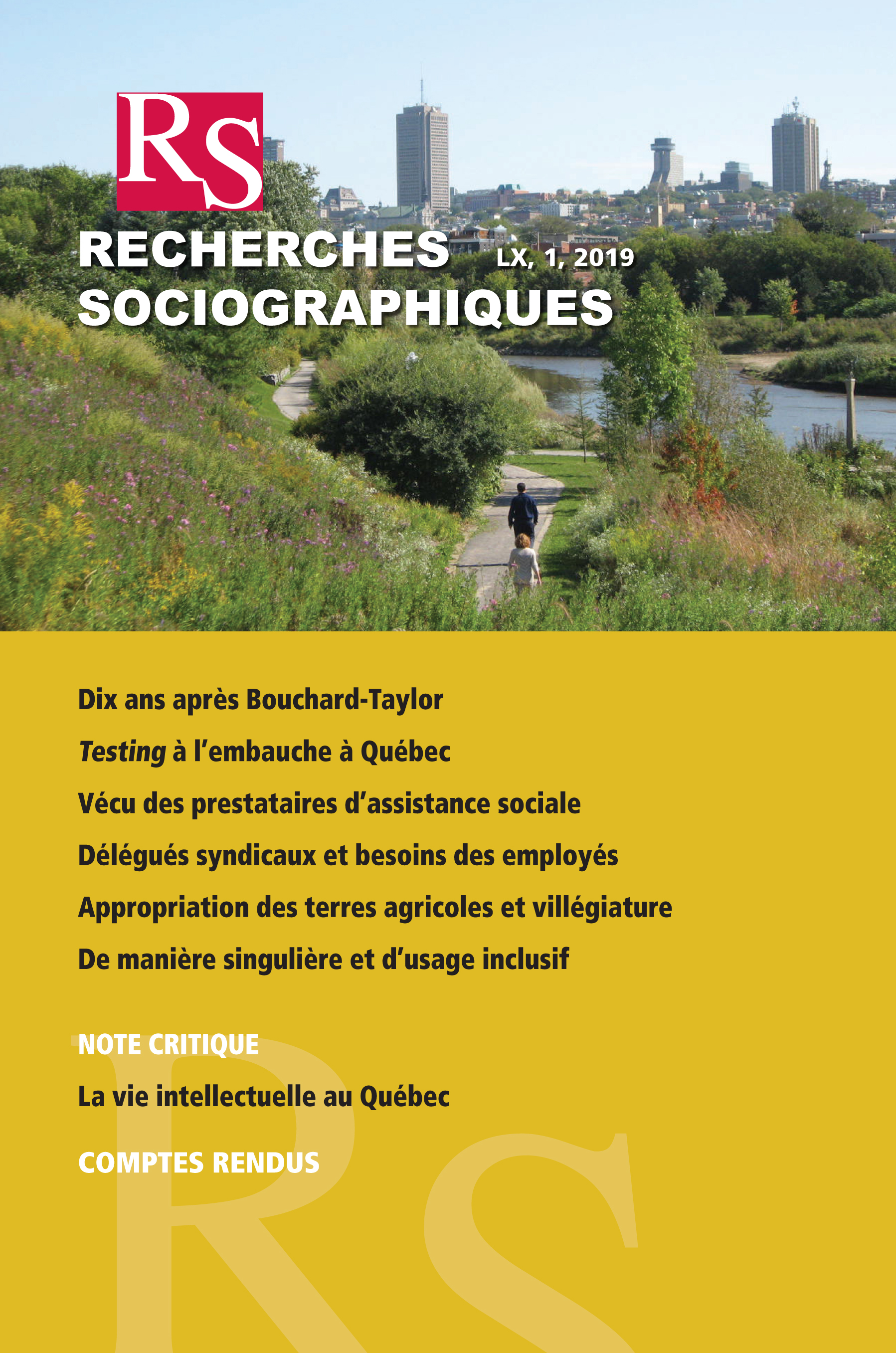Article body
Après une carrière au Ministère des Relations internationales du gouvernement du Québec (1979-2008) menée en parallèle avec la vague montante de l’indépendantisme québécois, Michel Brunet s’est dévoué à la recherche historique. Il veut expliquer les « tendances structurelles » qui ont rendu possible la Conquête et comprendre pourquoi ce « traumatisme de 1759 » est encore « si fortement ressenti de nos jours » (p. 15). Au terme de l’analyse très factuelle présentée dans cet ouvrage, Brunet attribue la faiblesse et l’impuissance de la Nouvelle-France à l’égard de ses ennemis anglais et américains à « sa dépendance envers la métropole » (p. 18) à l’intérieur du système impérial. En bout de ligne, soutient-il, la France ne fut jamais capable de peupler sa colonie d’outre-mer comme le firent les autres puissances coloniales. Par conséquent, au moment de la guerre finale, la colonie ne fut pas en mesure de se défendre. L’auteur décrit cette relation avec la France impériale comme l’« histoire d’un amour des colons pour une métropole qui n’éprouvait rien en retour pour eux » (p. 18). Le moment où ce manque d’amour fut dévoilé dans toute sa crudité ne fut pas 1759, accident de parcours plutôt que défaite, mais 1763, une cession qui eut lieu sans passion et sans regret de la part de la métropole.
Nous ne pouvons pas nous attarder sur la question du peuplement de la colonie, qui a fait l’objet d’études poussées au moins depuis les années 1970 (et que l’auteur ne mentionne pas), ni reparcourir le débat sur la Conquête qui a passionné les historiens québécois des années 1950 débat bien rappelé dans ce livre. En effet, Michel Brunet n’apporte pas d'éléments de réinterprétation s’appuyant sur des sources nouvelles. Il nous offre pourtant une explication globalisante des événements des années 1759-1763 à partir d’une relecture des ouvrages des historiens « classiques » de la Nouvelle-France, des synthèses « populaires » de l’histoire du Québec, ainsi que d’une littérature historique états-unienne qui trahit encore l’influence d’un Francis Parkman même si elle date du nouveau millénaire.
L’auteur effectue cette relecture globalisante à travers le filtre de deux concepts fondamentaux et intimement liés entre eux, les « ancêtres » et le « peuple ». « Nos ancêtres » d’autrefois, délaissés et trahis par la France, ne furent pas coupables de la défaite de 1759, mais à travers la sauvegarde de leur identité « en tant que peuple », ils ont été capables quelques décennies plus tard « de définir, d’articuler et d’oeuvrer directement à la matérialisation de leurs nouveaux intérêts collectifs » (p. 168). Les éléments indispensables de cette identité furent, pour les ancêtres, « la langue, la religion, la culture française » ainsi qu’« une vision spatiale du territoire ». Pour leurs héritiers d’aujourd’hui, les Québécois, si la langue reste un élément fondamental, religion et culture se sont muées en éducation et bien-être matériel (p. 237). Il y a donc une continuité entre le « peuple » canadien du moment de la Conquête et le « peuple » québécois d’aujourd’hui (Brunet n’utilise pas le mot « nation »). Par surcroît, dans les deux cas, ce « peuple » se définit aussi par rapport à un autre « peuple », évidemment celui qui ne partage ni sa langue ni sa culture (voir par exemple p. 235 et p. 254, n.6).
Somme toute, voici un livre qui n’est pas un livre d’histoire au sens propre du terme, étant donné que les historiens montrent toujours une tendance à souligner la complexité des événements et de l’agentivité humaine plutôt qu’à expliquer et simplifier. La France impériale et la Nouvelle-France est plutôt un essai et un plaidoyer, qui par ailleurs risque de ne prêcher qu’aux convertis. Cependant, malgré la surabondance de caractères italiques et gras, guillemets, et points d’exclamation, ces convertis liront ce livre de M. Brunet avec intérêt et avec le plaisir d’avoir finalement tout bien compris.