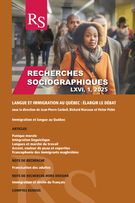
Volume 9, Number 1-2, 1968 L’urbanisation de la société canadienne-française
Table of contents (17 articles)
I. Le processus d'urbanisation
-
Le Québec : une ville à inventer
Gérald Fortin
pp. 11–21
AbstractFR:
Faisant le bilan des études urbaines portant sur le Québec, Yves Martin signalait, lors de notre premier colloque de 1962, la présence de plusieurs études particulières, surtout de type historique, et de certains essais qui tentaient une définition générale du processus d'urbanisation. Il regrettait toutefois qu'il n'existât pratiquement aucune relation entre ces études proprement monographiques et ces hypothèses globales. Ce manque de liaison, par ailleurs, se faisait surtout sentir dans le domaine de l'organisation sociale et politique ainsi que dans le domaine de la culture. La ville en tant que principe d'organisation de notre société était affirmée sans être analysée, ni de façon empirique, ni même de façon théorique.
Déjà, en 1962, l'urbanisation et le phénomène urbain québécois apparaissaient comme objet d'étude particulièrement fructueux pour l'un de nos colloques. L'objectif de ces colloques, en effet, est d'essayer d'ouvrir de nouveaux chantiers de recherche ou de consolider ceux qui sont encore embryonnaires. Comme dans le cas des colloques précédents, il ne s'agit pas, cette fois non plus, d'apporter une solution définitive a l'analyse de l'urbanisation mais plutôt d'essayer de structurer de façon un peu plus précise les avenues qui pourraient être fructueuses pour les chercheurs contemporains et futurs.
Par ailleurs, en six ans, la situation décrite par Yves Martin et son commentateur Louis Trotier a évolué dans deux sens. Des études empiriques et monographiques ont été accomplies pour combler les lacunes graves au point de vue de l'organisation sociale et politique de même qu'au point de vue de la mentalité. C'est à partir de certains faits vérifiés et qui sont présentés dans les travaux de ce colloque que nous pourrons maintenant commencer à discuter des problèmes. Nous avons dépassé l'étape des questions purement académiques et théoriques. D'autre part, la société québécoise elle-même s'interroge de plus en plus sur son caractère urbain et commence à découvrir les véritables dimensions de sa transformation profonde ainsi que les véritables questions que son urbanisation pose à son devenir. Non seulement la problématique des hommes de science devient-elle plus concrète, mais elle commence à se rapprocher d'une problématique que la société dans son ensemble est en train d'élaborer.
Ce rapprochement de la pensée scientifique et de la pratique politicosociale dépasse le phénomène de l'urbanisation et donne à la pensée scientifique, en particulier à la pensée des sciences humaines, un dynamisme nouveau. Il lui propose un défi tout à fait particulier. Nous ne pouvons plus nous contenter de décrire les phénomènes, nous devons chercher à faire de la prospective et, pour autant, à déterminer les grandes lignes qui deviendront les axes fondamentaux de notre développement. Je tomberai peut-être dans le vice de la «spéculation» dénoncé par Yves Martin en 1962, mais j'ose espérer que les propos qui suivent, tout en restant spéculatifs, s'appuieront à la fois sur les études nouvelles qui ont été faites depuis quelques années et sur la problématique sociétale qui semble se développer dans notre milieu.
Malgré certains retards dus à la conjoncture ou malgré certaines impatiences d'individus ou de groupes plus clairvoyants, il semble acquis que le Québec, comme toute société moderne, est une société qui se donne comme objectif premier le développement et le contrôle de ce développement. La caractéristique la plus fondamentale de toute société moderne est d'être une société qui veut bâtir son devenir à partir de sa propre définition de ce qu'elle veut être. L'évolutionnisme ou le déterminisme historique et social cède le pas au volontarisme sociétal. Dans ce contexte, l'urbanisation ou du moins certains styles d'urbanisation ne paraissent plus comme des nécessités inéluctables mais plutôt comme la résultante de certains choix. Sans doute, le choix des orientations urbaines à prendre est-il limité par un très grand nombre de contraintes historiques, économiques, sociologiques. Mais à l'intérieur de ces contraintes, plusieurs possibilités demeurent et il nous reste à déterminer collectivement laquelle ou lesquelles sont désirables pour la société québécoise.
Dans ces propos préliminaires, nous chercherons donc à nous interroger à la fois sur notre connaissance de ce qu'a été et de ce qu'est le phénomène urbain québécois et sur notre connaissance de ce qu'il sera ou pourrait être. En d'autres termes, je voudrais que ce colloque cherche non seulement à déterminer ce qui est institutionnalisé dans le phénomène urbain et dans le processus d'urbanisation, mais encore qu'il s'inquiète et qu'il recherche les innovations sociales encore mal définies qui contiennent déjà l'embryon des institutions futures possibles.
Ces interrogations, je voudrais les diriger sur trois objets qui sont loin d'épuiser toutes les questions que l'urbanisation du Québec pose et posera, mais qui m'apparaissent comme les plus urgentes. Il s'agit du réseau du tissu urbain; du mode de vie urbain; du système politique qui animera à la fois ce tissu et cette vie urbaine.
-
La genèse du réseau urbain du Québec
Louis Trottier
pp. 23–32
AbstractFR:
Ce n'est pas une mince entreprise que de tenter de reconstituer la genèse du réseau urbain du Québec. Aux difficultés qui découlent de l'insuffisance des connaissances sur l'histoire économique et sociale s'ajoutent, en effet, celles que poserait la présentation des documents statistiques et cartographiques nécessaires pour une analyse approfondie du sujet. Nous avons donc renoncé à présenter un véritable essai d'interprétation géographique du réseau urbain québécois, difficile à imaginer sans recours aux méthodes quantitatives et sans référence aux schémas théoriques utilisés ailleurs dans l'analyse des réseaux urbains. Laissant de côté plusieurs questions importantes, comme l'évolution du rôle des villes dans l'organisation de l'espace géographique québécois ou les transformations dans les structures des espaces urbanisés, nous nous limiterons à présenter un tableau général de l'évolution des effectifs urbains, des fonctions des villes et de leur répartition.
II. L'administration urbaine
-
L'administration scolaire
Guy Rocher
pp. 35–43
AbstractFR:
Au Québec, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, l'administration scolaire fait partie du paysage urbain; chaque ville aussi bien que chaque village est doté d'un corps public chargé d'assurer le bon fonctionnement des services scolaires pour toute la population de son territoire. Durant 125 ans, la commission scolaire locale a été au Québec le seul organisme public directement responsable devant la population de l'administration de la chose scolaire. Depuis quelques années, de nouveaux corps publics sont apparus, en particulier la commission scolaire régionale et la corporation du collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP). Mais avant d'analyser la place de l'organisation scolaire en milieu urbain, il sera utile de commencer par remonter aux origines des commissions scolaires et à leur première évolution.
-
L'administration municipale
III. Aspects de la vie urbaine
-
Un nouveau type de relations familiales
Nicole Gagnon
pp. 59–66
AbstractFR:
Les remarques que j'ai à proposer sur le thème de la famille en regard du phénomène d'urbanisation se basent sur trois séries d'entrevues, recherches entreprises au Département de sociologie et d'anthropologie de Laval, l'une par Jocelyne Valois et les deux autres par moi-même. La première de ces recherches remonte à l'hiver de 1962-1963; il s'agit d'une étude exploratoire en vue d'établir un modèle général de la famille ouvrière urbaine québécoise. À cet effet, 72 entrevues ont été recueillies auprès de femmes d'ouvriers de quatre entreprises montréalaises. La seconde recherche, celle de Jocelyne Valois, s'est effectuée dans le quartier Saint-Sauveur de Québec; 52 familles ont été visitées en 1956-1966. Quant à la dernière recherche, actuellement en cours, il s'agit de 28 familles d'ouvriers des raffineries de pétrole de Montréal que j'ai interviewées au cours de l'automne de 1966.
-
Vie urbaine et criminalité
Denis Szabo
pp. 67–81
AbstractFR:
Les transformations quantitatives et qualitatives de la société, depuis la révolution industrielle, ainsi que les changements technologiques subséquents ont affecté profondément la santé mentale et sociale des populations. La délinquance et la criminalité constituent un aspect de ces conflits, de ces tensions et de ces déséquilibres profonds apportés par le nouveau genre de vie et désignés par le terme «milieu technique». Le changement rapide dans les relations humaines, provoquant la rupture de liens considérés comme naturels dans les sociétés rurales caractérisées par des siècles de stabilité relative, est devenu le barème d'un progrès. Ses bénéfices se comptabilisent par degrés de bien-être et son prix, par degrés de pathologie mentale et sociale.
Il n'y a donc rien d'étonnant que les premiers sociologues aient accordé une attention particulière à l'étude des relations entre urbanisation et criminalité, leurs œuvres se situant au tournant du siècle. Durkheim et Tarde, pour ne citer que les Français, ont consacré des études importantes à ce phénomène; le concept d'« anomie », élaboré à propos des suicides dans les sociétés industrielles, est devenu une notion-clef dans la criminologie sociologique de la deuxième moitié du XXe siècle, grâce en particulier à des mises au point de Mer ton [15], de Cloward et d'Ohlin [7]. La sociologie a toujours privilégié l'étude des conflits, elle se soucie uniquement de ce qui va mal. Crimes et villes allient conjointement sur une toile de fond: industrialisation; changement technologique rapide; déplacement de populations par migrations massives interrégionales, internationales et intercontinentales; symptômes de la crise accompagnant la gestation d'un monde nouveau.
Quelle est la situation au Québec, société où coexistent à bien des égards des caractéristiques typiques de la société pré-industrielle, aux côtés de formes nouvelles qui s'apparentent à la société « technétronique » de demain, comme l'appelle Brzezinski [3] ? Les données sont éparses, les analyses inexistantes, le chantier en friches. Néanmoins, nous esquisserons avec des moyens de fortune quelques données du problème en indiquant ce qui rapproche et ce qui distingue le modèle québécois de celui d'autres sociétés occidentales. Nous envisagerons le problème sous deux angles complémentaires : les relations entre l'urbanisation et la criminalité en termes statistiques à partir de bases régionales; quelques caractéristiques quantitatives et qualitatives de la criminalité à l'intérieur de l'espace urbain.
IV. Rénovation urbaine
-
Les Chambres de commerce
Marc Bélanger
pp. 85–103
AbstractFR:
L'étude qui suit découle d'une recherche entreprise en 1965 sur les chambres de commerce. Elle fait suite à l'intérêt que suscita chez l'auteur la communication de Jean-Charles Falardeau sur L'origine et L'ascension des hommes d'affaires dans la société canadienne-française au Ve Colloque de l'Association internationale des sociologues de langue française tenu, au lac Beauport, en 1964. Analysant l'accès des hommes d'affaires au statut de catégorie dirigeante, Jean-Charles Falardeau soulignait l'importance des chambres de commerce en tant que laboratoires de leurs attitudes et de leurs idéologies et en tant que cadres professionnels d'organisation. Bien que l'auteur partage l'opinion exprimée par Jean-Charles Falardeau quant à l'intérêt que présenterait une histoire de ce mouvement dans le Québec, cet exposé n'a rien d'un essai historique. Son propos est tout autre; on sait que traditionnellement les chambres se sont donné comme objectif de «favoriser et d'améliorer le commerce et le bien-être économique, civique et social» de leur district. À un moment où le gouvernement cherche à mettre sur pied des conseils économiques régionaux et où se poursuivent des expériences comme celle du B. A. E. Q., il n'est certes pas sans intérêt d'étudier les réactions des chambres de commerce.
Celles-ci sont généralement reconnues comme des organismes représentant les hommes d'affaires. Par ailleurs, il est vrai que, dans plusieurs régions, elles ont présidé à la formation de conseils économiques. Il y a néanmoins lieu de se demander si l'hypothèse de Jean-Charles Falardeau est valable pour l'ensemble des chambres de commerce; nous serions portés, quant à nous, à faire l'hypothèse que certaines chambres, épousant les tensions socio-économiques du milieu, s'apparentent à des coopératives de développement plus qu'à des groupes de pression.
Au reste, Jean-Charles Falardeau n'écarte pas cette possibilité. Il reconnaît, à la suite de Fernand Ouellet, que la Chambre de Québec, au gré d'une participation accrue des francophones québécois, en vint à se préoccuper essentiellement d'intérêts proprement locaux et régionaux. En effet, devant contrer les difficultés que posait l'évolution économique du milieu, elle entreprit de grossir ses effectifs en élargissant ses critères d'admission. D'organisme de défense et de promotion économique, elle se transforma de la sorte en organisme de promotion communautaire. Nos recherches nous ont conduits à poser le problème de la cohérence dans la diversité au sein d'une organisation regroupant environ 270 chambres de commerce constituant 32 régionales. Toutefois, dans le cadre de cet exposé, nous nous appliquerons plutôt a faire ressortir une certaine correspondance entre la diversité de l'action des chambres et l'axe de développement rural-urbain. À cette fin, nous procéderons en trois étapes.
Dans une première, appliquant au Québec un modèle regroupant les facteurs de différenciation de l'action, nous tenterons de formuler quelques hypothèses relatives à l'interrelation entre le niveau de développement de divers milieux et le type d'action caractéristique des chambres dans ces milieux. L'élaboration d'une double typologie et les opinions recueillies auprès de militants permettront de contrôler la validité de ces hypothèses.
Dans une seconde étape, nous limitant à quelques variables, nous montrerons en quoi se différencient les chambres des milieux hautement urbanisés et celles des autres milieux. Enfin, une troisième étape permettra de formuler quelques hypothèses quant aux problèmes que pose la participation des organismes appartenant à une même Fédération mais œuvrant dans des milieux dont le niveau d'urbanisation est très inégal.
-
Urbanisme : réalisations et obstacles
-
Vie urbaine et animation sociale
Michel Blondin
pp. 111–119
AbstractFR:
Les animateurs sociaux de Montréal formés soit en service social, soit en sociologie, soit dans les deux disciplines, ont eu tôt fait de prendre connaissance des textes sociologiques québécois portant sur la vie urbaine car ces textes sont peu nombreux et en somme assez pauvres. Ils se tournèrent alors vers la sociologie américaine et la sociologie française, ce qui fut encore décevant, même si la sociologie américaine nous a légué un plus grand nombre de documents, dont peu cependant dépassent l'écologie ou la déviance. Mais pourquoi les animateurs sociaux se tournèrent-ils vers la sociologie ? Qu'y cherchaient-ils ? Qu'y ont-ils trouvé ? L'animation sociale en milieu urbain s'attaque à des réalités difficiles à saisir. Discipline d'intervention à la recherche d'elle-même, elle consacre un important effort de réflexion à l'explicitation de ses intuitions profondes et a l'expérimentation de ses techniques de base. Il lui est cependant nécessaire, parallèlement, de connaître et de comprendre la réalité urbaine dans ce qu'elle a de plus profond. L'animateur social se sent un peu comme l'ancêtre-chirurgien qui découvre laborieusement les techniques chirurgicales et doit les appliquer à un organe, le cœur par exemple, alors même qu'il ne connaît pas le rôle ou le fonctionnement de cet organe central parce que les scientifiques ne le lui ont pas encore appris.
Les animateurs sociaux du Conseil des œuvres travaillent depuis quelques années, quatre exactement, dans certains quartiers ouvriers de Montréal, soit: Saint-Henri, la Pointe Saint-Charles, la Petite Bourgogne, Centre-Sud et Hochelaga. Ces quartiers, où vivent 220,000 personnes, près de 18 pour cent de la population de la ville de Montréal, sont en même temps ceux où habite la population la plus défavorisée de la région métropolitaine. L'animateur se sent une responsabilité particulière et originale et il sait qu'il engage l'avenir. Son travail influencera l'avenir de Montréal car ses interventions dans des quartiers en transformation auront un impact certain sur l'ensemble de Montréal. Il engage aussi l'avenir de la dizaine de milliers de personnes qu'il rejoint plus ou moins directement par la mise en branle qu'il provoque. Il ne peut, enfin, jamais oublier que celles-ci sont parmi les plus défavorisées de Montréal.
Cette responsabilité de l'animateur social est d'autant plus écrasante à certains jours que sa tâche nécessite qu'il explicite progressivement mais rapidement deux inconnues: son propre métier, l'animation sociale; son champ d'action, quelques quartiers d'une région métropolitaine, cœur d'une société en pleine transformation.
Je voudrais présenter brièvement trois défis que, comme animateurs sociaux, nous devons relever dans notre travail quotidien:
1. La compréhension de la vie urbaine: ce qu'elle est, ce qu'elle deviendra;
2. Le développement de l'autonomie des groupes engagés dans l'apprentissage de la rationalité dans l'action collective;
3. La participation de cette population à la vie urbaine par l'accès aux
décisions.
V. Dialectique des recherches urbaines
-
Les deux espaces québécois
-
La ville : phénomène économique
-
Comportements politiques et milieux urbains
-
Villes et société urbaine
-
La notion d'urbanisation
-
Essai de synthèse
André Lux
pp. 133–140
AbstractFR:
Les exposés de ce colloque et les discussions qu'ils ont suscitées ramènent sans cesse à l'esprit la question de savoir ce qu'est en définitive la ville comme phénomène sociologique dans notre société. En essayant d'y répondre, les participants se sont vus forcés de soulever d'autres questions qui apparaissent liées spontanément à celle-ci. Dès lors, il faut s'interroger sur la nature de ces liens pour leur trouver une ordonnance hiérarchique. En même temps, ces questions portent sur la validité d'une présentation dichotomique des différents aspects ainsi liés d'une réalité mouvante et ambivalente. En d'autres mots, à ce stade, c'est l'opposition des concepts polaires «urbain-rural» qui est soumise à la question, d'abord en elle-même, en même temps parce qu'elle fait surgir une autre opposition entre des concepts polaires, « traditionnel-moderne », qui la concurrence dans l'explication de la dynamique concrète de la société historique, tout en étant, comme elle, à cet égard intrinsèquement controversable. Sous-jacente à cette double interrogation est la question du degré d'originalité ou, au contraire, de conformité de l'expérience québécoise en regard du modèle général (s'il en existe un) de l'urbanisation des sociétés industrielles. L'opposition entre «industriel» et «pré-industriel» vient encore compliquer le jeu des interactions entre les deux dichotomies précédentes, de manière à nous imposer le recours à tout un ensemble de nuances pour caractériser l'urbanisation de la société canadienne-française.
Il est, en effet, probable qu'apparaissent des discordances d'évolution selon les paliers de la réalité sociale. Ainsi par exemple, l'objectif d'efficacité administrative qui guide les réformes institutionnelles commandées par les nouvelles structures urbaines se révèle souvent en conflit avec l'objectif de la participation démocratique qui sert de pôle, parmi d'autres, aux mutations idéologiques.
Les exposés du colloque montrent enfin que peuvent exister des discordances entre les voies d'approche et les concepts utilisés par les différentes disciplines concernées par le phénomène de l'urbanisation. Celui-ci n'a donc pas nécessairement la même portée pour chacune d'entre elles et rend leur collaboration délicate. Cette collaboration est néanmoins d'autant plus indispensable que le colloque montre aussi que le problème de l'urbanisation ne peut se poser ni s'analyser correctement que dans le cadre beaucoup plus large de la problématique de l'évolution globale de notre société.



