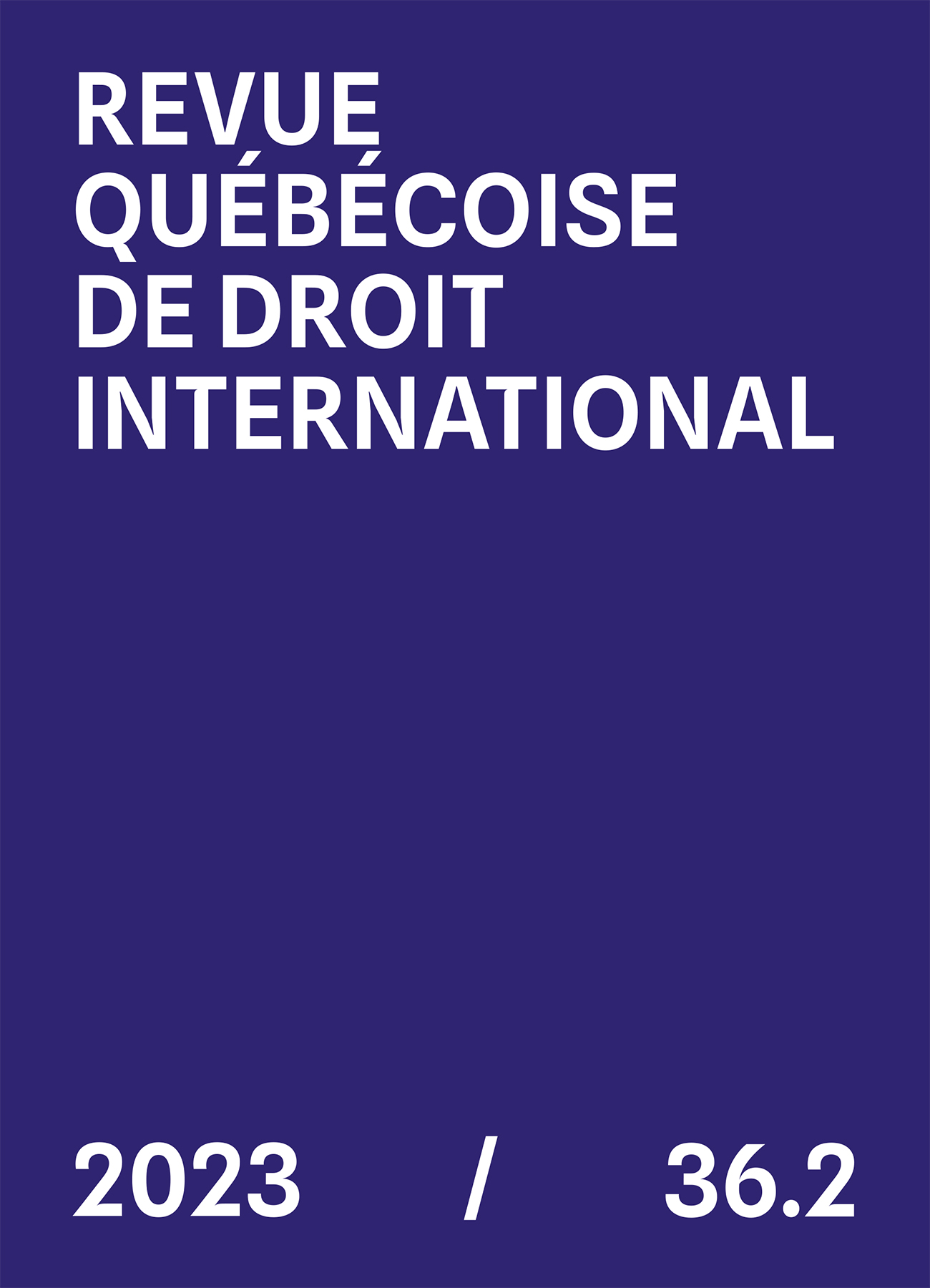Ce manuel porte sur l’engagement de longue date qu’entretient le droit international occidental avec la doctrine philosophique de l’anthropocentrisme. À l’heure de l’anthropocène, ou plus simplement, à celle de l’humain, dans quelle mesure les structures juridiques internationales sont-elles construites selon l’idée que l’humain est socialement et politiquement au centre de l’univers? La première édition de cet ouvrage est dirigée par les docteur·es Vincent Chapaux, Frédéric Mégret et Usha Natarajan, respectivement chercheur à l’Université libre de Bruxelles en Belgique, professeur titulaire à l’Université McGill au Canada et chercheuse invitée à la Faculté de droit de l’Université de Yale aux États-Unis. Par une approche critique du droit, cet ouvrage, qui rassemble les écrits de 22 chercheur·es et professeur·es, explore la relation entre l’anthropocentrisme et diverses branches du droit international, les relations de pouvoir que ce droit reproduit ainsi que le rôle que joue ce dernier dans la crise socio-environnementale actuelle. Visant à offrir un enrichissement de l’analyse anthropocentrique du droit international, cet ouvrage de 17 chapitres est divisé en trois sections : la première intitulée « Unveiling the Anthropcentrism of International Law » offre une analyse variée démontrant, d’hier à aujourd’hui, l’intégration de la logique anthropocentrique du droit international. Critique, la deuxième section intitulée « Conceptualising the Anthropocentrism of International Law » théorise sous plusieurs angles l’anthropocentrisme. Prospective, la troisième section intitulée « Imagining a Non-Anthropocentric International Law » explore, en mettant de l’avant certaines voies condamnées au silence, différentes trajectoires juridiques post-anthropocentriques. La première section débute par une contribution au chapitre 1 de Mario Prost qui propose d’analyser la structure profondément anthropocentrique de la notion juridique de la souveraineté du 16e siècle à aujourd’hui. Il y est argumenté que l’exploitation de la nature n’est pas qu’un simple attribut légalement protégé et légitimé en vertu de cette doctrine mais a été, à bien des égards, une exigence sine qua non de la formation de tout État souverain « moderne » aux yeux du droit international occidental. Pour ce faire, Prost explore les origines coloniales de la doctrine de la souveraineté en exposant la théorie lockéenne de la propriété fondée sur l’exploitation de la terre ainsi que sa réinterprétation par le juriste Emer de Vattel. Dans un deuxième temps, bien que le discours se transforme, l’auteur expose par l’entremise d’exemples, dont celui de la théorie développementaliste, l’héritage contemporain de cette doctrine anthropocentrique toujours perceptible au sein des normes et des procédés discursifs du droit international. Bien que la notion de souveraineté et les origines conceptuelles de la pensée juridique occidentale caractérisées par l’accaparement et l’exploitation licite de la terre ont été largement documentées, ce premier chapitre s’avère déterminant à la compréhension, tout au long de cet ouvrage, du lien qu’entretient l’anthropocentrisme juridique au néocolonialisme et au néolibéralisme. Au chapitre 2, Frédéric Mégret propose d’explorer l’inhérente nature anthropocentrique des droits humains, fondée sur une justice intra-humaine se caractérisant par une exclusion des espèces vivantes non-humaines et de l’environnement. Après avoir retracé les origines historiques de l’édification du « projet » des droits humains fondé sur la supériorité des humains sur l’environnement/les animaux, il met en lumière, par l’entremise d’une analyse jurisprudentielle, l’approche anthropocentrique actuelle du droit international des droits humains. À cet égard, il démontre que la dégradation de l’environnement représente avant tout une menace portée contre l’humain nécessitant une intervention étatique, et non une obligation visant à prévenir un préjudice dirigé contre l’environnement. De surcroît, à travers divers procédés, il souligne que les droits humains conceptualisent, par le prisme du droit à la propriété, du droit à l’auto-détermination et des droits socio-économiques, l’environnement et les animaux comme une marchandise exploitable aux fins …