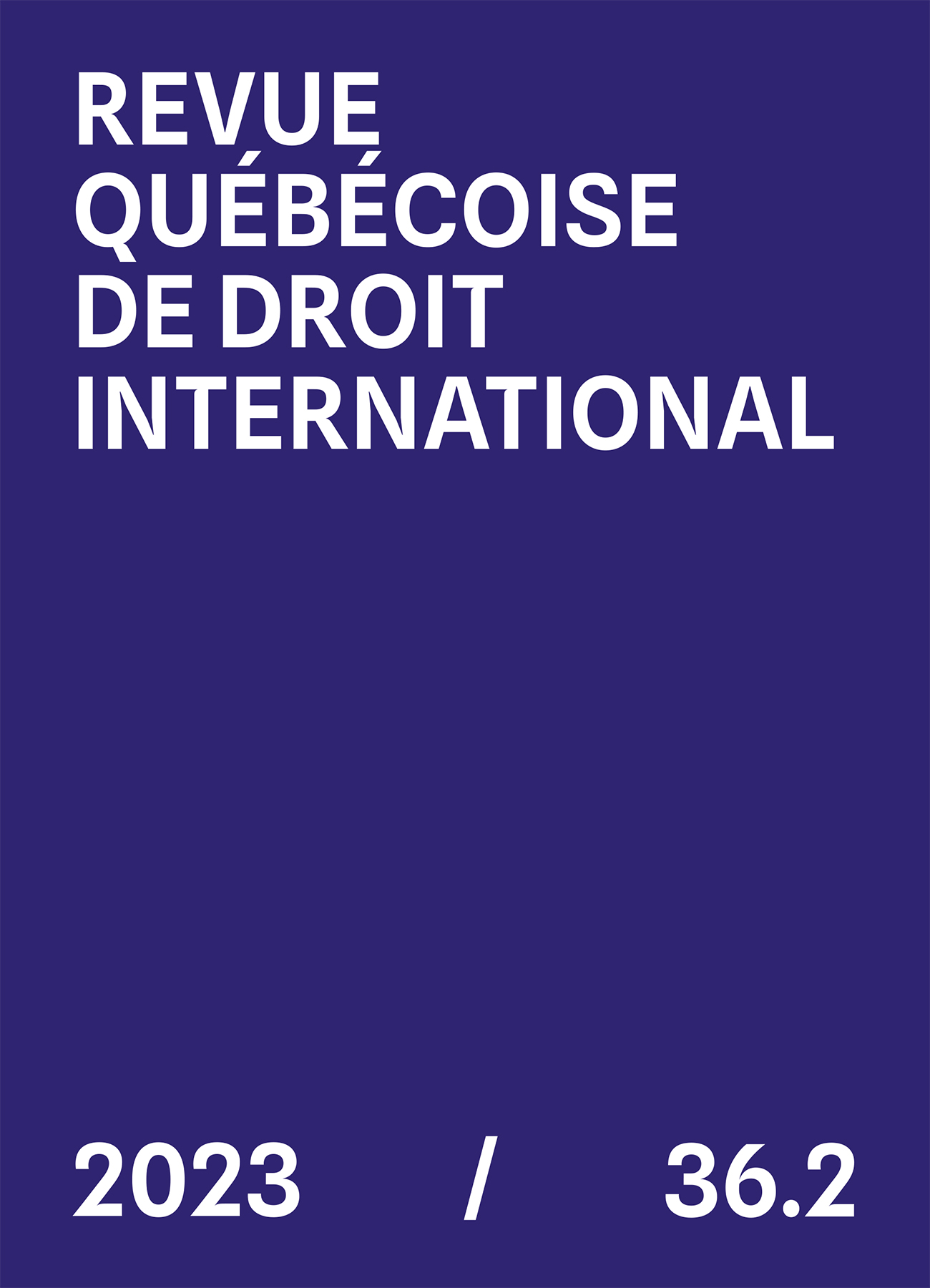À la suite du tumulte politique du printemps arabe, une nouvelle constitution tunisienne est adoptée en 2014. Malgré son abrogation entière à l’été 2019 par le chef d’État Kais Saïd, le processus de rédaction de la loi suprême du pays permet un examen intéressant des interactions entre droit international et droit constitutionnel. Dans un contexte de remise en question de la légitimité de l’ordre juridique international, il est opportun d’analyser de quelle manière ce dernier peut s’immiscer au sein des pouvoirs constituants d’un État souverain. L’objet d’étude est d’autant plus pertinent compte tenu de l’influence des puissances étrangères ou bien de l’Organisation des Nations unies dans l’historique constitutionnel tunisien. C’est dans cette perspective que l’auteure de l’ouvrage, Rawaa Salhi, doctorante en droit international ainsi que spécialiste des questions de coopération internationale dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a procédé à une étude du flux de connectivité entre droit international et droit constitutionnel. L’objet de l’étude est la constitution tunisienne de 2014. Le contexte postrévolutionnaire nécessitant à la fois des notions de science juridique et de science politique, l’auteure a su mobiliser une approche pluridisciplinaire. Elle combine une approche matérielle, menant à une analyse du texte lui-même, à une approche formelle des interactions liées à la transition démocratique et à la procédure constituante. L’auteure avance comme hypothèse qu’un phénomène d’internalisation du droit aurait eu lieu. Au niveau méthodologique, l’ouvrage propose une analyse documentaire qui s’appuie sur différents instruments juridiques internationaux, la doctrine juridique pertinente en l’espèce et les contributions intellectuelles de certains éminents penseurs philosophiques. L’étude est structurée en deux parties principales, chacune mettant en évidence un argument central. La première partie porte sur l’internationalisation normative de la constitution tunisienne de 2014 ayant conduit à une intégration des valeurs et des référentiels de l’impératif démocratique. La seconde partie analyse comment cette internationalisation n’aurait pas pour autant exclu l’appropriation nationale de la constitution, confirmant ainsi sa légitimité démocratique. La partie initiale se divise en deux titres comprenant chacun deux sous-chapitres. Elle aborde le caractère miscible de la constitution tunisienne de 2014. Les relations systémiques entre ordre international et ordre interne constitutionnel se manifestent par plusieurs points. Salhi établit, dès le premier titre, que la constitution adhère au patrimoine constitutionnel commun. Le premier chapitre démontre que la Tunisie a renforcé, en consacrant la primauté du droit, la tendance mondiale d’harmonisation, voire d’uniformisation, des droits de la personne. Cette position est notamment confirmée par l’intégration au texte constitutionnel, conformément à l’article 21(3) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du principe de volonté du peuple ainsi que de l’importance d’un régime démocratique représentatif. Ces deux éléments permettraient alors un renforcement de l’État de droit. Dans le même ordre d’idée, l’auteure explique que la constitution intègre une réelle séparation des pouvoirs. La magistrature serait pour une première fois libérée de « la domination de l’exécutif », assurant ainsi une vraie protection des droits et libertés fondamentales. En raison de son respect de la liberté d’expression, le texte constitutionnel aurait également été influencé par le libéralisme sociopolitique. Toujours en adéquation avec les standards internationaux, l’auteure démontre au chapitre 2 de ce même premier titre que le processus constituant aurait bel et bien consacré « l’idéal commun » en matière de droits de la personne. Sans surprise, Salhi argumente que cet ajout serait plus visible sur le plan des droits civils et politiques que sur celui des droits économiques et sociaux. Elle démontre que, contrairement aux lacunes de la constitution de 1959 en la matière, les libertés fondamentales sont désormais garanties par la possibilité d’entamer un recours judiciaire en cas d’atteinte par …