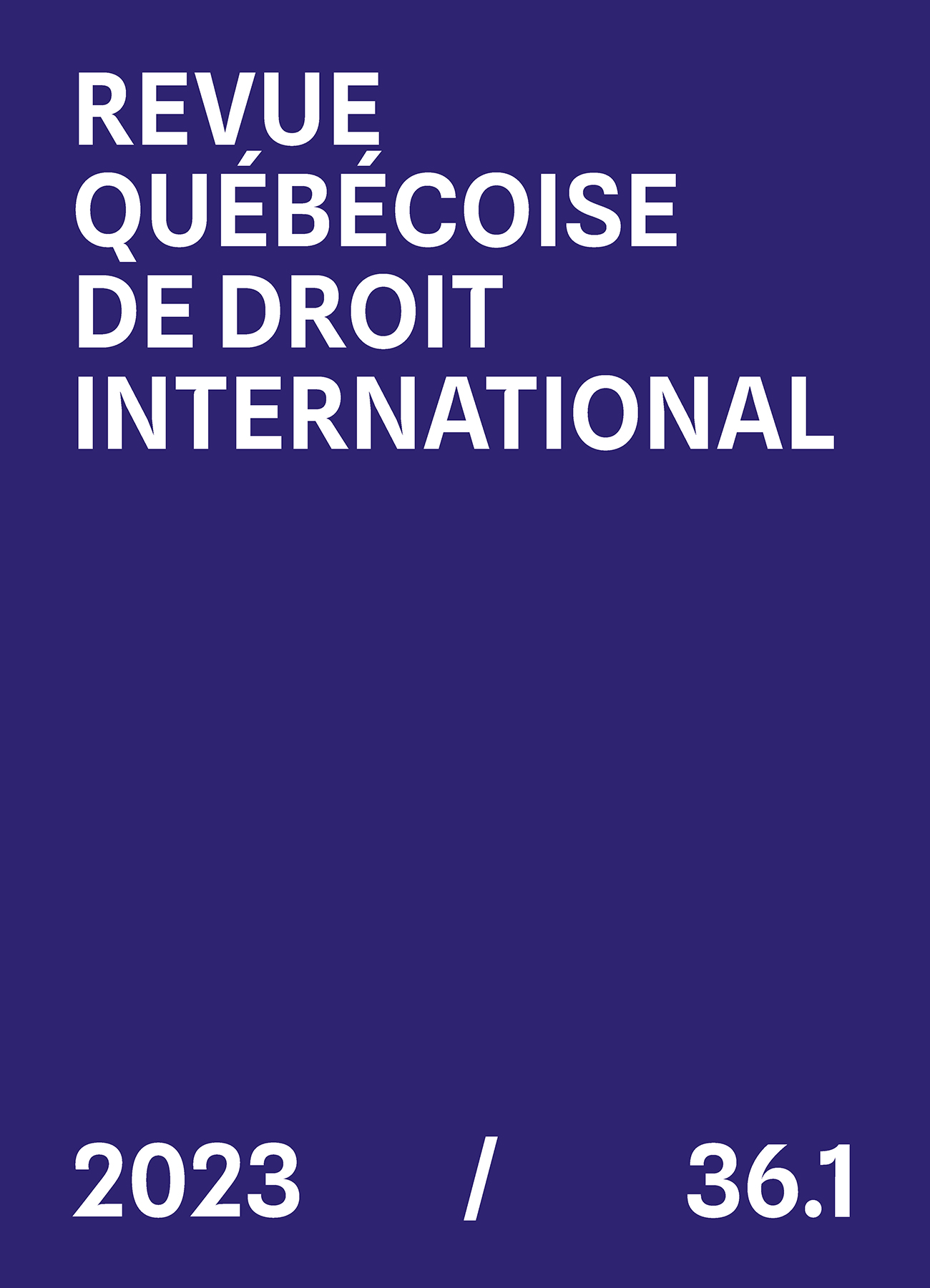Le présent mémoire a été soumis par la Société québécoise de droit international (SQDI) à la Cour suprême du Canada dans le cadre de son intervention dans l’affaire Association du transport aérien international c Office des transports du Canada (ATAI). La SQDI s’est vue octroyer le statut d’intervenante afin de présenter une analyse distincte des parties concernant les questions juridiques soulevées dans l’affaire, contribuant ainsi à élargir l’éventail des points de vue présentés à la Cour suprême. L’affaire ATAI porte sur la validité du Règlement sur la protection des passagers aériens, communément appelée la Charte des voyageurs, adopté en 2019 par l’Office des transports du Canada pour indemniser les passagers relativement à divers retards, pertes et inconvénients subis lors de voyages aériens internationaux. Plusieurs compagnies aériennes demanderesses contestent les dispositions du Règlement en soulignant, notamment, qu’elles contreviennent aux obligations internationales du Canada prévues par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, aussi appelée Convention de Montréal. Afin d’appuyer leurs arguments, les demanderesses ont tenté en première instance de déposer une preuve d’expert portant sur l’interprétation de la Convention de Montréal. Le procureur général du Canada a toutefois demandé la radiation de ces affidavits au motif qu’il s’agissait d’avis juridiques portant sur des questions de droit international qui ne sont pas des questions de fait, mais plutôt des questions de droit dont le juge canadien doit prendre connaissance d’office. La Cour d’appel fédérale a donné raison au procureur général du Canada en première instance à ce sujet. La Cour suprême doit maintenant se prononcer à son tour sur l’admissibilité et l’utilisation de la preuve d’expert relative aux questions de droit international. C’est sur cette question fondamentale que la SQDI a présenté ses observations. Son mémoire porte principalement sur l’application et l’interprétation de l’article 2807, alinéa 2, du Code civil du Québec (CcQ) qui prévoit que le tribunal doit prendre connaissance d’office des « traités et accords internationaux s’appliquant au Québec » et du « droit international coutumier ». Cette disposition est la seule codification législative de la connaissance d’office du droit international au Canada et son interprétation pourrait jouer un rôle important dans l’analyse de la Cour suprême. La Société québécoise de droit international (SQDI) intervient dans la présente affaire concernant la connaissance d’office du droit international (DI) par le juge québécois et canadien. Comme l’a affirmé le Comité de révision du droit de la preuve dans les travaux préparatoires du Code civil du Québec (CcQ), un régime de preuve doit « être ferme sans être rigide ; il doit être souple, sans être inconsistant afin de pouvoir concilier les impératifs de la vérité et ceux de la sécurité juridique ». Cette perspective guide la SQDI dans son intervention. L’affirmation voulant que, contrairement aux États-Unis, le Canada suit une approche dualiste en ce qui concerne les rapports entre les traités et son droit interne, appelle des nuances qui ont une incidence sur l’appréciation de l’étendue de la connaissance d’office du DI. Il est incontestable que le Canada est dualiste en ce qui concerne les traités, mais il faut se garder de simplifier à outrance les rapports entre ceux-ci et le droit canadien. La conclusion du traité à elle seule ne peut certes pas modifier le droit en vigueur au Canada, sans le concours du législateur compétent. La présomption de conformité concernant l’interprétation des lois et de la Charte canadienne des droits et libertés signifie toutefois que le juge doit se référer aux traités liant le Canada même si ceux-ci ne font pas l’objet d’une loi …