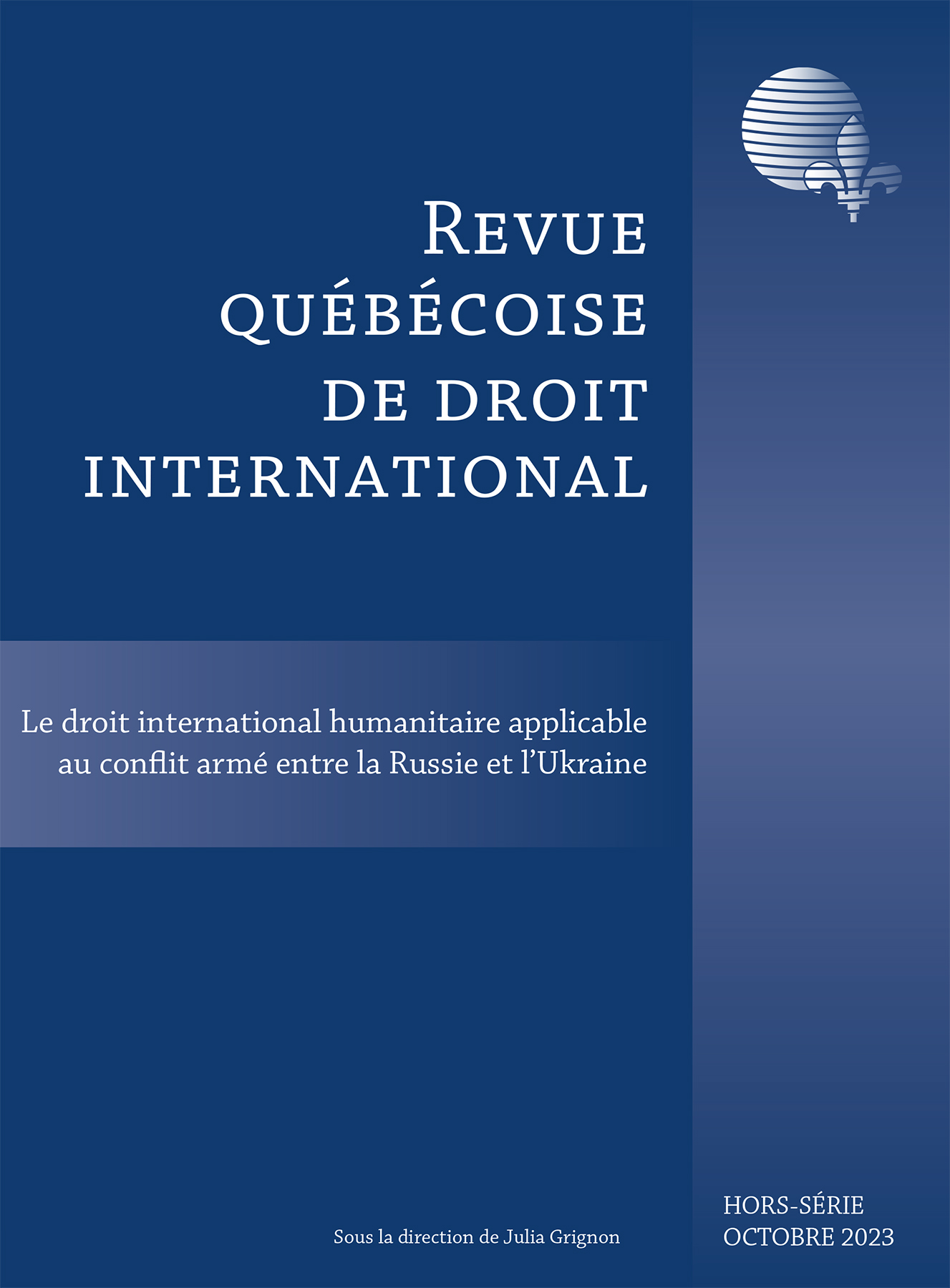Article body
Je suis très honoré d’avoir l’occasion d’écrire cette courte note d’ouverture pour le numéro spécial de la Revue québécoise de droit international consacré à la guerre qui se déroule présentement entre la Russie et l’Ukraine, la plus grande guerre continentale en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les divers articles inclus dans ce numéro se concentrent principalement sur le droit international humanitaire (DIH), un sujet qui a occupé une partie importante de ma vie académique, ainsi que sur quelques sujets qui lui sont étroitement liés. Pourtant, ma tâche n’a pas du tout été facile. Que puis-je dire exactement sur le DIH et sa pertinence aujourd’hui, au milieu de la terrible guerre qui détruit ma patrie et qui coûte la vie à mes compatriotes tous les jours, presque comme une routine ? Devrais-je me contenter de reproduire un ensemble de vérités bien connues ou, peut-être, de dire ce que je pense au risque de paraître légèrement déséquilibré, voire émotif ? De toute manière, ce texte ne peut être que très personnel.
Ayant enseigné le droit international public — et plus particulièrement le DIH et les disciplines connexes, en Ukraine et ailleurs pendant une vingtaine d’années — et ayant bénéficié de nombreuses opportunités de coopération académique avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), notamment en résumant la pratique de mon pays pour deux mises à jour de l’étude du CICR sur le DIH coutumier, en révisant en tant que pair son nouveau commentaire des Conventions de Genève ou en siégeant au comité de rédaction de la Revue internationale de la Croix-Rouge, est-ce que je crois encore au potentiel du DIH pour remplir sa mission ? Ou, plus généralement, que vaut le droit international face à la tragédie qui se manifeste par de nombreuses violations de ses règles les plus importantes ?
Mes études sur le droit des conflits armés, qui étaient considérées par mes collègues ukrainiens comme purement théoriques pour notre pays pacifique, sont devenues plus que d’actualité depuis 2014. Tout comme ces collègues, j’avais l’habitude de considérer comme acquis le fait que je resterais à l’abri de la guerre, théorisant sur la fragmentation du droit international et sur l’autonomie du DIH en tant que régime juridique (autonome ?) (Quelle discussion inutile, dirais-je maintenant !), sur divers modèles d’interaction entre le DIH et le droit international des droits humains ou sur la (re) conceptualisation de la relation entre la responsabilité de l’État et celle de l’individu pour les violations des lois et des coutumes de la guerre. On aurait vraiment préféré que les choses restent exactement comme cela. Évidemment, la guerre qui a frappé l’Ukraine a radicalement changé la donne. Le traumatisme qui accompagne inévitablement la guerre n’a cessé de croître et de s’approfondir dans la société ukrainienne, ne laissant personne indifférent, aujourd’hui et pour de nombreuses générations à venir. Personnellement, la chance tragique de pouvoir mettre en pratique mes connaissances en matière de droit international humanitaire s’est révélée être un moyen de rester sain d’esprit et pertinent au beau milieu de la guerre.
Mes préoccupations, voire mes frustrations, à l’égard de la discipline et de son application pratique n’ont cessé d’augmenter depuis le début du conflit armé international entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, c’est-à-dire depuis la fin février 2014, lorsque la première a commencé son opération de prise de contrôle de la République autonome de Crimée, en Ukraine. À chaque nouveau développement, des révélations ont été faites. La simple logique selon laquelle l’annexion d’un territoire étranger équivaut à un acte d’agression et que le territoire en question ne peut être considéré que comme occupé (« [i] l n’y a pas un atome de souveraineté dans l’autorité de la puissance occupante », comme l’a écrit Lassa Oppenheim en 1917[2]), et que l’occupation belligérante signifie toujours l’existence d’un conflit armé international entre les États concernés, conformément aux dispositions communes de l’article 2 des Conventions de Genève de 1949, n’est pas apparue, à ma grande surprise, comme quelque chose d’évident, et pas seulement pour le grand public. La plupart des organisations internationales et des hauts fonctionnaires ont soigneusement évité de faire une telle déclaration, même après que les rapports annuels du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) sur les activités d’examen préliminaire concernant la situation en Ukraine, à partir de 2016, l’aient clairement explicité[3]. Il semblerait que pour le CICR, par exemple, le fait de dire publiquement quelque chose de ce genre reviendrait à compromettre gravement sa neutralité. Mais est-ce vraiment le cas ?
Néanmoins, admettons que le CICR avait des raisons valables de se comporter comme il l’a fait. Cependant, pour les autres acteurs, ceux qui n’ont pas de contraintes similaires à celles de la plus grande organisation humanitaire, ignorer l’évidence était un moyen commode de continuer à faire comme si de rien n’était. Aujourd’hui encore, il existe une forte tendance à continuer de parler de « la guerre en Ukraine » ou, pire encore, de « la crise ukrainienne » et à éviter autant que possible de mentionner l’autre partie de ce conflit armé international. Cette tendance entraîne inévitablement des répercussions sur le discours juridique international.
De nombreux concepts liés au DIH semblent bien établis, surtout si l’on se contente de suivre le courant dominant, en particulier celui propagé par le CICR. Des concepts tels que l’utilisation de l’allégeance au lieu de la nationalité pour définir l’applicabilité ratione personae du DIH, en particulier de la Convention de Genève (IV), la portée et la signification des mesures de précautions prises par la partie défenderesse, la responsabilité des États à l’égard des « sociétés militaires et de sécurité privées », la participation directe aux hostilités et bien d’autres peuvent, dans leur application pratique, sembler assez différents de la version simplifiée de la doctrine officielle telle qu’elle est présentée aux étudiants et utilisée par le CICR pour une diffusion plus large des connaissances en matière de DIH.
Plus généralement, le rôle des juristes pendant un conflit armé est multiple et dépend beaucoup de la situation de chaque universitaire. Une question fondamentale est celle de l’objectivité. Aider les victimes à trouver les meilleures réponses juridiques aux dommages qu’elles ont subis serait, à mon avis, parfaitement compatible avec le principe d’objectivité académique. Ce n’est toutefois pas la position que tout le monde adopterait. Le débat sur l’idée de créer un tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine illustre parfaitement la différence entre les différentes notions d’objectivité académique dans le cas de la guerre en cours. Alors qu’un grand nombre d’universitaires a travaillé sur la meilleure façon de punir les responsables du déclenchement et de la conduite de la guerre, notamment en développant le droit international, d’autres ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à expliquer pourquoi cela n’était pas possible ou à simplement participer au whataboutism.
Le rôle des juristes internationaux dans l’Ukraine d’aujourd’hui consisterait certainement avant tout à aider leur pays. Ils doivent rester objectifs, mais il serait absurde d’exiger d’eux qu’ils fassent preuve de neutralité. Les universitaires ont le devoir moral de conseiller les fonctionnaires, les parlementaires, les juges et les procureurs en matière de droit international humanitaire ; en d’autres termes, tous ceux qui ont besoin de ces conseils. En outre, dès le début du conflit armé, en 2014, les médias ukrainiens ont soudainement eu une forte demande pour faire entendre la voix des juristes internationaux. Les professeurs de droit international sont devenus des personnalités publiques, bien plus qu’auparavant.
Expliquer les bases du droit international humanitaire au public a toujours été un défi. D’une certaine manière, cela permet également de tester la compréhension des concepts qui sous-tendent le droit des conflits armés. Selon mon expérience, deux de ces concepts ont été les plus difficiles à expliquer à des personnes dotées d’un solide bon sens, mais ne connaissant pas la doctrine juridique internationale. Il s’agit (1) de la nécessité d’établir et de toujours maintenir une distinction claire entre le jus ad (ou contra) bellum et le jus in bello, et (2) de la nécessité de qualifier le conflit armé d’international (CAI) ou de non international (CANI) avant de procéder à toute autre évaluation des droits et obligations conférés par le DIH aux acteurs concernés, ou même de l’option d’utiliser les deux qualifications presque en même temps.
Permettez-moi de revenir brièvement sur ces deux concepts et sur les idées fausses qui les entourent. En 2014, alors que le conflit armé se développait dans les deux régions de l’est de l’Ukraine, Donetsk et Louhansk, on a beaucoup parlé de la nature « non internationale » du conflit. En 2023, avec du recul, peu de gens s’en tiendraient encore à ce point de vue, mais au départ, on ne pouvait peut-être pas l’ignorer, à la suite de la réponse notoire et maintes fois répétée, depuis 2014, de Poutine à la question de la présence de l’armée russe, d’abord en Crimée, puis dans l’est de l’Ukraine : « Il n’y en a pas. » La discussion qui s’en est suivie a fourni un bon exemple de quelque chose qui a été plus ou moins unanimement accepté par les universitaires, mais qui reste extrêmement difficile à expliquer au grand public. Il faut revenir aux sources, pour ainsi dire, et admettre que la distinction même entre les deux types de conflits armés, sans parler de l’idée d’une « double qualification », est le résultat de la réticence des États à mettre en place un cadre à part entière pour réglementer les conflits armés non internationaux. Fondée à l’origine sur la réticence des États à laisser le droit international pénétrer trop loin dans leur domaine réservé lorsqu’il s’agissait de réprimer des émeutes internes, elle s’est transformée en un terreau idéal pour ce que l’on appelle la « guerre hybride ».
La nécessité de séparer totalement les arguments « jus ad bellum » et « jus in bello » s’est avérée être un défi encore plus grand. La raison d’être de cette séparation est bien connue et étayée par des preuves. Cela dit, cette séparation ne peut fonctionner correctement dans le monde réel du XXIe siècle que si la violation des règles fondamentales régissant l’utilisation de la force fait l’objet d’une réponse adéquate de la part de la communauté internationale. La perception de la guerre comme un mal inévitable qui a influencé le développement de l’éthique des lois et coutumes de la guerre, et de la doctrine juridique du CICR, est difficilement soutenable de nos jours.
Le fait que la Russie occupe un siège permanent, celui attribué en 1945 à l’Union des républiques socialistes soviétiques, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, rend cet organe clé incapable de prendre les décisions nécessaires. Le droit international humanitaire faisant partie intégrante du droit international public, il me semble que si la partie de la réponse juridique internationale à l’acte d’agression est absente, le reste de la discussion se concentre sur les seuls arguments du droit international humanitaire. En l’absence d’un organe d’établissement des faits fonctionnel et obligatoire (on se souviendra que la Russie a commodément retiré, en 2019, son consentement à être liée par l’article 90 du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève, qui prévoit les pouvoirs de la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits), la machine de propagande de l’État a toute latitude pour affirmer que toutes ses actions militaires en Ukraine étaient dirigées contre des objectifs militaires. L’argument est ensuite poussé plus loin en affirmant que le droit international humanitaire autorise en fait leur action militaire en Ukraine, c’est-à-dire qu’elle est parfaitement licite. C’est toutefois la dimension du jus ad bellum qui établit clairement qu’il ne peut y avoir un seul cas licite d’utilisation de la force militaire dans le cadre d’un acte d’agression, qu’un acte particulier soit conforme ou non au droit international humanitaire.
Un autre aspect du DIH frappe ceux qui le découvrent : ce régime juridique ne prévoit aucun recours individuel pour les victimes de ses violations. Cette frustration est toutefois quelque peu atténuée dans le contexte particulier de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. La guerre en question se déroule dans l’espace juridique européen, l’Ukraine y étant liée par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), et la Russie faisant partie de la CEDH jusqu’au 16 septembre 2022 (c’est-à-dire six mois après son expulsion du Conseil de l’Europe, qui a déclenché son départ de la Convention). La jurisprudence de la Cour EDH concernant les situations de conflit armé et l’application du droit international humanitaire est loin d’être simple. Toutefois, il s’agit d’une juridiction internationale de premier plan qui pourrait potentiellement examiner les allégations de violations des droits humains, dont beaucoup seraient également des violations du droit international humanitaire, au cours de la guerre, avec les limitations temporelles susmentionnées. Plusieurs requêtes interétatiques déposées par l’Ukraine contre la Russie, ainsi que des milliers de requêtes individuelles contre l’un ou l’autre État, voire les deux, sont en cours de traitement par la Cour EDH. Il reste à voir ce que cette cour internationale sera en mesure de dire exactement et comment cela pourra influencer la mise en oeuvre du droit des conflits armés.
La guerre change notre optique ; elle nous fait adopter une approche plus ciblée et plus sobre de questions qui semblaient auparavant n’avoir qu’un intérêt théorique, en mettant l’accent sur leurs implications pratiques. Elle nous fait également prendre conscience avec plus de clarté que le droit, et plus encore le droit international, est loin d’être un ensemble de normes gravées dans le marbre ; il s’agit en fait, comme l’ont souligné de nombreux éminents universitaires et praticiens, de Dame Rosalyn Higgins, première femme présidente de la Cour internationale de justice, au professeur Volodymyr Butkevych, premier juge ukrainien à la Cour européenne des droits de l’homme, d’un processus plutôt que d’un simple ensemble de règles[4]. Les décisions prises et mises en oeuvre au cours de cette guerre auront certainement modifié le DIH et le droit international en tant que tels, du moins la manière dont leurs normes sont perçues et appliquées.
Strasbourg, juillet 2023
Appendices
Notes
-
[1]
Traduit de la version anglaise originale par le Service de la recherche et de la création de l’Université du Québec à Montréal.
-
[2]
Lassa Oppenheim, « The Legal Relations Between an Occupying Power and the Inhabitants » (1917) 33:4 Law Q Rev 363 à la p 364.
-
[3]
Cour pénale internationale, « Report on Preliminary Examination Activities (2016) » (14 novembre 2016), en ligne (pdf): CPI <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf>.
-
[4]
Rosalyn Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford, Oxford University Press, 1995 aux pp 1–12; Volodymyr Butkevych, « Poniattia, pryroda ta sfera dii mizhnarodnoho prava » [Notion, nature et champ d’application du droit international], dans Volodymyr Butkevych, Vsevolod Mitsik, Oleksandr Zadorozhniy (dir) Mizhnarodne pravo [Droit international], Kiev, Lybid Publishing House, 2002, 15 aux pp 22–25 [en ukrainien].