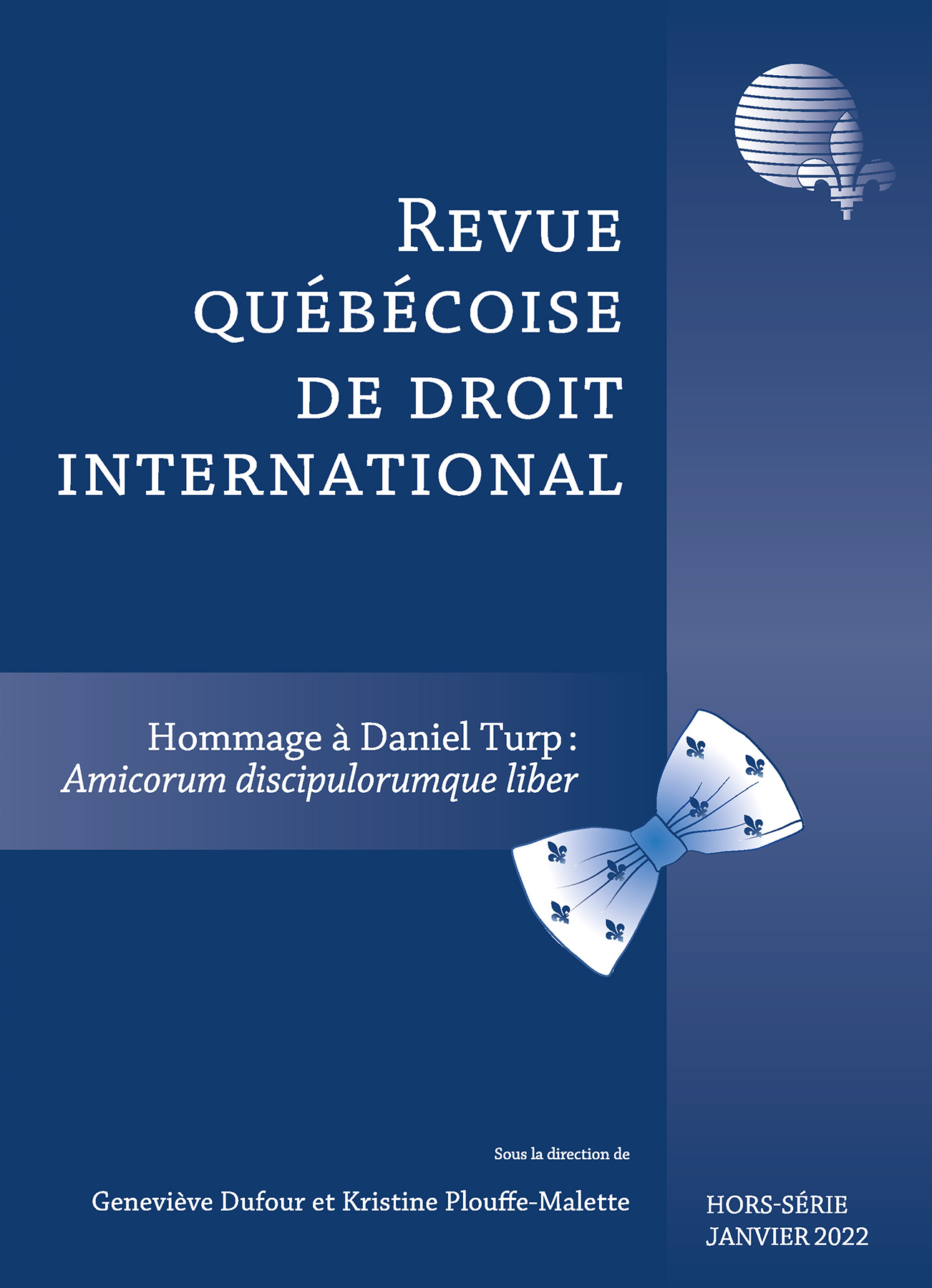Article body
La RQDI présente une compilation des différentes lettres ouvertes, disponibles en ligne, signées par Daniel Turp, pendant la période 1993-2021, publiées dans différents journaux d’ici et d’ailleurs.
« L’impact d’un pacte international » Daniel Turp et William Schabas Le Devoir (5 juillet 1993)
Une constatation du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur la loi 178 n’est pas dénuée de toute valeur juridique lorsqu’elle conclut à la violation d’un traité
L’analyse faite par nos collègues Henri Brun et Jean Maurice Arbour sur le contenu et la portée de la constatation du Comité des droits de l’homme dans l’affaire relative à la loi 178, publiée dans Le Devoir du 4 juin, nous inspire la réplique suivante.
Comme le font remarquer nos collègues Brun et Arbour, la constatation du Comité des droits de l’homme dans l’affaire relative à la loi 178 n’a pas en tant que telle la portée d’un arrêt obligatoire. Mais, en tout respect pour l’opinion de nos collègues, une constatation du Comité des droits de l’homme n’est pas dénuée pour autant, selon nous, de toute valeur juridique lorsqu’elle conclut à une violation d’un traité, en l’occurrence le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Canada a adhéré, après avoir reçu l’assentiment du Québec.
On ne saurait à notre avis se retrancher derrière la nature déclaratoire ou « recommandatoire » d’une constatation du Comité des droits de l’homme pour priver celle-ci de toute portée juridique.
En effet, elle constate la violation d’un article d’un traité qui a, quant à lui, une valeur contraignante et qu’un État partie doit exécuter de bonne foi, en vertu d’une règle fondamentale du droit international des traités.
Par son adhésion au Protocole facultatif, lequel reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner des communications individuelles, un État partie au Pacte sur les droits civils accepte selon nous de donner suite aux constatations du Comité des droits de l’homme et de respecter de la sorte les obligations internationales telles qu’elles ont été interprétées et appliquées par le Comité.
Cela est d’autant plus vrai dans le cas où un gouvernement collabore de façon active à la procédure d’examen d’une communication, notamment par la présentation d’observations écrites, comme l’a fait le gouvernement du Québec dans l’affaire relative à la loi 178. On ne saurait non plus invoquer l’absence de mécanisme d’exécution ou de sanctions pour justifier le non respect d’une constatation du Comité.
L’impossibilité pour ce dernier de faire exécuter une constatation est susceptible de diminuer l’efficacité de ses constatations dans le cas où un État n’est pas disposé à leur donner effet, mais ne saurait occulter le fait qu’une violation d’une obligation internationale a été constatée et que des mesures appropriées devraient être prises par l’État partie pour qu’il cesse d’être en violation de cette obligation. Une attitude de respect à l’égard des constatations des droits de l’homme s’est d’ailleurs imposée dans la pratique d’États de droit qui, comme le Canada, les Pays-Bas et la Finlande, n’ont pas hésité à donner effet aux constatations du Comité.
Nous réalisons avec plaisir que la très grande majorité des intervenants dans le débat linguistique actuel ont exprimé une volonté de voir le Québec donner lui aussi suite aux constatations du Comité et d’exiger dès lors que le Québec se comporte comme un État de droit respectueux des obligations internationales auxquelles il s’est déclaré lié.
Le Québec se devrait aussi de respecter le délai de six mois dans lequel le Comité souhaiterait être informé des mesures pertinentes prises par le Québec pour donner suite aux constatations du Comité.
À cet égard, nous sommes d’accord avec nos collègues que le délai de six mois (qui prend fin le 27 septembre 1993) n’est pas un délai de rigueur, mais il importe que le gouvernement du Québec donne tout de même suite au souhait exprimé par le Comité.
Il serait pour le moins inopportun selon nous que le Québec invoque le précédent de l’affaire Lovelace où le Canada n’avait informé le Comité des mesures prises pour mettre fin à sa violation du Pacte que quatre ans après l’adoption de la constatation du Comité.
Il faut d’ailleurs préciser qu’en 1981, le Comité des droits de l’homme ne fixait aucun délai précis, pour la présentation d’informations par les États parties sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
Le Québec pourrait fort bien par ailleurs informer le Comité, dans le délai de six mois, qu’il désire disposer d’un délai additionnel pour adopter les mesures qui s’imposent et le Comité n’hésiterait pas, à notre avis, à l’accorder.
Que l’on soit en accord ou en désaccord avec les conclusions du Comité, qui comportent en partie les arrêts des tribunaux québécois et canadiens, le respect de la constatation du Comité s’impose selon nous.
Mais on ne doit pas passer sous silence, comme le font nos collègues Brun et Arbour, le fait que la motivation de la constatation du Comité dans l’affaire relative à la loi 178 est non seulement sommaire, mais au surplus insatisfaisante.
Nous n’hésitons pas à juger sévèrement une constatation qui consacre l’essentiel de son propos à exposer les faits et à résumer les observations des parties (59 paragraphes — 15 pages) et qui ne réserve qu’une partie négligeable de la constatation à l’examen du fond de la communication (5 paragraphes — 2 pages). Les cinq modestes paragraphes consacrés à l’examen des prétentions de violation des droits linguistiques (art. 27), de la liberté d’expression (art. 19) et des droits à l’égalité (art. 26) sont d’un laconisme injustifié pour un Comité dit de 18 experts indépendants possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de la personne.
Ils sont également fort décevants quand on les compare aux motifs très élaborés énoncés par les 16 juges de la Cour supérieure et d’appel du Québec et de la Cour suprême du Canada, qui se sont prononcés sur la question et qui ont d’ailleurs été portés à la connaissance des membres du Comité.
Dans l’affaire relative à la loi 178, le Comité des droits de l’homme a ainsi fait la preuve qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter convenablement d’une tâche qui a pourtant un impact significatif sur l’exercice des compétences dans un État de droit démocratique.
Le nombre insuffisant de séances que le Comité peut consacrer à l’examen des communications, l’impossibilité qu’il a d’entendre des plaidoiries orales des parties et le manque de ressources humaines et matérielles peuvent expliquer les motivations insatisfaisantes de ses constatations. Des mesures s’imposent pour corriger cette situation, car de telles motivations portent atteinte à la crédibilité du Comité et de ses membres ainsi qu’à l’autorité de ses constatations.
Les gouvernements du Canada et du Québec devraient faire part de leurs préoccupations au Comité et proposer des réformes qui permettraient à celui-ci d’exercer ses compétences au titre du Protocole facultatif de façon sérieuse. Mais ils devraient également accélérer le processus de signature et de ratification de la Convention américaine des droits de l’homme, à laquelle le Canada peut devenir partie depuis qu’il est devenu membre de l’Organisation des États américains en 1990.
En se déclarant liés par cette Convention, les gouvernements canadien et québécois pourront conférer à un véritable tribunal international, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la compétence de rendre des arrêts à portée véritablement obligatoire, dont la motivation devrait, à la lumière de la pratique actuelle de la cour interaméricaine, être nettement plus crédible que celle du Comité des droits de l’homme.
« Daniel Johnson en Europe : Omission diplomatique » Daniel Turp et Louise Beaudoin Le Devoir (16 février 1994)
Dans un geste incompréhensible, le premier ministre Daniel Johnson décidait il y a quelques semaines de démembrer l’appareil des relations internationales du Québec, en nommant Mme Frulla « responsable » (et non ministre) de la Francophonie et en privant ainsi le détenteur du portefeuille des Affaires internationales, M. Ciaccia, d’un dossier d’importance stratégique pour la politique étrangère du Québec. Cette décision faisait douter de la volonté - sinon de la capacité - de M. Johnson à mener une politique étrangère québécoise cohérente. Elle avait suscité des appréhensions et celles-ci se sont hélas vite matérialisées par la longue succession de bourdes, de faux pas et d’erreurs que M. Johnson vient d’accumuler lors de son récent voyage en Europe.
Ainsi, le premier ministre a tenu, en l’encadrant ostensiblement dans une tournée européenne, à banaliser sa visite à Paris, seule capitale où la représentation du Québec a rang d’ambassade et où, par conséquent, le premier ministre du Québec est reçu par un chef d’État sans chaperon fédéral. À cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que c’est grâce au général de Gaulle que le Québec obtint ce statut en 1964.
Il importe aussi de souligner que c’est grâce au même général de Gaulle que le Québec a signé ses premières ententes internationales, que la coopération franco‑québécoise a pris son envol, que l’Office franco-québécois pour la jeunesse a vu le jour et que les visites alternées de premier ministre, contenues en germe dans les accords Johnson-Peyrefitte de 1967, ont pu être institutionnalisées à compter de 1977. Alors même que le Rassemblement pour la République (RPR), ce parti qui revendique globalement l’héritage du général de Gaulle, exerce le pouvoir en France, non seulement Daniel Johnson fils feint-il d’ignorer le rôle de celui-ci, mais, à Paris, il ose désavouer son « Vive le Québec libre » de juillet 1967. Imagine-t-on un homme politique responsable censurer ainsi à Londres les messages historiques de Churchill ou à Washington ceux de Roosevelt?
En accédant au poste de premier ministre du Québec, Daniel Johnson père avait acquis une véritable stature de chef d’État: visiblement, dans la même circonstance, il n’en est rien pour le fils.
Cette aberration en annonçait une autre. En présence du ministre des Affaires étrangères de France, M. Alain Juppé, le premier ministre du Québec affirmait, à l’ahurissement général, que « la France tient encore moins que le Québec au rayonnement de la Francophonie ». Sa mise au point contournée du lendemain ne faisait qu’ajouter à la confusion et démontrait visiblement l’absence de sens politique et diplomatique de M. Johnson. Enfin, que recherchait le premier ministre en invitant le président Mitterrand à venir au Québec à la mi-août, c’est-à-dire selon tous les signaux émis par le Parti libéral du Québec, à la veille des élections générales? En emboîtant ainsi le pas, le faux pas, à M. Chrétien, il force le président de la République française à refuser, dans les circonstances, son invitation.
Si le nouveau premier ministre n’a pas su démontrer son habileté diplomatique pendant l’étape française de son périple européen, il a prouvé en revanche qu’il pouvait, comme son prédécesseur, verser dans la démagogie la plus partisane. C’est en terre britannique, une terre que M. Johnson semblait retrouver avec soulagement après son passage « obligé » en France, que ses vertus partisanes ont été mises en lumière et qu’il a choisi de faire l’éloge du fédéralisme et le procès de la souveraineté. Curieux choix quand on sait ce pays défenseur acharné de la souveraineté et adversaire farouche d’une Europe à vocation fédérale.
Passant outre à la fatigue constitutionnelle qui semble le hanter autant que M. Chrétien, M. Johnson a pourtant affirmé péremptoirement à Londres que le fédéralisme canadien est « un cadre où il existe assez de souplesse pour qu’à chaque fois que, comme premier ministre d’une province comme le Québec, je choisisse que certains pouvoirs doivent être exercés par le Québec plutôt que par quelqu’un d’autre selon des ententes ». Cette souplesse serait telle que l’on pourrait ainsi « éliminer les dédoublements de juridiction et économiser de l’argent en réaménageant les administrations publiques ».
La démagogie partisane
Cette prétendue souplesse du fédéralisme n’a pourtant pas conduit à l’acceptation des accords de Meech et de Charlottetown, lesquels devaient constituer la démonstration même de cette souplesse. Ce cadre fédéral pourtant si souple ne paraît pas non plus devoir se traduire par des ententes intergouvernementales d’une importance significative, comme en fait d’ailleurs foi l’attitude adoptée par le nouveau gouvernement fédéral de Jean Chrétien à l’égard de l’entente Campbell-Bourassa sur la formation de la main-d’oeuvre.
La démagogie partisane du premier ministre doit être encore plus sévèrement condamnée lorsque celui-ci accuse le président du Parti québécois, Jacques Parizeau, de proférer un « grossier mensonge » en soutenant que l’espace économique canadien serait maintenu une fois l’indépendance déclarée » et en ajoutant qu’il voulait faire « sauter » l’union économique canadienne.
Se faisant ici encore l’écho de Jean Chrétien, qui aime répéter que les « séparatistes » québécois veulent couper tous les liens avec le Canada, le premier ministre Johnson induit en erreur les partenaires internationaux du Québec sur les projets des souverainistes québécois. Tout observateur de la scène politique québécoise sait que le Parti québécois et le Bloc québécois se sont engagés à maintenir l’espace et l’union économique canadiens.
Un discours non crédible
Si des propos aussi irresponsables ne sont pas dignes d’un chef de gouvernement québécois, ils font la preuve que le premier ministre n’a plus de discours crédible sur le fédéralisme et qu’il manque non seulement de respect à l’égard de ses adversaires mais aussi d’un électorat québécois qui vient d’élire 54 députés souverainistes du Bloc québécois. Les promoteurs de la souveraineté, et en particulier MM. Parizeau et Bouchard, ne se livreront jamais, depuis des tribunes étrangères, à des attaques aussi partisanes que personnelles. Mais ils ne se priveront pas, dans les mois qui viennent, de démontrer que le cadre fédéral ne répond plus à nos attentes et que la souveraineté s’avère l’avenue souhaitable pour le Québec. Lorsque les leaders souverainistes du Québec sillonneront à leur tour l’Europe dans les mois prochains, ils réaffirmeront clairement l’ouverture du Québec sur le monde, tout en rappelant la place privilégiée qu’occupera l’Europe dans cette politique, notamment celle du partenaire économique important que demeurera le Royaume-Uni, mais aussi, et sans doute surtout, celle de l’alliée politique privilégiée du Québec, la République française.
Heureusement pour les relations internationales et la politique étrangère du Québec, M. Johnson est un premier ministre en sursis. N’étant investi d’aucune légitimité populaire, le premier ministre du Québec doit agir de façon responsable et démocratique et déclencher des élections générales plutôt que de faire campagne à l’étranger.
Sans doute craint-il un jugement sévère du peuple québécois qui n’aura guère apprécié les quatre longues années et demie du second mandat du Parti libéral du Québec dont le nouveau premier ministre s’est avéré l’un des piliers depuis 10 ans.
« La mondialisation, une priorité pour tous, sauf pour le Québec » Daniel Turp Le Devoir (25 septembre 2003)
Si le Québec s’est souvent inspiré de la France lorsqu’il s’est doté d’instruments collectifs, comme ce fut le cas pour la Caisse de dépôt et de placement, la mise sur pied d’institutions québécoises originales semble aussi s’avérer une source d’inspiration pour les dirigeants politiques français.
Ainsi en est-il de l’Observatoire québécois de la mondialisation institué en janvier 2003 par l’Assemblée nationale du Québec à l’initiative de Louise Beaudoin. Le président Chirac avait certainement cette heureuse initiative à l’esprit lorsqu’il affirmait, le 29 août dernier, que « pour rassembler l’expertise et mieux organiser les débats [...], notamment avec la société civile, j’ai demandé au premier ministre de me faire des propositions pour la mise en place d’un observatoire français de la mondialisation ».
Cette proposition tire d’ailleurs son origine du rapport Réconcilier la France et la mondialisation, dont une des propositions invite le gouvernement à « installer un observatoire de la mondialisation » « semblable » à celui créé par le Québec.
Il importe dès lors de faire comprendre aux Québécois qu’alors que la France veut créer un observatoire de la mondialisation, celui du Québec n’est plus. Pourtant, la mondialisation affecte au quotidien la vie des citoyens, l’activité des entreprises et l’action des gouvernements. Il s’agit d’un phénomène qui affecte inévitablement les droits des travailleurs, la qualité de l’environnement et la capacité d’agir de l’État et qui, comme le démontre l’intérêt qu’il suscite auprès des jeunes, doit être mesuré en regard de son impact sur les générations futures.
Une approche critique de la mondialisation s’impose en ce début de siècle, approche qui ne doit pas être réservée aux militants altermondialistes mais qui doit aussi être celle des partis politiques et des gouvernements. Par exemple, les traités qui ont créé des zones de libre-échange pourraient être réévalués - on pense notamment au recours investisseurs-États du chapitre XI de l’ALENA - et les retombées de la création d’une nouvelle zone de libre-échange, comme la ZLEA, devraient être sérieusement évaluées avant que le Québec n’aille plus loin.
Le Québec doit se doter d’instruments lui permettant de comprendre la mondialisation, d’en combattre les effets les plus pervers. Au lendemain de l’échec de Cancún, les travaux de l’Organisation mondiale du commerce doivent faire l’objet d’une veille constante, tout comme le débat sur l’adoption d’un instrument international sur la diversité culturelle. Les objectifs poursuivis par le gouvernement du Québec dans ces deux dossiers devraient être alimentés par des analyses qui permettraient au Québec d’appuyer ses positions sur des arguments solides. Et sur le front environnemental, la mise en oeuvre du protocole de Kyoto et la participation éventuelle au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques - entré en vigueur le 11 septembre dernier et que le Canada tarde à ratifier — s’inscrivent dans un processus de mondialisation qui rend urgente la formulation par le Québec de positions visant à favoriser le développement durable.
Pourquoi l’Observatoire québécois de la mondialisation a-t-il subi le couperet du gouvernement Charest? La raison évoquée par la ministre des Relations internationales du Québec lors de l’étude des crédits de son ministère, le 10 juillet 2003, est de nature budgétaire. Une somme de 1,5 million aurait permis le fonctionnement de l’observatoire. Il faut penser que le gouvernement Charest a décidé que la mondialisation et son analyse ne faisaient tout simplement pas partie de ses priorités. Pourtant, à la même époque, le gouvernement de Jean Charest faisait un cadeau de 1,7 million aux évêques catholiques du Canada pour renflouer le déficit des Journées mondiales de la jeunesse tenues à Toronto.
L’abolition de l’Observatoire québécois de la mondialisation - dont la collaboration avec un observatoire français aurait pu constituer un volet original de la coopération franco-québécoise - est un geste irréfléchi qui démontre le peu d’intérêt et le manque de vision du gouvernement pour les relations internationales. Ces relations ne se limitent pas à participer à des rencontres avec des chefs d’État et de gouvernement. La crédibilité des représentants du Québec lors de ces rencontres devrait s’appuyer sur une connaissance approfondie des relations internationales et en particulier du phénomène de la mondialisation.
N’est-il d’ailleurs pas ironique que les premières rencontres d’importance du nouveau premier ministre du Québec aient eu lieu avec le premier ministre Jean-Pierre Raffarin et le président Jacques Chirac, ceux-là mêmes qui, aujourd’hui, préparent la mise sur pied d’un observatoire français de la mondialisation inspiré par le Québec?
« Québec abdique-t-il sur la scène internationale? » Daniel Turp Le Devoir (5 février 2004)
Après neuf mois au pouvoir et le récent voyage de Jean Charest en Europe, force est de constater que le dossier des relations internationales du Québec ne fait pas exception à la mauvaise gestion du gouvernement libéral. L’annonce d’une perte de plus de 550 emplois pendant le Forum de Davos traduit bien le manque de préparation de la mission internationale du premier ministre et augure mal pour l’avenir. Mais au-delà du drame pour les gens du Saguenay, n’assistons-nous pas à une véritable abdication du gouvernement du Québec sur la scène internationale?
Dans un contexte de mondialisation accélérée, une telle abdication est particulièrement désolante et résulte d’une vision provinciale de l’État québécois, d’un intérêt manifestement limité pour la chose internationale et de l’amateurisme de Jean Charest et de son cabinet. Une analyse des faits et gestes du gouvernement de Jean Charest le démontre.
D’abord, les occasions ratées. L’absence inexplicable de Line Beauchamp au Festival de Cannes alors que le cinéma québécois, primé de surcroît, y occupait une place remarquée. La moisson de misère de Jean Charest à Davos, d’autant plus incompréhensible qu’une certaine presse tend à donner aux libéraux du Québec un sens inné pour tisser des liens d’affaires. Et une absence remarquée et injustifiée du gouvernement du Québec au IIIe Forum social mondial à Mumbai, en Inde.
Ensuite, les maladresses. En mai 2003, Jean Charest reçoit la visite d’Edmund Stoiber, ministre-président de l’État libre de la Bavière. Cette entité fédérée partage avec le Québec la rarissime particularité de ne pas avoir signé la Constitution de son État fédéral. Or on remarque que même dans les interpellations protocolaires du premier ministre, le mot « libre » est omis de l’expression correcte, comme s’il pouvait être porteur du moindre équivoque.
Le premier ministre reçoit ensuite son homologue français, Jean-Pierre Raffarin. Cette visite se fait dans le cadre des visites alternées de premiers ministres français et québécois, un précieux acquis diplomatique légué par René Lévesque et Raymond Barre. Très peu de nations cultivent des relations aussi suivies, a fortiori deux nations séparées par un océan. Or le gouvernement du Québec ne fait rien pour dissiper un dangereux glissement sémantique de la « visite au Canada » de Jean-Pierre Raffarin.
Après ces figures imposées prévues à l’agenda diplomatique, la première décision du gouvernement actuel est de tuer dans l’oeuf l’Observatoire québécois de la mondialisation, dont la création faisait consensus. Jean Charest avait pourtant déclaré, le 23 mai 2003, que « le Québec, comme la France, croit que la mondialisation doit être observée, comprise et balisée ». Dorénavant, c’est la France seule qui observera, comprendra et balisera. En effet, ironie du sort, la France envisage aujourd’hui de créer, sur le modèle québécois, un observatoire national des effets de la mondialisation, dont la création est proposée dans le rapport Lepeltier et auquel le premier ministre Jean-Pierre Raffarin s’est engagé à donner suite favorablement.
Recentrer l’action
Pour le gouvernement Charest, on doit recentrer son action sur les « vraies » affaires, les affaires internationales plutôt que les relations internationales, et sur le « vrai » partenaire, les États-Unis d’Amérique. Or, là aussi, c’est l’abdication. En novembre 2003, Monique Gagnon-Tremblay accepte sans broncher le fait que le Québec n’ait pas de représentation politique à Washington et se contente de son actuel « bureau du tourisme ». Elle abandonne ainsi une revendication chère à Robert Bourassa. C’est pourtant dans la capitale américaine que plusieurs décisions importantes se prennent et affectent les Québécois dans leur vie quotidienne. Le gouvernement ne se soucie guère davantage de l’ensemble des Amériques: l’incapacité de Michel Audet de présenter la position québécoise sur les négociations relatives à la ZLEA est symptomatique d’un manque de vision économique troublant.
Mais c’est la diplomatie culturelle de Line Beauchamp et de Monique Gagnon‑Tremblay qui aura été la grande déception de la rentrée d’automne. Que le gouvernement canadien s’attribue le mérite de la décision de la 32e session de la Conférence générale de l’UNESCO, qui lançait les négociations sur la diversité culturelle, c’est une chose. Et tant mieux si une convention voit le jour. Mais le fait d’avoir vu la ministre Line Beauchamp se faire bâillonner le 13 octobre dernier par la ministre du Patrimoine canadien, Sheila Copps, c’est inadmissible. Encore plus inadmissible lorsqu’on apprend que le discours du Québec est jugé « caduc » par l’ambassadeur du Canada à l’UNESCO, Louis Hamel. Dans la diversité culturelle, le Québec troque son rôle de pionnier dans la Francophonie pour celui de valet du Canada. Mais pour Monique Gagnon-Tremblay, se taire renforce la position du Québec. C’est ce qu’elle a affirmé à l’Assemblée nationale.
La diplomatie culturelle du Québec n’en était hélas pas à ses premiers reculs. À l’heure où le Centre culturel canadien fait flèche de tout bois à Paris, à l’heure où les artistes québécois et les gens d’affaires s’affirment de plus en plus dans le marché européen, l’abandon du projet du Centre Québec-Europe, en juin dernier, est un véritable geste d’automutilation non seulement culturel mais aussi économique. Jean Charest, dans l’opposition, avait pourtant qualifié le projet - qui devait héberger une librairie, une médiathèque, une salle de spectacles - de « très valable ».
L’événement « Voilà Québec en Mexico » s’avère un succès. Qu’à cela ne tienne: la fin des Saisons du Québec est confirmée par la ministre de la Culture et des Communications, Line Beauchamp. Les quelque 20 employés du Bureau des événements seront sans emploi sous peu. Ce gouvernement croit que des événements tels les Saisons du Québec s’improvisent à la petite semaine. Hélas, la réalité est autre. La diplomatie politique, culturelle ou économique ne s’improvise pas. Les acquis diplomatiques, toujours fragiles, s’accumulent par sédimentation.
Au Québec, les gouvernements sont rarement élus ou défaits en fonction de leurs réalisations internationales. Personne ne se souviendra des voyages de Jean Charest à New York ou à Davos. Cela n’en rend pas moins pernicieuse l’abdication du gouvernement de Jean Charest sur la scène internationale au cours des derniers mois et l’affaiblissement de la diplomatie québécoise, qui s’inscrit dans une réingénierie qu’il faut dénoncer et contre laquelle il importe de lutter.
« Un avant-projet insatisfaisant et décevant » Daniel Turp Le Devoir (20 août 2004)
En juillet 2004, l’UNESCO a rendu compte des travaux entrepris au lendemain de l’adoption par sa conférence générale, le 17 octobre 2003, d’une résolution selon laquelle la question de la diversité culturelle devait faire l’objet d’une convention internationale. Ainsi, un avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques a été rendu public, accompagné d’un rapport préliminaire du directeur général de l’UNESCO ainsi que des rapports de trois réunions du groupe d’experts indépendants chargé de rédiger l’avant-projet.
Cet avant-projet sera maintenant examiné par un groupe d’experts gouvernementaux dont la première réunion aura lieu du 20 au 25 septembre 2004 au siège de l’UNESCO, à Paris. Il retiendra en outre l’attention lors de la réunion des ministres de la Culture de l’Organisation des États américains des 22 et 23 août à Mexico, à laquelle participeront les ministres Liza Frulla et Line Beauchamp.
Le texte de cet avant-projet est à la fois insatisfaisant et décevant. Il devrait susciter de vraies inquiétudes et donner lieu à des modifications [...].
La nécessité d’une préséance
Bien que l’avant-projet de convention reconnaisse le droit des États de se doter de politiques culturelles et de prendre des mesures visant à protéger et promouvoir la diversité culturelle sur leur territoire, il n’est pas du tout certain que cette reconnaissance suffise à assurer l’effectivité de ces mesures. Ce droit pourrait être battu en brèche en raison de la disposition portant sur la relation de la future convention avec les autres instruments internationaux que l’on retrouve à l’article 19 de l’avant-projet.
Cet article est d’ailleurs le seul à n’avoir pas fait l’objet d’un accord parmi les experts indépendants, et l’avant-projet en présente deux variantes.
Variante A
« 1. Rien, dans la présente convention, ne peut être interprété comme portant atteinte aux droits et obligations des États parties au titre de tout instrument international existant relatif aux droits de propriété intellectuelle auxquels ils sont partis.
2. Les dispositions de la présente convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour un État partie d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité des expressions culturelles ou constituait pour elle une sérieuse menace. »
Variante B
« Rien, dans la présente convention, ne modifie les droits et obligations des États parties au titre d’autres instruments internationaux existants. »
D’un libellé identique à l’article 22 de la Convention sur la diversité biologique, la variante A de l’article 19 est insatisfaisante. [...] Elle ne garantit aucunement la préséance de la future convention, d’autant que celle-ci est liée à l’existence de « sérieux dommages » et d’une « menace sérieuse » à la diversité des expressions culturelles.
En définitive, ce sont les droits et obligations découlant d’accords internationaux existants, et au premier chef d’accords commerciaux internationaux, qui auront préséance si on n’est pas en mesure de faire la preuve de sérieux dommages ou d’une sérieuse menace à la diversité des expressions culturelles. Ainsi, la préservation de la diversité culturelle ne sera assurée qui si l’État satisfait à un fardeau de preuve qui paraît démesuré et qui dépend du caractère « sérieux » des dommages et de la menace. [...]
La variante B de l’article, dont on sait qu’elle est d’inspiration américaine, est quant à elle inacceptable. Elle a pour conséquence de subordonner la future convention sur la diversité culturelle aux accords commerciaux internationaux, même dans le cas de sérieux dommages ou de menace sérieuse à la diversité culturelle.
La culture au rang constitutionnel
Si l’objectif est véritablement de protéger la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques contre une libéralisation du commerce des biens et services culturels, une préséance doit véritablement être donnée à la Convention sur la diversité culturelle. Une autre variante de l’article 19 doit être proposée, et il est suggéré de s’inspirer de l’article 103 de la Charte des Nations unies, qui confère une primauté de cette charte sur les autres traités internationaux.
Le libellé d’une variante C pourrait être le suivant: « En cas d’incompatibilité entre les obligations des États parties à la présente convention et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »
Bien qu’il faille reconnaître que la primauté de la Charte des Nations unies est en définitive fondée sur son caractère « constitutionnel » et que l’article 103 de celle-ci a une très vaste portée, l’obligation de promouvoir et de préserver une diversité culturelle, que l’alinéa 3 de l’avant-projet qualifie de patrimoine commun de l’humanité, mérite aussi de se faire attribuer un rang constitutionnel et justifie dès lors que la future convention prévale sur tout autre accord international, notamment sur les accords commerciaux internationaux.
Règlement des différends
Si une telle disposition est susceptible de conférer préséance à la future convention, elle ne suffira toutefois pas à assurer une application véritable de la convention. Des mécanismes de règlement des différends doivent être créés pour les fins d’une telle application.
À ce sujet, l’avant-projet de Convention sur la diversité culturelle est plus que décevant. Les mécanismes proposés sont d’une faiblesse inquiétante et souffrent notamment d’une comparaison avec les procédures pour résoudre les litiges commerciaux au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’alinéa premier de l’article 24 de l’avant-projet prévoit d’abord que les parties doivent régler leurs différends par voie de négociation. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, trois procédures de règlement des différends, de nature facultative, sont retenues dans l’avant-projet:
le recours aux bons offices ou la demande de la médiation d’un tiers;
une procédure arbitrale;
une procédure juridictionnelle devant la Cour internationale de justice.
Ces procédures sont facultatives dans la mesure où elles ne peuvent être déclenchées que « d’un commun accord » ou « à la demande conjointe » des parties. La seule procédure obligatoire de règlement des différends est la procédure de conciliation, mais aucune « décision » ne peut découler de cette procédure. Les parties ne s’engagent d’ailleurs qu’à examiner « de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la commission de conciliation ». De plus, aucun régime de sanctions n’est instauré.
On est loin des procédures de règlement des différends au sein de l’OMC. Celle-ci a adopté un « mémorandum d’accord sur le règlement des différends » et a institué un « organe de règlement des différends » qui peut être saisi à la demande d’une seule partie et qui confie à des groupes spéciaux le soin d’examiner les différends. Un organe d’appel peut traiter des appels portant sur les affaires soumises à ces groupes spéciaux.
Les groupes spéciaux et l’organe d’appel formulent des recommandations que l’organe de règlement des différends transforme en décisions, dont il assure la surveillance. Et pour assurer leur efficacité, l’OMC a institué un régime de sanctions fondé sur des règles voulant que la partie en défaut doive compenser l’État victime ou que cette dernière puisse suspendre des concessions à l’égard de la partie en défaut. [...]
Les experts gouvernementaux doivent refaire les devoirs des experts indépendants et proposer l’institution d’un organe de règlement des différends qui fera écho à celui qui a été créé dans le cadre de l’OMC. Ce nouvel organe pourrait s’avérer être un contrepoids utile à l’organe de règlement des différends de l’OMC, qui tend à s’arroger le pouvoir de décider d’affaires qui sont relatives au commerce mais qui ont également des incidences importantes en matière de biens et services culturels, comme l’a clairement démontré le dossier des périodiques au Canada.
En raison de l’importance des négociations qui vont se poursuivre sur la base de l’avant-projet, le gouvernement du Québec doit de son côté associer l’Assemblée nationale à toutes les étapes devant conduire à l’adoption de la Convention sur la diversité culturelle. Les ministres responsables des négociations devraient d’ailleurs présenter des rapports périodiques sur les négociations aux parlementaires et répondre à leurs questions. Lors de la rentrée parlementaire, je compte d’ailleurs demander à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale d’entreprendre, de sa propre initiative, une surveillance de ces négociations dont l’intérêt public est incontestable. [...]
« Un combat d’avant-garde » Daniel Turp La Presse (17 novembre 2004)
Je tiens à formuler une revendication qui me semble essentielle dans le contexte du débat sur la diversité culturelle et qui est d’autant plus pertinente que le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, Benoît Pelletier, paraît avoir reçu du premier ministre Jean Charest le mandat de négocier un accord bilatéral spécial avec Ottawa afin que le Québec puisse avoir un siège à l’UNESCO et y parler en son nom propre.
Je demande au gouvernement du Québec de réclamer, aux fins de véritablement participer aux efforts de promotion et de préservation de la diversité culturelle, un statut de membre associé de l’UNESCO. L’UNESCO admet en son sein non seulement des États membres, mais également des membres associés. Ainsi, le paragraphe II alinéa 3 de l’Acte constitutif de l’UNESCO prévoit que les « territoires ou groupes de territoires qui n’assument pas eux-mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures peuvent être admis comme membres associés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, si cette admission a été demandée, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures ».
Cette disposition peut être interprétée comme permettant au « territoire » du Québec d’être admis, avec l’autorisation du Canada, en qualité de membre associé de l’UNESCO. Le Québec pourrait être ainsi considéré comme un « territoire » au sens de ces articles, comme pourrait l’être également la Catalogne dont les dirigeants partagent d’ailleurs une telle interprétation et envisagent de revendiquer également pour la Catalogne le statut de membre associé de l’UNESCO.
Si le Québec devait acquérir le statut de membre associé, il pourrait ainsi avoir un véritable droit de participation aux travaux de l’UNESCO, et y détenir autant un droit de parole qu’un droit de vote. S’agissant de la diversité culturelle, la rédaction actuelle de l’avant-projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques ne permettrait toutefois pas au Québec, en sa nouvelle qualité de membre associé, de devenir partie à la future Convention, de participer aux travaux de l’Assemblée générale et du Comité intergouvernemental en cette qualité et de présenter de même la candidature d’un expert québécois au Groupe consultatif. Le Québec doit donc chercher à faire apporter une modification au paragraphe 25 alinéa 1 de l’avant-projet pour que celui-ci permette à la fois aux « États membres » et aux « membres associés » de l’UNESCO de ratifier, d’accepter ou d’approuver la Convention ou d’y adhérer.
Pour exercer, comme il l’a fait dans le passé, et comme il doit continuer de le faire, un véritable leadership en la matière, le Québec doit donc revendiquer et obtenir un statut de membre associé à l’UNESCO. Le gouvernement du Québec pourrait d’ailleurs rappeler au premier ministre du Canada, Paul Martin, qu’il a affirmé que, dans les négociations sur la diversité culturelle, il accepterait qu’un ministre du Québec soit à la table et que « ce serait un atout. » (L’Actualité, 15 avril 2004). Le Canada devrait donc accepter qu’un ministre soit également autour de la table de l’Assemblée générale des États parties et du Comité intergouvernemental de la future Convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles.
Le Québec doit pouvoir participer de façon directe aux travaux de la future convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques. Alors que les ministres fédéraux se querellent sur la question de savoir si le Québec peut parler au nom du Canada ou non, le gouvernement du Québec doit aujourd’hui revendiquer le droit de parler de sa propre voix à l’UNESCO et obtenir, à cette fin, le statut de Membre associé de cette institution spécialisée des Nations unies.
Bien que le Parti québécois demeure convaincu que seule l’indépendance nationale garantira au Québec le droit de participer de façon pleine et entière au débat sur la diversité culturelle et à l’ensemble des autres grands débats internationaux, il est disposé à soutenir le gouvernement du Québec dans ses efforts pour obtenir un statut de Membre associé à l’UNESCO et élargir ainsi, comme le proposait la Déclaration concernant la participation du Québec aux forums internationaux traitant d’éducation, de langue, culture et d’identité du 24 mars 1999, « la coalition des peuples, gouvernements et États qui appuient ce combat ».
Le Québec doit ainsi demeurer à l’avant-garde d’un combat qui vise à consacrer la diversité culturelle comme patrimoine commun de l’Humanité. Car il veut enrichir, à sa façon et par la culture québécoise, ce patrimoine commun de l’Humanité.
« Le sacrifice de l’autonomie internationale du Québec » Daniel Turp Le Devoir (9 mai 2006)
L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) signé à Québec le 5 mai 2006 a fait l’objet d’interprétations divergentes sur sa contribution à l’accroissement de l’autonomie internationale du Québec. Alors que le gouvernement du Québec est d’avis que l’accord du 5 mai 2006 va dans ce sens et qu’il constitue, à cet égard, un accord aussi « important » qu’« historique », l’opposition officielle est d’avis que l’accord se traduit par une participation minoritaire et diluée au sein de la délégation canadienne et que le Québec n’obtient pas une place à l’UNESCO, mais bien « une place au sein de la délégation canadienne présente à l’UNESCO ».
Une lecture des 15 articles de l’accord sur l’UNESCO ainsi qu’une comparaison de celui-ci avec les ententes et les pratiques qui s’appliquent dans la Francophonie, et auxquels on peut légitimement faire appel en raison de l’engagement du Parti conservateur du Canada d’« inviter le gouvernement du Québec à jouer un rôle à l’UNESCO selon des modalités analogues à sa participation à la Francophonie », permet de conclure que l’accord du 5 mai 2006 constitue non seulement un recul pour le Québec, mais un sacrifice de l’autonomie internationale du Québec dans des matières qui, comme l’éducation, la science et la culture, ressortissent à sa compétence constitutionnelle.
Une telle conclusion est notamment fondée sur le fait que, contrairement à ce qui se produit dans la Francophonie, le représentant du gouvernement du Québec devra travailler sous la « direction » d’un diplomate canadien et que le Québec ne se voit reconnaître qu’un droit de « compléter » la position canadienne.
Sous la « direction » d’un diplomate canadien
Une lecture attentive des articles des parties 1 et 2 de l’accord du 5 mai 2006 tend à révéler que le représentant du gouvernement du Québec ne jouira pas d’une véritable autonomie au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO dont il sera d’ailleurs « membre ». Même s’il se « rapportera » au ministère des Relations internationales du Québec, l’accord prévoit qu’il travaillera en étroite collaboration avec les agents de la délégation permanente et il rappelle que l’ambassadeur et délégué permanent du Canada auprès de l’UNESCO assure la « direction générale » de l’ensemble de la mission canadienne.
Cette référence à la mission canadienne semble une confirmation du fait que le représentant du gouvernement du Québec devra être intégré à la « mission canadienne » et que sa présence physique au sein de la mission canadienne est exigée. Et pour plus de certitude, et pour bien faire comprendre que le représentant du gouvernement du Québec ne jouit pas d’une véritable autonomie au sein de la délégation et de la mission, l’article 2.1 de l’accord relatif à l’UNESCO prévoit ceci: « Lors de ces travaux, réunions et conférences, tout représentant du gouvernement du Québec travaillera sous la direction générale du Chef de la délégation canadienne. »
Ainsi, la ligne hiérarchique est clairement délimitée, et le représentant du gouvernement du Québec est donc sous l’autorité du diplomate canadien qu’est l’ambassadeur et délégué permanent canadien auprès de l’UNESCO. Comme on l’a d’ailleurs fait remarquer, la désignation diplomatique de « conseiller » que le gouvernement du Canada consent à conférer au représentant du gouvernement du Québec, notamment aux fins de son accréditation auprès l’UNESCO, confirme le rang hiérarchique inférieur de la personne appelée à intervenir au nom du Québec.
À cet égard, il est intéressant de noter que l’accord ne prévoit pas que le représentant permanent désigné par le gouvernement du Québec doit obligatoirement être « accueilli » par le gouvernement du Canada, et il peut donc être interprété comme permettant au Canada d’imposer son veto sur la désignation de toute personne désignée par le Québec.
Un droit de « compléter » la position canadienne
Un autre accroc à l’autonomie internationale du Québec résulte du fait que le Québec ne pourra pas présenter de « position québécoise » à l’UNESCO. Ainsi, même s’il pourra faire valoir sa voix, l’article 2.3 est très clair sur le fait que cette voix sera mise au service de la « position canadienne ». Cet article se lit comme suit: « Lors de ces travaux, réunions et conférences, tout représentant du gouvernement du Québec aura droit d’intervenir pour compléter la position canadienne et faire valoir la voix du Québec. »
Ainsi, la voix du Québec sera mise au service de la position canadienne pour la « compléter » et il doit être compris que le droit d’intervenir ne saura être exercé que si la voix du Québec s’accorde avec celle du Canada et est susceptible de la compléter. En cas de désaccord, l’on doit donc comprendre que le Québec devra s’abstenir de faire valoir sa voix.
Une telle interprétation est confirmée par le fait que le gouvernement du Canada pourra, en conformité avec l’article 3.1 de l’accord, se comporter comme il l’entend à l’égard de « tout vote, toute résolution, toute négociation et tout projet d’instrument international élaborés sous l’égide de l’UNESCO » et qu’« en l’absence de consensus entre les gouvernements du Canada et du Québec, et sur demande de ce dernier, le gouvernement du Canada remettra une note explicative de sa décision au gouvernement du Québec ».
Si cet article ajoute que le Québec « décidera seul s’il entend assurer la mise en oeuvre des questions pour lesquelles il a la responsabilité », il demeure que le gouvernement du Québec reconnaît officiellement, pour la première fois dans l’histoire du Québec et en contradiction avec la doctrine Gérin-Lajoie, que le gouvernement du Canada puisse faire à l’égard d’un instrument international ressortissant de la compétence constitutionnelle du Québec un acte sans l’assentiment du gouvernement du Québec.
D’ailleurs, dans l’allocution qu’il prononçait à l’occasion de la signature de l’accord, le premier ministre du Québec a erré en laissant entendre que le gouvernement du Canada reconnaissait dorénavant que le Québec devait donner « son assentiment avant que le Canada ne signe un traité ou un accord et se déclare lié par celui-ci ». Non seulement l’accord ne fait aucune mention de cette question et ne fait aucunement dépendre l’acceptation d’un instrument international adopté par l’UNESCO à l’assentiment du Québec, il reconnaît au contraire que, s’agissant du vote sur un tel instrument international, le Canada peut dorénavant arrêter sa position sans tenir compte des vues du Québec et sans obtenir son assentiment.
Dangereux précédent
L’accord Canada-Québec sur l’UNESCO est loin de conférer au Québec l’équivalent du statut de gouvernement participant qu’il détient dans la Francophonie et qui est d’ailleurs pleinement justifié dans des matières qui, comme la science, l’éducation et la culture, sont si importantes pour le développement du Québec. L’accord du 5 mai 2006 constitue tout au contraire un précédent dangereux qui pourra dorénavant être invoqué par le Canada pour régir la participation du Québec à toute organisation internationale aux travaux desquels le gouvernement du Québec souhaiterait participer.
Ainsi, le gouvernement Charest a-t-il sacrifié l’autonomie internationale du Québec sur l’autel d’un fédéralisme canadien qui ne saura véritablement satisfaire la quête d’une plus grande liberté pour le Québec.
Comme de nombreux Québécois, je demeure convaincu que le Québec ne pourra participer de façon pleine et entière à l’UNESCO et être libre de son destin international que s’il accède au statut de pays.
« Un an après son adoption — Pour une loi de mise en oeuvre de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions culturelles » Marie Malavoy et Daniel Turp Le Devoir (20 octobre 2006)
Il y a un an, jour pour jour, la Conférence générale de l’UNESCO adoptait, à 148 voix contre deux, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, laquelle entrera en vigueur après que 30 États l’auront ratifiée.
À ce jour, 13 États ont déposé leurs instruments de ratification, dont le Canada, pendant que huit autres ont mené à terme leurs processus de ratification selon leur droit national. Enfin, un même processus est en cours dans plusieurs autres pays, ce qui nous laisse croire que la convention pourrait entrer en vigueur avant la prochaine Conférence générale de l’UNESCO, prévue pour octobre 2007.
Le Québec a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de cette convention. Son avènement résulte d’une initiative du gouvernement du Québec, qui fut le premier à promouvoir l’adoption d’un instrument international contraignant en matière de diversité culturelle et qui se coalisa notamment avec la France pour plaider la cause de la diversité culturelle dans divers forums internationaux, notamment dans le cadre de la Francophonie.
La Coalition internationale pour la diversité culturelle, dont le siège se trouve à Québec et dont les principaux animateurs sont également québécois, a également participé activement à l’élaboration de la convention et contribué à son adoption par son démarchage auprès des gouvernements des États membres de l’UNESCO.
Après avoir effectué un suivi de la négociation au moyen d’un mandat d’initiative de sa Commission de la culture, l’Assemblée nationale du Québec a par ailleurs été le premier parlement national à approuver la convention.
Faire appliquer les dispositions
Si le Québec a assumé une importante responsabilité dans l’émergence de la convention et doit participer à l’effort visant à susciter le plus grand nombre de ratifications, il doit aujourd’hui veiller à sa mise en oeuvre et assurer l’application de ses dispositions sur son territoire. À cette fin, il doit non seulement adopter des mesures visant à protéger et à promouvoir sa propre culture nationale mais également s’efforcer, comme le prévoit la convention, de créer un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de son territoire ainsi que des autres pays du monde.
La convention prévoit de même qu’il doit favoriser et développer la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment au moyen de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public.
Le Québec doit également s’employer à renforcer sa coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles et s’engager de même à favoriser la coopération pour le développement en adoptant des mesures visant notamment le renforcement des industries culturelles des pays en développement par l’octroi d’une aide publique au développement, y compris une assistance technique destinée à stimuler et à soutenir la créativité.
Devant l’étendue de ses obligations et pour s’acquitter adéquatement de celles‑ci, l’adoption d’une loi de mise en oeuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles constituerait un geste audacieux démontrant la volonté du Québec de donner véritablement suite à ses engagements.
Cette loi viserait à offrir, d’une manière appropriée, des occasions aux activités, biens et services culturels nationaux de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur le territoire du Québec pour ce qui est de leurs création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits biens, services et activités.
Elle prévoirait en outre que les institutions nationales et les sociétés d’État, notamment le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), doivent protéger et promouvoir, par leurs activités et leurs programmes de soutien, la diversité des expressions culturelles.
Cette loi devrait également comporter des dispositions demandant aux institutions, et notamment aux institutions d’enseignement, d’établir des programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public à la diversité des expressions culturelles. Une telle loi pourrait contenir un grand volet international et confier au gouvernement la responsabilité de conclure une nouvelle génération d’ententes de coopération et de développement pour la diversité des expressions culturelles.
Mais tout n’y serait pas...
Dans le contexte fédératif canadien, les dispositions d’une telle loi ne pourront toutefois pas s’appliquer à l’ensemble des matières et des institutions, qu’il s’agisse du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle ou des institutions de radiodiffusion et de télédiffusion.
L’accession du Québec à la souveraineté sera l’occasion non seulement pour le gouvernement de réitérer l’engagement du Québec à l’égard de la Convention de l’UNESCO mais également pour son parlement d’étendre la portée de sa loi de mise en oeuvre à toutes les matières et à toutes les institutions du Québec susceptibles de contribuer à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
En adoptant la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles le 20 octobre 2005, l’UNESCO a démontré qu’elle était soucieuse, comme son acte constitutif l’y enjoint, d’assurer l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures.
Après avoir joué un rôle clef dans l’élaboration de la convention, il appartient aujourd’hui au Québec de donner à nouveau l’exemple et de faire d’autres gestes pionniers pour protéger et promouvoir non seulement sa culture nationale mais également les autres cultures du monde. Par ses décideurs et ses créateurs, par leurs politiques et leurs oeuvres, le Québec assurera aussi le respect de la diversité culturelle et participera à l’enrichissement du patrimoine culturel de l’humanité.
« TV5 Monde : non à la France! » Pierre Curzi et Daniel Turp Le Soleil (30 janvier 2008)
Si le droit de la France de refonder son dispositif audiovisuel extérieur est incontestable et qu’il y a même lieu de saluer la volonté de porter une présence plus massive de la France dans le monde, la volonté de son gouvernement d’inclure TV5 Monde au sein du dispositif réformé est inacceptable. Le Parti québécois, dont le gouvernement fut à l’origine du partenariat unique et innovateur que fut TV5 au moment de sa création en 1984, s’oppose à toute tentative de placer TV5 Monde sous la gouverne d’un futur holding France-Monde et de modifier la vocation multilatérale d’un opérateur de la Francophonie qui contribue au rayonnement de la langue française et des expressions culturelles des États et nations de la Francophonie. Le Parti québécois dit non à la mainmise de la France sur TV5 Monde.
Nous tenons ainsi à ajouter notre voix à la voix énergique de la ministre de la Culture de la Communauté française de Belgique, qui a affirmé que sa communauté « ne paierait pas pour un outil de rayonnement franco-français », et le directeur de la Télévision suisse romande, qui a déclaré que, « si la dimension multilatérale de TV5 n’est pas garantie, nous n’avons pas vocation à y rester ». Nous nous élevons aussi, comme le secrétaire général de la Francophonie, Abou Diouf, contre un projet qui aurait comme résultat concret de faire de TV5 Monde une « filiale » de la future France‑Monde.
À la préservation de ce caractère multilatéral et francophone doit également s’ajouter une détermination d’assurer l’indépendance éditoriale de TV5-Monde. Le projet de la France de mutualiser les moyens de production des rédactions des chaînes françaises, autour d’un news room unique permettant une production centralisée et coordonnée de l’information, et de créer un pôle unique de production pour alimenter l’ensemble des antennes, en faisant notamment appel à des journalistes de TV5, n’est guère rassurant à cet égard.
Nous exigeons dès lors du gouvernement du Québec une position plus ferme dans ce dossier. Il ne suffit pas d’être « préoccupé », comme a dit l’être le premier ministre du Québec au premier ministre français, ou d’affirmer mollement, comme l’a fait la ministre de la Culture et des Communications du Québec, qu’on est prêts pour moderniser (TV5) « et qu’on pense que ça ne peut être la voix française; c’est une voix francophone ». Il y a lieu d’envoyer à la France un message clair : le Québec récuse toute prise de contrôle de la France sur TV5 Monde et fait front commun avec ses partenaires pour préserver le caractère multilatéral de la chaîne télévisuelle internationale de la Francophonie.
Il est par ailleurs étonnant d’observer le mutisme du gouvernement du Canada dans ce dossier et l’absence de toute résistance à une prise de contrôle de TV5 Monde par la France. Cette prise de contrôle est ainsi susceptible de menacer la présence de Radio-Canada dans l’univers télévisuel international et de marginaliser les contenus radio-canadiens sur TV5 Monde. Le silence du gouvernement canadien laisse songeur.
« Un avenir et une Francophonie en partage » Patrick Bloche et Daniel Turp Le Devoir (3 juillet 2008)
En ce 3 juillet 2008, le Québec et la France célèbrent le 400e anniversaire de fondation de Québec. Cette célébration est aussi celle de la naissance d’une Nouvelle‑France dont le Québec assure aujourd’hui, quatre siècles plus tard, la succession en terre d’Amérique.
Cette succession a pu être assumée en raison d’une lutte d’émancipation nationale qui n’a jamais cessé depuis le jour où Samuel de Champlain a dirigé les premières institutions politiques créées pour gouverner la Nouvelle-France. L’histoire nationale du Québec est ponctuée de gestes qui non seulement ont contribué à la pérennité de l’identité française en Amérique mais ont permis le développement d’une nation francophone moderne sur le continent des Amériques.
Par leur résistance pacifique en des lendemains de Conquête, la Rébellion des Patriotes et la lutte pour le gouvernement responsable, la renaissance de leurs institutions au lendemain du pacte fédératif de 1867, les transformations issues de la Révolution tranquille et les tentatives, toujours inachevées, de définition du statut politique de leur nation, les descendants des Français et les personnes qui ont choisi le Québec comme terre d’adoption ont façonné un État moderne.
Le devoir d’accompagner le Québec
La France a accompagné l’État du Québec durant ce parcours. La nation française a le devoir d’accompagner la nation québécoise dans ses choix, y compris le choix que les Québécois pourraient faire d’accéder à la souveraineté politique. La France a d’ailleurs contribué à l’émergence d’une nation québécoise, libre de ses choix, qui entretient avec la nation française une relation unique.
Enracinée dans une histoire partagée et façonnée par une langue commune, cette relation est directe et privilégiée en raison de la volonté de la France et de ses chefs d’État et de gouvernement successifs de conférer un tel caractère à cette relation. Cette relation a notamment permis au Québec de prolonger sur la scène internationale ses compétences.
L’ouverture de la délégation générale du Québec à Paris, la conclusion entre le Québec et la France d’engagements internationaux en matière d’éducation et de culture et l’obtention par le Québec, avec l’appui de la France, d’un statut de gouvernement membre au sein de la Francophonie sont des gestes qui ont assuré au Québec une personnalité internationale.
Cette personnalité s’est d’ailleurs façonnée en dépit des objections répétées du gouvernement du Canada à l’égard des propositions visant à doter le Québec d’un statut et d’une voix distincts au sein de la communauté francophone. L’acquisition d’une authentique capacité internationale par le Québec a ainsi résulté de stratégies communes caractérisées par la persévérance du Québec et le soutien durable de la France.
Kyoto
De telles stratégies communes doivent pouvoir être utilisées à nouveau dans l’avenir et les autorités françaises doivent être conscientes que leurs intérêts continueront d’être bien servis par une politique et un discours permettant au Québec et à la France de faire front commun dans plusieurs dossiers d’intérêt. Ainsi, pour prendre un exemple d’actualité, le Québec et la France partagent une volonté d’assurer l’application effective du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de poursuivre la lutte contre les changements climatiques par l’adoption d’un protocole de Kyoto II en 2012.
Sur cette question, les intérêts du Québec et de la France convergent, alors que le Canada s’est plutôt aligné sur la position des États-Unis d’Amérique, qui cherchent à priver le protocole de Kyoto de ses effets. Sans vouloir antagoniser le Canada, la France devrait continuer de pouvoir appuyer la différence québécoise, d’autant qu’il s’agit d’une différence avec laquelle elle est en accord.
Des chantiers pour la Francophonie
En ce jour où s’ouvrent par ailleurs les travaux de la XXIVe session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Québec, il importe d’affirmer que c’est également au sein de la Francophonie que le Québec et la France ont un avenir en partage. L’avenir de la Francophonie multilatérale elle-même repose sur les deux grandes nations francophones du monde et c’est sur ces nations que cette Francophonie peut s’appuyer pour prendre l’élan dont elle a besoin aujourd’hui.
Le Québec et la France ont pris des initiatives qui, comme celle ayant mené à l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la promotion et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ont consolidé la place de la Francophonie dans le dialogue mondial des cultures.
Le Québec et la France doivent aujourd’hui lancer d’autres projets pour que la Francophonie assume un leadership dans ce dialogue et se dote d’outils pour faire face aux défis de ce siècle. Dans cette perspective, la Francophonie pourrait ouvrir de nouveaux chantiers et s’engager à adopter des mesures visant notamment à promouvoir l’adoption d’une convention sur la diversité linguistique aux fins d’assurer la pérennité des langues qui fondent la diversité des expressions culturelles et envisager la création d’une RADIO 5 Monde dotant la Francophonie d’un service public multilatéral de radiodiffusion.
Il importerait également de renforcer le dispositif visant à protéger et à promouvoir la démocratie, les droits et libertés et de prendre des mesures pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays de la Francophonie. De plus, la création d’un opérateur de la Francophonie dans le domaine de l’éducation mériterait d’être envisagé et celui-ci pourrait définir un projet éducatif destiné à favoriser l’égalité des chances aux citoyens et citoyennes de la Francophonie.
Une relation à solidifier
Faisant fond sur les doctrines qui ont été développées par leurs chefs d’État et de gouvernement depuis près de 50 ans maintenant, la relation directe et privilégiée entre le Québec et la France doit être consolidée et renforcée. Ayant un avenir en partage, l’État québécois et l’État français doivent dès lors collaborer de façon encore plus étroite et fonder leurs relations bilatérales sur de nouvelles positions, actions et stratégies communes.
Le Québec et la France doivent de même s’efforcer de donner un nouveau souffle à la Francophonie multilatérale et s’engager à ouvrir de nouveaux chantiers pour une organisation dont ils ont aussi l’avenir en partage.
« Statut d’autonomie de la Catalogne — Un ordre constitutionnel imposé, comme au Québec » Daniel Turp Le Devoir (16 juillet 2010)
Dans une sentence prononcée le 28 juin 2010 et après un délai de quatre ans, qui est inconcevable dans un État de droit qui se respecte, le Tribunal constitutionnel espagnol statuait sur un recours en inconstitutionnalité de la loi organique 6/2006, du 19 juillet, concernant la réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne dont il avait été saisi le 31 juillet 2006 par 99 députés du Parti populaire (PP).
Ce recours avait été pris quelques semaines à peine après l’approbation du statut par la voie d’un référendum tenu en Catalogne le 18 juin 2006 et à l’occasion duquel le OUI l’avait emporté avec 73,9 % des suffrages exprimés. Le Statut ainsi approuvé avait auparavant fait l’objet d’un vote favorable, tant au Parlement catalan qu’au Parlement espagnol.
Dans sa sentence à laquelle sont jointes les opinions individuelles de cinq des dix juges du tribunal, le Tribunal déclare d’abord que les références à la « Catalogne comme nation » et à « la réalité nationale de la Catalogne » contenues dans le préambule du Statut d’autonomie n’ont aucun effet juridique interprétatif. Le tribunal déclare ensuite 14 dispositions du Statut d’autonomie inconstitutionnelles, et donc, nulles.
Catalan
Parmi les dispositions qui sont ainsi privées d’effet, on note celle qui prévoit que « le catalan est la langue utilisée “de préférence” par les administrations publiques et les médias publics de Catalogne ». La volonté de la Catalogne d’administrer la justice sur son propre territoire est freinée par le Tribunal constitutionnel espagnol, qui annule certaines dispositions du Statut conférant des pouvoirs au Conseil de justice de Catalogne. Plusieurs dispositions du Statut relatives aux compétences économiques sont également déclarées inconstitutionnelles, comme le sont des compétences fiscales, et notamment « la capacité législative d’établir et de réguler les impôts propres des gouvernements locaux ».
Tout en ne déclarant pas inconstitutionnelles 24 autres dispositions du Statut d’autonomie, le Tribunal précise que leur constitutionnalité n’est assurée que dans la mesure où elles sont interprétées en conformité avec les principes juridiques (« fundamento juridico ») énoncés par le Tribunal. Parmi les dispositions dont la « précarité » constitutionnelle saute aux yeux, l’on compte celle qui enchâsse les « droits historiques du peuple catalan » et vise « la reconnaissance d’une position particulière de la Generalitat en ce qui concerne le droit civil, la langue, la culture, ainsi que la projection de celles-ci dans le domaine de l’éducation et le système institutionnel dans lequel est organisée la Generalitat ».
L’article du Statut d’autonomie proclamant que « [l]e catalan est la langue officielle de la Catalogne » est également assujetti, selon le Tribunal constitutionnel, aux principes juridiques énoncés par celui-ci, comme l’est également la disposition qui prévoit que « [l]a Catalogne, définie en tant que nationalité à l’article 1, a comme symboles nationaux le drapeau, la fête et l’hymne ». Plusieurs droits et devoirs linguistiques énoncés dans le Statut sont de même susceptibles d’être limités dans leur portée par le Tribunal, qui les assujettit au respect de sa jurisprudence constitutionnelle.
Influence
Cette jurisprudence et les principes juridiques qu’elle a engendrés pourraient exercer, comme l’énonce le Tribunal, une influence sur l’interprétation de plusieurs autres dispositions du Statut d’autonomie, qu’il s’agisse de celles qui concernent le gouvernement local et le régime juridique des régions, l’exercice des compétences partagées et exécutives, et en particulier celles dans des domaines aussi névralgiques pour l’identité catalane que la culture, le droit civil et l’immigration, mais également les finances de la Generalitat (l’organisation politique de la Catalogne).
S’agissant de l’article 122 du Statut d’autonomie, selon lequel « la Generalitat a une compétence exclusive pour établir le régime juridique, les modalités, la procédure, la réalisation et la convocation, par la Generalitat elle-même ou par les entités locales, dans le domaine de leurs compétences, d’enquêtes, d’audiences publiques, de forums de participation et de tout autre instrument de consultation populaire, exception faite de ce qui est prévu à l’article 149.1.32 de la Constitution », le Tribunal a affirmé qu’il n’était pas inconstitutionnel.
Mais, dans son opinion individuelle, le juge Jorge Rodriguez-Zapata Perez ne semble pas hésiter à affirmer l’inconstitutionnalité de cette disposition du fait qu’elle confère à la Generalitat une compétence exclusive pour la convocation de consultations populaires. Il cite d’ailleurs à cet égard la loi 4/2010, du 17 mars, sur les consultations populaires par voie de référendum adoptée par le Parlement de Catalogne qui, selon lui, enfreint les compétences de l’État espagnol en la matière.
Mauvaise réception
La sentence du 28 juin 2010 n’a pas été bien accueillie en Catalogne, comme en fait foi la manifestation du 10 juillet 2010 qui a rassemblé à Barcelone plus d’un million de Catalans. Ce non massif à la sentence du Tribunal constitutionnel espagnol devrait avoir un effet déterminant sur les relations entre la Catalogne et l’État espagnol, et notamment sur la suite du processus de consultation sur l’indépendance organisée par la société civile dans les diverses municipalités catalanes, ainsi que la prochaine élection générale en Catalogne, prévue pour l’automne 2010.
Comme pour bien d’autres aspects de leur vie nationale respective, la situation de la Catalogne et celle du Québec présentent d’étonnantes analogies. Ainsi la nation québécoise s’est-elle fait imposer, avec l’aval de la Cour suprême du Canada, un nouvel ordre constitutionnel par la proclamation, sans son consentement, de la Loi constitutionnelle de 1982. Aujourd’hui, c’est la Catalogne qui se voit imposer, en dépit d’un Statut d’autonomie qui a été approuvé par son peuple à l’occasion d’un référendum, un ordre constitutionnel par dix juges qui récusent ainsi la souveraineté populaire.
On comprend dès lors que les Catalans aient choisi de dire haut et fort le 10 juillet dernier, en réponse à la sentence du 28 juin 2010: « Nous sommes une nation. Nous décidons pour nous-mêmes. » Le droit pour la nation catalane de choisir son statut politique est appelé à devenir un enjeu majeur dans les prochains mois, et il est à espérer que l’État espagnol, comme en a finalement pris acte l’État canadien, comprendra que dans une véritable démocratie, ce droit collectif est fondamental.
« L’avis sur le Kosovo fait avancer la souveraineté » Daniel Turp La Presse (31 juillet 2010)
Depuis la formulation par la Cour internationale de justice (CIJ) d’un avis sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo le 22 juillet dernier, plusieurs opinions ont été exprimées sur la portée de cet avis, et notamment sur les enseignements qui peuvent en être tirés pour le Québec.
Ce qu’illustre vraiment l’avis de la CIJ sur le Kosovo, c’est non pas, comme l’a prétendu dans ces pages l’instigateur de la Loi sur la clarté, le député Stéphane Dion, qu’il est « difficile d’obtenir la reconnaissance internationale dans le cadre d’une sécession unilatérale » (il n’est d’ailleurs aucunement question d’obtention de reconnaissance dans l’avis), mais plutôt le fait que les juges ont refusé de faire dire au droit ce qu’un État, en l’occurrence la Serbie, voulait lui faire dire pour contrer la volonté du Kosovo d’accéder à la souveraineté et à l’indépendance.
Ainsi, en refusant de dire qu’une déclaration d’indépendance unilatérale était contraire au droit international général et en précisant que la pratique, à la fois des États et du Conseil de sécurité des Nations unies, ne révélait aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance, la Cour internationale de justice a refusé à l’État « parent » serbe un argument d’autorité fondé sur le droit. L’attitude de la CIJ n’a pas été très différente en cela de celle de la Cour suprême du Canada qui avait non seulement omis de répondre par oui ou non aux deux questions l’invitant à nier le droit de sécession du Québec, mais avait plutôt affirmé que le Québec détenait, sur la base de principes constitutionnels, « le droit de chercher à réaliser la sécession ». « L’arroseur arrosé », pourrait-on affirmer à l’égard de la Serbie et du Canada qui croyaient, à tort, que les tribunaux conforteraient leurs arguments et qui, au contraire, les ont réfutés.
Pas très loin du Kosovo
Dans cette perspective, l’avis de la Cour internationale de justice fait avancer la cause de ceux et celles qui plaident, aux quatre coins du monde, pour que les nations puissant choisir librement leur statut politique et accéder, si telle est leur volonté, à la souveraineté et à l’indépendance. Une telle volonté doit être exprimée par les nations et leurs institutions et ne devrait d’ailleurs pas être assujettie à celle de l’État « parent ». C’est pourtant là l’objet inavoué de l’inique Loi sur la clarté adoptée à l’encontre de la volonté de majorité des députés québécois de la Chambre des communes et que tous les partis politiques du Québec ont récusée.
La volonté des peuples d’accéder à la souveraineté et à l’indépendance résulte souvent, et généralement, du refus pour les États souverains de donner suite à des demandes légitimes d’autonomie politique et de respect des identités nationales en leur sein. En ce sens, mais avec les distinctions qui s’imposent et les exactions en moins, le Québec n’est pas très loin du Kosovo.
Le Canada refuse non seulement de satisfaire les attentes constitutionnelles du Québec, mais il continue de porter atteinte à son autonomie en réclamant des compétences exclusives dans le domaine des valeurs mobilières et en exerçant un pouvoir de dépenser dans plusieurs matières d’importance fondamentale pour la nation québécoise. C’est la raison pour laquelle le combat pour l’indépendance nationale du Québec continue pour que le Québec puisse accéder au statut d’État souverain et ainsi agir en toute liberté.
« Environnement —Pour une signature symbolique du Protocole de Kyoto par les Québécois et les Québécoises de toutes les générations » Daniel Turp Le Devoir (4 janvier 2012)
Par la voix de son ministre de l’Environnement, le gouvernement du Canada a annoncé, le 12 décembre 2011, qu’il avait l’intention de dénoncer le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et il l’a fait en ces termes: « Comme nous l’avons déclaré, Kyoto est chose du passé pour le Canada. À ce titre, nous invoquons notre droit reconnu par la loi de nous retirer officiellement de Kyoto. Cette décision officialise ce que nous avons affirmé depuis 2006, à savoir que nous ne mettrons pas en oeuvre le Protocole de Kyoto. »
Le Québec, son gouvernement et son parlement n’ont jamais considéré que le Protocole était chose du passé. Non seulement le Québec a toujours été d’avis que le Protocole de Kyoto était, pour reprendre les mots qu’a prononcés le premier ministre Jean Charest lors de la Conférence de Montréal de 2006, « ce que nous avons de mieux pour combattre le réchauffement climatique », mais il considère aussi que ce traité est un engagement international important du Québec.
Ainsi, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales, l’Assemblée nationale du Québec a-t-elle approuvé le Protocole de Kyoto en adoptant à cette fin une motion, et ce, à l’unanimité (92 voix pour, 0 contre), le 28 novembre 2006. Après cette approbation, le gouvernement du Québec s’est quant à lui déclaré lié par le Protocole de Kyoto en adoptant un décret le 5 décembre 2007.
L’Assemblée nationale du Québec et le gouvernement du Québec ne sauraient dès lors accepter que le Canada dénonce un engagement international que le Québec considère comme important, que son Assemblée nationale a approuvé et à l’égard duquel le gouvernement du Québec s’est déclaré lié.
Des compétences du Québec
Une intervention du Québec se justifie d’autant plus que cet accord international du Canada ressortit, en grande partie, des compétences du Québec et que sa mise en oeuvre relève des compétences de l’État du Québec. Cette voix doit s’exprimer formellement en raison du fait que la procédure d’approbation et d’assentiment prévu dans la Loi sur le ministère des Relations internationales s’applique aussi à la dénonciation d’un accord international du Canada que le Québec considère comme un engagement international important.
Ainsi, l’Assemblée nationale du Québec doit exercer son pouvoir d’approuver ou de ne pas approuver la dénonciation du Canada. Si elle désapprouve cette dénonciation, comme nous le souhaitons, le gouvernement du Québec devra réaffirmer qu’il se considère encore comme lié, quant à lui, au Protocole de Kyoto et qu’il vise toujours à réduire ses émissions de ces gaz d’au moins 5 %, par rapport au niveau de 1990, au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012.
L’Assemblée nationale tout entière devrait être associée à la défense du Protocole de Kyoto et convoquée, et elle devrait pouvoir réitérer son appui à cet engagement international important du Québec. Cette démarche démontrerait à la communauté internationale des États dans son ensemble que le Québec entend préserver le système climatique dans l’intérêt des générations futures et continuer d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques.
L’ensemble des Québécois et Québécoises devraient aussi participer à cette défense du Protocole de Kyoto. Je propose dès lors d’ouvrir à la signature des Québécois et des Québécoises de toutes générations cet engagement international important, pour rappeler que le peuple du Québec, comme son parlement et son gouvernement, appuie le Protocole de Kyoto, l’approuve et veut que le gouvernement du Québec continue d’être lié par celui-ci. Les personnes désireuses de signer le Protocole de Kyoto pourront le faire en se rendant à l’adresse http://danielturpqc.org/protocoledekyoto.php.
La dénonciation par le Canada du Protocole de Kyoto offre au Québec une belle occasion d’affirmer sa personnalité internationale et d’indiquer que le Québec ne doit pas faire les frais du désaveu, par la communauté internationale, de la position du Canada auquel on assiste au lendemain de la Conférence de Durban.
« Protocole de Kyoto — Le Canada fait fi du droit et de la démocratie » Daniel Turp Le Devoir (17 janvier 2012)
Le 15 décembre dernier, le gouvernement du Canada a transmis une notification de dénonciation du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques au Secrétaire général des Nations unies. Cette dénonciation, qui ne peut prendre effet que le 15 décembre 2012, placerait le Canada en marge des 191 autres États et de l’Union européenne qui sont liés par ledit protocole et l’amènerait à rejoindre les États-Unis d’Amérique, seul État développé à n’être jamais devenu partie au protocole.
Nous sommes persuadés que la dénonciation du Canada est illégale, et un avis de demande de contrôle judiciaire de la légalité de cette dénonciation a été déposé par Me Julius Grey le vendredi 13 janvier 2012 devant la Cour fédérale du Canada. Cette décision enfreint selon nous la Loi de mise en oeuvre du protocole de Kyoto adoptée par le Parlement du Canada et sanctionnée le 22 juin 2007. Elle viole également les principes de la primauté du droit, de la séparation des pouvoirs et de la démocratie. Nous demandons à la Cour fédérale du Canada de déclarer que cette dénonciation est sans effet.
Les engagements juridiques du Canada
L’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en mars 1994 illustre la volonté de la communauté internationale de s’attaquer au problème des changements climatiques et, plus précisément, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a été adopté trois ans plus tard en décembre 1997 pour concrétiser les engagements des parties à la convention-cadre.
À l’initiative du gouvernement du Canada, la Chambre des communes a adopté le 10 décembre 2002 une motion demandant au gouvernement de ratifier le protocole de Kyoto. Le gouvernement a donné suite à cette demande et dépose un instrument de ratification aux Nations unies le 17 décembre 2002. Le Canada s’est ainsi engagé ainsi à réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 6 % par rapport au niveau de 1990 pour les années 2008 à 2012. Le protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005 et a commencé à produire à compter de cette date ses effets juridiques à l’égard du Canada.
Reconnaissant l’importance de ses obligations internationales, le Parlement du Canada a adopté en 2007 la Loi de mise en oeuvre du protocole de Kyoto dont l’objet est d’assurer la prise de mesures efficaces et rapides par le Canada afin qu’il honore ses engagements dans le cadre du protocole de Kyoto et aide à combattre le problème des changements climatiques mondiaux. L’article 7 de cette loi stipule en outre que « le gouverneur en conseil [doit] veille[r] à ce que le Canada honore les engagements pris en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto ».
La dénonciation illégale du Canada
La dénonciation par le Canada du protocole de Kyoto expose clairement l’intention du gouvernement de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis du protocole. Il s’agit d’une violation de l’article 7 de la Loi de mise en oeuvre du protocole de Kyoto l’obligeant à honorer en tout temps les obligations prises dans le cadre du protocole. Par le dépôt de cet instrument, le gouvernement du Canada a enfreint une loi adoptée par le Parlement du Canada qui est toujours en vigueur.
En vertu du principe de la primauté du droit, le gouvernement du Canada doit se soumettre aux lois en vigueur au même titre que toutes les personnes morales et physiques évoluant sur le territoire canadien. La Loi de mise en oeuvre du protocole de Kyoto n’ayant pas été abrogée au moment de la dénonciation le 15 décembre dernier, le gouvernement fait fi de ce principe constitutionnel fondamental.
Par ailleurs, le principe de la séparation des pouvoirs enchâssé dans la Constitution du Canada implique que seul le Parlement puisse abroger une loi. Bien que le gouvernement jouisse de la prérogative royale dans le domaine des affaires étrangères, la dénonciation du protocole de Kyoto par le pouvoir exécutif n’entraîne pas une abrogation implicite de la loi. Cette dénonciation viole ainsi un autre principe constitutionnel fondamental qu’est la séparation des pouvoirs.
À la lumière du fait que la Chambre des communes a été consultée avant que le Canada ne procède à la ratification du protocole de Kyoto, nous sommes également d’avis que le principe démocratique impose au gouvernement du Canada l’obligation constitutionnelle de consulter à nouveau cette instance parlementaire avant de mettre fin au traité. En l’absence d’une telle consultation, nous considérons que le gouvernement du Canada a agi en toute illégalité en violant le principe démocratique.
Des appuis à la démarche judiciaire
Plusieurs organismes et regroupements, dont l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, nous ont déjà témoigné leur soutien. Nous lançons une invitation à toutes les organisations ainsi qu’à toute personne qui souhaite soutenir notre démarche (www.facebook.com/equipekyoto).
Par notre geste, nous souhaitons contribuer à une mobilisation contre la dénonciation par le gouvernement du Canada du protocole de Kyoto. Il nous apparaît évident que le gouvernement a posé un acte qui va à l’encontre des préoccupations environnementales des citoyens du Québec, du Canada et du monde, et notamment à l’égard des changements climatiques. Mais la dénonciation est aussi contraire à la loi et à plusieurs principes constitutionnels fondamentaux qui ne sauraient être transgressés dans un véritable État de droit.
« Protocole de Kyoto —Le Canada a déjà engagé sa responsabilité internationale » Geneviève Dufour et Daniel Turp Le Devoir (22 février 2012)
Le 15 décembre 2011, le Canada a dénoncé le Protocole de Kyoto. Cette décision a fait couler beaucoup d’encre, ici comme ailleurs dans le monde. Si cette dénonciation porte considérablement atteinte à la réputation du Canada et qu’il est tout à fait juste de s’insurger contre une position aussi indéfendable, elle ne produira, si elle est maintenue, à peu près pas d’effets juridiques.
En effet, tel que prévu par le Protocole, un État peut se retirer à condition de notifier sa décision un an à l’avance. C’est donc dire que le retrait du Canada ne prendra effet que le 15 décembre 2012. En conséquence, le Canada ne sera libéré de ses obligations découlant du Protocole de Kyoto que seulement 15 jours avant l’échéance fixée pour atteindre l’objectif de 6 %.
Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005. Il impose aux États l’ayant accepté de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 en dessous d’un certain seuil par rapport à ceux émis en 1990. Le Canada s’est engagé à les réduire de 6 % durant cette période. Or, on le sait, loin d’avoir atteint cet objectif, le Canada a plutôt augmenté ses émissions de gaz à effet de serre.
Le ministre de l’Environnement, Peter Kent, a fondé la décision du Canada sur des considérations d’ordre financier. Le Canada devrait agir ainsi pour éviter d’avoir à payer une amende de plusieurs milliards de dollars. Cette explication est non seulement fondée sur une fausse prémisse, du fait que le Protocole n’impose pas de sanction monétaire, mais elle est insuffisante, puisque le retrait du Protocole à deux semaines de l’échéance n’empêche pas de conclure à une violation par le Canada de ses obligations internationales.
En effet, on peut se demander si par son retrait, le Canada n’aurait aucun compte à rendre quant à ses agissements des dernières années. Et si ce retrait pourrait le libérer de l’obligation de réduction qu’il devait assumer entre le 1er janvier 2008 et le 15 décembre 2012. La réponse est simple: aucunement. En fait, ce retrait ne pourrait faire oublier l’inaction canadienne dans le domaine de la protection de l’environnement. Le Canada avait l’obligation, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en février 2005, de tout mettre en oeuvre pour atteindre sa cible au 31 décembre 2012. Qui plus est, il a encore cette obligation, et ce, jusqu’au 15 décembre 2012. Sa dénonciation et son retrait du Protocole ne modifient en rien cette obligation.
La violation des obligations
L’annonce de l’intention du Canada de se retirer du Protocole de Kyoto a attiré l’attention sur l’inaction du Canada au regard de ses obligations découlant du protocole. Une inaction qui se traduit rétrospectivement comme une série d’omissions et qui n’est rien de moins, en termes juridiques, qu’une violation continue d’une obligation internationale claire et consentie.
On peut donc soutenir que le Canada, par ses omissions multiples et continues, a commis et commet encore aujourd’hui un fait composite, illicite dans son ensemble, engageant la responsabilité internationale du Canada. Le Protocole impose bien une obligation à exécution successive, en opposition à une obligation instantanée, et en conséquence, il avait et a encore l’obligation de tout faire pour atteindre sa cible.
L’annonce du retrait du 15 décembre prochain ne modifie en rien son obligation de tendre vers une diminution. Certes, le Canada a adopté des plans d’action desquels ont découlé quelques mesures concrètes. Il n’en demeure pas moins que le Canada n’a pas fait assez ni assez bien dans les dernières années, puisque ses taux d’émissions ont augmenté au lieu de diminuer. Et il le savait. Il n’en demeure pas moins, non plus, que le Canada ne fait pas le nécessaire en ce moment, alors qu’il est toujours tenu de respecter son engagement. Conclure autrement donnerait au retrait un caractère rétroactif et irait à l’encontre du but du Protocole ainsi qu’au principe de bonne foi dans les relations internationales.
Il est difficile de prévoir si le Canada aura à réellement répondre de ses actes. Une décision relative aux sanctions applicables à l’égard des États ne respectant pas leurs obligations découlant du Protocole de Kyoto a été adoptée à Marrakech en 2001, mais son caractère obligatoire fait encore l’objet de dissensions parmi les États. Quant à une éventuelle poursuite devant la Cour internationale de justice, pourtant compétente en l’espèce, encore faudrait-il qu’un pays décide d’entamer une poursuite contre le Canada.
En 2002, lorsque le Canada a ratifié le Protocole de Kyoto, le ministre de l’Environnement de l’époque faisait allusion avec fierté au « désir du peuple canadien de participer à l’effort mondial » contre les changements climatiques. On peut se demander si le projet de retrait du Protocole répond cette fois-ci réellement à un désir du peuple!
« Le droit de décider et le principe démocratique » Daniel Turp Le Devoir (5 novembre 2014)
Depuis l’élection du 25 novembre 2012 et la formation d’un Parlement composé majoritairement de députés favorables à l’indépendance, le peuple catalan vit avec l’espoir de se prononcer sur son avenir politique. Un tel espoir repose aussi sur l’adoption par le même Parlement catalan le 23 janvier 2013 d’une résolution appuyée par 83 de ses 135 députés affirmant notamment que « [c]onformément à la volonté démocratiquement exprimée par la majorité du peuple de Catalogne, le Parlement de Catalogne convient d’engager le processus visant à exercer le droit de décision [dret a decidir] afin que les citoyens de Catalogne puissent décider de leur avenir politique collectif ». La résolution ajoutait : « Le Parlement de Catalogne encourage l’ensemble des citoyennes et des citoyens à prendre une part active dans le processus démocratique d’exercice du droit de décision du peuple de Catalogne. »
En application de cette résolution, le Parlement et le gouvernement de Catalogne ont progressivement mis en place les instruments visant à favoriser la participation dans ce processus et permettre l’exercice du droit de décider. Ainsi, la commission d’étude sur le droit de décider du Parlement catalan a procédé à des consultations et a cherché à éclairer la population sur les tenants et aboutissants de ce droit. Les travaux de cette commission ont contribué à l’émergence d’un vaste consensus autour du processus de consultation présenté le 12 décembre 2013 par le président de la Generalitat, Artur Mas, avec l’appui de 87 députés, issus de sa formation politique (Convergencia i Unio) (CiU) ainsi que de quatre autres partis : Esquerra republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) et Candidatura d’Unitat Popular (CUP). C’est également à cette occasion que ce dernier rendait public le texte des deux questions qui feraient l’objet de la consultation : 1) « Voulez-vous que la Catalogne devienne un État ? » ; 2) « En cas de réponse affirmative, voulez-vous que cet État soit indépendant ? »
Après avoir tenté en vain de convaincre l’État espagnol d’organiser un référendum selon une modalité prévue dans la Constitution espagnole et essuyé une fin de non-recevoir, le Parlement catalan a adopté le 19 septembre 2014, et ce par 106 députés sur 134, la Loi sur la consultation populaire non référendaire et la participation citoyenne. Et c’est sur la base de cette loi que le président Artur Mas signait le 27 septembre un décret autorisant la tenue de la consultation non référendaire le 9 novembre et mettait en place par un décret le 2 octobre suivant une Commission de contrôle des consultations populaires non référendaires.
Réponse légale
La réponse de l’État espagnol aux gestes posés pour favoriser l’exercice par le peuple catalan de son droit de décider aura consisté, pour l’essentiel, à faire invalider ceux-ci par le Tribunal constitutionnel espagnol. Ainsi, le gouvernement demandait en premier lieu aux 12 juges de cette cour d’invalider la résolution du 23 janvier 2013. Les juges statuaient en ce sens le 25 mars 2014. Le gouvernement espagnol faisait à nouveau appel à ce tribunal pour déclarer l’inconstitutionnalité de la loi sur les consultations ainsi que du décret pris en son application. Comme l’y autorise la Constitution espagnole, le Tribunal suspendait l’application de ces loi et décret. Disant vouloir rester dans la légalité, le gouvernement catalan décidait le 17 octobre de s’abstenir de tenir une consultation en application des loi et décret dont la constitutionnalité était remise en cause. Il substituait à cette démarche un processus de participation citoyenne (www.participa2014.cat) destiné à permettre aux Catalans et Catalanes de se prononcer sur leur avenir politique. Le gouvernement espagnol s’est attaqué aussi à ce processus et une nouvelle requête en illégalité a été déposée auprès du Tribunal constitutionnel espagnol le 31 octobre. Le tribunal prononce a également prononcé une suspension de ce processus mardi.
Si la Constitution espagnole affirme en son article 2, « l’unité indissoluble de la nation espagnole » et que « la patrie est indivisible », le peuple catalan est titulaire, comme le peuple québécois, du droit à disposer de lui-même. Il peut déterminer librement, en application de ce droit, son statut politique. L’affirmation de ce caractère indissoluble et indivisible est d’ailleurs contraire à la norme impérative du droit international qu’est devenu le droit à l’autodétermination des peuples. Il l’est également avec le principe démocratique présenté par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec comme le fondement du droit du Québec à chercher à réaliser la sécession. Cet avis consultatif du 20 août 1998 contient des énoncés qui ont une portée universelle et devraient s’appliquer dans toute société qui se considère comme démocratique, y compris l’Espagne.
Les Catalans et les Catalanes ont raison d’affirmer leur droit de décider et peuvent invoquer à leur bénéfice le principe démocratique. Luttant pour la liberté et voulant assurer la pérennité d’une langue et d’une culture, leur peuple, dont les artistes ont tant contribué à enrichir le patrimoine culturel de l’humanité, qu’il s’agisse de Joan Miró, Antoni Tàpies, Frederic Mompou, Jordi Savall, Lluís Lachs et Josep Carreras, poursuit sa démarche d’autodétermination avec courage, persévérance et détermination. Il mérite l’appui des Québécois et des Québécoises.
« Arabie saoudite : une autorisation illégale » Daniel Turp Le Devoir (10 février 2016)
L’appui du gouvernement du Canada à la vente de véhicules blindés légers (VBL) par General Dynamics Land Systems Canada à l’Arabie saoudite en a fait sourciller plusieurs au cours des derniers mois. Nous nous serions en effet attendus à ce que le nouveau gouvernement de Justin Trudeau, s’autoproclamant « le gouvernement du vrai changement », remette en question la décision prise par son prédécesseur de soutenir une telle vente. De toute évidence, l’idée que du matériel militaire fabriqué au Canada puisse contribuer à commettre des violations des droits fondamentaux des populations civiles en Arabie saoudite et dans les pays voisins est immorale. Nous sommes aussi d’avis que l’autorisation d’exporter des chars d’assaut en Arabie saoudite est illégale.
La preuve que l’Arabie saoudite viole les droits les plus fondamentaux de la personne humaine est accablante. Son historique en la matière de violation des droits est de notoriété publique. La liste est longue. On parle de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants, et notamment dans l’imposition de la peine de mort ; du mépris total de l’égalité hommes-femmes ; d’exécutions et de détentions arbitraires ; d’atteinte à la liberté de religion et à la liberté d’expression ; du déni des droits des défenseurs des droits fondamentaux, de la liberté de presse, du droit à un procès juste et équitable.
Depuis le début de l’année 2016, 58 exécutions sommaires ont eu lieu et neuf personnes ont été emprisonnées pour avoir défendu les droits fondamentaux. Condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet, le blogueur Raïf Badawi, de même que son avocat Waleed Abulkhair, est incarcéré en violation de ses droits. Un rapport de l’ONU confirme que l’Arabie saoudite bombarde des écoles au Yémen et un rapport d’Amnistie internationale rappelle les violations constantes du gouvernement saoudien à l’égard des droits de sa propre population. [...]
Si le gouvernement du Canada refuse de faire preuve de cohérence entre les idéaux de respect des droits fondamentaux et ses décisions en matière d’exportation de matériel militaire, il est néanmoins tenu de se conformer au droit. Dans un État de droit, le gouvernement doit respecter le principe constitutionnel de la primauté du droit et veiller au respect de ses lois et de la législation dans son ensemble.
Existe-t-il alors des normes interdisant l’exportation de matériel militaire à un pays violant de façon systématique les droits fondamentaux de ses citoyens et de ceux des pays voisins ? Adoptées par le cabinet en 1986, des lignes directrices énoncent que « le Canada contrôle étroitement l’exportation de produits militaires vers les pays [...] dont les gouvernements commettent constamment de graves violations des droits de la personne contre leurs citoyens, à moins que l’on ne puisse prouver que les produits ne risquent pas d’être utilisés contre la population civile ».
L’Arabie saoudite a commis et continue de commettre de telles graves violations, et il existe un risque réel que les véhicules blindés légers fabriqués par General Dynamics servent à commettre des exactions contre la population civile d’Arabie saoudite et de ses États voisins. De plus, la décision d’autoriser la vente d’armes canadiennes à l’Arabie saoudite pourrait contrevenir à certains engagements internationaux du Canada en matière de droits fondamentaux et de contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage.
Soucieux des enjeux juridiques soulevés par l’exportation des véhicules blindés en Arabie saoudite, nous avons décidé de lancer l’opération « Droits blindés ». En clair, nous comptons contester, par tous les moyens juridiques à notre disposition, la légalité de l’exportation de ce matériel militaire.
« De la “conviction responsable” à la décision irresponsable » Daniel Turp La Presse (3 avril 2016)
M. Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères du Canada, lors de votre allocution à l’Université d’Ottawa du mardi 29 mars 2016, vous avez réitéré la position de votre gouvernement visant à honorer un marché conclu par le gouvernement précédent relativement à la fourniture de véhicules blindés par une entreprise canadienne à l’Arabie saoudite.
Vous avez dit vouloir « tenir compte du monde réel » et être un « décideur responsable ». Vous avez fait appel à une nouvelle formule, celle de la « conviction responsable ». Définissant cette formule, vous avez précisé que « [vos] valeurs et [vos] convictions incluent le sens des responsabilités » et ajouté que « [n]e pas tenir compte des conséquences, pour autrui, de [vos] paroles et de [vos] actes serait contraire à [vos] convictions », et que vous vous estimiez « responsable des conséquences de [vos] actes ».
Cette formule de la conviction responsable inspire donc les premiers gestes de la politique étrangère du gouvernement Trudeau et est ainsi appliquée à la question de la vente d’équipement militaire à l’Arabie saoudite. Mais qu’en est-il de l’Arabie saoudite?
Le bilan de l’Arabie saoudite en matière de violations des droits fondamentaux de la personne est un des pires au monde.
Depuis le début de l’année 2016, le gouvernement saoudien a procédé à 79 exécutions sommaires et neuf personnes sont présentement emprisonnées pour avoir exigé le respect de la liberté fondamentale d’expression, dont le blogueur Raif Badawi qui a été condamné à une peine de 10 ans de prison assortie de 1000 coups de fouet. Un rapport de l’ONU a confirmé en janvier 2016 que l’Arabie saoudite avait bombardé des écoles et des hôpitaux au Yémen et un rapport d’Amnistie internationale condamne les violations sévères et répétées des droits fondamentaux par le gouvernement saoudien.
En autorisant la vente d’environ 1000 véhicules blindés légers à l’Arabie saoudite, le Canada risque de contribuer à la violation continue des droits fondamentaux en armant un gouvernement sanguinaire qui fait fi de l’appel au respect des droits fondamentaux de la communauté internationale, y compris du Canada. Votre gouvernement, en appliquant votre formule de la conviction responsable, cautionnera le comportement d’un gouvernement qui porte atteinte par ses gestes à la dignité humaine la plus élémentaire.
En vertu du principe de la continuité de l’État, nous comprenons qu’il est difficile de révoquer un contrat avec une puissance étrangère. Mais la bonne chose à faire n’est pas toujours la plus facile. Lorsque le gouvernement d’Afrique du Sud violait les droits de la personne en imposant l’apartheid, le Canada n’a certainement pas exporté plus d’armes pour que l’Afrique du Sud puisse renforcer ses politiques discriminatoires. Il a plutôt imposé de larges sanctions économiques pour faire pression sur l’Afrique du Sud afin qu’elle cesse de violer les droits fondamentaux. Le Canada doit retrouver ce rôle international de grand défenseur des droits fondamentaux. Au nom de la conviction responsable, votre gouvernement prend, et en début de mandat de surcroît, une décision irresponsable.
Cette irresponsabilité est éloquemment illustrée par l’argument voulant que si le Canada rompt ce contrat, l’Arabie saoudite trouvera ses armes ailleurs. Tel que l’a reconnu l’ancienne haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Louise Arbour, votre argument reste « très, très faible ». Il pourrait excuser de pires comportements. Nous croyons que le Canada doit plutôt prêcher par l’exemple tel que l’ont fait les députés de l’Union européenne et des Pays-Bas en empêchant que tout contrat d’armement soit conclu entre un État membre de l’Union et l’Arabie saoudite.
De plus, le Canada est un État de droit dans lequel les actes du gouvernement sont soumis à la loi. Le gouvernement ne peut justifier son choix par un argument d’ordre économique, philosophique ou stratégique, alors que la législation canadienne interdit l’exportation vers des pays où les droits des citoyens font l’objet de violations sérieuses et répétées de la part du gouvernement. L’Opération « Droits blindés » que nous avons mise en oeuvre donnera l’occasion aux tribunaux de statuer sur la question du respect par le gouvernement de sa législation ainsi que de ses engagements internationaux. Et il est à espérer que la décision irresponsable que prend le gouvernement en matière de vente d’armes à l’Arabie saoudite sera sévèrement sanctionnée par le pouvoir judiciaire.
« Accord de Paris sur le climat: des omissions et des retards inexcusables » Daniel Turp Le Devoir (19 octobre 2016)
L’accord de Paris sur le climat entrera en vigueur le 4 novembre 2016. Cette entrée en vigueur surviendra moins d’un an après l’adoption par consensus de l’accord lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015. La rapidité avec laquelle les États, et l’organisation économique régionale qu’est l’Union européenne, ont consenti à être liés par ce nouveau traité est digne de mention, si on compare ce délai de moins de 12 mois avec celui des sept années qui ont séparé l’adoption du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 11 décembre 1997 de son entrée en vigueur, le 16 février 2005.
Le Canada compte aujourd’hui parmi les 76 parties à l’accord de Paris et l’est devenu après la transmission aux Nations unies d’un instrument de ratification par le ministre des Affaires étrangères le 5 octobre 2016. Le dépôt par le Canada de cet instrument a contribué à la réalisation de la deuxième condition d’entrée en vigueur selon laquelle les parties à l’accord devaient être responsables ensemble d’un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La première condition prévoyant qu’au moins 55 États ou organisations économiques régionales devaient avoir consenti à être liés par l’accord avait été remplie le 21 septembre 2016.
Il y a lieu de souligner par ailleurs le fait qu’après avoir déposé l’accord de Paris, accompagné d’une note explicative, à la Chambre des communes du Canada le 6 mai 2016, le gouvernement du Canada a présenté le 3 octobre à cette même Chambre une motion voulant « [q]ue la Chambre appuie la décision du gouvernement de ratifier l’accord de Paris aux termes de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signé par le Canada à New York le 22 avril 2016 [...] ». Cette motion a été adoptée le 5 octobre 2016 par 207 voix contre 81.
Affirmer ses compétences
L’on aurait pu s’attendre à ce qu’à l’égard de l’accord de Paris, le gouvernement du Québec pose les actes prévus dans la Loi sur le ministère des Relations internationales. Comme la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto, l’accord de Paris porte sur des matières ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec. Dès lors et aux fins de respecter l’esprit et la lettre de loi, le gouvernement aurait dû dans un premier temps donner son agrément à la signature par le Canada de l’accord, avant que celui-ci ne le signe le 22 avril 2016. Le gouvernement du Québec s’est contenté à cet égard de diffuser le même jour un communiqué de presse et n’a pas accompli la formalité, comme il l’a fait pour d’autres conventions internationales du Canada, qu’est l’envoi au gouvernement du Canada d’une lettre d’agrément à la signature.
Encore plus regrettable aura été l’omission de déposer à l’Assemblée nationale, comme le requiert la loi et en raison du fait que, comme le protocole de Kyoto, l’accord de Paris mérite d’être qualifié d’engagement international important, le texte de cet accord avec une note explicative. De plus, le gouvernement n’a pas présenté une motion demandant à l’Assemblée nationale de donner son approbation à l’accord de Paris, comme le prévoit aussi la loi. Une telle motion aurait d’ailleurs dû être débattue avant le dépôt par le Canada de son instrument de ratification le 5 octobre de façon à permettre au gouvernement du Québec d’adopter quant à lui un décret en vertu duquel il aurait donné son assentiment à ce que le Canada exprime son consentement à être lié par l’accord de Paris et par lequel il se déclarerait lui-même lié à cet accord. Une telle formalité aurait dû être accomplie avant le dépôt par le Canada de son instrument de ratification le 5 octobre, car un assentiment à la ratification devrait, en toute logique, précéder une telle ratification. Cette omission gouvernementale a d’ailleurs privé l’Assemblée nationale et ses parlementaires de débattre avant la ratification du Canada du contenu de l’accord de Paris et des mesures que le Québec envisage de prendre pour se conformer à cet accord.
Alors que le gouvernement du Québec entreprend une consultation pour doter le Québec d’une nouvelle politique internationale, il ne devrait pas oublier qu’il existe une Loi sur le ministère des Relations internationales dont il doit respecter l’esprit et la lettre. Cette loi a consolidé au fil du temps la doctrine Gérin-Lajoie et a imposé au gouvernement le devoir d’affirmer ses compétences à l’égard de traités ressortissant de sa compétence constitutionnelle. Elle a aussi cherché, avec raison, à démocratiser le processus par lequel le Québec se déclare lié par des traités qui, comme l’accord de Paris, doivent être considérés comme des engagements internationaux importants et qu’il a le devoir de soumettre pour approbation aux membres de l’Assemblée nationale.
Même s’il devait soumettre l’accord de Paris à une telle approbation avant le début de la prochaine conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 22) qui doit avoir lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, le gouvernement du Québec aura, par ses omissions et retards, manqué, de façon inexcusable, à ses devoirs.
« L’enjeu fondamental du “droit de décider” » Daniel Turp La Presse (24 septembre 2017)
Le 14 septembre dernier, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) a rendu public à Barcelone le rapport du Groupe d’experts internationaux sur le processus d’autodétermination du peuple catalan par l’IRAI.
Rédigé par un groupe d’universitaires de réputation internationale, la Danoise Nina Caspersen (Université York, Royaume-Uni), le Britanno-Canadien Matt Qvortrup (Université Coventry, Royaume-Uni), l’Argentine Yanina Welp (Université de Zurich, Suisse) et moi-même, ce rapport a examiné les aspects historiques, sociologiques, politiques et légaux du processus d’autodétermination mis en branle par le gouvernement et le Parlement de la Catalogne.
Ce processus comprend la tenue d’un référendum prévue pour le dimanche 1er octobre 2017 et à l’occasion duquel les Catalans répondront à la question suivante : « Voulez-vous que la Catalogne devienne un État indépendant sous la forme d’une république ? »
Dans le déroulement du processus en cours, un enjeu fondamental, soit celui du « droit de décider », c’est-à-dire le droit du peuple catalan de se prononcer librement et démocratiquement sur son statut politique, a émergé.
Après avoir constaté qu’une très forte majorité de Catalans sont en faveur d’un tel droit, qu’ils appuient ou non l’indépendance de la Catalogne, le rapport rappelle que le droit de décider trouve son fondement dans le droit à l’autodétermination des peuples consacré par la Charte des Nations unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, et peut également s’appuyer sur des développements récents du droit européen ainsi que sur le droit constitutionnel comparé, notamment sur l’avis de la Cour suprême du Canada formulé dans le cadre du Renvoi relatif à la sécession du Québec qui ancre le droit de décider dans le principe démocratique.
Quelques observations
Plusieurs autres observations formulées dans les quatre parties du rapport et relatives au processus d’autodétermination du peuple catalan actuellement en cours méritent d’être soulignées.
• On assiste à la montée de l’indépendantisme non seulement parmi les décideurs politiques, mais également au sein de la société civile de Catalogne à la suite de la sentence du Tribunal constitutionnel espagnol de 2010, déclarant inconstitutionnelles plusieurs dispositions d’un nouveau Statut d’autonomie ayant pourtant été approuvé par les Parlements de Catalogne et d’Espagne, de même que par le peuple catalan par référendum ;
• La Loi sur le référendum d’autodétermination adoptée par le Parlement catalan le 6 septembre dernier respecte, pour l’essentiel, les standards internationaux en matière d’organisation de référendums ;
• Étant une décision de nature politique, la reconnaissance par les États de la Communauté internationale d’une déclaration d’indépendance de la Catalogne est difficile à prédire. La réponse de Madrid jouera très certainement un rôle déterminant, mais les États de la communauté internationale pourraient ne pas être indifférents à la volonté d’indépendance de la Catalogne exprimée de façon pacifique et démocratique.
Au moment où l’État espagnol multiplie les gestes tendant à nier le droit de décider du peuple catalan, il importe de rappeler que plusieurs pays ont choisi de respecter la volonté démocratique de leurs peuples et d’accepter que le principe démocratique soit pleinement mis en oeuvre.
Le Québec et l’Écosse sont deux exemples où le principe démocratique a prévalu, mais il y en aura plusieurs autres à venir dans de nombreuses régions du monde.
Tout au long de son histoire, le peuple catalan a su préserver son identité distincte par des moyens démocratiques — y compris des référendums. Il se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins en cherchant à mener à terme un processus d’autodétermination dans l’exercice de son droit de décider.
« De la grandeur et du destin du principe d’autodétermination des peuples » Daniel Turp Le Devoir (7 novembre 2017)
Consacré par la Charte des Nations unies en 1945 et décrit par la Cour internationale de Justice comme un principe essentiel, voire une norme impérative de droit international, le principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, connu aussi comme le principe d’autodétermination, n’a jamais été aussi présent dans l’actualité.
Les deux référendums tenus au Kurdistan et en Catalogne les 25 septembre et 1er octobre 2017 suscitent des débats sur la portée du principe et la mise en oeuvre du droit à l’autodétermination qui y prend sa source. Et le débat reprendra en 2018 lorsque les référendums d’autodétermination seront organisés en Nouvelle-Calédonie et dans la région autonome de Bougainville en Nouvelle-Guinée, et que le référendum constitutionnel prévu aux îles Féoré soulèvera l’enjeu de l’enchâssement dans une première constitution de cette communauté autonome du Danemark du droit à l’autodétermination du peuple féroïen.
Principe
C’est en application de ce principe et à la suite d’un processus qui y prenait appui qu’ont accédé à l’indépendance plus d’une centaine de peuples coloniaux durant la deuxième moitié du XXe siècle. Se fondant sur le même principe et s’affirmant titulaires du même droit, plus d’une vingtaine d’autres peuples ont choisi d’opter pour l’indépendance et sont nés de la dissolution de l’Union soviétique, de la Yougoslavie et de Tchécoslovaquie, mais aussi de leur détachement -- en ce début de XXIe siècle -- de l’Éthiopie pour l’Érythrée et du Soudan pour le Soudan du Sud.
Ce principe trouve sa grandeur -- et son expression juridique -- dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés en 1966 dont l’article premier qui leur est commun affirme que « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
Les modes de mise en oeuvre de droit ont par ailleurs été explicités dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies qui a indiqué les trois modes de mise en oeuvre du droit à l’autodétermination, à savoir « [l]a création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration dans un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple ».
Se fondant sur le caractère universel d’un droit qui autorise la création d’un État souverain et indépendant, des peuples comme ceux du Québec et d’Écosse ont également tenu des référendums et ont d’ailleurs vu le Canada et le Royaume-Uni prendre une part active à l’exercice. Et de nombreux autres peuples du monde aujourd’hui se réclament du droit à l’autodétermination pour obtenir plus d’autonomie au sein de l’État dont ils font partie. Et les peuples autochtones peuvent aujourd’hui se référer à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones pour revendiquer et exercer leur droit à l’autodétermination et déterminer librement leur statut politique. Ils possèdent aussi, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activite?s autonomes.
Objections
Comme on le constate au Kurdistan et en Catalogne, la portée universelle du principe d’autodétermination et le droit à l’indépendance sont récusés par des États qui opposent aux peuples qui les composent tantôt leur intégrité territoriale, tantôt leur caractère indissoluble.
Alors que la première objection ne trouve plus de fondement en droit international depuis que la Cour internationale de Justice a rappelé, dans son Avis consultatif sur le Kosovo (2010), que le principe de l’intégrité territoriale n’était applicable que dans les relations interétatiques, l’argument de l’indissolubilité pose la question de la conformité d’une telle norme constitutionnelle avec le principe d’autodétermination et le droit qui en découle de déterminer librement son statut politique. Et si c’est en toute liberté que les peuples peuvent déterminer un tel statut politique, le destin du principe d’autodétermination est en vérité intimement lié à la démocratie et au principe démocratique.
En 1917, l’autodétermination a été décrite comme étant un mot d’ordre de la politique internationale, comme en faisaient foi les vues exprimées par le président américain Woodrow Wilson : « Aucune paix ne peut durer, ni ne devrait durer, si elle ne reconnaît et n’accepte le principe que les gouvernements dérivent tous leurs pouvoirs légitimes du consentement de ceux qui sont gouvernés et que nul n’a le droit de transférer les peuples d’un potentat à l’autre, comme s’ils étaient une propriété. » Cent ans plus tard, l’autodétermination n’a pas perdu de son intérêt. Son exercice pour les peuples qui aspirent à plus de liberté et s’appuient sur le droit à l’autodétermination demeure le plus grand des défis.
L’IRAI organisera un colloque sur le thème « L’autodétermination des peuples au XXIe siècle : perspectives internationales et comparées » à l’auditorium de la Grande Bibliothèque de Montréal le vendredi 10 novembre 2017.
« Faire du fleuve Saint-Laurent un sujet de droit » Yenny Vega Cardenas, Nathalia Parra et Daniel Turp Le Devoir (4 mai 2018)
Dans un jugement audacieux, la Cour suprême de Colombie a déclaré que l’Amazonie colombienne était une personne non humaine.
Cette décision répond à une action présentée le 29 janvier 2018 par un groupe de 25 enfants et jeunes de diverses municipalités de Colombie réclamant la protection de l’Amazonie de la déforestation et de leurs propres droits fondamentaux à la vie, à l’eau et à un environnement sain.
Ce statut de sujet de droit a été reconnu à ce « poumon du monde [...] dans le but de protéger cet écosystème vital pour le futur global, de la même manière que la Cour constitutionnelle a déclaré le fleuve Atrato [...] comme entité “sujet de droit” titulaire du droit à la protection, à la conservation, à l’entretien et à la restauration, sous la responsabilité de l’État et des entités territoriales que l’intègrent ». [Traduction libre]
Cette déclaration garantit ainsi des droits à la nature et lui confère une personnalité juridique, de la même manière qu’ont été reconnus des droits et une telle personnalité à l’individu. Ce nouveau courant s’est imposé en Équateur, qui a introduit dans sa Constitution de 2008 les droits de la nature, comme l’ont également fait la Bolivie en adoptant en 2012 une loi sur les droits de la nature, la Nouvelle‑Zélande qui a reconnu des droits au fleuve Whanganui en 2017 et l’Inde qui a emboîté le pas en mars 2017 concernant le fleuve Gange.
Il s’agit d’un mouvement qui vise à répondre aux problématiques environnementales comme les changements climatiques, la décontamination des rivières hautement polluées ainsi que la protection des régions d’une importance vitale pour les communautés.
Avec un tel changement de paradigme, l’homme n’est plus compris comme dominant la terre et les diverses espèces vivantes. Il est compris plutôt comme faisant partie de la nature. Une vision écocentriste, s’appuyant notamment sur des savoirs traditionnels autochtones et soulignant l’importance de respecter les droits autonomes des autres espèces et milieux de vie sur la Terre, tend ainsi à se substituer à l’approche anthropocentriste qui a prévalu à ce jour.
L’effet boule de neige de cette nouvelle vision semble pénétrer d’autres pays, tels le Mexique, où les droits de la nature ont été insérés en janvier 2017 dans la Constitution de la ville de Mexico, le Brésil, où un regroupement de juges a adopté une déclaration récemment à cet égard lors du Huitième Forum mondial de l’eau, mais aussi l’Afrique, qui cherche à faire reconnaître le fleuve Éthiopie comme sujet de droit, et l’Australie, qui semble se diriger vers la reconnaissance du fleuve Margaret comme personne non humaine.
Au Québec
Le cadre juridique du Québec ne serait pas incompatible avec une telle vision. En effet, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (Recueil des lois et règlements du Québec, RLRQ, c. C-6.2), prévoit que ces ressources en eau du Québec font partie du « patrimoine commun de la nation québécoise ». La loi prévoit en outre que « [l]a protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable, tout en ajoutant qu’“[a] fin de favoriser l’accès public au fleuve Saint-Laurent et aux autres plans ou cours d’eau [...], le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut prendre des mesures à cette fin”. L’une de ces mesures de ne serait-elle pas de déclarer le fleuve Saint-Laurent comme sujet de droit et de personne non humaine ?
Cela serait d’autant plus justifié que le statut patrimonial des ressources en eau a dorénavant pour conséquence qu’un préjudice autonome peut être causé à la ressource. En fait, l’article 8 de la loi introduit le concept de responsabilité sans faute lorsque des dommages sont causés aux ressources en eau. D’ailleurs, le procureur général peut, en application de cet article, « au nom de l’État gardien des intérêts de la nation dans ces ressources, intenter contre l’auteur des dommages une action en réparation ». La loi reconnaît indirectement dans ce même article les droits à la conservation, à la réparation et à la protection des ressources en eau. Plus encore, la loi, en instaurant le programme favorisant la restauration et la création de milieux humides et hydriques, met en avant encore plus la protection de l’eau. Eu égard à ces développements, une déclaration élevant le fleuve Saint-Laurent et ses affluents au statut de sujet de droit, ou de personne non humaine, n’irait pas à l’encontre du droit actuel, mais renforcerait la préservation du grand réservoir hydrique qu’est ce grand fleuve.
En outre, il s’agirait d’un geste d’une symbolique incommensurable, étant donné qu’il ferait du Québec un État avant-gardiste emboîtant le pas à la Nouvelle‑Zélande, à la Colombie, à l’Inde, à l’Équateur et à plusieurs autres États qui ont adopté des lois visant à reconnaître les droits de la nature ou sont maintenant disposés à le faire. En fait, bien que le Saint-Laurent a été désigné en 2017 comme « lieu historique » en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, élever son statut à celui de sujet de droit et de personne non humaine permettrait de lui assurer une mise en valeur en tant que milieu de vie.
Cette question sera d’ailleurs débattue dans le cadre de l’école d’été organisée conjointement par l’Université de Montréal et l’Universidad de Costa Rica du 7 au 25 mai 2018, et à laquelle prendront part les signataires du présent texte.
« L’urgence de refuser l’agrément du Québec » Daniel Turp Le Journal de Québec (20 octobre 2018)
En une veille d’élections générales au Québec et un 30 septembre 2018, les États-Unis, le Mexique et le Canada ont annoncé qu’ils avaient achevé des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel Accord États-Unis— Mexique-Canada (AEUMC).
Destiné à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et se présentant dans son préambule comme étant « un accord du XXIe siècle de haut niveau visant à soutenir un commerce mutuellement bénéfique, conduisant à des marchés plus libres et plus équitables et une croissance économique robuste dans la région » [notre traduction], le projet d’AEUMC n’a pas encore été conclu et n’est pas une réalité juridique. Le texte fait actuellement l’objet d’un examen juridique pour précision, clarté et cohérence, sous réserve d’authentification linguistique.
La gestion de l’offre
Il est donc encore temps pour le Québec d’agir et il y a même urgence de le faire avant la signature de l’accord. Et pourquoi est-il urgent d’agir ? Une raison principale milite pour une action décisive du Québec. Elle tient au fait que le gouvernement du Canada n’a pas, au terme des négociations, tenu compte de la volonté du Québec de préserver l’intégralité et l’intégrité du système de gestion de l’offre.
Si le Canada prétend avoir maintenu ce système pour une autre génération de producteurs laitiers, il reconnaît avoir accepté, en vertu de l’accord, d’« ouvrir de nouveaux marchés aux États-Unis sous la forme de contingents tarifaires pour les produits laitiers, la volaille et les produits d’oeufs ». Combinées au fait que les dispositions de l’accord sont assujetties à une « révision commune » au sixième anniversaire de son entrée en vigueur et que les États— Unis ont pour objectif ultime d’amener le Canada à éliminer son système de gestion de l’offre, ces concessions constituent une dangereuse brèche à ce système. Le gouvernement du Québec doit dès lors faire savoir au gouvernement du Canada qu’il n’accepte pas que de telles concessions aient été faites sans son consentement.
La doctrine Gérin-Lajoie
En application de la doctrine Gérin— Lajoie, la Loi sur le ministère des Relations internationales [du Québec] (R.L.R.Q., c. M-25.1.1) prévoit en son article 22.1 que le ministre [des Relations internationales] “veille aux intérêts du Québec lors de la négociation de tout accord international, entre le gouvernement du Canada et un gouvernement étranger [...] portant sur une matière ressortissante à la compétence constitutionnelle du Québec” et « peut donner son agrément à ce que le Canada signe un tel accord ».
Le ministre peut aussi ne pas donner son agrément. La négociation de l’AEUMC n’étant pas terminée et son texte n’ayant pas été signé, le temps est propice pour refuser son agrément à la signature de l’AEUMC. Il faut dire haut et fort que le peuple québécois n’accepte pas les dispositions qui ont été incluses dans l’accord sans tenir compte de ses intérêts supérieurs. Le nouveau premier ministre doit saisir l’occasion pour démontrer qu’il croit en la doctrine Gérin-Lajoie et que, comme ses prédécesseurs, de tous partis confondus, il est prêt à se tenir debout pour en faire assurer le respect.
Un tel geste devrait d’ailleurs bénéficier de l’appui des autres partis représentés à l’Assemblée nationale, qui ont fait front commun sur cette question pendant la dernière campagne électorale. Ce geste sera, en définitive, un véritable acte d’autodétermination par lequel le Québec rappellera au Canada, aux États-Unis, au Mexique et au monde qu’il a le droit de disposer de lui-même et qu’il peut assurer librement son développement économique, social et culturel.
« Une nouvelle procédure pour faire cesser l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite » Daniel Turp Le Devoir (16 septembre 2019)
Le mardi 17 septembre 2019, trois mois après le dépôt de son instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations unies, le Canada deviendra le 105e État partie au Traité sur le commerce des armes (TCA), adopté le 2 avril 2013 et entré en vigueur le 24 décembre 2014.
L’on peut se réjouir du fait que le Canada sera dorénavant résolu à agir selon les principes énumérés à l’article 1er du traité. L’un de ces principes est celui qui rappelle l’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de l’homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Mais, encore faudra-t-il que le Canada en exécute maintenant de bonne foi les dispositions.
L’une de ces dispositions, l’article 6 § 3, prescrit que l’État partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes s’il a connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre. Or, il ne fait aucun doute que le Canada a une connaissance de telles violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne, résultant de bombardement sur des civils et dont l’Organisation des Nations unies a informé ses États membres dès le 31 mars 2015.
Ces preuves se sont multipliées depuis. Tout récemment, dans son rapport du 9 août 2019, le Groupe d’experts éminents des Nations unies sur le Yémen indiquait que les forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen avaient enfreint le droit international et qu’une enquête sur la commission de crimes de guerre s’imposait. Le rapport établissait le lien direct entre la catastrophe au Yémen et le soutien apporté par les gouvernements extérieurs aux forces combattantes au Yémen. Le groupe rappelle aussi que “le Traité sur le commerce des armes […] interdit aux États parties d’autoriser le transfert d’armes s’ils ont connaissance que ces armes pourraient servir à commettre des crimes de guerre” et « constate que les armes qui continuent d’être fournies aux parties au conflit au Yémen alimentent le conflit et perpétuent les souffrances de la population ».
Une deuxième disposition du traité, l’article 7 § 1, prévoit que chaque État partie exportateur, avant d’autoriser l’exportation d’armes, évalue si l’exportation de ces armes ou biens pourrait notamment servir à commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission pour commettre une violation grave du droit international des droits de l’homme ou à en faciliter la commission. L’article 7 § 3 ajoute que si, à l’issue de cette évaluation, l’État partie exportateur estime qu’il existe un risque prépondérant de commission de telles violations, il n’autorise pas l’exportation.
À la lumière des faits portés à la connaissance du Canada par l’ONU depuis 2015, toute évaluation doit inévitablement conduire à la conclusion qu’il existe un risque prépondérant de commission de telles violations. Une telle évaluation (ou prise en considération selon les termes de l’article 7 § 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation), modifiée pour permettre l’adhésion du Canada au Traité sur le commerce des armes, doit amener le Canada à ne plus délivrer de licences d’exportation, mais également à annuler les licences d’exportation émises antérieurement.
Le Traité sur le commerce des armes offre de nouvelles bases juridiques pour exiger qu’il soit mis fin à ces exportations. Après avoir fait appel aux tribunaux pour faire cesser l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite en application des Lignes directrices du cabinet fédéral de 1986 et sans obtenir gain de cause, je ferai parvenir le 17 septembre 2019 une nouvelle mise en demeure à la ministre des Affaires étrangères lui enjoignant d’annuler immédiatement toutes les licences d’exportation qui ont été délivrées à ce jour et de ne pas en délivrer de nouvelles pour l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite.
À défaut de recevoir une réponse favorable de la ministre avant le 30 septembre 2019, je compte lancer, en poursuivant ainsi l’Opération Droits blindés, une nouvelle procédure judiciaire afin de faire respecter les obligations du Traité sur le commerce des armes ainsi que celles qui lui incombent aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Je me réjouis par ailleurs de savoir que plusieurs organisations de la société civile canadienne et québécoise, notamment Amnistie Internationale, les Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, l’Institut Rideau, Oxfam Canada, Oxfam-Québec et Project Ploughshares, auxquelles je joindrai aussi ma voix, réclameront également la cessation des exportations d’armes vers l’Arabie saoudite.
Alors que le Royaume-Uni et la Belgique ont cessé l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite en raison de décisions de leurs tribunaux et que d’autres pays, tels l’Allemagne et les Pays-Bas, ont mis fin à leurs transferts d’armes vers ce pays sans qu’il ait été besoin d’intenter de recours judiciaires, le Canada a maintenant l’occasion — mais surtout le devoir — de promouvoir et de protéger les droits les plus fondamentaux de la personne humaine. Et d’agir ainsi pour que soit donné, tant au Yémen qu’en Arabie saoudite et partout ailleurs dans le monde, un veritable sens à l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
« Vendre des armes à l’Arabie saoudite pour bombarder le Yémen est contraire au droit international » Éric David, Benoît Muracciole et Daniel Turp Le Monde (30 septembre 2019)
Les rapports de l’ONU sur la guerre au Yémen démontrent que l’Arabie saoudite se livre à des attaques contre des civils dans ce pays. Dans ce contexte, la France doit cesser de vendre des armes aux Saoudiens et respecter ses engagements internationaux, demande, dans une tribune au « Monde », un collectif de spécialistes en droit international.
S’agissant des premières, le droit de la responsabilité internationale de l’État prévoit qu’un État ne peut aider un autre État à violer le droit international. Quant au DIH, tant conventionnel que coutumier, il oblige les États à agir pour en faire respecter les règles. Enfin, le DIDH prévoit que les États s’engagent à favoriser le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous et d’agir en conséquence, comme le précisent les articles 55 et 56 de la charte des Nations unies. Quant au traité sur le commerce des armes, son article 6, § 3, précise qu’aucun État partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques s’il sait que celles-ci pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, ou des crimes de guerre. Si l’article 6, § 3, s’avère inapplicable, l’article 7 oblige les États parties à s’assurer qu’un transfert d’armes ne risque pas de contribuer à des violations du DIH ou du DIDH. Pour les raisons exposées plus haut, si l’art. 7 est appliqué de bonne foi, les faits présentés permettent de conclure qu’il existe un risque réel que le transfert d’armes classiques contribue à violer gravement le DIH ou le DIDH et qu’il doit donc être refusé.
Depuis peu, la justice de certains États (Royaume-Uni, Belgique, France et Canada) a été saisie de recours sur la légalité des transferts d’armes vers de la coalition de pays dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette guerre qui affecte une population de 27 millions de personnes a donné lieu à des crimes de guerre commis par toutes les parties au conflit.
Les rapports d’experts des Nations unies et de chercheurs indépendants sur le terrain démontrent que les forces de la coalition de pays dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont participé à plusieurs reprises à des attaques, aériennes et terrestres dont les victimes sont principalement des civils. La guerre qui oppose la coalition prétendument destinée à soutenir le « gouvernement yéménite » contre les « insurgés Houthi », est à l’origine, selon le rapport du Armed Conflict Location & Event Data Project de plus de 90 000 morts depuis 2015. Save the Children a dénoncé la mort indirecte de plus de 85 000 d’enfants de moins de 5 ans pour cette même période. Le Conseil de sécurité des Nations unies du 17 juin 2019 a déclaré que la guerre a plongé plus de 24 millions de personnes, 80 % de la population, dans une demande d’assistance humanitaire.
Obligations qu’impose le droit international
En dépit des demandes répétées du Conseil de sécurité de l’ONU et ce depuis le 14 avril 2015, les parties au conflit ne se sont pas acquittées des obligations que leur impose le droit international, notamment le droit international humanitaire (DIH) et le droit international des droits de l’homme (DIDH). De nouvelles violations ont d’ailleurs été commises, le 29 juillet 2019, lors du bombardement d’un marché situé dans le nord du Yémen à Al-Thabet dans la province de Saada. Le bilan fait état de 14 morts, dont deux enfants, et 27 blessés.
Il n’y a pas que des attaques dont les victimes sont des civils : le blocus imposé au Yémen par la coalition entraîne une famine qui touche surtout la population civile alors que le DIH interdit « l’utilisation de la famine contre les civils comme méthode de guerre », comme l’a souligné, avec justesse, le Groupe d’experts des Nations unies. Les récentes informations diffusées par le site d’investigation Disclose sur l’activité des navires de guerre français dans le blocus confirment l’importance de l’implication de la France.
Dans ces conditions, les États peuvent-ils, juridiquement, vendre des armes à l’Arabie saoudite et à ses alliés alors que le droit international interdit de transférer des armes à des États qui s’en servent pour le violer ? Cette interdiction est fondée, d’une part, sur les normes du droit de la responsabilité des États ainsi que sur celles du DIH et du DIDH, d’autre part, sur le traité des Nations unies relatif au commerce des armes.
S’agissant des premières, le droit de la responsabilité internationale de l’État prévoit qu’un État ne peut aider un autre État à violer le droit international. Quant au DIH, tant conventionnel que coutumier, il oblige les États à agir pour en faire respecter les règles. Enfin, le DIDH prévoit que les États s’engagent à favoriser le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous et d’agir en conséquence, comme le précisent les articles 55 et 56 de la charte des Nations unies. Quant au traité sur le commerce des armes, son article 6, § 3, précise qu’aucun État partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques s’il sait que celles-ci pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, ou des crimes de guerre. Si l’article 6, § 3, s’avère inapplicable, l’article 7 oblige les États parties à s’assurer qu’un transfert d’armes ne risque pas de contribuer à des violations du DIH ou du DIDH. Pour les raisons exposées plus haut, si l’art. 7 est appliqué de bonne foi, les faits présentés permettent de conclure qu’il existe un risque réel que le transfert d’armes classiques contribue à violer gravement le DIH ou le DIDH et qu’il doit donc être refusé.
Ces obligations auraient dû être respectées dès le moment où ont été portées à la connaissance des États exportateurs, les informations sur les bombardements et le blocus du Yémen. Le Groupe d’éminents experts du Conseil des droits de l’homme des Nations unies a, dans un rapport du 9 août, demandé aux États de s’abstenir de fournir un soutien militaire quel qu’il soit aux parties en conflit au Yémen affirmant qu’ils pourraient en être tenus responsables.
Cour de Justice de l’Union européenne
A défaut pour les États exportateurs d’armes d’assumer leurs obligations, c’est donc vers les tribunaux que se sont tournés plusieurs organisations de la société civile et des défenseurs des droits fondamentaux. A ce jour, des arrêts du Conseil d’État belge et d’une cour d’appel du Royaume-Uni ont conduit à la suspension du transfert d’armes vers l’Arabie saoudite. En France, le tribunal administratif de Paris, saisi par l’ONG Action sécurité éthique républicaines (ASER), rejointe par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), s’est déclaré compétent pour connaître une matière jusqu’à présent considérée comme relevant de la raison d’État. Il a toutefois rejeté la requête refusant aux ONG le droit de se prévaloir dans un litige avec l’administration de textes internationaux dont les stipulations « ont pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne créent aucun droit dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ».
ASER a fait appel de ce jugement et présentera une demande de renvoi préjudiciel sur la question de l’effet direct devant la Cour de Justice de l’Union européenne. La Cour fédérale du Canada, tant en première instance qu’en appel, a aussi reconnu l’intérêt à agir d’un citoyen-défenseur des droits de la personne, mais elle s’est abstenue d’exiger la suspension des transferts d’armes vers l’Arabie saoudite. L’adhésion récente du Canada au traité sur le commerce des armes devrait fournir de nouveaux arguments pour convaincre les juges de suivre la voie tracée par les magistrats belges et britanniques.
« Une violation de nos droits les plus fondamentaux » Daniel Turp Le Devoir (30 septembre 2020)
Cinquante ans après la crise d’octobre 1970, nous ne devons jamais oublier que les actes de violence et les crimes commis par les membres Front de libération du Québec ont servi de prétexte à l’imposition, pour l’unique fois en temps de paix, de la Loi sur les mesures de guerre et à la violation des droits les plus fondamentaux des Québécois et Québécoises, du Parti québécois et du peuple québécois.
Si ces gestes de répression semblent avoir eu comme fondement une disposition de la Loi sur les mesures de guerre rendue applicable par la Proclamation sur l’état d’insurrection du 16 octobre 1970 (« proclamation Trudeau ») ainsi qu’un article de la loi de 1970 concernant l’ordre public (« loi Turner ») qui a déclaré explicitement que cette loi s’appliquait nonobstant la Déclaration canadienne des droits et libertés, il n’aurait jamais dû être tenu pour acquis que de telles dérogations n’avaient pas entraîné la violation par le Canada des droits les plus fondamentaux de la personne.
En 1970, le Canada était lié par des règles du droit international des droits fondamentaux, en particulier celles de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Quelle que soit la source susceptible d’être invoquée pour reconnaître une valeur juridique aux droits fondamentaux énoncés par la Déclaration universelle 22 ans auparavant, il est clair que certains des droits fondamentaux garantis par la Déclaration universelle devaient être respectés par le Canada au moment de la crise d’Octobre du fait de leur caractère obligatoire.
En examinant les faits qui se sont déroulés durant la crise d’Octobre et à la lumière des témoignages recueillis durant les 50 dernières années, et aussi d’informations rapportées dans les décisions judiciaires et dans l’abondante littérature sur la crise d’Octobre, on peut conclure à l’existence d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes et massives des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Sur les 497 personnes emprisonnées en octobre 1970, 435 furent libérées sans aucune accusation (87,5 %). Quant aux 62 personnes accusées, 44 furent acquittées ou bénéficièrent d’une ordonnance d’arrêt des procédures.
Parmi les dispositions auxquelles on a porté atteinte, on compte notamment les articles suivants de la Déclaration universelle : 3 (droit à la vie), 5 (interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 8 (droit à un recours effectif devant les tribunaux), 9 (interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraires), 11 (interdiction de l’application rétroactive de la législation pénale), 12 (interdiction d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, d’atteintes à son honneur et à sa réputation) et 19 (liberté d’opinion et d’expression).
À l’égard de ces violations, 50 ans plus tard, l’impunité persiste. D’ailleurs, il serait grand temps d’entamer des démarches afin que les institutions et les personnes qui ont commis de telles violations répondent de leurs actes et que les victimes obtiennent pleine et entière réparation.
Pour le Parti québécois
Parmi les personnes arrêtées et détenues, on dénombrait un grand nombre de membres du Parti québécois, et en particulier des personnes qui exerçaient des fonctions au sein des associations de circonscription de ce parti politique créé à peine deux ans plus tôt. Le PQ était, de toute évidence, la principale cible des « mesures de guerre ». La stratégie de répression ourdie à Ottawa bien avant octobre 1970 et son ampleur étaient destinées à affaiblir le nouveau vaisseau amiral que venaient de se donner les indépendantistes. [...]
Si l’on peut démontrer que les droits les plus fondamentaux des Québécois et Québécoises ont été violés pendant les événements d’octobre 1970 et que le PQ a été aussi une victime des mesures de guerre, ne peut-on pas aussi conclure que c’est le droit collectif le plus fondamental qui a été violé, celui du peuple québécois à l’autodétermination ? La Déclaration sur les relations amicales adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies pendant la crise d’Octobre elle-même, le 24 octobre 1970, affirme que le droit d’un peuple à disposer de lui-même a comme corollaire le devoir de l’État de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait un peuple de ce droit. On doit donc conclure que l’application de la « proclamation Trudeau » et de la « loi Turner » a conduit à des mesures de coercition qui ont constitué une violation grave de cette norme impérative du droit international qu’est devenu le droit à l’autodétermination des peuples.
Si la violence politique, comme celle à laquelle a eu recours le Front de libération du Québec, a été et doit encore être condamnée à juste titre et ne devrait pas être considérée comme une option, les violations des droits fondamentaux pendant la crise d’Octobre ne sauraient être plus acceptables et ne seront jamais suffisamment condamnées quant à elles.
De telles violations ont sans doute provoqué une prise de conscience et joué le rôle d’un puissant électrochoc. Elles n’ont de toute évidence pas refroidi l’ardeur de ceux et celles qui poursuivent le long et patient travail de persuasion démocratique pour convaincre la majorité de nos compatriotes de dire OUI, un jour prochain, à l’indépendance.
« Conflit au Haut-Karabakh : la paix par l’autodétermination » Daniel Turp La Presse (22 octobre 2020)
Comme tant de Québécois qui ont à coeur la vie du peuple arménien et d’une diaspora dont le courage et la résilience ne peuvent que susciter l’admiration, nous sommes préoccupés par la situation qui règne dans le territoire du Haut-Karabakh.
Comme cela est arrivé à de trop nombreuses reprises déjà, le conflit qui persiste entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet de ce territoire et de sa population donne lieu à l’emploi d’une force armée entraînant des pertes de vies. Au moment où ces lignes sont écrites, ces pertes de vie sont évaluées à plus d’un millier, y compris un nombre significatif de personnes civiles.
Un examen des faits révèle que ce nouveau conflit résulte d’une offensive lancée par l’armée de l’Azerbaïdjan le 27 septembre. Menée avec l’aide d’armes que la Turquie a diverties vers l’Azerbaïdjan, comme l’a reconnu le Canada en suspendant le 5 octobre les licences d’exportation de caméras qui aident les drones à mieux cibler la population civile arménienne, cette offensive, comme les précédentes, vise à reprendre le territoire dont le contrôle effectif échappe au gouvernement azéri depuis 1991.
Il y a d’ailleurs lieu de rappeler à cet égard que la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) avait non seulement entraîné l’accession à la souveraineté internationale de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, mais également une proclamation, le 2 septembre 1991, de l’indépendance par l’Assemblée nationale du Haut-Karabakh. En réaction à cette proclamation, l’Azerbaïdjan mettra fin, le 26 novembre 1991, au statut d’autonomie que détenait jadis le Haut-Karabakh au sein de la république soviétique azérie. Ce geste n’empêchera pas toutefois la population de ratifier la proclamation d’indépendance lors d’un référendum tenu le 10 décembre suivant à l’occasion duquel 82,17 % des personnes inscrites approuveront cette proclamation d’indépendance à une majorité de 99,98 %.
Ainsi, la population du Haut-Karabakh a pu, il y a presque 30 ans déjà, disposer d’elle-même et déterminer librement son statut politique. L’Azerbaïdjan n’a jamais voulu prendre acte de cette démarche d’autodétermination et respecter la volonté si clairement exprimée par une population.
Alors que ce pays est, du fait de son adhésion en 1992 aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenu de « faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », il fait plutôt obstacle à l’exercice continu en oeuvre de droit collectif si fondamental qu’il a été élevé au rang de norme impérative de droit international.
Le rôle-clé que doit jouer le principe d’autodétermination a d’ailleurs été reconnu par le Groupe de Minsk qui a été constitué par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en 1992. Coprésidé par les États-Unis, la France et la Russie, ce groupe s’est vu confier le mandat d’aider les parties à résoudre le conflit de façon pacifique et négociée et a proposé que la discussion du futur statut du Haut‑Karabakh soit fondée sur « le principe de l’expression populaire, notamment lors d’un référendum ».
Si les Principes de Madrid formulés en décembre 2007 parmi lesquels se retrouve celui de l’expression populaire ne font pas tous consensus entre les parties, on peut espérer que ce principe guide en 2020 le Groupe de Minsk qui a maintenant repris du service. Après avoir condamné la violence, s’être dit inquiet de l’augmentation des morts de personnes civiles et réussi à négocier un premier cessez-le-feu avec les parties, celui-ci a rappelé l’importance d’une reprise de « négociations de fond, en toute bonne foi et sans conditions préalables ».
Les québécois solidaires
Que nos frères et soeurs d’Arménie d’ici et d’ailleurs sachent que les Québécois, dont l’Assemblée nationale adoptait en 2003 la Loi proclamant le Jour commémoratif du génocide arménien et qui, par la voix d’un Bloc québécois ayant fait adopter une motion reconnaissant le génocide arménien adoptée par la Chambre des communes le 21 avril 2004, sont solidaires de leur lutte permanente pour l’existence, la reconnaissance et la paix.
Et s’agissant de la paix, nous nous permettons de reprendre ici les propos du président américain Woodrow Wilson. Connu également de l’Arménie pour sa sentence arbitrale du 22 novembre 1920 relative aux frontières du pays, celui-ci avait, trois ans plus tôt, formulé l’avis selon lequel « aucune paix ne peut durer ni ne devrait durer si elle ne reconnaît et n’accepte le principe que les gouvernements dérivent tous leurs pouvoirs légitimes du consentement de ceux qui sont gouvernés ».
« À la crise d’Octobre de 1970 et la fraude d’Octobre 1995, le peuple québécois doit répondre : nous avons droit à un pays » Daniel Turp Le Journal de Montréal (30 octobre 2020)
En ce 30 octobre 2020, un grand nombre de Québécois et Québécoises se souviendront du référendum du 30 octobre 1995 à l’occasion duquel 93,52% des personnes habilitées à voter avaient répondu à la question « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du Québec et de l’entente signée le 12 juin 1995? ». Le Oui avait récolté 49,52% des votes validement exprimés, alors que le Non obtenait 50,58% de ces voix, 54 288 voix à peine séparant le OUI du Non.
Comme René Lévesque l’était en 1980, j’étais convaincu, en 1995, que ce serait pour la prochaine fois, que cette prochaine fois ne saurait tarder... et qu’elle serait la bonne!
25 ans plus tard, cette prochaine fois ne s’est pas encore produite. Depuis lors, des violations du dispositif référendaire québécois ont été mises en lumière. Ne devrait-on pas conclure qu’à une « crise d’Octobre de 1970 », dont on vient de souligner le cinquantenaire, a succédé une « fraude d’Octobre de 1995 »?
Tout comme les gestes qui ont été posés pendant la crise d’Octobre constituent une atteinte au droit du peuple québécois à disposer de lui-même, de nombreux actes commis par le camp du Non en 1995, avec l’appui du gouvernement du Canada, sont aussi des violations du droit collectif fondamental à l’autodétermination du peuple québécois.
Comme pour la crise d’Octobre de 1970, il y a des raisons de poursuivre la recherche de la vérité au sujet de « la fraude d’Octobre 1995 ». Mais, il appartient à tous les Québécois et à toutes les Québécoises de défendre le droit à l’autodétermination de leur peuple et de se solidariser autour de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (loi 99), dont l’article premier prévoit que “[l]e Québec peut, en fait et en droit, disposer de lui-même” et qu’“[i]l est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité́ de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes”. Le peuple québécois doit répondre: Nous avons droit au pays.
Il appartient en outre aux indépendantistes de définir les avenues qui mèneront à la création du pays du Québec et d’avoir à l’horizon les prochaines échéances électorales de 2022 et de 2026... et de militer sans relâche pour que l’indépendance nationale advienne au plus tard 50 ans après le premier référendum d’autodétermination du 20 mai 1980.
« Pour ne pas en finir avec Octobre » Daniel Turp Le Journal de Montréal (29 décembre 2020)
Il y a 50 ans, le 28 décembre 1970, trois membres de la cellule Chénier du Front de libération du Québec (FLQ), Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard, étaient arrêtés dans un chalet de la municipalité de Saint-Luc où ils s’étaient réfugiés après l’assassinat du ministre Pierre Laporte. Négociée par le docteur Jacques Ferron, cette reddition est vue comme la fin de la crise d’Octobre, dont le 50e anniversaire a été souligné de multiples façons durant l’année 2020.
Pour ne pas en finir avec Octobre, il importe toutefois que se poursuivent les initiatives prises en 2020 pour continuer de faire toute la lumière sur les violations des droits fondamentaux qui ont été commises pendant la crise d’Octobre et obtenir pour les personnes qui en ont été victimes les réparations qui s’imposent.
Acte d’intervention
Par un Acte d’intervention volontaire à titre conservatoire, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) a entrepris une démarche visant à lui permettre d’intervenir dans l’affaire Dostie et Justice pour les prisonniers d’Octobre 1970 c. Procureur général du Canada. Se fondant sur les conclusions de son étude Démesures de guerre: abus, impostures et victimes d’Octobre 1970, l’IRAI a décidé d’appuyer les conclusions des parties demanderesses visant à faire déclarer invalides la Proclamation de 1970 sur les mesures de guerre (Proclamation Trudeau), le Règlement de 1970 concernant l’ordre public et la Loi de 1970 concernant l’ordre public (Loi Turner) ainsi que tous les actes posés illégalement par le gouvernement du Canada, et dont il appert qu’ils ont porté atteinte aux droits les plus fondamentaux de la partie demanderesse, Gaétan Dostie, et de toutes autres personnes ainsi brimées par ces actes dont l’association Justice pour les prisonniers d’Octobre 1970 se fait la porte-parole.
Comme il l’indique son acte d’intervention, l’IRAI considère que l’invalidité́ de la Proclamation Trudeau, du Règlement 1970 et de la Loi Turner entraîne avec elle la nullité́ de la suspension alléguée des droits survenue durant la crise d’Octobre, et restaure ainsi les garanties constitutionnelles de la Déclaration canadienne des droits. L’invalidité permet également d’invoquer les droits ayant leur source dans la coutume internationale et dans les principes généraux du droit, tel qu’ils sont reflétés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La demande d’intervention de l’IRAI dans l’affaire Dostie ne semble pas avoir plu au Procureur général du Canada qui a formulé le 17 décembre 2020 une opposition à cette intervention. L’IRAI est confiant que la Cour supérieure du Québec lui reconnaîtra un intérêt suffisant à intervenir dans cette affaire en raison de l’importance des questions qu’il soulève ainsi que l’expertise que ses chercheurs détiennent relativement aux enjeux de droits fondamentaux, tant individuels que collectifs, qui sont au coeur du litige. Pour les fins de cette intervention, l’IRAI sera représenté par Me Maxime Laporte ainsi que par le coordonnateur à la recherche de l’IRAI, Me Anthony Beauséjour.
Pour que justice soit rendue
Il ne faut donc pas se contenter de se souvenir une fois encore dans 10 ans, en 2030, de la crise d’Octobre. Si, par son geste, l’IRAI contribuera au devoir de mémoire, il passe aujourd’hui à l’action pour que justice soit rendue pour les prisonniers d’Octobre 1970 et pour que soit mis fin à l’impunité des acteurs d’une crise qui constitue l’un des plus sombres moments de l’histoire du Canada et du Québec.
« Le Canada doit cesser d’armer l’Arabie saoudite » Libby Davies, Douglas Roche et Adam Vaughan Le Devoir (18 septembre 2021)
La politique étrangère n’est généralement pas un enjeu lors des élections au Canada, et cette élection ne fait pas exception. Le rôle du Canada dans le monde a jusqu’à présent reçu peu d’attention sur le terrain. Cependant, en tant qu’anciens députés de quatre des cinq principaux partis politiques du Canada, nous sommes d’accord sur une question urgente de politique étrangère qui doit transcender les lignes de parti, soit celle de mettre fin aux exportations d’armes du Canada vers l’Arabie saoudite et de faire de cette question une priorité du prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur politique. […]
La majeure partie des exportations d’armes canadiennes vers l’Arabie saoudite consiste en des véhicules blindés légers, ou VBL, fabriqués par General Dynamics Land Systems-Canada à London, en Ontario. En 2014, le gouvernement canadien a négocié la vente de centaines de VBL à la Garde nationale saoudienne. D’une valeur estimée à 14 milliards de dollars, ce contrat d’armement est le plus important de l’histoire du Canada. Les transferts d’armes vers l’Arabie saoudite représentent désormais une majorité écrasante du total des exportations militaires non américaines du Canada.
L’Arabie saoudite présente un bilan désastreux en matière de droits de l’homme, tant sur son propre territoire qu’à l’étranger. Sur le plan intérieur, les autorités saoudiennes répriment les dissidents, les militants des droits des femmes et les religieux indépendants. Sur le plan international, l’Arabie saoudite dirige depuis 2015 une coalition d’États militairement impliqués au Yémen, où elle cherche à soutenir le gouvernement du président Hadi, engagé dans un conflit armé avec les forces rebelles houthies qui seraient liées à l’Iran.
Depuis que cette coalition a commencé son intervention, elle a été largement condamnée pour des violations graves et répétées du droit international humanitaire international, notamment le ciblage délibéré de personnes civiles à l’aide d’armes fournies par plusieurs des principaux exportateurs d’armes du monde. Le bilan des Houthis n’est pas meilleur et mérite certainement d’être condamné. Mais c’est l’Arabie saoudite que le Canada arme.
Des personnes civiles tuées
Les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont été indiscriminées et disproportionnées, tuant des milliers de personnes civiles tout en détruisant des infrastructures essentielles, notamment des installations d’eau, des fermes, des hôpitaux, des usines et des marchés. En 2017, une frappe aérienne de cette coalition contre un autobus scolaire a tué 40 enfants yéménites et en a blessé des dizaines. Un récent rapport d’une organisation yéménite indépendante de défense des droits de la personne a révélé que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pourrait avoir commis le crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode.
Un récent rapport du Groupe d’experts éminents des Nations unies sur le Yémen a désigné le Canada, pour une deuxième année consécutive, comme l’une des puissances mondiales qui contribuent à perpétuer le conflit yéménite en continuant à fournir des armes à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Ardi Imseis, professeur de droit à l’Université Queen’s et membre du groupe d’experts, a déclaré ceci : « Tant que les armes continueront à circuler, cette guerre ne fera qu’empirer. »
Traité sur le commerce des armes
Le 17 septembre 2021 a par ailleurs marqué le deuxième anniversaire de l’adhésion du Canada au Traité sur le commerce des armes, un accord multilatéral historique qui vise à réglementer le transfert international d’armes afin de réduire les dommages causés aux personnes civiles pendant les conflits armés. En tant qu’État partie, le Canada doit veiller à ce que les armes canadiennes ne soient pas utilisées pour cibler de telles personnes civiles. Comme l’a montré un récent rapport d’Amnistie internationale Canada et de Project Ploughshares, le Canada continue d’exporter, en violation de ces obligations juridiques, des véhicules blindés vers l’Arabie saoudite en dépit des violations des droits de la personne commises — et largement documentées — par ce pays dans le cadre du conflit au Yémen.
Après six ans de guerre, le Yémen connaît l’une des pires crises humanitaires au monde. On estime que 20,1 millions de Yéménites ont besoin d’une aide humanitaire, que 16,2 millions sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et que plus de 5 millions sont au bord de la famine. Le Yémen souffre d’années de conflit et d’un blocus imposé par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. […]
Le Canada a un rôle à jouer pour ramener la paix au Yémen ainsi qu’une obligation juridique de se conformer aux contrôles nationaux et internationaux des exportations. Le prochain gouvernement du Canada devrait suivre l’exemple de plusieurs pays européens et suspendre immédiatement les exportations d’armes vers l’Arabie saoudite, accroître l’aide humanitaire au Yémen et jouer un rôle diplomatique pour mettre fin à ce conflit brutal.
« Vers une justice climatique pour la nature, et non pour l’humain » Yenny Vega Cardenas, Sokhana Sene et Daniel Turp La Presse (30 octobre 2021)
Alors qu’une importante rencontre internationale sur le climat (COP26) au cours de laquelle seront examinés les progrès accomplis depuis Paris se tiendra au début de novembre prochain, il est probable que les gestes posés par la communauté internationale ne soient pas à la hauteur des défis climatiques décrits par les scientifiques. Le défi est autant plus difficile à relever lorsque les pays se rencontrent à une période où la pandémie de COVID-19 demeure toujours d’actualité. La lutte contre les changements climatiques risque de ne pas être perçue comme une priorité par certains pays.
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tire – encore – la sonnette d’alarme sur l’urgence climatique. En 30 ans, c’est la première fois qu’un rapport du GIEC utilise les mots « sans équivoque » pour désigner la responsabilité humaine dans les changements climatiques.
Il n’est aujourd’hui plus possible de douter raisonnablement de la gravité de la crise climatique causée par les activités humaines.
Les changements climatiques créent déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. À ce rythme, il n’y a pas de doute qu’on vivra tous plus d’évènements climatiques et avec une intensité croissante.
Ces changements généralisés sont d’autant plus importants lorsqu’ils affectent directement ou implicitement le cycle de l’eau. À titre d’exemple, le fleuve Saint-Laurent est, en raison de sa vulnérabilité aux changements climatiques, considérablement touché. Selon les experts, les températures des eaux profondes du Golfe ont enregistré une augmentation significative depuis quelques années, ce qui affecte notamment la population de bélugas. L’augmentation de la température réduit de même le débit d’eau et entraîne une augmentation de la concentration des polluants dans le Saint-Laurent. La contamination est aussi à la base d’un déclin d’espèces aquatiques alimentaires telles que la crevette nordique, le saumon de l’Atlantique et le crabe des neiges.
Pourtant, la prise de conscience climatique de la part des populations, des gouvernements et des décideurs tarde à se traduire en actes forts qui permettraient de réduire les effets ravageurs du réchauffement de notre planète. Alors qu’on montre du doigt l’humain, un changement de paradigme pourrait bien venir à la rescousse, car le dérèglement climatique n’est qu’une conséquence de la destruction sans limites de la nature.
La garantie de droits de la nature se présente comme un outil pour réaliser un modèle alternatif dans la transition écologique. Adoptée en 1992, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement proclame que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable et qu’ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Cette idéologie qui place l’humain au centre des préoccupations contraste avec celle des droits de la nature qui représente une vision intégrée et holistique de toute vie et de tous les écosystèmes.
On doit effectivement apprendre à vivre en harmonie avec la nature. En s’inspirant des traditions juridiques des peuples autochtones, cette tendance s’inscrit dans un courant écocentriste qui considère que l’Homme n’est plus le « maître » de la nature, mais une espèce parmi d’autres.
Elle implique de reconnaître les valeurs intrinsèques de la nature et des entités qui deviendront dorénavant des sujets de droit. Il est alors incontestable qu’un changement profond de paradigme de l’anthropocentrisme à l’écocentrisme doit se tenir afin de ralentir le rythme actuel des phénomènes climatiques.
À la reconnaissance de la nature comme un sujet de droit doit également s’ajouter celle d’une représentation. Il a été proposé que cette représentation soit assurée par des gardiens qui seraient épaulés par la communauté scientifique et auront connaissance des pratiques traditionnelles et ancestrales. Ces gardiens pourront représenter la nature à la table de négociation dans le cadre des projets qui pourraient impacter de manière importante les droits fondamentaux de la nature. Les dommages aux entités naturelles seraient donc internalisés dans l’économie qui devra prendre en compte la valeur des écosystèmes en santé, ainsi que leur droit à être restaurés et préservés. D’ailleurs, étant dans la décennie des Nations unies pour la restauration, nous serions dans l’obligation d’agir !
C’est dans cette voie que s’inscrit la mission de l’Observatoire international des droits de la nature (OIDN). Considérant que l’état du plus grand cours d’eau au Québec qu’est le fleuve Saint-Laurent se dégrade au fil des années, l’OIDN fait la reconnaissance de la personnalité juridique à ce fleuve l’un de ses projets phares en alliance avec des organismes comme Eau Secours, Waterlution et Stratégies Saint‑Laurent.
L’OIDN a rédigé un projet de loi qui reconnaît le fleuve Saint-Laurent comme une entité juridique et un sujet de droit. L’adoption d’un tel projet de loi pourrait permettre d’assurer une meilleure protection et contribution à sa restauration de ce fleuve. Cette initiative se veut un projet structurant pour une meilleure gouvernance de nos comportements vis-à-vis du fleuve. Notre projet de loi, publié depuis printemps 2021, est disponible dans notre ouvrage collectif intitulé Une personnalité juridique pour le fleuve Saint-Laurent et les fleuves du monde.
Pour faire émerger une alliance citoyenne autour du fleuve Saint-Laurent et s’inscrivant de la Journée mondiale des rivières et des fleuves l’OIDN a tenu le 26 septembre dernier une consultation publique pour entendre les citoyens et citoyennes sur le sujet. Cette consultation se poursuit et toute personne intéressée est invitée répondre à une série de questions visent entre autres à identifier les meilleurs gardiens du fleuve, les droits à reconnaître au fleuve Saint-Laurent et à la pertinence d’étendre ce statut à d’autres cours d’eau, tels les rivières et les lacs.
« Pour un traité mondial sur la riposte aux pandémies » Michael J.S. Beauvais, Bartha Maria Knoppers et Daniel Turp Le Devoir (6 décembre 2021)
L’arrivée du variant Omicron est un rappel brutal que la COVID-19 demeure un problème mondial nécessitant des réponses coordonnées, équitables et justes. Les membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ayant officiellement convenu, le 1er décembre 2021, d’aller de l’avant avec un traité sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, nous pensons que le Canada et le Québec doivent montrer la voie.
Les arguments en faveur d’un traité peuvent se résumer en une seule proposition: il n’existe actuellement aucun cadre international pour la préparation et la réponse en cas de pandémie. Le Règlement sanitaire international de l’OMS ne contient pas de règles spécifiques concernant les pandémies et n’oblige pas les pays à prendre des mesures particulières. Un traité offre la possibilité d’une réponse internationale harmonisée. Étant engagés envers le multilatéralisme et favorables à un ordre international fondé sur des règles, le Canada et les provinces, et en particulier le Québec, peuvent apporter des idées audacieuses à la négociation et à la rédaction du traité qui devrait être construit autour des six piliers suivants:
1. Priorité harmonisée des ressources — La disponibilité des équipements de protection individuelle, des produits thérapeutiques et des vaccins illustre des disparités de développement entre les pays. Les efforts mondiaux de vaccination se sont révélés nettement inadéquats, et l’adoption d’un cadre pour l’harmonisation de certains aspects des dispositions matérielles s’impose. Au minimum, les travailleurs et travailleuses de la santé et les personnes particulièrement vulnérables à une maladie donnée devraient être prioritaires pour les futures parties.
2. Approche « une seule santé » — Le Canada et le Québec peuvent plaider en faveur d’une approche « une seule santé » visant à rassembler les données sur les humains et les animaux non humains, y compris les séquences d’agents pathogènes, les données cliniques et génomiques pertinentes, ainsi que les données relatives à l’origine sociodémographique et géographique et à l’origine animale. Le fait que la COVID-19 soit très probablement apparue par transmission interespèces ne fait que souligner l’importance de cette démarche pour la santé de toutes les espèces.
3. Science ouverte — Le Canada et le Québec devraient faire pression pour le partage le plus large possible des données scientifiques et des résultats de recherche. La science ouverte gagne rapidement du terrain sur la scène internationale et promet de remettre en question les hiérarchies établies dans le domaine scientifique. Des approches plus souples en matière de propriété intellectuelle liée aux vaccins et thérapies COVID-19 devraient d’ailleurs être privilégiées.
4. Gouvernance des données — Le Canada et le Québec doivent tirer les leçons de leur propre expérience en matière de gouvernance des données. Les données doivent être considérées comme un bien public. Le traité devrait viser à créer des voies par lesquelles les données cliniques et de santé publique pourraient être utilisées en toute sécurité pour la recherche, d’une manière qui respecte les attentes et les besoins du public.
5. Renforcement des capacités — Le Canada et le Québec peuvent tirer parti de leur expérience en matière de renforcement des capacités et préconiser des facteurs favorables pour que tous les pays puissent remplir leurs obligations en vertu du traité. Les ressources humaines et matérielles ainsi que les connaissances doivent être partagées afin de garantir des capacités optimales de biofabrication réparties entre les pays. Des contributions financières minimales de la part des pays du Nord aideraient également, tout comme le fait de permettre la compensation de la dette existante par des investissements dans la formation et l’infrastructure informatique.
6. Cadre institutionnel — Dans le cadre institutionnel qui sera choisi, la création de groupes d’experts chargés de mettre à jour, tous les cinq ans, les règles contenues dans le traité et adoptées en vertu de celui-ci. Les groupes d’experts pourraient être institués pour s’intéresser à la surveillance de la santé publique, à la confidentialité et à la sécurité des données, aux droits fondamentaux ainsi qu’à la santé publique et à l’éthique de la recherche. La création de tels groupes favoriserait une approche interdisciplinaire de la préparation, et la réponse à la pandémie combinant les connaissances et l’expertise actuelles.
La pandémie de COVID-19 est malheureusement un événement susceptible de se répéter. S’il est impossible de savoir quand, où et comment la prochaine pandémie se produira, nous pouvons néanmoins définir comment la communauté internationale s’y préparera et répondra aux menaces futures. L’adoption d’un traité dès lors constitue une voie ambitieuse. Mais n’est-il pas temps, au bénéfice de l’humanité tout entière, d’avoir des idées ambitieuses ?