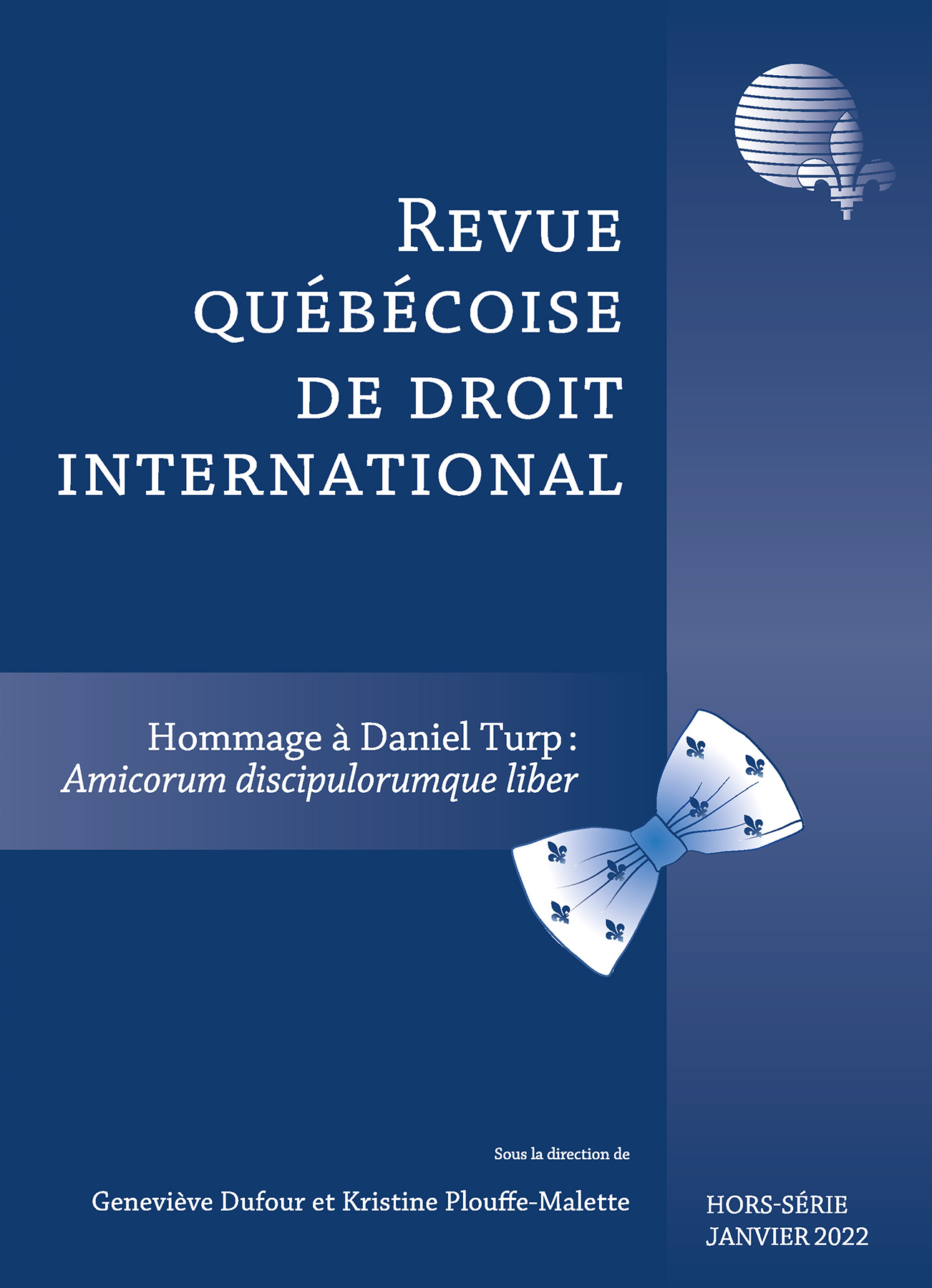Abstracts
Résumé
En 2006, la Commission de la culture de l’Assemblée nationale du Québec déposait son rapport Croire au patrimoine religieux du Québec, aux termes d’une vaste consultation publique, et formulait ses recommandations visant à assurer la pérennité du patrimoine religieux du Québec. Elle proposait l’imposition d’un moratoire sur la vente et le changement de vocation de tout lieu de culte, le temps qu’un inventaire de ce patrimoine soit complété, tenant compte de l’orgue comme critère d’intérêt. Les recommandations de ce rapport sont restées lettre morte, et la saga entourant la sauvegarde de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal donna lieu au lancement, par Daniel Turp et Antoine Leduc, du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, en juin 2010. Ce Manifeste demandait au premier ministre Jean Charest de nationaliser les plus beaux lieux de culte et d’en assurer le financement à long terme, dès lors que l’inventaire en serait complété. Une décennie s’est écoulée et l’idée même de la sauvegarde du patrimoine religieux s’est effacée du discours public au Québec, aucune politique n’ayant été adoptée en la matière, la Loi sur le patrimoine culturel conférant toujours au ministre de la Culture la discrétion entière du classement, du déclassement, de l’acquisition ou de l’aliénation des biens culturels. La Loi sur la laïcité de l’État, par une rédaction imprécise, pourrait ouvrir la porte aux objections de ceux qui refusent que l’État du Québec finance le patrimoine religieux, même si sa sauvegarde est reconnue à l’échelle des droits fondamentaux. La politique culturelle du Québec, Partout, la culture, adoptée en 2018, ne mentionne, pour tout programme relatif au patrimoine religieux, que le défi de l’actualisation de l’usage d’édifices religieux, dont la « requalification » des lieux de culte dits « excédentaires » en est l’illustration. Requiem pour le patrimoine religieux du Québec.
Abstract
In 2006, the Committee on Culture of the Quebec National Assembly tabled its report Croire au patrimoine religieux du Québec, following a broad public consultation, and formulated its recommendations aimed at ensuring the sustainability of Quebec’s religious heritage. It proposed the imposition of a moratorium on the sale and change of vocation of any place of worship until an inventory of this heritage is completed, taking into account the organ as a criterion of interest. The recommendations of this report went unheeded, and the saga surrounding the safeguarding of the Très-Saint-Nom-de-Jésus church in Montreal led to the launch, by Daniel Turp and Antoine Leduc, of the Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, in June 2010. This Manifeste asked then Premier Jean Charest to nationalize the most beautiful places of worship and to ensure their long-term funding once the inventory is completed. A decade has passed and the very idea of safeguarding religious heritage has faded from public discourse in Quebec, as no policy has been adopted on the matter, since the Cultural Heritage Act still gives the Minister of Culture complete discretion over the classification, declassification, acquisition, or alienation of cultural property. The Act Respecting the Laicity of the State, by virtue of its imprecise wording, could open the door to the objections of those who refuse to allow the State of Quebec to fund religious heritage, even though its preservation is recognized as a fundamental right. Quebec’s cultural policy, Partout, la culture, adopted in 2018, mentions as only program relating to religious heritage the challenge of updating the use of religious buildings, of which the “requalification” of so-called “surplus” places of worship is an example. Requiem for Quebec’s religious heritage.
Resumen
En 2006, el Comité de Cultura de la Asamblea Nacional de Quebec presentó su informe Creer en el patrimonio religioso de Quebec, luego de una amplia consulta pública, y formuló sus recomendaciones destinadas a garantizar la sostenibilidad del patrimonio religioso de Quebec. Propuso la imposición de una moratoria a la venta y cambio de vocación de cualquier lugar de culto, hasta que se complete un inventario de este patrimonio, teniendo en cuenta el órgano como criterio de interés. Las recomendaciones de este informe quedaron en letra muerta, y la saga en torno a la salvaguardia de la iglesia del Très-Saint-Nom-de-Jésus en Montreal dio lugar al lanzamiento, por parte de Daniel Turp y Antoine Leduc, del Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, en junio de 2010. Este Manifeste le pedía al primer ministro Jean Charest que nacionalizara los lugares de culto más hermosos y garantizara su financiación a largo plazo, una vez que se completara el inventario. Ha pasado una década y la idea misma de salvaguardar el patrimonio religioso se ha desvanecido del discurso público en Quebec, pues no se ha adoptado ninguna política en esta área, y la Loi sur le patrimoine culturel aún le confiere al ministro de Cultura total discreción en materia de clasificación, desclasificación, adquisición o enajenación de bienes culturales. La Loi sur la laïcité de l’État, por su redacción imprecisa, podría abrir la puerta a las objeciones de quienes se niegan a que el Estado de Quebec financie el patrimonio religioso, aunque se reconozca su salvaguardia a nivel de los derechos fundamentales. La política cultural de Quebec, Partout, la culture, adoptada en 2018, menciona como único programa relacionado con el patrimonio religioso, el desafío de actualizar el uso de los edificios religiosos, del cual la “recalificación” de los lugares de culto llamados “excedentes” es una ilustración. Réquiem por la herencia religiosa de Quebec.
Article body
Je crois surtout que, confusément, ma grand’mère trouvait au clocher de Combray ce qui pour elle avait le plus de prix au monde, l’air naturel et l’air distingué. Ignorante en architecture, elle disait : « Mes enfants, moquez-vous de moi si vous voulez, il n’est peut-être pas beau dans les règles, mais sa vieille figure bizarre me plaît. Je suis sûre que s’il jouait du piano, il ne jouerait pas sec. » Et en le regardant, en suivant des yeux la douce tension, l’inclinaison fervente de ses pentes de pierre qui se rapprochaient en s’élevant comme des mains jointes qui prient, elle s’unissait si bien à l’effusion de la flèche, que son regard semblait s’élancer avec elle; et en même temps elle souriait amicalement aux vieilles pierres usées dont le couchant n’éclairait plus que le faîte et qui, à partir du moment où elles entraient dans cette zone ensoleillée, adoucies par la lumière, paraissaient tout d’un coup montées bien plus haut, lointaines, comme un chant repris « en voix de tête » une octave au-dessus.
C’était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration.
Marcel Proust, Du côté de chez Swann – À la recherche du temps perdu I, Paris, Gallimard, 1987 aux pp 63-64
Le 15 avril 2019, à 19h50, heure de France, l’humanité retient son souffle. Notre-Dame de Paris brûle. Et avec elle, notre civilisation. Car c’est bien de notre civilisation occidentale dont il est question à ce moment[1].
Une vague d’émotions déferle alors dans le monde entier. Lorsque les voûtes de la nef s’effondrent, y laissant tomber la « forêt » qui retient le toit de cette cathédrale depuis des siècles, après que la célèbre flèche de Viollet-Le-Duc s’écroula sous la proie des flammes, l’impossible se produisit. Les débris envahirent le lieu, mais le crucifix du choeur se trouvant derrière le maître-autel, lui, resta debout. Et les grandes-orgues de Notre-Dame, les plus célèbres et célébrées, tout juste restaurées, ne reçurent point d’eau et s’en tirèrent miraculeusement, n’ayant souffert que de la poussière de plomb qui s’incrusta dans ses tuyaux.
Le président Macron, dans une adresse solennelle au peuple français le soir du drame, promit immédiatement de la restaurer. L’État français, propriétaire de cette cathédrale – comme de toutes les autres de France – ne ménagera aucun moyen à cet égard et s’acquittera de la tâche avec célérité. Si tout fonctionne comme prévu, le Te Deum y sera chanté en 2024, juste à temps pour le début des Jeux olympiques d’été qui doivent s’y tenir. Et l’archevêque de Paris pourra de nouveau y célébrer la messe, tandis que l’archidiocèse y reprendra ses activités cultuelles et culturelles, alors que les fidèles, autant que les touristes, pourront recommencer à en apprécier la grandeur et la beauté.
On s’est demandé s’il fallait la reconstruire à l’identique, ou si l’occasion n’était pas à saisir de poser un geste artistique moderne fort. Ce faisant, certains ont suggéré qu’un architecte contemporain puisse concevoir une nouvelle flèche, au goût du jour. On a ainsi pensé à Jean Nouvel, l’auteur de nombreux chefs-d’oeuvre architecturaux, dont la Philharmonie de Paris, pour y remédier. Interrogé à ce sujet, Jean Nouvel a simplement affirmé que la flèche de Viollet-Le-Duc devait être reconstruite à l’identique[2]. La réflexion s’est poursuivie en haut-lieu et l’on opta finalement pour une reconstruction à l’identique de Notre-Dame dans son ensemble[3].
L’État français ne sera pas seul dans ce vaste projet. Ainsi, les donateurs se sont généreusement manifestés dans les heures qui suivirent le sinistre. Grâce à une fiscalité avantageuse, les dons atteignirent très rapidement le milliard d’Euros[4]. Signe tangible de l’attachement dont Notre-Dame fait l’objet, cet empressement à vouloir sauver ce symbole phare de la France et de la civilisation occidentale ne manqua pas de susciter certaines critiques, principalement de la part de militants environnementalistes, qui voudraient que la cause environnementale et la crise des changements climatiques bénéficient d’un appui similaire[5]. Ces militants oublient toutefois que la préservation et la sauvegarde du patrimoine font partie intégrante du développement durable et de la lutte aux changements climatiques. Les diverses lois ou politiques adoptées en la matière s’en réclament d’ailleurs ouvertement depuis plusieurs années[6].
L’exemple de la reconstruction de Notre-Dame de Paris nous fournit les éléments essentiels qui doivent être considérés lorsqu’il s’agit d’aborder la délicate question de la sauvegarde, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine religieux d’une société donnée. Si d’autres modèles existent et bien qu’il ne soit pas parfait, le modèle français est néanmoins riche d’enseignements. C’est à cette aune que nous évaluerons le modèle qui prévaut actuellement au Québec. Car notre mère patrie nous devance en effet tant en ce qui a trait à la gestion de son patrimoine religieux qu’en matière de laïcité, ayant démontré que ces deux notions n’étaient pas incompatibles.
En 2005, la Commission de la culture de l’Assemblée nationale du Québec (la « Commission ») lança, proprio motu, une consultation générale sur l’avenir du patrimoine religieux du Québec, afin d’étudier la question dans une perspective globale, en ce qui a trait au patrimoine religieux bâti, mobilier, archivistique et immatériel appartenant à l’ensemble des traditions religieuses du Québec. L’objectif poursuivi était de trouver des solutions durables afin de savoir que conserver, comment le conserver et qui le conservera.
Dans le document de consultation de juin 2005 préparé par la Commission en amont des consultations qu’elle allait mener sur tout le territoire du Québec entre septembre 2005 et février 2006, la problématique de la sauvegarde du patrimoine religieux, en ce qui a trait aux églises, était ainsi posée :
[…] Le choix des églises à conserver ou à fermer n’est cependant pas fait sur la base de leur seule valeur patrimoniale. L’accessibilité du lieu, la solidité et l’état général de conservation du bâtiment sont aussi des critères qui sont pris en considération au moment de la prise de décision. Ainsi, une église plus récente et en « meilleure condition » peut être privilégiée au détriment de bâtiments de qualité architecturale et artistique supérieure, mais dont les coûts d’entretien et de restauration sont plus élevés. C’est de cette façon que peut actuellement être mis en péril le riche patrimoine collectif que constituent les églises[7]. [Nous soulignons]
Le professeur émérite Daniel Turp, alors député de la circonscription de Mercier, en était le vice-président. C’est dans ce contexte que nous avons connu le professeur Turp, lors des audiences de la Commission, alors que nous déposions un mémoire intitulé « L’avenir de l’orgue et de ses artisans dans le contexte de la conservation du patrimoine religieux québécois : quelques éléments cruciaux à prendre en considération »[8].
Nous proposions alors de constituer un véritable inventaire des lieux de culte du Québec ainsi que des orgues qui s’y trouvent, l’orgue devenant un critère d’intérêt et de classement du bâtiment, pour qu’ensuite soient nationalisés par l’État du Québec les lieux dits d’intérêt national. Jusqu’à ce que ce travail d’inventaire fût complété, nous proposions que la législation québécoise soit modifiée pour imposer un moratoire aux fabriques et communautés religieuses restreignant leur droit de disposer ou de modifier la vocation des biens constituant ce patrimoine religieux.
Plusieurs de nos recommandations furent retenues par la Commission dans son rapport Croire au patrimoine religieux du Québec[9], dont le président du comité de rédaction était le professeur Turp, parmi lesquelles la réalisation de l’inventaire proposé et l’adoption d’un moratoire, le temps nécessaire à sa complétion et à l’articulation d’une politique du patrimoine religieux du Québec. De belle facture et de grande qualité, ce rapport présentait les 33 recommandations de la Commission visant à assurer la conservation et la pérennité du patrimoine religieux du Québec.
Bien qu’il fût donné suite à certaines de ses recommandations, le rapport, pour l’essentiel, fut tabletté. Depuis lors, la situation du patrimoine religieux du Québec n’a cessé de se précariser. Par la suite, nous avons eu l’occasion de nous lier d’amitié avec le professeur Turp lors de combats que nous avons menés ensemble pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec. En juin 2010, nous étions les co-instigateurs du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec[10]. Nous allons, dans un premier temps, rendre compte du contexte ayant donné lieu à ce Manifeste, des démarches et interventions publiques que nous avons poursuivies ensemble dans sa foulée, et dresser un état des lieux quant aux propositions que nous avions défendues et au sort qui leur fut réservé (I).
En second lieu, nous verrons que l’idée même de la sauvegarde du patrimoine religieux s’efface progressivement du débat public au profit d’un discours le ravalant comme étant un élément parmi d’autres d’un patrimoine dit « culturel », qui se veut plus général et englobant.
L’exemple le plus récent et le plus éloquent à ce sujet nous vient de haut : dans son rapport accablant déposé au mois de juin 2020 portant sur la sauvegarde et la valorisation du « patrimoine immobilier » du Québec, le Vérificateur général du Québec, tout en coiffant du bonnet d’âne le ministère de la Culture et des Communications[11] qui
n’assume pas adéquatement ses responsabilités en matière de patrimoine immobilier et n’exerce pas le leadership attendu dans la résolution d’enjeux de sauvegarde qui existent depuis des décennies [...][12]
indique, quant à la portée de ses travaux, qu’ils excluent les tâches déléguées par le ministère au Conseil du patrimoine religieux du Québec qui, faut-il le rappeler, administre toutes les sommes et les programmes de l’État en matière de sauvegarde et de « requalification » du patrimoine religieux bâti du Québec. La belle affaire! Quand on sait, en effet, que le patrimoine religieux constitue, au Québec, tant quantitativement que qualitativement, l’essentiel de notre patrimoine, tant bâti qu’immatériel[13], avec celui de l’Église catholique au premier plan, pour des raisons historiques et culturelles[14].
Pourtant, les écueils qui ont été soulevés depuis plusieurs années concernant la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec subsistent toujours. De là à dire que la cause du patrimoine religieux est entendue, il n’y a qu’un pas, que nous franchissons dans ce texte.
Ainsi, depuis la Révolution tranquille et jusqu’à nos jours, la laïcisation progressive de notre société et de ses institutions s’est accompagnée d’une désaffection grandissante de la pratique religieuse, pour ne pas dire, dans bien des cas, d’une aversion au fait religieux[15]. Nous avons assisté, comme ailleurs en Occident, à une « sortie de la religion », pour reprendre le mot de Marcel Gauchet[16].
Dans l’aboutissement logique et historique de la consécration législative du principe de laïcité de l’État du Québec[17], il faudra voir si la quadrature du cercle en résultera, puisque certains esprits malavisés pourraient prétendre que la rédaction actuelle de la Loi sur la laïcité de l’État[18] ne permette à l’État du Québec de continuer, d’une part, de subventionner la sauvegarde, la réfection, l’entretien ou la conversion du patrimoine religieux du Québec et, d’autre part, d’accorder divers avantages fiscaux ou congés de taxes, foncières ou autres, aux organismes religieux, même si des arguments légitimes et sérieux peuvent être opposés à l’encontre de telles objections (II). Une meilleure rédaction législative aurait empêché de donner éventuellement prise à de tels débats, dont le patrimoine religieux n’a pas besoin.
Si tel s’avère le cas, en plus de l’inaction dont ont fait preuve les gouvernements, les autorités religieuses et la société civile depuis trop longtemps en la matière, il faudra malheureusement en faire le deuil et chanter le Requiem du patrimoine religieux du Québec.
I. Du contexte ayant donné lieu au Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec
Ne revenons donc pas sur la chose jugée et bien jugée; et disons de haut au gouvernement, aux communes, aux particuliers, qu’ils sont responsables de tous les monuments nationaux que le hasard met dans leurs mains. Nous devons compte du passé à l’avenir. Posteri, posteri, vestra res agitur.
Quant aux édifices qu’on nous bâtit pour ceux qu’on nous détruit, nous ne prenons pas le change; nous n’en voulons pas. […] De grâce, employez mieux vos millions.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris – 1482, Paris, Gallimard, 2009, 726 à la p 739
Nous allons présenter les grands traits du rapport de la Commission, Croire au patrimoine religieux du Québec (A), pour ensuite aborder le cas de la sauvegarde de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (B), qui allaient mener au lancement du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, en juin 2010.
A. Croire au patrimoine religieux du Québec
Le moment est venu où il n’est plus permis à qui que ce soit de garder le silence. Il faut qu’un cri universel appelle enfin la nouvelle France au secours de l’ancienne. Tous les genres de profanation, de dégradation et de ruine menacent à la fois le peu qui nous reste de ces admirables monuments du moyen âge, où s’est imprimée la vieille gloire nationale, auxquels s’attachent à la fois la mémoire des rois et la tradition du peuple.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris – 1482, Paris, Gallimard, 2009, 726
En juin 2005, dans le Document de consultation diffusé par la Commission sollicitant des mémoires pour les audiences publiques qu’elle s’apprêtait à tenir, la préoccupation qui anime ses membres est clairement exprimée dans son avantpropos :
Ces dernières années, rares sont les députés qui n’ont pas été sollicités ou consultés relativement à la sauvegarde d’une église menacée de fermeture, à l’entretien déficient d’un bâtiment religieux, à la vente annoncée d’un monastère ou à la restauration coûteuse d’une oeuvre d’art religieux. Derrière ces demandes particulières, auxquelles des solutions ponctuelles ou à plus long terme ont souvent été trouvées, se cache toutefois une problématique qui requiert plus que des interventions à la pièce[19]. [Nous soulignons]
Ainsi, les participants étaient invités à répondre de leurs suggestions aux principales questions qui intéressaient la Commission, à savoir :
Quels sont les critères ou les valeurs qui devraient être au coeur du processus de sélection des biens à caractère religieux devant être préservés et mis en valeur?
Les outils législatifs et réglementaires permettent-ils de répondre adéquatement aux défis actuels posés par le patrimoine religieux, en ce qui concerne notamment la propriété de ce patrimoine, sa protection, sa gestion future?
À votre avis, la Loi sur les fabriques devrait-elle être revue? Quelles modifications y apporteriez-vous?
À votre avis, la Loi sur les biens culturels devrait-elle être revue? Quelles modifications y apporteriez-vous?
Quel devrait être le rôle respectif des différents acteurs concernés par la protection du patrimoine religieux du Québec (État, Église, communautés religieuses, municipalités, citoyens, etc.)?
Le Québec devrait-il s’inspirer d’expériences et d’initiatives étrangères dans sa recherche de solutions pour la protection et la mise en valeur de son patrimoine religieux? Si oui, lesquelles?[20]
Comme on peut le constater, la Commission a ratissé large et posé la problématique de la conservation du patrimoine religieux avec un désir sincère de trouver des solutions pérennes à son avenir. Elle nous mettait cependant en garde, dès le premier abord, comme s’il s’agissait là d’une fatalité, de résister à la tentation de « vouloir tout conserver ou de tout confier à l’État », proposant plutôt aux divers acteurs une « réflexion commune sur l’avenir d’un patrimoine collectif, la prémisse des travaux [devant] être celle des responsabilités partagées »[21].
Qualifié aussi de « patrimoine aux pieds d’argile »[22], en raison du déclin de la pratique et des vocations religieuses, dont l’impact sur l’utilisation, le sens et les finances de ce patrimoine est évident, le concept d’églises dites « excédentaires » y est évoqué, de même que la classification et la hiérarchisation des lieux de cultes en fonctions d’inventaires alors en cours de réalisation, afin de déterminer les églises qui seront conservées.
À ce moment-là, ce qui avait été fait, en matière de conservation du patrimoine religieux québécois, consista d’une part à maintenir le statu quo législatif, et d’autre part à financer au cas par cas les diverses initiatives locales visant à préserver ce patrimoine religieux.
Pour ce faire, la Fondation du patrimoine religieux[23], mise sur pied en 1995, par un regroupement multiconfessionnel de diverses traditions religieuses propriétaires de lieux de cultes et d’autres bâtiments à caractère religieux, avait servi jusqu’alors de véhicule de distribution des subventions gouvernementales aux divers projets de restauration qui lui étaient soumis, divers comités d’experts permettant à la fondation de faire des choix, éclairés ou non, quant aux projets devant être retenus et financés, et travaillant à la réalisation de premiers projets d’inventaires.
Dans son rapport Croire au patrimoine religieux du Québec, la Commission formule ses recommandations selon quatre axes, à savoir : (i) connaître le patrimoine religieux, (ii) protéger le patrimoine religieux, (iii) transmettre le patrimoine religieux, et (iv) gérer le patrimoine religieux.
Au sujet du premier volet, la Commission recommande de compléter les inventaires du patrimoine religieux matériel et d’accorder la priorité à l’inventaire des archives religieuses et des orgues. De même, elle suggère de commander un programme d’enquête sur le patrimoine religieux immatériel et de stimuler la formation et la recherche sur le patrimoine religieux[24].
Quant à la protection du patrimoine religieux, la question de la nationalisation du patrimoine religieux du Québec fut lancée s’inspirant, en cela, du modèle français qui, depuis la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État[25], a confié la responsabilité des cathédrales à l’État et celle des églises paroissiales aux communes, conférant ainsi aux autorités civiles la responsabilité du patrimoine religieux français[26]. La Commission, devant les objections de l’ensemble des autorités religieuses de toutes confessions qu’elle entendît, n’a pas retenu cette piste, jugeant que la question du droit de propriété des lieux de culte et autres bâtiments religieux ne nécessitait pas de solutions « radicales »[27]. La Commission se montra cependant consciente du fait que cette question soit au coeur de la problématique de la conservation du patrimoine religieux :
Si la question de la propriété des biens religieux a tant retenu l’attention, c’est qu’elle est intimement liée au processus décisionnel conduisant au choix des lieux de culte à conserver ou à aliéner. Ce n’est toutefois pas l’identité du titulaire du droit de propriété des lieux de culte qui, selon la Commission, pose véritablement problème, mais plutôt le pouvoir d’aliénation des biens qui est associé à ce droit de propriété. […] C’est justement ce droit de regard sur l’avenir des biens religieux que revendiquent les citoyens, les municipalités et même l’État. Les municipalités et l’État ne nient pas que les corporations ecclésiastiques et religieuses soient, selon les règles du droit civil, les seuls véritables propriétaires de ces lieux.
La Commission constate que les citoyens ne revendiquent pas en définitive le droit de propriété sur ces bâtiments, mais plutôt le droit d’être impliqués dans les décisions touchant à la reconversion de bâtiments auxquels ils sont attachés. Les municipalités, qui ont notamment à coeur l’aménagement de leur territoire et qui considèrent le tourisme culturel comme une avenue à explorer, souhaitent quant à elles être informées et consultées avant la fermeture, la vente ou la démolition d’un bien religieux qui structure leur environnement. L’État, qui subventionne la restauration des lieux de culte, revendique aussi le droit de participer au choix des lieux de culte à conserver[28]. [Nous soulignons]
Sans préconiser de solutions « radicales » à cet état de fait, la Commission en a néanmoins proposé qui soient originales. Pensant alors l’avenir du patrimoine religieux dans le « temps long », à l’invitation des historiens Luc Noppen et Lucie K. Morisset, la Commission retient « que l’échéance pour mettre en place et donner effet aux diverses mesures visant la sauvegarde du patrimoine religieux, en particulier des lieux de culte, soit fixée à l’an 2010 »[29].
Afin de permettre la complétion des inventaires, l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique visant l’ensemble du patrimoine, la Commission proposa que soit institué un moratoire sur l’aliénation et la modification des bâtiments religieux et des cimetières pour l’ensemble du territoire québécois[30].
Dans la même veine, elle recommanda d’introduire un mécanisme relatif à l’aliénation des bâtiments religieux et des cimetières, consistant en l’inscription de charges patrimoniales, à la suite de la réalisation des inventaires, au registre foncier quant aux titres de propriété des biens religieux que l’État souhaite préserver et qui ne seraient pas couverts par les autres moyens de protection alors prévus dans la Loi sur les biens culturels[31] ou d’autres lois applicables.
Ce mécanisme obligerait le propriétaire de tout bien grevé d’une telle charge patrimoniale de publier un avis dans les douze (12) mois précédant son intention de l’aliéner, forçant la tenue d’une assemblée publique par la municipalité où se trouve le bien, lors de laquelle une présentation du Conseil du patrimoine religieux du Québec serait faite afin d’expliquer la valeur patrimoniale du bien visé et de rendre publique toute étude en visant la reconversion ou la mise aux normes. Dans les soixante (60) jours précédant toute transaction, l’État ou la municipalité, locale ou régionale, disposerait d’un droit de premier refus de se porter acquéreur du bien grevé qui permettrait de préserver, si cette autorité publique l’exerce, la valeur patrimoniale des bâtiments et cimetières aliénés[32].
En ce qui a trait à la transmission du patrimoine religieux, la Commission proposa une kyrielle de mesures visant à soutenir les efforts de mise en valeur, dont la promotion du tourisme religieux, l’initiation des jeunes au patrimoine religieux et la sensibilisation du public en général à ce patrimoine. La Commission a en effet constaté qu’en dépit des nombreux mémoires déposés et témoignages entendus, le patrimoine religieux demeurait largement méconnu de la majorité des citoyens du Québec, en raison, notamment, de la baisse de la pratique religieuse, de la déconfessionnalisation du système scolaire québécois[33] et, aussi, d’une absence de spécialistes en histoire de l’art capables d’en expliquer le sens[34].
Pour y remédier, la Commission recommanda qu’une partie des subventions versées par l’État relativement au patrimoine religieux soit réservée à sa mise en valeur[35]. Quant à la transmission du sens, elle suggéra que le ministère de l’Éducation s’assure qu’un volet de sensibilisation au patrimoine religieux soit inclus dans le nouveau programme d’éthique et de culture religieuse qui était alors en cours d’élaboration[36]. Elle proposa enfin l’instauration d’une Journée nationale du patrimoine religieux[37].
Pour ce qui est de la gestion du patrimoine religieux, la Commission souhaita consolider le rôle de coordination du Ministère, recommanda de transformer la Fondation du patrimoine religieux du Québec en un Conseil du patrimoine religieux du Québec, incita à ce que les responsabilités régionales et locales de gestion de ce patrimoine soient reconnues (lire des municipalités), et plaida pour la diversification des modes de financement de ce patrimoine[38].
En ce qui a trait au rôle du Ministère, la Commission écrivit :
La Commission est convaincue que la connaissance, la protection et la transmission du patrimoine religieux doivent être consacrées comme mission nationale. L’intérêt qu’a suscité la consultation publique démontre un attachement des Québécois à leur patrimoine religieux. L’État doit en prendre acte, ce qui suppose dès lors que le gouvernement du Québec doit s’acquitter de cette mission et assurer la coordination des actions visant à protéger et à mettre en valeur le patrimoine religieux. Le ministère de la Culture et des Communications doit continuer d’agir et d’assurer cette coordination[39]. [Nous soulignons]
Dans cet esprit, la Commission recommanda de consolider ce rôle du Ministère (i) en édictant des orientations ministérielles qui s’appliqueront aux autres ministères, sociétés d’État et agences gouvernementales dans le domaine du patrimoine religieux, et (ii) en élaborant et coordonnant un plan d’action gouvernemental en la matière[40].
De même, la Commission proposa de revoir le rôle de la Fondation du patrimoine religieux du Québec et la transformant en Conseil du patrimoine religieux du Québec, revoyant sa gouvernance et les programmes dont elle serait responsable, confirmant non seulement son rôle de gestionnaire des subventions de l’État, mais prévoyant aussi la possibilité que ce conseil puisse devenir propriétaire et gestionnaire du patrimoine religieux dit « excédentaire », afin de le mettre en valeur, tout en développant une expertise de services-conseils et de formation des artisans en matière de sauvegarde du patrimoine religieux[41].
Quant au financement du patrimoine religieux, la Commission recommanda de maintenir les programmes existants, mais d’en ajouter de nouveaux, favorisant le mécénat, et d’accorder des avantages fiscaux à ceux qui deviendraient propriétaires de lieux de cultes dits « excédentaires », dans la mesure où ils poursuivent des objets de bienfaisance[42].
En somme, la Commission proposait une petite révolution dans l’approche gouvernementale de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine religieux du Québec, qui aurait pu servir à l’élaboration d’une véritable politique en la matière, tout autant que d’assises à celle d’une politique du patrimoine culturel pris dans son ensemble[43]. Elle le pourrait toujours, d’ailleurs.
Cette révolution n’eut pas lieu. Pas d’inventaires, pas de moratoire, Québec ayant opté pour un « moratoire volontaire » avec les propriétaires de bâtiments religieux[44], et ce, nonobstant un projet de loi présenté par le professeur Turp, alors député de Mercier, mort au feuilleton[45].
L’échéance de l’an 2010 évoquée plus tôt pour y parvenir ne fut pas respectée, loin s’en faut, mais fut plutôt le théâtre d’une véritable saga, entourant la sauvegarde de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal et de ses grandes orgues, ramenant de plein fouet la question de la propriété du patrimoine religieux et de ceux qui ont véritablement voix au chapitre quant à son avenir, mais constituant aussi une fable sur l’incompétence de l’administration publique et la mauvaise foi de certains politiques.
B. L’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal et ses grandes orgues
Ceci est une question d’intérêt général, d’intérêt national. Tous les jours, quand l’intérêt général élève la voix, la loi fait taire les glapissements de l’intérêt privé. La propriété particulière a été souvent et est encore à tous moments modifiée dans le sens de la communauté sociale. On vous achète de force votre champ pour en faire une place, votre maison pour en faire un hospice. On vous achètera votre monument.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris – 1482, Paris, Gallimard, 2009, 726 aux pp 740-741
C’est une histoire de mort, de descente aux enfers et de résurrection. Littéralement. Le cas de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus est unique.
D’abord mise à mort en juin 2009 par l’archevêque de Montréal de l’époque, son Éminence le Cardinal Jean-Claude Turcotte, par sa fermeture au culte[46], fait inusité, elle fut ressuscitée par son successeur, Monseigneur Christian Lépine, en décembre 2014. Sans que les pouvoirs publics n’y puissent quoi que ce soit.
Au moment de sa fermeture, les autorités religieuses invoquèrent les frais importants d’entretien annuel, de coûteuses réparations majeures urgentes à y effectuer, et leur absence de moyens pour s’en acquitter, afin de justifier cette décision. En porte-à-faux avec les paroissiens, le curé et la coalition pour la sauvegarde de l’église (composée de gens du quartier et d’élus locaux), l’année 2010 fut riche en rebondissements dans cette affaire qui allait être hautement médiatisée.
Ainsi, en avril 2010, le quartier Hochelaga-Maisonneuve apprit que l’archidiocèse de Montréal avait reçu une offre de la cathédrale de Toronto pour l’achat de ses grandes-orgues, qu’il envisageait très sérieusement d’accepter, pour ensuite céder la propriété de l’église en contrepartie d’une somme symbolique d’un dollar à compter du mois de juillet 2010, cessant alors de l’assurer et de la chauffer, afin qu’elle soit démolie pour y faire place à des logements sociaux, considérés comme « moindre mal »[47].
La coalition pour la sauvegarde de l’église demanda au Ministère de débloquer des fonds d’urgence de l’ordre de 500 000 $ pour consolider la façade et protéger l’orgue, le temps qu’une nouvelle vocation lui soit trouvée. Le ministère fit d’abord la sourde oreille, indiquant que l’église et ses orgues ne présentaient pas de valeur patrimoniale – ce qui fut contredit par le Conseil du patrimoine religieux du Québec[48] – et ne pas disposer de tels fonds d’urgence.
N’y changeait rien le fait que les grandes-orgues avaient été restaurées à grands frais par de généreuses subventions gouvernementales et une souscription publique échelonnée sur plusieurs années, puisque l’église était demeurée ouverte durant plus de cinq ans après l’octroi de ces subventions, seule exigence gouvernementale à cet égard, ni le fait que s’en était suivi la création du festival Orgue et couleurs qui avait, à ce moment, animé la vie culturelle montréalaise durant plus d’une décennie, l’attachée de presse de la ministre affirmant alors qu’
[o]n a déjà classé une trentaine d’orgues, on ne peut pas faire une collection d’orgues. Car ça vient avec des responsabilités. On ne peut sauver toutes les églises, comme on ne peut pas sauver tous les chats qui sont dans les ruelles[49],
et la ministre de la Culture indiquant quant à elle avoir « des choix difficiles à faire »[50].
Les réactions fusèrent de toutes parts, allant de l’un des titulaires du grand orgue de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, déclarant la chose « impensable »[51], à Phyllis Lambert et Serge Joyal, soulignant « le symptôme d’un manque de vision »[52].
C’est dans ce contexte que nous avons rédigé et lancé, avec le professeur Turp, sur le parvis de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, le 8 juin 2010, le Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec[53]. Forts de l’appui de plus de 129 signataires[54], nous demandions au premier ministre Jean Charest de cesser les interventions ponctuelles et à la carte, en dotant le Québec d’une véritable politique culturelle d’ensemble (intégrant le patrimoine religieux) qui soit cohérente, soulignant qu’il n’y avait pas d’intérêt à continuer d’investir de la sorte dans sa préservation si, cinq ans après l’octroi d’une subvention, l’Église peut unilatéralement décider de reprendre à son compte ce patrimoine et d’en disposer à sa guise! Voici les demandes faites à monsieur Charest :
Considérant la valeur historique et culturelle que représente notre patrimoine religieux pour la nation québécoise, nous vous demandons, monsieur le Premier Ministre, ainsi qu’au gouvernement du Québec, de poser les gestes suivants :
-d’imposer un moratoire sur la vente, le changement de vocation ou toute autre disposition des lieux de culte du Québec pour une période d’un an;
-de former un comité d’experts chargé (i) de compléter l’inventaire de ce patrimoine religieux, y compris le patrimoine organistique, afin d’identifier les églises qu’il faudrait impérativement conserver; (ii) de faire des recommandations à ce sujet, afin de séparer le bon grain de l’ivraie, d’ici la fin de l’année 2010;
-parmi les critères devant présider à l’établissement des lieux à conserver, que l’orgue et la riche tradition musicale qu’il représente soit un critère prépondérant;
-qu’aux fins d’un classement patrimonial, l’époque de construction des églises et des instruments ne soit pas limitée dans le temps et à la seule facture d’ici. Par exemple, les trois orgues construites par le facteur allemand Rudolf von Beckerath, installées à Montréal à la Queen Mary United Church, à l’Oratoire Saint-Joseph et à l’église de l’Immaculée-Conception, de 1959 à 1961, ont une importance historique indéniable dans l’évolution de notre facture et de notre école d’orgue et, à ce titre, méritent tout autant d’être conservées que des instruments plus anciens, fabriqués par des facteurs d’ici;
-de décréter, suite aux recommandations du comité d’experts, que seuls les plus beaux lieux soient nationalisés par le gouvernement du Québec à titre de patrimoine collectif de tous les Québécois;
-de circonscrire les subventions gouvernementales aux lieux patrimoniaux nationalisés;
-de demander aux Églises des diverses confessions présentes sur le territoire du Québec de privilégier l’exercice du culte dans ces plus beaux lieux patrimoniaux et de vendre les autres, moins importants, afin de financer l’entretien du patrimoine nationalisé, le produit de cette vente devant être versé à un fonds du Conseil du patrimoine religieux administré par l’État québécois;
-de doter le Québec d’une véritable politique du patrimoine culturel, y compris du patrimoine religieux, afin d’en assurer la pérennité, la constante évolution et la mise en valeur, en s’assurant notamment que les artisans et musiciens, dont les organistes, soient associés à l’élaboration de cette politique;
-enfin, de pourvoir immédiatement aux besoins urgents que nécessitent la préservation et la réouverture de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal.[55]
La ministre de la Culture de l’époque, Christine St-Pierre, affirma « comprendre nos revendications », mais indiqua du même souffle « ne pas disposer de l’enveloppe budgétaire pour nationaliser le patrimoine religieux ». Elle précisa qu’en vertu d’un classement effectué par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus n’avait obtenu que la cote « C »[56], ne présentant pas de valeur patrimoniale nationale. De même, ses grandes orgues ne font pas partie des orgues Casavant classées. « Même si l’on classait l’orgue, ça ne règlerait pas le problème de l’église ». Mentionnant n’avoir reçu aucun projet de la part de quiconque pour assurer son avenir, la ministre conclut en disant qu’« en même temps, cette bâtisse nécessite des travaux dont les coûts seraient supérieurs à 2 M$ et je n’ai pas cet argent »[57].
Pourtant, l’architecte et urbaniste émérite Jean-Claude Marsan revint sur le problème de l’inventaire réalisé par ledit Conseil :
L’inventaire : voilà la source première du problème. La réalisation de celui-ci a débuté en 2004, mais n’est pas fiable, comme le démontre, entre autres, le cas de cette église TSNJ classée « C » alors que, de toute évidence, elle mérite mieux. Il y a une explication à cette dérive : au lieu de recourir pour cet inventaire à une méthodologie rigoureuse, éprouvée à l’échelle internationale, les responsables de l’opération au ministère de la Culture ont concocté une méthodologie maison, présentant de nombreuses lacunes. Plusieurs personnes compétentes dans le domaine ont tenté d’attirer l’attention du ministère sur ces déficiences, mais en vain. […]
Le Québec possède le plus important patrimoine religieux au nord du Mexique. Ses efforts pour le sauvegarder ne seront prometteurs que s’ils prennent appui sur un inventaire de première qualité, rigoureux et complet, défendable à l’échelle internationale[58].
Nonobstant nos efforts et ceux de la coalition pour la sauvegarde de l’église, les démarches ne portèrent pas les fruits escomptés. Le 21 juin 2010, la coalition avait réduit sa demande d’aide au Ministère à 50 000 $, somme minimale requise pour chauffer l’édifice pendant l’hiver. Elle essuya une fin de non-recevoir, alors que le diocèse de Montréal avait consenti à un moratoire sur la vente de ses orgues au diocèse de Toronto, malgré une offre ferme d’un million de dollars et l’assumation par l’acheteur des dépenses de démantèlement et de déménagement de l’orgue[59].
C’est dans ce contexte que nous avons déposé auprès de la ministre de la Culture, le 24 août 2010, avec le professeur Turp et l’organiste Gaston Arel, des demandes de classement de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus et de ses grandes orgues Casavant en vertu de la Loi sur les biens culturels[60]. Nous avons reçu un accusé de réception le 27 août 2010. Puis, le 20 septembre 2010, moins d’un mois après leur dépôt, la décision discrétionnaire et sans appel du Ministère tombait, rejetant nos demandes[61] :
Nous avons le regret de vous annoncer que la demande d’attribution de statut ne peut être retenue. La complexité du patrimoine religieux a commandé une analyse globale de la situation et votre dossier en a été tributaire. […]
L’intérêt patrimonial de cette église se situe au niveau local. […]
Nous tenons à vous assurer que, même si nous n’envisageons pas le classement de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus et de son orgue, nous vous encourageons dans vos démarches de sensibilisation et de mise en valeur de ce patrimoine précieux à tout égard. D’ailleurs, vous savez que votre municipalité pourrait utiliser ses propres pouvoirs en vertu de la Loi sur les biens culturels pour citer l’église à titre de monument historique. […]
Sachant que dans son plus récent rapport d’audit la Vérificatrice générale déplorait les délais entourant le traitement des demandes de classements, dont certaines demeurent sans réponse plus de dix ans après leur dépôt auprès du Ministère[62], force est de constater que notre dossier a fait l’objet d’un traitement « spécial », à saveur hautement politique, lui réservant un enterrement de première classe.
En janvier 2011, avec le professeur Turp, nous avons continué nos démarches dans le cadre des consultations publiques portant sur le projet de loi 82 qui allait mener à l’adoption de la Loi sur le patrimoine culturel[63]. Dans notre mémoire[64], en plus de déposer officiellement en commission parlementaire le texte du Manifeste, nous proposions de reconnaître le caractère particulier du patrimoine religieux, le projet de loi ne prévoyant rien de particulier à ce sujet, alors que la notion de « paysages » y était introduite.
De plus, nous demandions un meilleur encadrement de la discrétion dont jouit le ministre de la Culture à l’égard du classement du patrimoine culturel. En effet, nous suggérions que ce processus soit clairement inscrit dans la Loi sur le patrimoine culturel et qu’il prévoit :
-les modalités pour tout citoyen ou groupe de citoyens désireux de faire une demande de classement au ministre de la Culture;
-les délais d’étude de toute telle demande par le ministre de la Culture et l’imposition d’un moratoire sur le bien visé pendant l’étude de la demande;
-l’obligation du ministre de la Culture de confier à un comité d’experts indépendant et identifié aux termes de la demande le soin d’évaluer une demande de classement;
-le délai de réponse à la demande de classement du ministre de la Culture sur réception de l’avis des experts;
-la possibilité, pour le citoyen demandeur, d’en appeler d’une décision défavorable du ministre de la Culture, dans un premier temps devant le Conseil du patrimoine culturel, et de produire dans ce contexte une autre expertise;
-la possibilité, pour le citoyen demandeur, d’aller en évocation d’une décision défavorable du Conseil du patrimoine culturel devant la Cour supérieure du Québec.
Ces mesures éviteraient que des demandes de classement sérieuses, comme celle que nous avions présentée relativement à l’église du TrèsSaint-Nom-de-Jésus et à ses grandes orgues, soient rejetées de façon complètement arbitraire. À l’heure actuelle, le ministre de la Culture jouit toujours de la discrétion la plus complète et cette discrétion n’est entourée d’aucune balise objective. [65]
Nos suggestions de modifications législatives sont demeurées lettre morte, mais elles sont à notre avis toujours d’actualité.
Quant au dénouement de la saga de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, c’est une histoire qui finit bien.
Après avoir fait volte-face quant à son moratoire relatif à la vente et à la démolition de l’église en septembre 2010[66], l’archidiocèse de Montréal avait finalement consenti, en janvier 2011, à céder l’église, en contrepartie de la somme symbolique de 1$, à la coalition qui s’était créée pour la convertir en « Maison de l’orgue », le Ministère et l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve s’étant montrés intéressés à financer le projet à certaines conditions[67].
Cependant, le temps passa et un changement de garde à l’archevêché de Montréal vint chambouler ces plans. Nommé le 20 mars 2012, Monseigneur Christian Lépine décréta, en septembre de la même année, un moratoire sur toute vente ou fermeture des églises de son diocèse[68]. En 2013, il fit part de son intention de rouvrir l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus comme lieu de culte[69]. Puis, le 24 décembre 2014, Monseigneur Lépine y célébra la messe de Noël, dans une église bondée comme aux premiers jours, après que l’archevêché de Montréal y eut investi deux millions de dollars pour la restaurer[70]. L’orgue fit l’objet d’une nouvelle restauration et l’église est toujours ouverte au culte depuis lors[71].
Si cette histoire finit bien, il n’en demeure pas moins qu’elle illustre, de manière éclatante, que les propriétaires des lieux de culte peuvent en faire ce qu’ils en veulent, malgré la mobilisation d’un milieu, en l’absence de tout classement ou citation. Le droit de propriété du patrimoine religieux demeure un enjeu fondamental, et aucune des mesures qui ont été envisagées pour établir un quelconque dialogue entre les autorités religieuses et la société civile quant au sort de ce patrimoine n’ont été adoptées.
Sachant qu’il n’y a pas d’uniformité d’approche d’un diocèse à l’autre[72], ni d’énoncé de ce qui pourrait tenir lieu de politique du patrimoine de la part de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, c’est encore et toujours l’approche au cas par cas, à la petite semaine, qui en tient lieu, sous le regard complice de l’État du Québec.
Il faudra voir si cette absence de volonté politique accentuera l’effacement du patrimoine religieux que l’on observe depuis quelque temps dans le discours public, et quel sera l’impact de la laïcité nouvelle et officielle de l’État du Québec, en cours d’apprivoisement, sur la sauvegarde du patrimoine religieux.
II. De la sauvegarde du patrimoine religieux à la laïcité de l’État du Québec, ou la quadrature du cercle
À l’époque où [Robert-Lionel Séguin] commençait ses études en histoire et en sciences sociales, dans les années quarante-cinq/cinquante, la dépossession progressive engendrée par la Conquête, marquée par le traumatisme de l’écrasement de la Rébellion de 1837, atteignait une phase ultime : une quasi-amnésie culturelle. On maintenait notre peuple dans une existence politique insignifiante et dans une aliénation qui l’amenait à mépriser ses valeurs originales au profit du modèle du conquérant. C’était une époque de honte de soi. On s’empressait de cacher ou de se défaire de vieux objets, des vieux meubles, bref de l’héritage, pour les remplacer par du moderne et du chromé. Prélarts, tapisseries, peintures recouvraient les matériaux d’origine. On avait donc peur de passer pour « habitant ». Quelqu’un avait-il l’air timide ou gauche, on l’accueillait par un « arrive en ville, maudit colon », ou par un « maudit habitant du fond des rangs ». Pendant ce temps-là, des camions chargés à bloc des choses de notre patrimoine prenaient le chemin de l’étranger après avoir écumé les campagnes. Sans que les pouvoirs publics s’en émeuvent. J’ai vu ça, avec un point au coeur.
Gaston Miron, « Robert-Lionel Séguin, historien de l’identité et de l’appartenance », dans Marie-Andrée Beaudet et Pierre Nepveu, dir, Gaston Miron, Un long chemin – Proses 1953-1996, Éditions de l’Hexagone, Montréal, 2004, 244 aux pp 247-48
Si la Loi sur la laïcité peut soulever certaines questions quant à la capacité de l’État du Québec de continuer d’assurer la sauvegarde de son patrimoine religieux, ce principe a néanmoins été reconnu à l’échelle des droits fondamentaux (A). En l’absence d’une politique du patrimoine culturel d’ensemble, la priorité de l’État du Québec, en matière de patrimoine religieux, est à la « requalification » des lieux de culte dits « excédentaires », contribuant ainsi au naufrage de notre civilisation (B).
A. La sauvegarde du patrimoine religieux reconnue à l’échelle des droits fondamentaux[73]
La Loi sur la laïcité édicte, à son article premier, que l’État du Québec est laïque. Elle précise, à son article second, que la laïcité de l’État repose sur les principes suivants, à savoir la séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de l’État, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, et la liberté de conscience et de religion. Puis, à son article troisième, la loi précise que
[l]a laïcité de l’État exige que, dans le cadre de leur mission, les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent l’ensemble des principes énoncés à l’article 2, en fait et en apparence.
Ces institutions sont celles identifiées à l’article 3, à savoir l’Assemblée nationale, les organismes énumérés aux paragraphes 1 à 10 de l’annexe I de cette loi (comprenant les municipalités), ainsi que les tribunaux du Québec qui y sont identifiés.
L’article 17 de cette loi se lit comme suit :
Les articles 1 à 3 ne peuvent être interprétés comme ayant pour effet d’exiger d’une institution visée à l’article 3 qu’elle retire ou modifie un immeuble ou un bien meuble qui orne un immeuble. Toutefois, une institution peut, de sa propre initiative, retirer ou modifier un immeuble ou un tel bien meuble.
Ces articles ne peuvent non plus être interprétés comme ayant un effet sur la toponymie, sur la dénomination d’une institution visée à l’article 3 ou sur une dénomination que celle-ci emploie.
Certains sont d’avis que cette disposition est plus large que la version qui en fut initialement proposée, puisqu’elle ne se limite pas à une référence au patrimoine culturel, dont le patrimoine culturel religieux, qui aurait été exclu des effets de la Loi sur la laïcité[74].
Avec déférence, nous ne partageons pas ce point de vue, puisque l’article 17 de cette loi se limite aux institutions qui sont identifiées à son article 3. L’adoption du libellé de l’article 16 du projet de loi initial eût été infiniment préférable, puisqu’il visait l’ensemble du patrimoine culturel, qui devenait hors de portée de l’application de cette loi :
16. La présente loi ne peut être interprétée comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec, notamment du patrimoine culturel religieux, qui témoignent de son parcours historique.[75]
Ce libellé reprenait substantiellement celui de l’article 16 de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État[76], qui fut toutefois abrogé aux termes de l’article 27 de la Loi sur la laïcité.
Malgré l’obiter dictum du juge Gascon dans l’arrêt Mouvement laïque québécois[77], où il affirme que « […] le devoir de neutralité de l’État ne l’oblige pas à s’interdire de célébrer et de préserver son patrimoine religieux », la rédaction de l’article 17 de la Loi sur la laïcité et l’abrogation de l’article 16 de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État pourraient donner prise aux arguments de ceux qui croient que l’État devrait s’abstenir de financer la sauvegarde du patrimoine religieux ou de lui accorder quelque traitement fiscal favorable, et ce, en vertu du principe de la séparation de l’État et des religions[78].
Certains se demandent en effet, puisque la plupart des organismes de bienfaisance enregistrés à caractère religieux, consacreraient, dit-on, toutes leurs ressources ou presque à des activités liées à la foi et au culte, où se trouve le « bénéfice public tangible »[79]?
Sans ces avantages fiscaux, il faut savoir que les autorités religieuses ne pourraient tout simplement plus subvenir à l’entretien du patrimoine religieux dont elles ont toujours la charge, ce qui devrait suffire à constater un premier « bénéfice public tangible ».
De plus, il est tout de même ironique de constater que de telles objections soient soulevées à ce moment-ci, lorsque l’on sait que les organismes de défense du patrimoine proposent d’étendre de tels avantages fiscaux aux propriétaires laïques de biens patrimoniaux, qui constituent toujours une charge particulière à ceux qui doivent en assurer la préservation[80].
Enfin, ces objecteurs de conscience font preuve non seulement d’insensibilité au fait religieux et aux besoins spirituels de plusieurs de leurs concitoyens, mais ne font pas de cas de la nécessité de préserver cet héritage pour la société dans son ensemble, sachant que le meilleur moyen d’y parvenir est d’assurer la vocation religieuse et cultuelle de ce patrimoine, et dont les retombées dépassent largement le seul cercle des fidèles[81].
Au-delà de tous ces arguments, cependant, l’on oublie que la laïcité repose aussi sur le principe de la liberté de conscience et de religion, que l’État doit favoriser, non seulement en vertu de la Loi sur la laïcité et de la Charte des droits et libertés de la personne[82], mais aussi de la Loi sur la liberté des cultes[83], et de l’obligation du Québec de se conformer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’égard duquel il s’est déclaré lié[84], ce que le droit constitutionnel canadien reconnaît également[85].
Il faut aussi ajouter qu’aux termes de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne a consacré la liberté des États de contribuer au financement des cultes, autorisant une différence de traitement des cultes pour des motifs objectifs, historiques et raisonnables dans une société donnée, permettant l’attribution d’un impôt ecclésial résultant d’un concordat entre l’État et une confession religieuse, reconnaissant le principe de l’autonomie ecclésiale, affirmant que le financement du culte est par ailleurs le gage de l’exercice collectif de la liberté de religion, le droit européen se montrant flexible en appliquant un principe de subsidiarité, donnant lieu à des solutions diverses en la matière d’un État à l’autre[86].
D’autre part, à la différence de la Loi du 9 décembre 1905 de la République française, la Loi sur la laïcité ne contient aucune interdiction au financement des cultes, ni d’exception en ce qui a trait au financement et au traitement fiscal du patrimoine religieux[87]. Malgré cette interdiction de principe, le Conseil d’État de France a récemment redéfini les conditions d’applications de ces dispositions législatives, permettant à l’État de ne pas seulement financer que les aspects relatifs à la conservation de ce patrimoine, mais aussi ceux relevant de sa valorisation[88].
Au final, cependant, cette question de la séparation de l’État et des religions pose celle des classements. En effet, que faut-il conserver et financer? Seuls des monuments types, représentant les plus beaux exemples de leur temps et, partant, n’accorder qu’à ces exemples un financement conséquent pour leur restauration complète et leur entretien permanent? Ou faut-il plutôt adopter une conception plus relativiste, extensive et égalitaire du patrimoine, aux termes de laquelle l’on classe tout ce qui peut l’être, conservant ainsi tout ce qui peut l’être, ne préservant pas que le seul monument « type », mais essayant plutôt d’« enrayer, par des travaux efficaces et modestes, la dégradation du plus grand nombre »[89]? C’est l’approche qui s’est imposée en France, entre 1905 et 1913, la restauration n’étant alors plus conçue comme « révélatrice », mais devenant « conservatrice ». Un travail de sécularisation des églises dans l’imaginaire collectif de France, à une époque d’anticléricalisme marqué, permit leur classement général et intégral, et la préservation du plus grand nombre.
Quel contraste avec ce classement type, hiérarchisé, par « classes », qui prévaut toujours au Québec, ne privilégiant que le monument « type »[90], et propageant ainsi le vandalisme à ce qui reste de notre patrimoine religieux dans cette vaste entreprise de « requalification » des lieux de culte dits « excédentaires ».
B. L’inqualifiable « requalification » des lieux de culte dits « excédentaires » ou le naufrage de la civilisation au Québec
À Paris, le vandalisme fleurit et prospère sous nos yeux. Le vandalisme est architecte. Le vandalisme se carre et se prélasse. Le vandalisme est fêté, applaudi, encouragé, admiré, caressé, protégé, consulté, subventionné, défrayé, naturalisé. Le vandalisme est entrepreneur de travaux pour le compte du gouvernement. Il s’est installé sournoisement dans le budget, et il grignote à petit bruit, comme le rat son fromage. Et, certes, il gagne bien son argent. Tous les jours il démolit quelque chose du peu qu’il nous reste de cet admirable vieux Paris. Que sais-je? le vandalisme a badigeonné Notre-Dame, le vandalisme a retouché les tours du Palais de justice, le vandalisme a rasé Saint-Magloire, le vandalisme a détruit le cloître des Jacobins, le vandalisme a amputé deux flèches sur trois à Saint-Germain-des-Prés. [...] Le vandalisme a ses journaux, ses coteries, ses écoles, ses chaires, son public, ses raisons. Le vandalisme a pour lui les bourgeois. Il est bien nourri, bien renté, bouffi d’orgueil, presque savant, très classique, bon logicien, fort théoricien, joyeux, puissant, affable au besoin, beau parleur, et content de lui. Il tranche du Mécène. Il protège les jeunes talents. Il est professeur. Il donne de grands prix d’architecture. Il envoie des élèves à Rome. Il porte habit brodé, épée au côté et culotte française. Il est de l’Institut. Il va à la cour. Il donne le bras au roi, et flâne avec lui dans les rues, lui soufflant ses plans à l’oreille. Vous avez dû le rencontrer.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris – 1482, Paris, Gallimard, 2009, 726 aux pp 734-35
La dernière réflexion un tant soit peu sérieuse au sujet du patrimoine religieux entreprise à la demande du gouvernement du Québec remonte à 2016, alors que la ministre de la Culture en titre, Hélène David, mandatait Michelle Courchesne et Claude Corbo, en amont de la rédaction d’une nouvelle politique culturelle du Québec, de lui faire des recommandations relatives au patrimoine culturel, quant au devoir d’exemplarité de l’État et à la cohérence de l’action gouvernementale, quant aux partenariats à être établis avec les municipalités et, enfin, de lui proposer un nouveau modèle pour le soutien gouvernemental aux « collectivités » et aux propriétaires d’édifices religieux ayant une « grande valeur patrimoniale », ce dernier élément ayant été limité au patrimoine religieux immobilier[91].
Malgré la « neutralité » de l’État du Québec et sa laïcisation progressive, le Rapport Courchesne-Corbo recommanda de reconnaître le patrimoine religieux dans la future politique culturelle, tout en légitimant et confirmant les modalités d’un soutien financier de l’État à ce patrimoine[92].
Il proposa de distinguer les immeubles religieux d’intérêt national de ceux présentant un intérêt régional ou local[93]. Les premiers seraient admissibles à un programme de soutien récurrent de l’État du Québec aux termes d’un plan décennal, tandis que les seconds seraient confiés aux municipalités, locales et régionales, avec une enveloppe budgétaire annuelle de dix millions de dollars à la clef (sujette à indexation), distribuée en vertu des programmes actuels[94].
Un comité d’experts serait mandaté par le ministre afin de faire des recommandations quant au système d’évaluation patrimoniale utilisé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec – lire, son inventaire critiqué[95] –, dont on propose qu’il soit réformé pour n’être composé que de personnes laïques[96].
Les autres recommandations reprennent, pour l’essentiel, celles du rapport Croire au patrimoine religieux, quant à l’établissement d’un mécanisme d’aliénation et de droit de premier refus conféré à l’État, de congé de taxes foncières suite à la désacralisation d’un lieu de culte et d’un régime particulier à cet égard pour tout bien recyclé, puis de confier un rôle accru aux municipalités régionales de comté dans la gestion de ce patrimoine[97].
Comme on peut le constater, en dépit de l’intérêt de plusieurs des recommandations de ce rapport, l’on propose, avec quelques nouveautés, des solutions qui avaient pour la plupart déjà été évoquées dans le rapport Croire au patrimoine religieux déposé dix ans plus tôt. Outre le fait qu’une prise en charge plus importante d’immeubles dits d’intérêt « national » y est suggérée, reprenant, en quelque sorte, la proposition phare du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux, mais sans le citer et, surtout, sans parler de nationalisation, puisque
[…] le droit des autorités religieuses de disposer des immeubles dont elles sont propriétaires ne saurait être mis en question, tout comme il leur est loisible de décider du moment où cela s’effectuera […][98],
cette approche repose toutefois encore et toujours sur le postulat fataliste voulant que l’on ne puisse pas tout conserver et qu’il faille faire des « choix ». Force sera bientôt d’admettre, cependant, que d’avoir laissé aller les choses ainsi et de n’avoir jamais fait de choix, le problème se règlera de lui-même, et le patrimoine religieux québécois s’en ira à vau-l’eau, pour ce qu’il en restera[99].
Le Rapport Courchesne-Corbo connaîtra le même glorieux sort que ceux qui l’ont précédé : finir sur une tablette. La politique culturelle du Québec déposée en 2018, intitulée pompeusement Partout, la culture, n’en a pratiquement rien retenu, la montagne accouchant d’une souris, énonçant, de manière vague et imprécise, « miser sur le plein potentiel du patrimoine culturel », et ne mentionnant, pour tout programme relatif au patrimoine religieux, que le « défi » de « l’actualisation de l’usage d’édifices religieux »[100].
Le plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023, assurant la mise en oeuvre de cette politique, ne prévoit pour cette période qu’une enveloppe budgétaire de vingt-cinq millions de dollars, afin de bonifier « l’aide financière consacrée à la conservation du patrimoine culturel à caractère religieux dans toutes les régions du Québec; [d’]élabor[er] [une] stratégie de protection des biens mobiliers à caractère religieux; [et de] recherche[r] [des] approches facilitant la conversion de lieux de culte désacralisés ou désaffectés, en particulier les immeubles patrimoniaux protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel »[101].
Changement de gouvernement oblige, ce plan d’action gouvernemental fut suivi d’un plan stratégique 2019-2023, dont le seul objectif, en matière de patrimoine, finalisant ainsi le travail d’abattage, consiste à « [f]avoriser le changement de vocation des immeubles patrimoniaux excédentaires à caractère religieux »[102], afin d’accompagner
les porteurs de projets en les outillant et en les soutenant financièrement dans leurs travaux de requalification, sur la base d’un état de situation de ces immeubles [que le Ministère] entend réaliser en 2019-2020[103].
C’est ainsi que le Conseil du patrimoine religieux du Québec, tout en continuant d’administrer, pour le compte du gouvernement du Québec, le Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux du Québec[104], aux termes duquel plus de 514 M $ ont été investis (ou plutôt, saupoudrés) depuis 1995, « pour préserver les biens les plus importants du patrimoine religieux du Québec »[105], s’acquitte désormais, au même titre, du Programme visant la requalification des lieux de cultes excédentaires patrimoniaux, en précisant que toute requalification doit tenir compte de la Loi sur la laïcité, mais sans donner plus de précision à ce sujet[106]. Cet organisme a depuis longtemps fait son lit, ayant publié, il y a quelques années déjà, sous les auspices d’Action patrimoine, un tiré à part du magazine Continuité, intitulé Nos églises, un patrimoine à convertir[107], et célébrant depuis lors, à l’invitation de Luc Noppen et Lucie K. Morisset, des « églises réinventées »[108].
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec décerne aussi ses prix d’excellence et ses mentions, notamment pour les « conversions » les plus réussies. À titre d’exemple, l’église Notre-Dame de Granby, la paroisse fondatrice de cette ville, désormais propriété de la ville et de son cégep, transformée de l’intérieur en salle multifonctionnelle, même si elle présentait sans aucun doute la plus forte valeur patrimoniale des églises de cette ville[109].
Si le Conseil du patrimoine culturel du Québec déplore, avec justesse, l’excès de « façadisme » dans la préservation du patrimoine bâti, qui consiste, essentiellement, à ne conserver que l’enveloppe extérieure d’un bâtiment pour en modifier l’intérieur en le destinant à un autre usage[110], il semblerait toutefois que cette pratique soit non seulement permise en ce qui a trait au patrimoine religieux, mais encensée, ce que nous avons eu l’occasion de dénoncer à maintes reprises[111]. N’y voyons pas, cependant, de problème là où se trouve la solution : avec le chanteur musicien Pilou, les églises désaffectées feront désormais partie de la relance des villages du Québec, chauffées à prix modeste aux Bitcoins et donneront accès à l’internet haute vitesse aux citoyens des coins les plus reculés du Québec[112]!
Bien que le Rapport du Vérificateur général 2020-2021 ne se soit pas penché sur le cas du patrimoine religieux, les constats qu’il pose s’y appliquent tout autant, notant l’absence de stratégie d’intervention du Ministère en matière de patrimoine immobilier, l’absence d’encadrement des municipalités, une information déficiente détenue par le Ministère quant à ce patrimoine qui lui permettrait de bien intervenir, un classement des biens patrimoniaux ne faisant pas l’objet d’un traitement équitable et diligent par le Ministère, une absence d’aide et d’outils aux propriétaires d’immeuble patrimoniaux et un manquement généralisé de l’État à son devoir d’exemplarité en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immobilier[113].
Le Ministère a pris acte de ce rapport dévastateur et s’est engagé dans une démarche visant à remédier aux graves lacunes ainsi dévoilées[114]. Dans cette veine, l’on envisage d’apporter certaines modifications à la Loi sur le patrimoine culturel, qui repose actuellement sur des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre, tant en ce qui a trait au classement des biens qu’au régime d’autorisations des actes réalisés dans l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé ou à l’égard d’un site patrimonial déclaré ou classé[115]. Le projet de loi 69 ne fait que proposer un encadrement limité de ces pouvoirs discrétionnaires, seulement en ce qui a trait au régime d’autorisations, quant au processus de traitement des demandes[116]. Rien n’est prévu quant à un encadrement éventuel du pouvoir discrétionnaire des demandes de classements, ou concernant le déclassement, l'acquisition ou l'aliénation de biens patrimoniaux, et c’est là que le bât blesse, car, comme nous l’avons vu, l’arbitraire devrait y céder le pas à un mécanisme d’abord fondé sur l’expertise[117].
S’il est suggéré de mieux consulter et informer les citoyens quant à l’importance du patrimoine et de sa sauvegarde, par la création d’une table de concertation en matière de patrimoine immobilier, et d’augmenter les pouvoirs municipaux de protection du patrimoine, en imposant la constitution d’inventaires des immeubles patrimoniaux pour les municipalités régionales de comté[118], il n’est pas encore question de l’adoption d’une politique d’ensemble visant le patrimoine culturel, encore moins le patrimoine religieux.
D’aucuns ne s’inquiètent du fait que la plupart des municipalités ont admis ne pas détenir l’expertise requise en matière de patrimoine[119], ni comment seront réalisés ces nouveaux inventaires, ou ce qu’il adviendra de ceux utilisés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec.
Enfin, puisque le sujet du patrimoine religieux est passé à la trappe et, avec lui, les questions légitimes entourant sa propriété et la prérogative qui incombe aux propriétaires, en définitive, de décider à eux seuls de ce qui sera jugé « excédentaire », non sans avoir au préalable écumé les subventions publiques et autres avantages fiscaux, voilà que sonne le glas du patrimoine religieux du Québec, désormais « requalifié », horizon indépassable et inqualifiable, qui tient lieu de politique gouvernementale du patrimoine en cette contrée, contribuant ainsi au naufrage de notre civilisation[120].
Requiescat in pace!
***
En 2006, suite au dépôt du rapport Croire au patrimoine religieux du Québec, grâce à un vaste travail de réflexion, de consultation et de mobilisation, l’on a cru assister à un mouvement qui aurait permis à l’État du Québec de mettre en oeuvre des solutions, de compromis, certes, mais assurant la pérennité du patrimoine religieux du Québec et qui auraient pu déboucher, à terme, sur l’adoption d’une véritable politique du patrimoine culturel pris dans son ensemble, incluant le patrimoine religieux.
Ce mouvement s’est rompu sur les digues de l’indifférence gouvernementale et des autorités religieuses face au sort de ce patrimoine, mais la mobilisation s’est néanmoins poursuivie dans la saga de la sauvegarde de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal, qui donna son impulsion au Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec. Cette mobilisation n’a, hélas, pas réussi à convaincre le Ministère de tenir compte de ses recommandations à l’occasion du remplacement de la Loi sur les biens culturels par la Loi sur le patrimoine culturel, cette loi consacrant toujours le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Culture tant en matière de classement des biens culturels que d’autorisations subséquentes les concernant.
En quinze ans, c’est l’idée même du patrimoine religieux qui s’est progressivement effacée du débat sociétal. La Loi sur la laïcité, par son mutisme à cet égard, pourrait ouvrir une boîte de Pandore quant à la possibilité pour l’État, non seulement de subventionner la conservation et la « requalification » de ce patrimoine, mais aussi quant aux avantages fiscaux qui sont conférés aux autorités religieuses, leur permettant d’assurer en partie, pour le moment du moins, l’entretien du patrimoine religieux dont elles ont la charge, capacité grandement fragilisée par cette pandémie résultant du coronavirus dit Covid-19, dont plusieurs paroisses et lieux de culte ne se remettront pas[121].
La conservation du patrimoine religieux, nécessaire à l’exercice du culte et, partant, relevant de la liberté de conscience et de religion, est néanmoins reconnue parmi les droits fondamentaux que l’État doit respecter, ce qui devrait tenir à quai ceux qui s’objectent aux aides étatiques dont il bénéficie.
Toutefois, malgré les conclusions du Rapport Courchesne-Corbo, déposé en 2016, et reprenant pour l’essentiel les recommandations du rapport Croire au patrimoine religieux du Québec formulées dix ans plus tôt en ce qui a trait au patrimoine religieux, la nouvelle politique culturelle du Québec, Partout, la culture, dévoilée en 2018, n’en a rien retenu. C’est toujours la politique du cas par cas, mais dont l’accent est mis, désormais, sur la « requalification » des lieux de culte dits « excédentaires », un façadisme, voire un vandalisme qui ne dit pas son nom. Le Rapport du vérificateur général 2020-2021 passe sous silence la question du patrimoine religieux, et le projet de loi 69 n’en traite pas davantage. De même, il n’existe pas de politique relative au patrimoine religieux qui aurait été adoptée par les autorités religieuses, et au premier chef, par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, les disparités étant, d’un diocèse à l’autre, flagrantes, celui de Montréal ayant imposé un moratoire sur la vente de ses lieux de cultes, tandis que le torchon brûle à Rimouski entre le diocèse et la fabrique de la Cathédrale Saint-Germain quant à l’avenir de cette cathédrale.
Voilà donc un patrimoine religieux qui est ni plus ni moins abandonné à son sort, tributaire des décisions qui seront prises (ou non) par les autorités religieuses qui en demeurent propriétaires, sous le regard attentiste de l’État et de la société civile, qui s’en lavent les mains.
Le mérite du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec fut de remettre en question le dogme de la propriété des lieux de culte et de proposer leur nationalisation par l’État, à l’instar de ce qui s’est fait en France il y a plus d’un siècle, la Loi du 9 décembre 1905 constituant un véritable cadre législatif de sauvegarde en la matière, affectant les lieux de culte à cet usage, ce qui ne fut certes pas du ressort de la Loi sur la laïcité. Ce Manifeste a cependant manqué, avec le recul, d’ambition, se limitant à ne suggérer que la nationalisation de certains lieux dits d’intérêt « national », plutôt que d’en viser une application universelle à l’ensemble du patrimoine religieux du Québec, à l’exemple de la solution française, la Loi sur le patrimoine culturel ayant au demeurant substitué cette notion d’intérêt « national » par celle d’intérêt « public ».
Cette limite, elle s’est imposée à nous puisque non seulement l’État, mais aussi les historiens de l’architecture Luc Noppen et Lucie K. Morisset, dont l’influence sur le débat fut déterminante, ont décrété que l’on ne pourrait pas tout conserver, et qu’il faudrait par conséquent « réinventer » ce patrimoine par des projets communautaires[122], délaissant ainsi l’idée d’une mission nationale et d’une expertise correspondante en cette matière, vidant aussi de son contenu ce patrimoine religieux, où l’héritage immatériel donne au patrimoine bâti tout son sens, ce qui militerait pourtant en faveur du maintien de leur vocation intégrale de lieux de culte. Ce devrait être le projet de l’État québécois qui, à l’instar de certains États européens, pourrait permettre l’attribution d’une partie de l’impôt des contribuables pour assurer le financement des lieux de cultes, mis à la disposition des fidèles et de la société dans son ensemble.
L’autre grande contribution du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec fut de mettre à l’avant-plan l’importance de l’Art et, surtout, de l’orgue, qui est indissociablement lié au patrimoine religieux, quant aux critères qui doivent présider au choix de conservation d’un lieu de culte. Au fond, le Manifeste plaidait pour une approche holistique, relativiste, démocratique et conservatrice du patrimoine, qui ne tiendrait pas seulement compte de ses aspects architecturaux, comme la tendance dominante le veut, et particulièrement au Québec. Du reste, cela explique sans doute en partie pourquoi les approches retenues, quant aux inventaires constitués et aux politiques envisagées, ne ratissent pas plus large qu’elles ne le devraient.
Cette largeur d’esprit, cependant, caractérise la vie intellectuelle et personnelle de Daniel Turp. Universitaire, professeur, juriste, internationaliste, mélomane, musicien, musicologue, épris de culture et amoureux de l’Art, en particulier de l’opéra, cet art « total » qu’il affectionne tant, homme politique, homme de culture et, aussi, militant à ses heures, son impressionnante contribution à la vie publique nous laisse un legs important, et c’est ce dont nous avons voulu témoigner dans cet article, à l’occasion de son départ à la retraite de l’Université de Montréal, vers une nouvelle vie dont nous n’avons pas de doute qu’elle sera aussi foisonnante qu’enrichissante. Nul doute aussi que le professeur Turp poursuivra son oeuvre et nous lui souhaitons nos meilleurs voeux en lui redisant notre amitié la plus sincère.
Éternel optimiste, Daniel Turp ne s’avoue jamais vaincu. Avec lui, nous voulons encore Croire au patrimoine religieux du Québec, même s’il traverse des jours sombres et qu’un certain fatalisme l’entoure. Nous espérons nous tromper et continuons malgré tout d’espérer, même si notre lueur d’espoir est très mince. Comme la Croix du choeur derrière le maître-autel de Notre-Dame de Paris, toujours debout face aux décombres, nous voulons croire, avec Daniel Turp et Victor Hugo, que le patrimoine religieux du Québec transcendera cette fatalité :
Il y a quelques années qu’en visitant, ou, pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, l’auteur de ce livre trouva, dans un recoin obscur de l’une des tours, ce mot gravé à la main sur le mur :
ΆNÁΓKH [123]
Ces majuscules grecques, noires de vétusté et assez profondément entaillées dans la pierre, je ne sais quels signes propres à la calligraphie gothique empreints dans leurs formes et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c’était une main du moyen âge qui les avait écrites là, surtout le sens lugubre et fatal qu’elles renferment, frappèrent vivement l’auteur.
Il se demanda, il chercha à deviner quelle pouvait être l’âme en peine qui n’avait pas voulu quitter ce monde sans laisser ce stigmate de crime ou de malheur au front de la vieille église.
Depuis, on a badigeonné ou gratté (je ne sais plus lequel) le mur, et l’inscription a disparu. Car c’est ainsi qu’on agit depuis tantôt deux cents ans avec les merveilleuses églises du moyen âge. Les mutilations leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne, l’architecte les gratte, puis le peuple survient, qui les démolit.
Ainsi, hormis le fragile souvenir que lui consacre ici l’auteur de ce livre, il ne reste plus rien aujourd’hui du mot mystérieux gravé dans la sombre tour de Notre-Dame, rien de la destinée inconnue qu’il résumait si mélancoliquement. L’homme qui a écrit ce mot sur ce mur s’est effacé, il y a plusieurs siècles, du milieu des générations, le mot s’est à son tour effacé du mur de l’église, l’église elle-même s’effacera bientôt peut-être de la terre.
C’est sur ce mot qu’on a fait ce livre.
Février 1831.[124]
ADDENDUM
Depuis le 31 janvier 2021, les principaux développements survenus en matière de patrimoine culturel au Québec sont les suivants[125].
Plusieurs voix demandèrent au gouvernement du Québec de retirer le projet de loi 69 de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale du Québec pour qu’il soit réécrit afin, pour certains[126], qu’une autorité institutionnelle indépendante soit créée pour intervenir au nom du patrimoine et le défendre comme bien public appartenant à tous, et pour d’autres[127], qu’une véritable politique du patrimoine culturel, incluant le patrimoine religieux, soit élaborée et que les pouvoirs discrétionnaires de la ministre de la Culture, aux termes de la Loi sur le patrimoine culturel, soient mieux encadrés.
En dépit de ces critiques, le projet de loi 69 fut adopté sans en tenir compte et entra en vigueur le 1er avril 2021[128]. Le 10 juin 2021, le gouvernement du Québec annonça la création des Espaces bleus,
un réseau constitué de bâtiments patrimoniaux restaurés et de quelques nouveaux bâtiments, qui auront pour vocation première de valoriser notre histoire, nos héroïnes et nos héros, de tous les horizons et de toutes les époques. Bénéficiant d’un montant de 259M$, ce projet d’une ampleur inédite a été dévoilé [le 10 juin 2021] au pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec, qui constituera la tête du réseau des Espaces bleus[129].
Le gouvernement confia au Musée de la civilisation la responsabilité de concevoir, de produire et de réaliser une exposition permanente et des expositions itinérantes pour chacun des Espaces bleus, afin qu’ils soient « des modèles de réussite en matière de requalification de lieux patrimoniaux »[130]. Vivement critiquée comme étant une mesure improvisée et incohérente, qui plus est adoptée sans concertation avec les acteurs du milieu muséal et du patrimoine[131], nous n’avions qu’à bien nous tenir, puisque le 29 octobre 2021, le Musée de la civilisation, avec la bénédiction de l’État du Québec, allait vendre à des intérêts privés la Maison JeanBaptisteChevalier, un site patrimonial datant de la Nouvelle-France et pourtant classé depuis 1956, manquant une fois de plus à son devoir d’exemplarité, mais donnant malheureusement encore une fois raison à tous les défenseurs du patrimoine sur la nécessité d’une véritable réforme de la Loi sur le patrimoine culturel qui ne soit pas que cosmétique[132].
Appendices
Notes
-
[1]
Voir, notamment, à ce sujet, Sébastien Spitzer, Dans les flammes de Notre-Dame, Paris, Éditions Albin Michel, 2019.
-
[2]
Claire Bommelaer, « Restauration de Notre-Dame : “Si je peux aider, je le ferai”, explique Jean Nouvel », Le Figaro [de Paris] (17 avril 2019), en ligne : ˂lefigaro.fr/culture/restauration-de-notre-dame-si-je-peux-aider-je-le-ferai-explique-jean-nouvel-20190417˃.
-
[3]
Bernard Gorce et Élodie Maurot, « Notre-Dame de Paris sera restaurée à l’identique », La Croix [de Paris] (9 juillet 2020), en ligne : ˂la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Notre-Dame-sera-restauree-lidentique-2020-07-09-1201104376˃.
-
[4]
Le Monde avec AFP et Reuters, « Notre-Dame de Paris : les dons par les grandes fortunes françaises font polémique », Le Monde [de Paris] (17 avril 2019), en ligne : ˂lemonde.fr/societe/article/2019/04/17/dons-pour-notre-dame-de-paris-les-deductions-fiscales-en-debat_5451667_3224.html˃.
-
[5]
Hélène Frade, « Les pierres de Notre-Dame vs. la faim dans le monde? », France 24 (17 avril 2019), en ligne : ˂france24.com/fr/20190417-rev-press-notre-dame-incendie-reconstruction-macron-gilets-jaunes-climat-famine-debat˃.
-
[6]
Voir notamment, à ce sujet, la Loi sur le développement durable, RLRQ c D-8.1.1, art 6 (k) : « “protection du patrimoine culturel” : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent; »; voir également la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ c P9.002, art 1 : « La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l’identité d’une société, dans l’intérêt public et dans une perspective de développement durable. […] » [Loi sur le patrimoine culturel].
-
[7]
Québec, Commission de la culture, Patrimoine religieux du Québec (Document de consultation), 2005 à la p 18, en ligne : ˂assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cc/mandats/Mandat-3163/index.html˃ [Commission de la culture, « Document de consultation »].
-
[8]
Antoine Leduc, « L’avenir de l’orgue et de ses artisans dans le contexte de la conservation du patrimoine religieux québécois : quelques éléments cruciaux à prendre en considération », Mémoire présenté à la Commission de la culture, (2005) n°50M, en ligne : ˂assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CC/mandats/Mandat-3163/memoires-deposes.html˃.
-
[9]
Québec, Assemblée nationale, Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec (Juin 2006), en ligne (pdf) : Le patrimoine immatériel religieux du Québec ˂ipir.ulaval.ca/pdf/2006_Croire-au-patrimoine-religieux_Commission-Culture.pdf˃ [Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec].
-
[10]
Antoine Leduc, Daniel Turp, et al, « Lettre au premier ministre Jean Charest - Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec », Le Devoir [de Montréal] (9 juin 2010) A7, en ligne : ˂ledevoir.com/opinion/idees/290490/lettre-au-premier-ministre-jean-charest-manifeste-pour-la-sauvegarde-du-patrimoine-religieux-du-quebec˃ [Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec ou Manifeste].
-
[11]
Ci-après le « Ministère » ou le « Ministère de la Culture ».
-
[12]
Québec, Vérificateur général du Québec, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021, (Juin 2020) c 3 aux pp 62-3, en ligne : ˂vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/163/vgq_tome-juin2020_web.pdf˃[Québec, « Rapport du Vérificateur général 2020-2021 »].
-
[13]
Voir Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 9-10.
-
[14]
Ibid; voir aussi : Michelle Courchesne et Claude Corbo, Le patrimoine culturel québécois : un héritage collectif à inscrire dans la modernité – Rapport sur la gouvernance du patrimoine soumis au ministre de la Culture et des Communications du Québec, 21 octobre 2016 aux pp 198-200 [non publié], en ligne: ˂partoutlaculture.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/GPIRF-MontageFinal.pdf˃ [Rapport Courchesne-Corbo]; Marc Chevrier, « Le Québec sous l’empire de ses deux cités », dans Lucia Ferretti et François Rocher, dir, Les enjeux d’un Québec laïque – La loi 21 en perspective, Montréal, Del Busso Éditeur, 2020, 77.
-
[15]
Les scandales d’abus sexuels dans l’Église catholique ont contribué, partout dans le monde et sans que le Québec n’y échappe, à décrédibiliser grandement l’institution auprès de ses fidèles et de la société civile; voir, de manière générale à ce sujet, Frédéric Martel, Sodoma – Enquête au coeur du Vatican, Paris, Éditions Robert Laffont, 2019.
-
[16]
Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie – Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998 à la p 14 : « La sortie de la religion, c’est le passage dans un monde où les religions continuent d’exister, mais à l’intérieur d’une forme politique et d’un ordre collectif qu’elles ne déterminent plus ».
-
[17]
Voir, à ce sujet, Guy Rocher, « La laïcité pour le Québec : quelques arguments », dans Daniel Baril et Yvan Lamonde, dir, Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec – Enjeux philosophiques, politiques et juridiques, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2013, 31; Julie Latour, « La laïcité de l’État : clé de voûte des droits individuels civils et politiques », dans Lucia Ferretti et François Rocher, dir, Les enjeux d’un Québec laïque – La loi 21 en perspective, Montréal, Del Busso Éditeur, 2020, 147.
-
[18]
Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c L-0.3 [Loi sur la laïcité]; voir, en particulier, l’article 17 de cette loi, que nous aborderons plus loin.
-
[19]
Commission de la culture, Document de consultation, supra note 7 à la p 9.
-
[20]
Ibid à la p 30.
-
[21]
Ibid à la p 9.
-
[22]
Ibid à la p 14.
-
[23]
Aujourd’hui connue sous le nom de Conseil du patrimoine religieux du Québec.
-
[24]
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 15 à 22.
-
[25]
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, JO, 11 décembre 1905, 7205, en ligne : ˂legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749/2021-01-25/˃ [Loi du 9 décembre 1905]. Au sujet de la genèse, de la mise en oeuvre et de l'évolution de cette loi, on lira avec intérêt Patrick Weil, De la laïcité en France, Paris, Grasset, 2021.
-
[26]
Commission de la culture, Document de consultation, supra note 7 à la p 25.
-
[27]
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 à la p 26.
-
[28]
Ibid à la p 25.
-
[29]
Ibid à la p 26.
-
[30]
Ibid à la p 27.
-
[31]
Loi sur les biens culturels, RLRQ c B-4, abrogée par la Loi sur le patrimoine culturel, LQ 2011 c 21 art 262.
-
[32]
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 28-30, 49.
-
[33]
Voir Julie Latour, supra note 17 à la p 160; Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, para XII-5.74 aux pp 1130-1131.
-
[34]
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 21-22, 3435.
-
[35]
Ibid aux pp 32-3.
-
[36]
Ce cours, objet de controverses idéologiques et judiciaires dès sa mise en oeuvre, a été retiré des programmes et l’on réfléchit en ce moment à un nouveau cours qui pourrait le remplacer; sur les controverses judiciaires, voir Julie Latour, « Assurer la protection législative de la laïcité : une démarche essentielle pour la cohésion sociale et la fraternité citoyenne », dans Daniel Baril et Yvan Lamonde, dir, Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec – Enjeux philosophiques, politiques et juridiques, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2013, 111, 126-129; sur la réflexion entourant son remplacement, voir le dossier de la revue Argument, Nadia El-Mabrouk et al, « Quelle éthique enseigner à nos enfants? », (2020-2021) 23:1 Argument 24; si l’enseignement religieux qui a prévalu au Québec pendant des siècles n’a pas suffi à transmettre à nombre de générations les connaissances voulues pour apprécier et connaître le patrimoine religieux du Québec, l’on peut douter que le cours d’éthique et culture religieuse et ce qui le remplacera puissent y remédier.
-
[37]
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 31-5.
-
[38]
Ibid à la p 38.
-
[39]
Ibid à la p 39.
-
[40]
Ibid à la p 40.
-
[41]
Ibid aux pp 40-44.
-
[42]
Ibid aux pp 47-50.
-
[43]
Ibid à la p 52 : « […] les membres [de la Commission] partagent l’avis formulé par l’ancienne présidente de la Commission des biens culturels, Mme Louise Brunelle-Lavoie, qui estime que l’adoption d’une politique générale sur le patrimoine “est préalable à toute révision de la Loi sur les biens culturels”. Elle ajoutait qu’il “ne sert à rien d’apporter des amendements à la pièce pour corriger certains outils si la logique d’ensemble est absente”. Si le gouvernement du Québec devait décider d’entreprendre la rédaction d’une politique du patrimoine, la Commission estime qu’il pourrait s’inspirer avantageusement des recommandations contenues dans le présent rapport. » [Références omises]
-
[44]
« Patrimoine religieux – Québec opte pour un “moratoire volontaire” » Radio-Canada (19 juin 2006), en ligne : ˂ici.radio-canada.ca/arts-spectacles/PlusArts/2006/06/19/006-patrimoine_religieux.asp˃.
-
[45]
PL 196, Loi instituant un moratoire visant à protéger le patrimoine religieux, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006.
-
[46]
Isabelle Paré, « Rapport inquiétant sur l’état de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Réussira-t-on à sauver le plus puissant orgue du Canada? », dans Le Devoir [de Montréal] (11 décembre 2009) B2; la paroisse cumule alors un déficit de 1,5 million et des bâtiments en décrépitude; l’orgue a déjà été offert à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) pour sa future salle de concert, mais l'OSM n’en a pas voulu.
-
[47]
Les membres de l'Atelier d'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve, « Église Très-Saint-Nom-de-Jésus - L’encan Montréal-Toronto », Le Devoir [de Montréal] (7 avril 2010) A7; voir aussi Andy Blatchford, « Un vieil orgue de Montréal convoité par Toronto », La Presse [de Montréal] (27 avril 2010) A7 : « Dans les années 90, l’orgue a été restauré au coût approximatif de 750 000 $, et sa construction s’élèverait, de nos jours, à près de 2,5 millions, estime-t-on. »; Nathalie Petrowski, « Vendre son âme à Toronto », La Presse [de Montréal] (28 avril 2010) C1; Andy Blatchford, « Heritage church organ in need of a flock » The Globe & Mail [de Toronto] (27 avril 2010) A10; Véronique Robert, « Orgue cherche sauveur », L’actualité [de Montréal] (1er août 2010) 64.
-
[48]
Isabelle Paré, « L’orgue et l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Le Conseil du patrimoine religieux contredit le ministère de la Culture », Le Devoir [de Montréal] (19 mai 2010) B8.
-
[49]
Isabelle Paré, « L’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus et son orgue sont menacés – Québec n’a pas l’intention de lever le petit doigt », Le Devoir [de Montréal] (14 mai 2010) B4; voir également Isabelle Paré, « La sauvegarde de l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus - Québec reste sourd aux S.O.S. », Le Devoir [de Montréal] (18 mai 2010) A1; Isabelle Paré, « La ministre St-Pierre refuse de débloquer des fonds d’urgence ou d’empêcher la vente à des acheteurs étrangers » Le Devoir [de Montréal] (20 mai 2010) B8.
-
[50]
Christine St-Pierre, « Église et orgue du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Des choix difficiles à faire », Le Devoir [de Montréal] (21 mai 2010) A9 : « En ce qui concerne la problématique soulevée par l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, je souligne qu’elle ne présente pas les caractéristiques qui en font un bien culturel d’intérêt national. Sa seule conservation nécessiterait des investissements de plusieurs millions de dollars. […] Quant à son orgue, personne ne remet en cause sa valeur. Il importe néanmoins de rappeler que le Québec possède actuellement un corpus de plus de 60 orgues protégés par la loi. »
-
[51]
Isabelle Paré, « Vente de l’orgue du Très-Saint-Nom-de-Jésus – “Impensable!” clame le titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris », Le Devoir [de Montréal] (27 mai 2010) B8 : « “La première chose qui m’interpelle, c’est qu’on se désintéresse d’un instrument dans lequel on a investi tant d’argent”, a soutenu M. Latry, qui est venu régulièrement à Montréal ces dernières années pour enseigner aux étudiants qui poursuivent leur formation d’organiste à l’Université McGill ».
-
[52]
Phyllis Lambert et Serge Joyal, « Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Le symptôme d’un manque de vision », Le Devoir [de Montréal] (2 juin 2010) A7 : « Ce qui est inacceptable, actuellement, c’est qu’en haut lieu on se lave les mains de l’avenir de l’église comme si celle-ci était une “verrue” du tissu urbain, reliquat encombrant d’un passé révolu ».
-
[53]
Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, supra note 10; voir aussi Isabelle Paré, « Une coalition réclame d’urgence la nationalisation des plus beaux éléments du patrimoine religieux » Le Devoir [de Montréal] (9 juin 2010) B8; Anabelle Nicoud, « Un manifeste pour sauver le patrimoine religieux », La Presse [de Montréal] (8 juin 2010) A8; « Un manifeste pour la sauvegarde des églises et des orgues », Radio-Canada (8 juin 2010), en ligne : ˂ici.radio-canada.ca/nouvelle/476157/eglise-orgue-manifeste˃.
-
[54]
Antoine Leduc et Daniel Turp, « La place du patrimoine religieux et de l’orgue dans le contexte de la Loi sur le patrimoine culturel », Mémoire présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec, 10 novembre 2010, n°007M, en ligne : ˂assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-13749/memoires-deposes.html˃ [Leduc et Turp, « La place du patrimoine religieux »]; parmi les plus connus, citons Jacques-Yvan Morin, Élisabeth Gallat-Morin, † Paul-André Crépeau, † Jean-Paul L’Allier, Hélène Dorion, Marc Hervieux, Bartha Maria Knoppers, Madeleine Cantin Cumyn, † Bernard Landry, Gérald R. Tremblay, † Raymond Daveluy, Gaston Arel, Lucienne L’Heureux-Arel, Geneviève Soly, Mireille Lagacé et Bernard Lagacé.
-
[55]
Manifeste, supra note 10.
-
[56]
Sur des cotes possibles de « A », « B » et « C »; voir, à ce sujet, Conseil du patrimoine religieux du Québec et ministère de la Culture et des Communications du Québec, Inventaire des lieux de culte du Québec, en ligne : ˂lieuxdeculte.qc.ca˃.
-
[57]
Stéphane Fortier, « Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine – Des églises et leurs orgues en périls », 24 heures [de Montréal] (8 juin 2010) 4.
-
[58]
Jean-Claude Marsan, « Lettres - Le patrimoine religieux sur une voie de garage! », Le Devoir [de Montréal] (12 juin 2010) C4.
-
[59]
Isabelle Paré, « Sauvegarde de l'église et des orgues du Très-Saint-Nom-de-Jésus - La ministre de la culture refuse d’injecter un sou pour entretenir l’édifice », Le Devoir [de Montréal] (8 juillet 2010) B8.
-
[60]
Stéphane Baillargeon, « Demande de classement pour l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus », Le Devoir [de Montréal] (8 septembre 2010) B10.
-
[61]
Isabelle Paré, « Le ministère de la Culture rejette la demande de classement de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus », Le Devoir [de Montréal] (5 octobre 2010) B8.
-
[62]
Québec, Rapport du Vérificateur général 2020-2021, supra note 12 à la p 90; aux termes de son quatrième constat, la Vérificatrice générale affirme que le classement des biens patrimoniaux ne fait pas l’objet d’un traitement équitable et diligent par le Ministère de la Culture et des Communications.
-
[63]
PL 82, Loi sur le patrimoine culturel, 2e sess, 39e lég, Québec, 2011 (sanctionné le 19 octobre 2011), LQ 2011, c 21.
-
[64]
Leduc et Turp, La place du patrimoine religieux, supra note 54; la présentation vidéo des auditions publiques de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec le 18 janvier 2011 est disponible, en ligne : ˂assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-34037.html˃.
-
[65]
Antoine Leduc et Daniel Turp, « Le patrimoine religieux doit être préservé et mis en valeur », Le Devoir [de Montréal] (18 janvier 2011) A7 [Leduc et Turp, « Le patrimoine religieux doit être préservé »].
-
[66]
Isabelle Paré, « L’archevêché perd foi en l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus », Le Devoir [de Montréal] (30 septembre 2010) B10; Karim Benessaieh, « Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Le comité de sauvegarde furieux contre l’Archevêché », La Presse [de Montréal] (1er octobre 2010) A14; Isabelle Paré, « Patrimoine - Les élus locaux rabrouent Mgr Turcotte », Le Devoir [de Montréal] (1er octobre 2010) B4; Nathalie Petrowski, « Au très saint nom de la démolition », La Presse [de Montréal] (6 octobre 2010) Arts et spectacles 3.
-
[67]
Isabelle Paré, « Un organisme sans but lucratif est créé pour sauver l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus », Le Devoir [de Montréal] (6 avril 2011) B10.
-
[68]
Frédérique Doyon, « Une double vocation pour l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus? », Le Devoir [de Montréal] (5 mars 2013) B8; Lisa-Marie Gervais, « Point chaud – La foi n’est pas affaire d’État », Le Devoir [de Montréal] (10 juin 2013), en ligne : ˂ledevoir.com/societe/380362/la-foi-n-est-pas-affaire-d-etat˃ : « Le diocèse de Montréal ne cache pas qu’il a récemment imposé un moratoire sur tout projet de cession de ses lieux de culte, notamment pour ceux qui ne partagent pas ses valeurs catholiques. […] “Il y a quand même cent paroisses qui ont été supprimées [fusionnées], par la force des choses. Et les ventes [d’églises] n’ont pas tellement rapporté de sous par rapport à la valeur réelle du marché.” [de dire Mgr Lépine] »; ce moratoire ne fait pas l’unanimité au sein de l’Église diocésaine, certains déplorant que l’entretien de ce patrimoine empêche l’Église de se consacrer à sa mission pastorale vu l’importance des fonds qu’elle doit y consacrer; voir, à ce sujet, Jonathan Guilbault, « Un archevêque dans sa tour d’ivoire », La Presse + (19 mars 2014) Débats écran 7, en ligne : ˂lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/jonathan-guilbault/201403/19/01-4749341-un-archeveque-dans-sa-tour-divoire.php˃.
-
[69]
Jean-Christophe Laurence, « Hochelaga-Maisonneuve - Une église pourrait renaître », La Presse [de Montréal] (4 mars 2013) A14.
-
[70]
Baptiste Zapirain, « Une église ressuscite après cinq ans de fermeture », Le Journal de Montréal (18 décembre 2014) 17.
-
[71]
Mario Cloutier, « Les orgues de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus ressuscitent », ludwig van Montréal (4 novembre 2019), en ligne : ˂ludwig-van.com/montreal/2019/11/04/nouvelle-les-orgues-de-leglise-du-tres-saint-nom-de-jesus-ressuscitent/˃.
-
[72]
Une bataille rangée est menée, depuis plus de cinq ans, à Rimouski, concernant le sort de la Cathédrale Saint-Germain, opposant la Fabrique de cette paroisse à l’Archevêché, l’église étant fermée au culte depuis plus de cinq ans, qui n’est pas sans rappeler l’affaire de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal; les parties sont devant les tribunaux… et le député local tente de faire classer l’église!; « Harold LeBel souhaite que la cathédrale de Rimouski soit classée patrimoniale », Radio-Canada (27 août 2020), en ligne : ˂ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729599/cathedrale-rimouski-patrimoine-religieux-culture-eglise˃; Julie Tremblay, « La cathédrale de Rimouski toujours au purgatoire, 5 ans après sa fermeture », Radio-Canada (24 novembre 2019), en ligne : ˂ici.radio-canada.ca/nouvelle/1391863/cathedrale-saint-germain-rimouski-archeveche-fabrique-conflit-histoire˃.
-
[73]
À l’invitation du professeur Turp, nous utilisons l’expression « droits fondamentaux » plutôt que « droits de l’homme », « droits de la personne », « droits et libertés » ou « droits humains »; voir, à ce sujet, Daniel Turp, « Droits de l’homme, droits de la personne, droits et libertés et droits humains : essai sur la dénomination des droits et plaidoyer pour les “droits fondamentaux” », dans Brigitte Lefebvre et Antoine Leduc, dir, Mélanges Pierre Ciotola, Montréal, Les Éditions Thémis, 2012, 539.
-
[74]
Voir Guillaume Rousseau, Loi sur la laïcité de l’État commentée et annotée : philosophie, genèse, interprétation et application, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2020 aux pp 425−51, en particulier à la p 434.
-
[75]
PL 21, Loi sur la laïcité de l’État, 1ère sess, 42e lég, Québec, 2019, art 16 (tel que présenté le 28 mars 2019).
-
[76]
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, RLRQ, c R-26.2.01 [Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État].
-
[77]
Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015 CSC 16 au para 116, juge Gascon [Mouvement laïque québécois].
-
[78]
Voir, cependant, Brun, Tremblay et Brouillet, Droit constitutionnel, supra note 33, para XII-5.72 aux pp 1129-1130.
-
[79]
Manon Cornellier, « Fiscalité et religion: la neutralité s’impose », Le Devoir [de Montréal] (8 juin 2019) B8 : « L’ensemble des mesures fiscales en faveur des OBE religieux coûterait au Québec quelques centaines de millions de dollars. Selon la dernière estimation annuelle obtenue par Le Devoir, les taxes municipales et scolaires ainsi perdues totaliseraient à elles seules 182,3 millions »; voir aussi : Stéphane Baillargeon et Magdaline Boutros, « Faut-il payer pour la foi? », Le Devoir [de Montréal] (8 juin 2019) B1; Stéphane Baillargeon et Magdaline Boutros, « Plus de 182 millions en taxes non perçues », Le Devoir [de Montréal] (8 juin 2019) B2; Stéphane Baillargeon, « Pourquoi la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré ne paye pas de taxes municipales, même sur son camping », Le Devoir [de Montréal] (8 juin 2019) B2.
-
[80]
Action patrimoine, Mémoire présenté par Action patrimoine dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, 24 novembre 2020 [non publié] à la p 16, en ligne : ˂actionpatrimoine.ca/wp/wp-content/uploads/2020/11/PL69_memoire_Action-patrimoine-1.pdf˃; Louise Mercier, « L’avenir du patrimoine bâti », Le Devoir [de Montréal] (8 février 2019) en ligne : ˂ledevoir.com/opinion/idees/547417/l-avenir-du-patrimoine-bati˃ : « Non, les propriétaires d’immeubles anciens n’ont pas tous les moyens d’entretenir leur bien patrimonial. Oui, l’État doit aider ces propriétaires. Leur bien va leur survivre et une aide de l’État ne va pas les enrichir au détriment des autres citoyens »; Raphaël Fischler, « Patrimoine : joindre le geste et la parole », Le Devoir [de Montréal] (8 avril 2019), en ligne : ˂ledevoir.com/opinion/libre-opinion/551649/patrimoine-joindre-le-geste-a-la-parole˃; Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 48-49.
-
[81]
Voir, notamment, à ce sujet : Jean-Sébastien Sauvé et Thomas Coomans, dir, Le devenir des églises – Patrimonialisation ou disparition, Québec, Presse de l’Université du Québec, 2014 à la p 4 : « Il est néanmoins entendu que le moyen le plus efficace d’assurer la conservation des églises et des chapelles reste certainement la perpétuité du culte en leurs murs »; Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Les églises du Québec – Un patrimoine à réinventer, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005 à la p 389 : « Si, aux plans symbolique et utilitaire, le meilleur sort d’une église est de garder un lieu de culte, la sacralisation doit surtout miser sur le caractère public, civil, inviolable et inaliénable qu’on attribue, non plus aux objets sacrés, mais au patrimoine, comme manifestation de notre désir collectif de nous projeter dans l’avenir. »
-
[82]
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c C-12, arts 3, 9.1, 10, 41.
-
[83]
Loi sur la liberté des cultes, RLRQ, c L-2, art 1 : « La jouissance et le libre exercice du culte de toute profession religieuse, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d’excuse à la licence, ni à autoriser des pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté au Québec, sont permis par la constitution et les lois du Québec à toutes les personnes qui y vivent. »
-
[84]
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 à la p 11.
-
[85]
Brun, Tremblay et Brouillet, Droit constitutionnel, supra note 33 aux pp 1121-1136.
-
[86]
Voir Gérard Gonzalez, « Le financement des cultes et la Convention européenne des droits de l’homme », (2016) 1 Revue du droit des religions 9, en ligne : ˂journals.openedition.org/rdr/1022˃.
-
[87]
Loi du 9 décembre 1905, supra note 25, art 2, al 1er : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. »; notons toutefois que l’État français confère aux diverses confessions l’usufruit des lieux de culte qui y demeurent affectés (arts. 4, 12, 13, 14), qui sont exemptés d’impôts fonciers (art. 24) et qui peuvent continuer de percevoir elles-mêmes des fonds de leurs fidèles pour assurer l’exercice du culte (art. 19); de plus, l’article 19 in fine de cette loi, édicte que « [n]e sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »
-
[88]
Anne Fornerod, « Financer le patrimoine religieux en France – De nouvelles limites entre cultuel et culturel », dans Jean-Sébastien Sauvé et Thomas Coomans, dir, Le devenir des églises – Patrimonialisation ou disparition, Québec, Presse de l’Université du Québec, 2014, 31, notamment à la p 43; une commune peut-elle subventionner la restauration de l’orgue de l’église paroissiale, sachant qu’au-delà sa vocation culturelle pour l’organisation d’activités artistiques, il sera néanmoins utilisé pour le culte? Le Conseil d’État n’y voit plus d’objection, contrairement à l’interprétation qui prévalait auparavant.
-
[89]
Voir Julien Lacaze, « Au chevet des églises avec Barrès (1905-1913) – Du classement à la protection des monuments », dans Jean-Sébastien Sauvé et Thomas Coomans, dir, Le devenir des églises – Patrimonialisation ou disparition, Québec, Presse de l’Université du Québec, 2014, 13 aux pp 27-28; voir la Loi du 9 décembre 1905, supra note 25, art 16.
-
[90]
Approche dénoncée, notamment, par Action patrimoine, supra note 80 aux pp 13-15.
-
[91]
Rapport Courchesne-Corbo, supra note 14; on s’étonnera du fait qu’il faille toujours, au Québec, réinventer la roue, puisque cette réflexion avait déjà été menée en bonne partie à l’occasion du rapport Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9.
-
[92]
Ibid aux pp 202 et 203 (Recommandation 49).
-
[93]
Ibid aux pp 206-207 (Recommandation 50); exit la notion d’« intérêt public » de la Loi sur le patrimoine culturel.
-
[94]
Ibid aux pp 207-219 (Recommandations 51 à 56); d’où provient l’idée d’une somme de 10 millions, nul ne le sait, ni sur quelles assises elle repose.
-
[95]
Ibid aux pp 219-220 (Recommandation 57).
-
[96]
Ibid aux pp 220-221 (Recommandation 58).
-
[97]
Ibid aux pp 223-229 (Recommandations 59 à 62).
-
[98]
Ibid à la p 223; on a vu, avec l’exemple de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, ce que cela signifie; aussi, on se demande bien en vertu de quoi cette nationalisation est impossible; la Loi du 9 décembre 1905, supra note 25, l’a pourtant accompli il y a plus d’un siècle en France, avec des résultats probants.
-
[99]
Morgan Lowrie, « Des dizaines d’églises québécoises attendent leur salut », Le Devoir [de Montréal] (7 janvier 2019), en ligne : ˂ledevoir.com/societe/544939/un-diocese-laisse-les-congregations-determiner-le-sort-de-ses-eglises˃.
-
[100]
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Partout, la culture – Politique culturelle du Québec, Québec, ministère de la Culture et des Communications, 2018 à la p 36, en ligne : ˂partoutlaculture.gouv.qc.ca/politique/˃ [ministère de la Culture et des Communications, « Partout, la culture »].
-
[101]
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Partout, la culture – Politique culturelle du Québec – Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023, Québec, ministère de la Culture et des Communications, 2018 à la p 12 (Mesure 24), en ligne : ˂partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/˃.
-
[102]
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Plan stratégique 2019-2023 – ministère de la Culture et des Communications, Québec, ministère de la Culture et des Communications, 2019 à la p 9, en ligne : ˂cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/strategie/PL_strategique_2019-2023.pdf?1575661737˃.
-
[103]
Ibid.
-
[104]
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux du Québec, en ligne : ˂patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/programme˃.
-
[105]
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Aide financière, en ligne : ˂patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere.
-
[106]
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Programme visant la requalification des lieux de cultes excédentaires patrimoniaux, en ligne : ˂patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/Programme_Re˃.
-
[107]
Continuité, Nos églises – Un patrimoine à convertir, Québec, no 131, Hiver 2011, en ligne : ˂magazinecontinuite.com/numero-131/˃.
-
[108]
Noppen et Morisset, supra note 81.
-
[109]
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Des églises réinventées – Série 2020 - Centre et pavillon Notre-Dame - Granby, en ligne : ˂patrimoine-religieux.qc.ca/uploads/documents/CPRQ_Fiches_Eglises_Granby_Final2.pdf˃.
-
[110]
Québec, Conseil du patrimoine culturel du Québec, Le façadisme – Analyse de cas, positions et orientations – Rapport final, Québec, février 2020, en ligne : ˂cpcq.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/docs/facadisme_rapport_final_200304.pdf˃; l’on a ainsi déploré le recours au façadisme dans le cadre de la réfection d’une ancienne école qui sera transformée en nouveau pavillon de l’UQAM; voir Caroline Montpetit, « La réfection d’un nouveau pavillon de l’UQAM décriée par des défenseurs du patrimoine », Le Devoir [de Montréal] (13 janvier 2021), en ligne : ˂ledevoir.com/non-classe/593198/patrimoine-la-refection-d-un-nouveau-pavillon-de-l-uqam-souleve-des-critiques˃, ce qui suscita l’ire de la rectrice de l’UQAM, Madga Fusaro, « Des critiques injustifiées sur le nouveau pavillon de l’UQAM », Le Devoir [de Montréal] (16 janvier 2021) B12, en ligne : ˂ledevoir.com/opinion/idees/593422/patrimoine-des-critiques-injustifiees-sur-le-nouveau-pavillon-de-l-uqam˃, qui affirma qu’« [e]n matière de patrimoine urbain et architectural, l’UQAM n’a de leçon à recevoir de personne », oubliant sans doute, au passage, le fiasco de l’Îlot Voyageur, un exemple en effet très concluant; Michel Munger, « L’îlot Voyageur, un gâchis coûteux », le Journal de Montréal (5 juillet 2013), en ligne : ˂journaldemontreal.com/2013/07/05/lilot-voyageur-un-gachis-couteux˃.
-
[111]
Voir, notamment, Antoine Leduc, « Nationalisons les églises! – Transformer un lieu de culte en autre chose n’a rien à voir avec la sauvegarde du patrimoine religieux », La Presse [de Montréal] (26 avril 2010) A17, en ligne : ˂lapresse.ca/debats/a-votre-tour/201004/23/01-4273716-nationalisons-les-eglises.php˃.
-
[112]
Émilie Côté et Martin Tremblay, « Musique – Pilou rêve grand », La Presse + [de Montréal] (30 janvier 2021), en ligne : ˂lapresse.ca/arts/2021-01-30/musique/pilou-reve-grand.php˃; Émilie Côté, « Une église chauffée aux bitcoins », La Presse + [de Montréal] (30 janvier 2021) Arts et être 3, en ligne : ˂lapresse.ca/arts/2021-01-30/une-eglise-chauffee-aux-bitcoins.php˃ : « Un réseau décentralisé de salles de serveurs de données permettrait de “connecter” [sic] enfin toutes les régions à l’internet haute vitesse, expose Pilou. “Le Conseil du patrimoine religieux prévoit qu’entre 1000 et 1500 églises seront abandonnées ou démolies d’ici cinq ans, souligne-t-il. Nous, on veut revaloriser ce patrimoine-là et le chauffer à peu près gratuitement.” »
-
[113]
Québec, Rapport du Vérificateur général 2020-2021, supra note 12 à la p 64; notons de nouveau que ces constats avaient été posés aux termes du rapport Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9.
-
[114]
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Plan d’action pour l’application des recommandations du Vérificateur général du Québec – Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier – Synthèse, Québec, Culture et communications, 2020, en ligne : ˂cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/Plan-Action-VGQ-2020-V22.pdf˃.
-
[115]
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Analyse d’impact réglementaire – Projet de loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, Québec, ministère de la Culture et des Communications, 2020, en ligne : ˂cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/publications-complementaires/Analyse_d_impact_reglementaire_projet_de_loi_modifiant_la_Loi_sur_le_patrimoine_culturel_et_d_autres_dispositions_legislatives.pdf˃.
-
[116]
PL 69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, 1ère sess, 42e lég, Québec, 2020 [PL 69].
-
[117]
Voir notre discussion, Leduc et Turp, Le patrimoine religieux doit être préservé, supra note 65.
-
[118]
PL 69, supra note 116, notes explicatives.
-
[119]
Québec, Rapport du Vérificateur général 2020-2021, supra note 12 aux pp 82-85; Jean-François Nadeau, « Phyllis Lambert dubitative face à la réforme de la loi sur le patrimoine », Le Devoir [de Montréal] (26 novembre 2020), en ligne : ˂ledevoir.com/politique/quebec/590441/patrimoine-phyllis-lambert-a-du-mal-a-trouver-du-bon-dans-le-projet-de-loi˃.
-
[120]
Sur ce thème, et de manière plus générale, on lira avec intérêt Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations, Paris, Grasset, 2019.
-
[121]
Marc Tison, « Les finances de l’archevêché – Des églises et des coffres presque vides à Noël », La Presse [de Montréal] (24 décembre 2020), en ligne : ˂lapresse.ca/affaires/2020-12-24/les-finances-de-l-archeveche/des-eglises-et-des-coffres-presque-vides-a-noel.php˃.
-
[122]
Voir Luc Noppen et Lucie K Morisset, supra note 81; voir aussi : Caroline Montpetit, « L'entrevue - Vouloir sauver des églises sans se faire d’illusions », Le Devoir [de Montréal] (28 juin 2010) A1; la vision de ces historiens, commode pour un État qui ne veut pas se donner les moyens de tout conserver, s’est imposée de façon durable dans les mentalités, devenant le paradigme dominant, sans qu’elle ne soit autrement véritablement contestée; elle a causé un tort probablement irrémédiable à la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, en tout cas pour ceux qui, comme nous, ne le réduise pas à une vision strictement utilitaire et communautaire.
-
[123]
Mot grec se disant Fatum, en latin, et « fatalité », en français.
-
[124]
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris – 1482, Paris, Gallimard, 2009 aux pp 59-60.
-
[125]
La recherche pour cet addendum est à jour au 28 novembre 2021.
-
[126]
Serge Joyal et Phyllis Lambert, « Il faut retirer le projet de loi 69 sur le patrimoine », Le Devoir [de Montréal] (9 février 2021), en ligne : <ledevoir.com/opinion/idees/594836/il-faut-retirer-le-projet-de-loi-69-sur-le-patrimoine>.
-
[127]
Antoine Leduc et Daniel Turp, « Le patrimoine religieux doit revenir au coeur du débat », Le Devoir [de Montréal] (15 février 2021), en ligne : <ledevoir.com/opinion/idees/595231/le-patrimoine-religieux-doit-revenir-au-coeur-du-debat>.
-
[128]
PL 69, supra note 116.
-
[129]
Québec, Ministre de la Culture et des Communications, « Culture et patrimoine – Québec annonce la création du réseau des Espaces bleus, un legs qui mettra en valeur l’héritage culturel québécois », en ligne : <quebec.ca/nouvelles/actualites/details/culture-et-patrimoine-quebec-annonce-la-creation-du-reseau-des-espaces-bleus-un-legs-qui-mettra-en-valeur-lheritage-culturel-quebecois-32310>.
-
[130]
Ibid.
-
[131]
Philippe Dubé, « Des Espaces bleus qui feront tache », Le Devoir [de Montréal] (14 juin 2021), en ligne : <ledevoir.com/opinion/libre-opinion/610530/libre-opinion-des-espaces-bleus-qui-feront-tache>.
-
[132]
Collectif d’auteurs, « La Maison Chevalier et la suite pour la Place Royale », Le Devoir [de Montréal] (1er novembre 2021), en ligne : <ledevoir.com/opinion/idees/644199/patrimoine-la-maison-chevalier-et-la-suite-pour-la-place-royale>; Antoine Leduc et Daniel Turp, « Vente de la Maison Chevalier : De la criante dissonance entre le discours et l’action de l’État », Le Journal de Montréal (23 novembre 2021), en ligne : <journaldemontreal.com/2021/11/23/vente-de-la-maison-chevalier-de-la-criante-dissonance-entre-le-discours-et-laction-de-letat>.