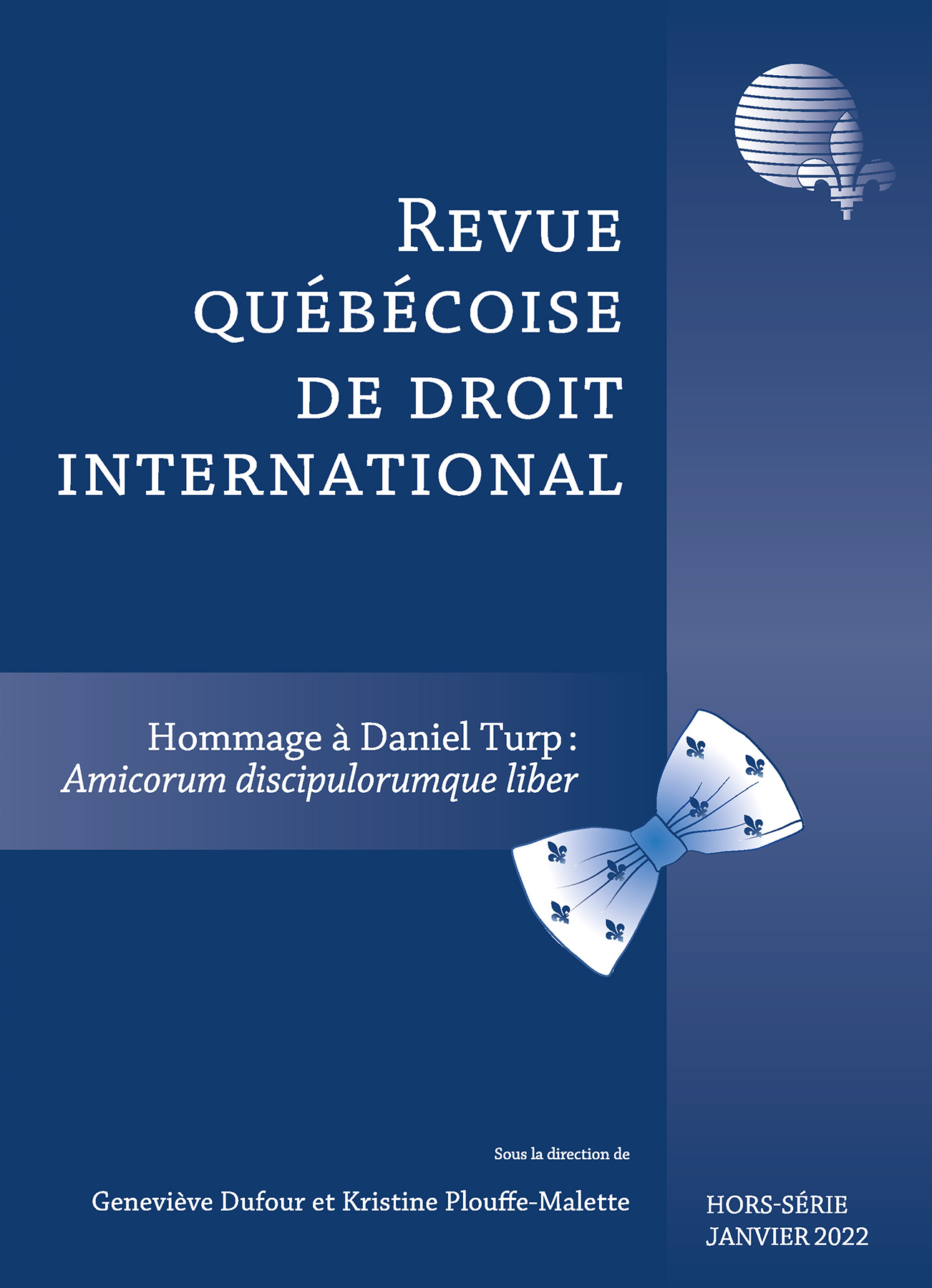Abstracts
Résumé
À ce jour, peu d’indépendantistes ont été attentifs à la revendication autochtone d’une possibilité de choisir de conserver leur lien avec le Canada dans l’éventualité d’un vote référendaire favorable à l’indépendance du Québec. Or, la légitimité d’une telle demande requiert de réfléchir à une solution négociée à même de concilier les volontés des peuples québécois et autochtones. Dans cette brève étude, les auteurs présentent les éléments fondamentaux d’un régime juridique qui permettrait à la fois au Québec d’accéder à son indépendance et aux peuples autochtones qui le souhaitent de rester rattachés juridiquement au Canada dans un Québec indépendant. Après avoir circonscrit le contenu matériel de la continuité canadienne et expliqué le rôle des peuples autochtones dans le processus de mise en place de cette continuité, les auteurs proposent un mécanisme supranational qui assurerait la reconduction sur le territoire du Québec indépendant des responsabilités et des normes canadiennes concernant les droits des peuples autochtones, ainsi que leur invocabilité à l’encontre des autorités québécoises et canadiennes devant les tribunaux québécois et canadiens. Les auteurs estiment que le respect par le Québec et le Canada de la continuité canadienne pour les peuples autochtones rend sans objet les thèses favorables à la partition territoriale d’un Québec indépendant fondées sur la volonté des autochtones de conserver leur lien avec le Canada.
Abstract
To date, few independentists have been attentive to the Aboriginal demand for the possibility of choosing to maintain their link with Canada in the event of a referendum vote in favour of Quebec independence. However, the legitimacy of such a demand requires reflection on a negotiated solution capable of reconciling the wishes of the Quebec and Aboriginal peoples. In this brief study, the authors present the basic elements of a legal regime that would allow both Quebec to achieve independence and the Aboriginal peoples who wish to do so to remain legally attached to Canada in an independent Quebec. After defining the substantive content of Canadian continuity and explaining the role of Aboriginal peoples in the process of establishing this continuity, the authors propose a supranational mechanism that would ensure the continuation of Canadian responsibilities and standards regarding the rights of Aboriginal peoples in the territory of an independent Quebec, as well as their invocability against Quebec and Canadian authorities in Quebec and Canadian courts. The authors believe that the respect by Quebec and Canada of Canadian continuity for Aboriginal peoples renders irrelevant the arguments in favour of the territorial partition of an independent Quebec based on the desire of Aboriginal peoples to maintain their link with Canada.
Resumen
Hasta la fecha, pocos independentistas han estado atentos a la reivindicación indígena de la posibilidad de elegir el mantenimiento de su vínculo con Canadá en caso de referéndum a favor de la independencia de Quebec. Sin embargo, la legitimidad de esta demanda exige una reflexión sobre una solución capaz de conciliar los deseos de los quebequenses y de los pueblos indígenas. En este breve estudio, los autores presentan los elementos fundamentales de un régimen jurídico que le permitiría tanto a Quebec alcanzar la independencia como a los pueblos indígenas que así lo deseen permanecer legalmente vinculados a Canadá en un Quebec independiente. Tras definir el contenido sustantivo de la continuidad canadiense y explicar el papel de los pueblos indígenas en el proceso de establecimiento de esta continuidad, los autores proponen un mecanismo supranacional que garantice que las responsabilidades y normas canadienses relativas a los derechos de los pueblos indígenas se extiendan al territorio de un Quebec independiente, y que se invoquen contra las autoridades quebequenses y canadienses ante los tribunales quebequenses y canadienses. Los autores consideran que el respeto por parte de Quebec y Canadá de la continuidad canadiense de los pueblos indígenas hace irrelevantes los argumentos a favor de la partición territorial de un Quebec independiente basados en el deseo de los pueblos indígenas de mantener su vínculo con Canadá.
Article body
Note liminaire : ce texte a été écrit en hommage à Daniel Turp, éminent juriste québécois dans la Cité, amoureux du genre humain, des arts, du Québec et de la liberté des peuples. Daniel a été et restera mon premier professeur de droit international, un maître d’une générosité intellectuelle et personnelle sans borne qui m’a ouvert toutes les portes. Qu’il sache qu’il a pour toujours mon respect, ma reconnaissance et mon amitié.
Ghislain Otis[∗∗∗]
La Cour suprême du Canada a reconnu sans ambages le droit des Québécois de se prononcer par référendum sur la question de l’indépendance du Québec[1]. La haute juridiction a de plus statué qu’un vote clairement majoritaire en faveur de cette option enclenchera l’obligation pour le Canada de négocier de bonne foi en vue de donner effet à la volonté démocratiquement exprimée par les Québécois[2]. Si l’obligation de négocier n’emporte pas un droit absolu pour le Québec de faire sécession[3], elle signifie que le droit canadien empêche que soit opposé un véto pur et simple à l’indépendance du Québec.
La question du statut et des droits des peuples autochtones vivant au Québec sera un des enjeux clés des négociations prescrites par la Cour suprême[4]. S’appuyant sur un ancrage territorial multiséculaire et sur une revendication de souveraineté ancestrale à laquelle ils n’ont pour la plupart jamais renoncé, ces peuples invoquent leur droit à l’autodétermination en vertu d’instruments internationaux qui percolent de plus en plus dans la jurisprudence internationale et dans le droit national[5]. Ils estiment en outre avoir le droit de conserver, si tel est leur choix, leur lien politique et juridique avec le Canada[6].
Un auteur a bien résumé le point de vue des autochtones opposés à la rupture de leur relation avec la Couronne fédérale :
Une telle opposition s’explique par le fait qu’ils considèrent n’avoir rien à y gagner et, au contraire, beaucoup à y perdre. L'accession du Québec à la souveraineté les laisserait face au seul gouvernement du Québec, alors qu'à l'heure actuelle ils peuvent mettre à profit la concurrence qui existe entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour tenter d'améliorer leur position. En outre, leur loyauté et leur identification vont au Canada avant d'aller au Québec. D'une part, parce que leur inclusion dans l'ensemble canadien facilite le maintien des liens avec les Autochtones des autres provinces (et correspond à la situation avant l'arrivée des Européens, lorsque leur espace géographique n'était pas divisé par des frontières politiques). D'autre part, parce que les peuples autochtones ont l'habitude de considérer les autorités fédérales comme leur interlocuteur privilégié dans la mesure où ce sont elles qui, prenant la suite de la Couronne britannique, exercent à leur égard, en vertu du droit constitutionnel, les principales responsabilités[7].
À titre d’exemple, un leader inuit exprime ainsi les préoccupations suivantes à l’égard des conséquences de l’indépendance du Québec sur son peuple :
[…] si ce projet se réalisait, les Inuit seraient les premières victimes de la séparation; nous serions désormais citoyens d’un nouveau pays que nous n’avons pas choisi. Ce serait la quatrième fois dans l’histoire que nous changerions de citoyenneté selon un processus qui nous échappe complètement. Nous nous retrouverions plus isolés de nos compatriotes inuit du Nunavut et du Labrador, parmi lesquels nous comptons de nombreux parents[8].
Cette désaffection autochtone à l’égard d’un Québec indépendant, qui s'est fortement manifestée lors du débat référendaire de 1995[9], s’explique peut-être par quelques rendez-vous historiques manqués entre le mouvement indépendantiste québécois et les peuples autochtones[10]. Le fait est que certains indépendantistes ont été à ce jour peu attentifs à la revendication autochtone d’une possibilité de choisir. Une critique de la doxa souverainiste pointe le paradoxe d’une indépendance québécoise qui risquerait d’être elle-même coloniale si elle faisait l’impasse sur l’enjeu de l’autodétermination autochtone :
L’échec le plus important du mouvement pour la souveraineté du Québec est à mon sens celui d’avoir cru que, pour se décoloniser, pour se désenclaver politiquement, il s’agissait non pas de détruire les structures coloniales de l’Empire britannique et de s’extraire du rapport de prédation au territoire et du racisme structurel qu’elles impliquent, mais de coloniser l’Amérique du Nord en son nom propre, en français, comme pour « reprendre » le flambeau du conquérant qui n’a pourtant jamais été le nôtre[11].
On peut tout de même supposer qu’avant ou au lendemain d’un hypothétique vote favorable à l’indépendance, le gouvernement du Québec tendrait la main aux peuples autochtones en vue de convenir d’un nouveau cadre de coexistence en dehors de la relation triangulaire actuelle . Il est aussi probable que les peuples autochtones voudront alors jauger les avantages potentiels d’en finir avec la tutelle fédérale. Toutefois, on ne peut exclure que certains expriment néanmoins le souhait de conserver leur lien avec le Canada, donc de rester assujettis à la compétence d’Ottawa et de bénéficier des droits et des protections offertes par le droit canadien.
Nous nous penchons dans cette étude sur la question de savoir comment, dans l’hypothèse d’un vote pour l’indépendance du Québec, pourrait être conciliée cette volonté démocratique parfaitement légitime en droit canadien, avec le choix tout aussi légitime que feraient certains peuples autochtones du Québec de conserver leur lien avec le Canada. La négociation d’une entente constitutionnelle et internationale tripartite assurant la continuité canadienne pour les autochtones du Québec qui la réclament est envisagée dans cet article comme une voie privilégiée de conciliation des volontés exprimées par les peuples en présence.
Il nous paraît cependant important de préciser d’entrée de jeu, et de manière non équivoque, que l’hypothèse de la continuité canadienne considérée dans les pages qui suivent ne doit pas être comprise comme une apologie du statu quo dans les relations entre le Canada, le Québec et les peuples autochtones. Les auteurs du présent article reconnaissent qu’une demande autochtone de continuité canadienne dans le contexte de la sécession du Québec ne serait pas l’expression d’une adhésion inconditionnelle et définitive à l’ordre canadien. Ils sont bien au fait de la critique parfois virulente que les observateurs, notamment autochtones, font de l’état actuel du droit positif qu’ils tiennent pour empreint d’une logique coloniale profonde[12].
Néanmoins, cette étude n’a pas pour objet d’identifier les voies d’une déconstruction-refondation de cet ordre même si la négociation de la sécession du Québec pourrait être un moment d’éclosion de possibles aujourd’hui impensés.
L’objectif est donc ici d’examiner s’il est techniquement faisable de maintenir un lien juridique entre les peuples autochtones et le Canada dans le contexte de la sécession du Québec. Il faut donc dans un premier temps identifier cet inchangé (I), puis penser à des formes et procédures inédites propres à satisfaire cette finalité. De manière à première vue paradoxale, nous proposons de garder un contenu normatif canadien, du droit interne donc, en l’élevant formellement à un niveau international, seul à même de respecter le consentement des collectivités en jeu (II). En puisant dans un traité international original, l’Accord sur l'Espace économique européen (Accord EEE)[13], pourront être imaginés les outils et les structures juridiques à même de garantir cette continuité (III).
I. Les assises juridiques maintenues après l’indépendance du Québec : normes et territoire
A. Le droit canadien du « bloc constitutionnel autochtone » reconduit
La préservation du lien juridique entre le Canada et un peuple autochtone passerait par le maintien en vigueur à l’égard de ce peuple des droits et des recours particuliers dont il bénéficie, en tant que peuple autochtone, tant à l’égard des autorités canadiennes que québécoises en vertu du droit canadien. L’expression « bloc constitutionnel autochtone » renvoie ici à un ensemble cohérent de règles et de principes constitutionnels régissant le rapport sui generis que l’histoire a forgé entre la Couronne (l’État) et les peuples autochtones au Canada[14]. Ce volet de la constitution concerne au premier chef les droits collectifs des autochtones en tant que nations et communautés politiques historiques distinctives. Sont visées les dispositions de la Proclamation royale de 1763[15], les articles des lois constitutionnelles relatives aux compétences législatives en matière autochtone[16], celles qui reconnaissent et confirment leurs droits ancestraux et issus de traités[17], ainsi que tous les principes constitutionnels non écrits ou de common law dont découlent les obligations de la Couronne d’agir honorablement et en bon fiduciaire dans ses relations avec les peuples autochtones[18].
Devraient se greffer à ce « noyau dur » du bloc autochtone des droits inhérents à la continuité canadienne tels la citoyenneté canadienne, la liberté de mouvement entre le Québec et le Canada, des droits linguistiques ainsi que des droits incidents qui viennent étayer l’effectivité de la continuité canadienne tels les droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés[19] dans le champ spécifique du bloc autochtone.
Une vaste gamme de questions ne revêt toutefois pas de spécificité tenant à la culture, aux droits collectifs singuliers, à la gouvernance et aux territoires autochtones. Pour ces matières, les peuples autochtones ne jouissent pas d’un statut politique et constitutionnel qui les distingue fondamentalement des autres citoyens en droit canadien, de sorte qu’elles n’auraient pas vocation à participer de la continuité canadienne.
La continuité canadienne signifierait, d’une part, que les responsabilités et les compétences du Canada à l’égard des peuples autochtones du Québec concernés et de leurs terres seraient reconduites ainsi que l’obligation pour les mesures canadiennes de respecter intégralement les droits constitutionnellement protégés de ces peuples dont, par exemple, les droits issus de traités énoncés dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois[20]. Elle emporterait d’autre part l’obligation pour le Québec de respecter les limites à son action pouvant résulter du maintien de la responsabilité canadienne et de se conformer à l’ensemble des normes canadiennes relevant du bloc autochtone, y compris les droits ancestraux et issus de traités. Le Québec serait aussi tenu de respecter les champs de compétences dévolus aux peuples autochtones en droit canadien.
En somme, la continuité canadienne assurerait aux peuples autochtones du Québec qui l’auraient choisie de pouvoir, même après l’accession du Québec à l’indépendance, invoquer directement devant les tribunaux québécois et canadiens la constitution, les lois, la jurisprudence et les programmes canadiens les concernant spécifiquement en tant que peuples autochtones. En plus de conserver tous leurs droits en tant que citoyens canadiens, y compris la liberté de se déplacer sans égard aux frontières, ils seraient protégés, notamment par la voie de recours judiciaires efficaces et connus, de toute atteinte éventuelle par le Québec et le Canada aux droits et avantages que leur garantit le droit canadien sur le fondement de leur statut de peuple autochtone.
Le Québec aurait toutefois le plein exercice de sa souveraineté pour toutes les matières ne se rapportant pas au bloc autochtone décrit ci-haut. Il conserverait en outre les compétences qu’il possède déjà puisque la compétence canadienne ne fait pas obstacle à la législation québécoise d’application générale qui peut souvent régir les autochtones comme les autres citoyens même pour des questions touchant aux droits ancestraux et issus de traités[21].
On ne peut toutefois omettre de mentionner qu’en obligeant le Québec à respecter la compétence canadienne eu égard au bloc autochtone, la continuité limiterait sa capacité d’innover en négociant, par exemple, avec les autochtones un nouvel ordre constitutionnel fondé sur une co-souveraineté, ou sur des souverainetés enchevêtrées, au sein d’un État réinventé[22]. Le Québec ne pourrait même pas offrir une solution de rechange à la Loi sur les Indiens[23] si celle-ci était en vigueur au moment de l’indépendance.
En outre, si les droits des autochtones reculaient au Canada, ils reculeraient aussi ipso jure au Québec dans l’hypothèse d’une stricte continuité. Cette dynamique potentielle de sclérose, voire même de régression, pourrait être soulignée par les représentants du Québec lors des négociations pour inciter les autochtones à opter pour une relation exclusive avec un Québec indépendant dont on devra par ailleurs pouvoir faire la démonstration convaincante qu’il est plus progressiste et prompt à rompre résolument avec la logique coloniale.
B. La difficile modification territoriale
La dimension autochtone de la question territoriale au Québec intéresse les juristes indépendamment de la sécession. Ainsi, la validité des frontières du Québec et des autres provinces auxquelles des terres visées par la Charte de la Compagnie de la Baie d’Hudson (Terre de Rupert) ont été annexées est contestée par Kent McNeil. Ce dernier avance que les lois de 1898 et de 1912 relatives aux frontières du Québec ne pouvaient ajouter à la province que les quelques parcelles de terre effectivement contrôlées par la Compagnie de la Baie d’Hudson et non les immenses espaces délimités dans ces lois[24]. Cette question se pose qu’il soit ou non question de la sécession du Québec et rien n’empêche aujourd’hui toute personne intéressée, autochtone ou non autochtone, d’invoquer ce genre d’argument pour contester l’application des lois des provinces concernées dans les régions ayant fait partie de la Terre de Rupert.
Le scénario de l’indépendance du Québec a cependant fait fleurir les thèses partitionnistes dont plusieurs se fondent sur des prétentions liées aux droits des peuples autochtones. Toutefois, ceux qui avancent ces thèses postulent une sécession unilatérale qui priverait les peuples autochtones de leurs droits et de leur rattachement au Canada sans leur consentement[25]. Elles deviennent donc caduques dès lors que le Québec respecte le choix des peuples autochtones de la continuité canadienne et négocie avec le Canada et les peuples concernés une entente garantissant cette continuité.
De fait, exiger que le Québec consente à la partition de son territoire comme condition sine qua non d’un accord de sécession en invoquant la volonté de certains autochtones de conserver leur lien avec le Canada, alors même que le Québec est prêt à concéder en respectant intégralement cette volonté, et ce sans que la partition ne soit aucunement nécessaire voire utile, pourrait aller à l’encontre de l’obligation de négocier de bonne foi imposée par la Cour suprême dans le Renvoi sur la sécession du Québec. Hawkins explique en effet que la mauvaise foi peut consister à « not reciprocating concessions especially where there are obvious concessions to be made »[26].
D’aucuns pourraient évoquer le souhait de certains peuples autochtones de se séparer du Québec nonobstant l’option du maintien de leur lien avec le Canada dans un Québec indépendant[27]. Ces derniers voudraient, autrement dit, pouvoir répudier librement toute continuité québécoise soit pour devenir eux-mêmes indépendants soit pour rattacher au Canada les parcelles de territoire où ils sont majoritaires.
Sans être impossible dans l’absolu, l’une ou l’autre de ces avenues pourra difficilement passer par une action autochtone unilatérale. Si on envisage le détachement de terres autochtones avant l’accession à l’indépendance du Québec, alors que ce dernier constitue toujours une entité fédérée canadienne, il faudrait son consentement à toute modification de ses frontières[28]. Rien n’interdit bien sûr d’envisager l’hypothèse que des négociations sur ce sujet aboutissent soit à l’annexion de certaines terres au Canada soit à l’indépendance autochtone, mais le scénario d’une action autochtone entièrement unilatérale serait à écarter du point de vue du droit canadien.
Une fois le Québec devenu un État souverain au regard du droit international, les autochtones pourraient envisager une séparation unilatérale, ce qui les placerait alors juridiquement dans la même situation difficile que le Québec dans l’hypothèse de sa séparation du Canada sans négociation préalable[29]. Ils n’ont en effet ni plus ni moins de droits que le Québec en matière de sécession. De même, le rattachement éventuel au Canada d’un territoire autochtone faisant partie du Québec constituerait une question relevant des États en droit international puisqu’il s’agirait de délimiter des frontières internationales. Une solution négociée de gré à gré devrait donc être recherchée sans qu’un peuple autochtone puisse agir de façon unilatérale.
II. Une nouvelle forme juridique à même de perpétuer le lien avec le Canada : une entente internationale tripartite
A. La pleine participation des peuples autochtones à une entente tripartite de portée constitutionnelle et internationale
Sans égard aux exigences juridiques formelles pouvant découler du droit constitutionnel canadien ou du droit international quant à la participation des peuples autochtones aux décisions qui les concernent, il va de soi que le respect du choix autochtone de la continuité canadienne exigera de reconnaître aux peuples concernés le droit de participer à part entière à la négociation et à la conclusion de l’entente ayant vocation à mettre en oeuvre cette continuité à leur égard.
Se posera la question de savoir quelles seraient les conséquences du refus d’un peuple de signer l’entente au motif qu’elle ne respecte pas le principe de la continuité du bloc autochtone canadien. Il faudra dans ce cas faire intervenir un arbitre qui tranchera la question. De fait, il n’est nullement exclu que le droit constitutionnel puisse alors être invoqué devant les tribunaux par ce peuple pour empêcher une modification constitutionnelle qui aurait pour effet de diminuer ou de supprimer ses droits sans son consentement[30]. Si l’arbitre statue que le projet d’entente opère effectivement la reconduction dans le Québec indépendant du bloc autochtone canadien, la question du bien-fondé de l’objection autochtone sera tranchée. Si, au contraire, le tribunal donne gain de cause au peuple autochtone, les parties devront poursuivre les négociations en vue d’assurer le respect de la continuité canadienne.
Il faut toutefois se rappeler que la légitimité de la demande de continuité canadienne repose sur l’existence de droits territoriaux, économiques, culturels et politiques singuliers reconnus aux peuples autochtones à titre de nations dont la revendication de souveraineté ancestrale n’a pas, dans la plupart de cas, été conciliée avec les prérogatives de la Couronne en droit canadien. Or les négociations suivant un vote en faveur de l’indépendance du Québec devront régler une foule de questions qui concernent l’ensemble de la population et ne revêtent pas de dimension proprement autochtone. Pour ce qui concerne ce volet des négociations, la continuité canadienne ne sera pas un enjeu de sorte que l’accord d’un peuple autochtone, bien que très souhaitable, ne sera pas requis.
De plus, il est important de considérer que si le Québec doit accepter qu’il ne puisse unilatéralement décider du lien entre un peuple autochtone et le Canada, les peuples autochtones doivent pour leur part convenir qu’il ne leur sera pas loisible de décider pour le Québec de sa relation avec le Canada et donc d'opposer un véto général à toute entente de sécession négociée pour le seul motif qu’ils tiennent à ce que le Québec reste dans le Canada.
Il reste que la participation des peuples autochtones du Québec à la négociation et à la conclusion d’une entente internationale serait un précédent notable en la matière. Le seul autre cas à ce jour est la participation des représentants du peuple Saami à la négociation du projet de Convention nordique Saami à intervenir entre la Finlande, la Norvège et la Suède[31].
B. La nécessité de dépasser certains précédents internationaux
D’abord, écartons les nombreux traités bilatéraux que nous a laissés l’histoire coloniale qui sont loin d’être exemplaires eu égard aux objectifs fixés par l’entente tripartite proposée. Il a pu arriver que des peuples colonisés se trouvent simultanément sous la coupe de plusieurs États pendant une période transitoire. Mais de telles situations étaient le résultat de rapports de force, éventuellement consacrés dans des conventions internationales, parfois qualifiées de « traités inégaux »[32]. Ils ne s’inscrivent donc pas dans une logique d’un accord de volonté pacifique, mais dans celle de la conquête occidentale caractéristique du XIXe siècle. En outre, les protectorats coloniaux de cette époque ne semblent pas à même de constituer un modèle acceptable pour les peuples autochtones du XXIe siècle, qui s’efforcent au contraire de voir leur autonomie reconnue dans une logique d’égale dignité.
L’entente sur la sécession du Québec serait originale sur le plan de sa substance. Certes, l’existence d’accords internationaux octroyant ou reconnaissant des droits spécifiques à une partie de la population d’un État maintenant un lien avec un autre État n’est pas en soi une nouveauté. Ainsi, à la suite des bouleversements territoriaux des XIXe et XXe siècles sur le continent européen, certaines populations se sont retrouvées sur un territoire géré par un État au sein duquel elles sont minoritaires, au regard de certaines caractéristiques linguistiques, religieuses, voire ethniques. Les États « parents » qui étaient originairement ceux de ces minorités nationales et avec qui elles continuent de partager ces caractéristiques, majoritaires dans cet État, ont pu conclure avec leurs États de résidence des traités bilatéraux afin de réglementer les droits de ces minorités et parfois de leur accorder une certaine autonomie. Nous examinerons d’abord le cas des îles Åland, puis les conventions bilatérales européennes de « bon voisinage » portant sur les minorités nationales, pour déceler les leçons à tirer de ces expériences pour notre étude et comprendre leur nécessaire dépassement à la faveur d’un modèle supranational.
Le premier cas, celui des îles Åland, est souvent cité comme un « modèle d’accommodements ethniques »[33], qui trouve son fondement dans le droit international[34]. Après la décision du conseil de la Société des Nations en 1921 estimant que ces îles étaient sous souveraineté finlandaise, mais mettant de côté la question de leur éventuelle autonomie qui permettrait aux habitants de conserver leur culture suédoise, la Suède et la Finlande ont conclu un traité accordant cette autonomie politique. Les îles disposent ce faisant d’institutions habilitées à édicter des normes, l’Assemblée législative d’Åland, un gouvernement, etc., ainsi que des droits linguistiques dérogatoires vis-à-vis du reste de la Finlande[35]. Mais cette autonomie s’avère avant tout garantie et mise en oeuvre selon le droit de l’État souverain auquel il est intégré, notamment par la Constitution finlandaise renvoyant à la Loi sur l’autonomie de 1991[36].
Contrairement à ce qui est évoqué dans la présente étude s’agissant des peuples autochtones du Québec ayant un désir similaire à celui de la population d’Åland qui voulait être rattachée à la Suède, aucun lien juridique avec cet État n’a été conservé. De plus, ni leurs droits ni l’autonomie spéciale dont ils jouissent ne sont garantis par une structure internationale. Cet exemple prouve néanmoins que le « nouvel État » peut parfaitement réussir à concilier le maintien de sa souveraineté territoriale avec la volonté d’une population minoritaire, qui préférait pour des raisons historiques et culturelles un rattachement à un autre État. De la même manière, bien des auteurs québécois ont tenté de « rassurer » les peuples autochtones hostiles à la souveraineté du Québec quant au respect de leurs droits et de leur autonomie par la constitution d’un Québec indépendant. Le problème est que ce modèle, qui a fonctionné, semble-t-il, pour les îles d’Åland, offre en réalité trop peu de garanties juridiques aux autochtones puisqu’elles dépendraient uniquement du droit interne québécois. Le traité entre la Suède et la Finlande à l’origine de la spécificité des îles ne prévoyait en effet aucun mécanisme de contrôle. L’entente que nous envisageons va donc bien au-delà du traité entre la Suède et la Finlande, non seulement en organisant de tels mécanismes, mais en laissant de surcroît perdurer un lien juridique et politique entre les peuples autochtones du Québec, et leur État d’origine, le Canada.
Le second exemple porte sur les traités bilatéraux relatifs aux minorités nationales[37] conclus à partir des années 1990 par certains États d’Europe centrale. On constate toutefois que leurs effets restent limités à plusieurs égards. En premier lieu, leur contenu s’avère restreint à des droits « élémentaires » pour des minorités (droit à la liberté d’expression, droit de maintenir leur identité culturelle linguistique ou religieuse) et à certains droits linguistiques[38]. Tout au plus, certaines conventions bilatérales stipulent le droit des minorités nationales de participer aux processus de décision politique les concernant[39] ou d’établir leurs propres institutions ou partis politiques[40]. Les titulaires des droits protégés ne sont que les personnes appartenant aux minorités nationales[41] et non les groupes en tant que tels. Si bien que les droits collectifs ne sont pas admis, et ces traités ne peuvent en aucun cas fonder une quelconque autonomie gouvernementale ou une forme d’autodétermination (contrairement au cas des îles Åland).
De plus, les effets de ces traités bilatéraux sont en réalité limités puisque les droits accordés s’exercent souvent en conformité avec la législation nationale ou dans le cadre du droit interne. De surcroît, les mécanismes juridiques garantissant la mise en oeuvre des protections prévues sont faibles, l’effectivité des traités reposant principalement sur des volontés politiques, sans aucune sanction formelle en cas de non-respect. Ces ententes sont avant tout des traités entre États, sans participation aucune des minorités concernées, dont le but est de contribuer à un bon voisinage et de réaffirmer leur intégrité territoriale et l’intangibilité des frontières antérieurement établies. Ce sont finalement davantage les États parents qui peuvent à travers des actes unilatéraux protéger les minorités nationales situées sur un État voisin. Cela étant, ces actes unilatéraux sont par nature limités par un principe essentiel en droit international : la souveraineté de l’État de résidence des minorités. Ainsi la Commission de Venise a explicitement récusé les effets extraterritoriaux de ces normes nationales au nom du respect de la souveraineté territoriale des États[42].
Ce type de conventions bilatérales ne peut pas non plus servir de modèle à l’entente entre les autochtones du Québec, le Canada et le Québec. Le contenu de l’entente que nous évoquons irait en effet beaucoup plus loin que les droits octroyés par ces accords et accorderait une place beaucoup plus grande aux populations concernées, à savoir les peuples autochtones du Québec. Mais surtout l’objet de l’accord serait précisément de laisser perdurer une part délimitée du droit canadien et même un rôle pour les institutions canadiennes sur le territoire québécois pour une partie de sa population. Le droit canadien aurait par conséquent un effet direct extraterritorial. Or les analyses menées par la Commission de Venise nous rappellent les limites inhérentes au principe de souveraineté territoriale[43], cardinal en droit international qui exige le consentement de l’État pour qu’une action unilatérale d’un autre État produise des effets à l’intérieur de ses frontières.
En définitive, aucun des précédents internationaux que nous venons d’examiner ne correspond totalement à l’entente que nous considérons. Dans les deux cas, force est de constater que les accords internationaux ne prévoyaient que peu de mécanismes juridiques assurant leur effectivité et des garanties suffisantes aux collectivités concernées, qui de manière générale, n’ont pas participé aux processus de négociation ou de mise en oeuvre. Si bien que, en dépit du caractère international des accords, les spécificités minoritaires des populations concernées ne sont efficacement protégées que par le droit interne, par des actes unilatéraux de l’État de résidence ou de l’État parent (ses actes étant eux fortement limités par la souveraineté de l’État de résidence). En effet, soit le statut de la minorité concernée dépend du nouvel État qui a réussi à accommoder ses revendications particulières (notamment en accordant une véritable autonomie), mais en coupant les liens avec l’État d’origine pour notre premier exemple des îles Åland. Soit les traités bilatéraux n’ont que peu de portée et les droits des minorités sont accordés par l’État parent et se pose dès lors un problème d’application extraterritoriale de ses normes unilatérales dans notre second cas de figure. Si bien que la comparaison avec ces traités bilatéraux permet finalement de mettre en exergue la nécessité du dépassement de ces modèles internationaux classiques à la faveur d’un modèle « supranational » apportant de meilleures garanties aux peuples autochtones du Québec.
Il faut en effet faire en sorte que l’ensemble des droits des peuples autochtones soit maintenu ainsi que les responsabilités du Canada telles qu’elles existent en droit canadien, mais aussi assurer leur effectivité par des mécanismes de contrôles politique et juridictionnel canadiens et québécois. Il faut dès lors dépasser le cloisonnement entre les deux ordres juridiques canadien et québécois qui empêche le maintien d’un lien juridique et politique pour les populations concernées. Dès lors, une application du droit canadien à l’égard des personnes ou des territoires situés dans un Québec indépendant devra nécessairement s’articuler dans le cadre d’un traité international dans lequel le Québec consent à l’opposabilité du droit canadien et à l’action des autorités canadiennes sur son territoire dans un champ circonscrit. Cela pourra donc se faire par la médiation de normes supranationales qui s’imposeront dans l’ordre juridique québécois, mais qui seront canadiennes. Il faudrait en outre assurer la réception constitutionnelle de ces normes supranationales tant en droit québécois qu’en droit canadien.
III. Des techniques supranationales assurant la continuité juridique : l’EEE comme source d’inspiration
A. Les modalités réalisables d’une « translation normative » d’un espace à l’autre
Un modèle pertinent a pu être trouvé dans un domaine qui ne concerne pas les minorités ou les peuples autochtones, auprès d’une structure supranationale à vocation économique : l’Espace économique européen (EEE). L’EEE, né des accords de Porto de 1992, est le fruit d’une histoire chaotique qui, pour résumer, permet de réaliser l’inclusion de certains États européens dans un grand marché européen, sans devenir membre de ce qui est aujourd’hui l’Union européenne (UE). Après avoir conçu l’Association européenne de libre-échange (AELE)[44] comme une organisation économique concurrente du projet communautaire, considéré comme trop « supranational » et excessivement politique, les États qui ne s’étaient pas tournés directement vers une adhésion (comme le Royaume-Uni) décidèrent de s’en rapprocher dans le cadre d’un partenariat économique poussé. Aujourd’hui, il concerne trois des quatre États de l’AELE (le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège[45]). Or, les négociations relatives au Brexit nous l’ont récemment rappelé, l’Union européenne n’ouvre son marché qu’à la condition de se conformer à ses règles communes[46]. Ces règles permettent ainsi d’assurer une saine concurrence ou encore une meilleure circulation en harmonisant les législations internes. Il est possible d’en garantir le respect par un ou plusieurs États pourtant non membres de l’Union européenne par l’intermédiaire d’un autre traité international, c’est l’objectif de l’Accord EEE[47].
Ce faisant, tout un pan du droit matériel de l’Union européenne (notamment les quatre libertés fondamentales du marché intérieur européen relatives aux marchandises, capitaux, services et personnes) s’applique à ces trois États et est justiciable sur leur territoire. L’Accord EEE reprend en effet une partie du droit des traités relatifs à l’Union européenne (le droit primaire), mais prévoit également que ces trois États non membres de l’UE soient assujettis à une portion du droit édicté par les institutions européennes (le droit dérivé). Cette structure supranationale procède ainsi à une translation d’un contenu normatif préexistant, et assure aussi une mise à jour continue des actes édictés depuis par les institutions de l’Union européenne, en matière commerciale, de protection des consommateurs ou encore d’environnement. S’agissant du droit dérivé, ce sont les annexes de l’Accord qui ont incorporé le grand nombre d’actes édictés par les institutions de l’UE au moment de la conclusion de l’Accord EEE. Or, « le droit dérivé applicable aux États non UE de l'EEE n'est en outre pas « gelé » à la date desdites annexes »[48], il est prévu des mécanismes juridiques afin d’aligner au fur et à mesure le droit applicable à ces États non membres à celui des États membres, dans les domaines définis par l’Accord EEE. Ainsi l’article 102 assure cette intégration continue dans les annexes :
Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du présent accord[49].
L’EEE comprend en effet une structure institutionnelle, ayant pour objectif de remplir le rôle dévolu à certaines institutions de l’UE (encore appelée Communauté en 1992), mais aussi afin d’assurer cette « translation normative ». Ainsi le Comité mixte de l’EEE, composé de représentants des États de l’EEE et de l’UE, à la charge de modifier ces annexes et d’adapter le droit de l’UE au contexte de l’EEE. En dépit de la nécessité de garantir qu’un droit identique s’applique dans ce domaine du marché intérieur à tous les États y participant, la transcription n’est pas automatique, mais filtrée.
Le recours à un tel modèle peut sembler à première vue étonnant, le domaine visé est dissemblable et il est proposé de comparer ce projet d’entente (qui serait selon les canons du droit international actuel un traité bilatéral entre le Québec et le Canada) avec une convention entre deux organisations internationales. Or l’approche comparative fonctionnelle permet de dépasser ces différences, pour s’attacher aux outils juridiques servant précisément à assurer les mêmes droits, dans un domaine déterminé, aux particuliers de part et d’autre de deux espaces normatifs distincts.
Ainsi l’entente pourrait largement s’inspirer des mécanismes juridiques préservant l’homogénéité juridique. L’entente pourrait ce faisant reprendre le contenu du « bloc constitutionnel autochtone » canadien dans son corps et de la même manière reproduire en annexe la législation canadienne pertinente. L’adaptation constante à la modification du droit canadien relatif aux peuples autochtones pourrait également se faire à la manière de l’EEE, en y apportant des améliorations techniques (puisqu’on a pu s’émouvoir d’un certain retard dans l’inscription dans les annexes[50]) et en tenant compte de la présence et du rôle des peuples autochtones. Dès lors, le Comité mixte d’une telle entente comprendrait non seulement des représentants canadiens et québécois, mais aussi des représentants autochtones. Sur le plan technique, l’entente pourrait prévoir une sanction plus efficace que celle de l’EEE lorsque le comité mixte ne modifie pas les annexes (une transcription automatique au-delà d’un délai par exemple).
En outre, une clause d’interprétation uniforme entre les dispositions de l’EEE et leurs « soeurs jumelles » en droit de l’UE (article 105 EEE), permet également une mise en oeuvre homogène en faisant en sorte que les mêmes droits et obligations s’appliquent aux opérateurs économiques. Une telle clause d’interprétation conforme entre le droit substantiel de l’entente reprenant le contenu normatif canadien avec celui-ci pourrait de la même manière garantir une application juridique équivalente pour les peuples autochtones de part et d’autre de la frontière entre le Québec et le Canada.
B. Les procédés de mises en oeuvre à adapter
De manière générale, les modalités d’application d’une telle entente ne sont pas à négliger et demandent la mise à disposition de ressources financières pour la mener à bien ou encore de réfléchir à une structure administrative et juridictionnelle. Bien entendu, les modalités précises prévues par l’Accord EEE ne sont pas toujours d’une grande pertinence dans le contexte nord-américain. Ainsi, la structure opérationnelle de l’entente tripartite gagnerait à coller davantage à la culture juridique canadienne et québécoise ainsi qu’aux modèles administratifs existants. Cela permettrait en outre d’assurer une continuité non seulement juridique, mais aussi administrative pour les peuples autochtones intéressés. Ainsi, les normes canadiennes pourraient par exemple être appliquées au Québec par l’administration canadienne si c’est le premier choix des autochtones. Il est aussi envisageable que les peuples autochtones du Québec eux-mêmes puissent administrer les lois et les politiques canadiennes qui les touchent. Cela présenterait l’avantage d’être conforme aux aspirations à l’autonomie des peuples autochtones.
S’agissant de l’architecture juridictionnelle de l’entente, nécessaire pour assurer sa bonne application et trancher les litiges la concernant, ici encore le maintien de la structure contentieuse actuelle paraît souhaitable. Ainsi s’agissant des premiers échelons juridictionnels ordinaires, l’entente pourrait reconduire la dualité judiciaire existant entre les juridictions québécoises et les juridictions fédérales. De la sorte, une norme canadienne applicable au Québec pourrait dans certains cas être contestée devant une juridiction canadienne et la contestation d’une norme québécoise, au motif qu’elle est contraire aux normes canadiennes reconduites par le traité, pourrait être faite devant un tribunal québécois. En revanche il paraît difficilement acceptable du point de vue du respect de la souveraineté du Québec de conserver une cour suprême « exclusivement canadienne » comme ultime degré de juridiction.
La Cour AELE offre alors une expérience intéressante dans la mesure où elle a été conçue comme la juridiction compétente pour interpréter l’Accord EEE, au côté de la Cour de justice de l’Union européenne qui garde son rôle d’ultime interprète du droit dans l’Union européenne. Au départ il avait été envisagé de créer une juridiction commune à l’EEE et à l’UE, la Cour EEE qui aurait été « intégrée dans son fonctionnement à la Cour de justice européenne […] et composée de cinq membres, dont trois siégeraient au sein de la Cour de justice européenne »[51]. Or, la Cour de justice européenne avait estimé en 1991 qu’une telle juridiction représentait un danger pour l’autonomie du droit de l’Union[52]. L'’actuelle Cour AELE n’a donc de compétences que vis-à-vis de l’AELE. Elles sont limitées aux seuls États AELE, aux individus et opérateurs économiques installés sur le territoire AELE ainsi qu'aux décisions prises par l’Autorité de surveillance AELE (l’institution ayant un rôle équivalent à la Commission européenne dans l’UE). En dépit de cette dualité, l’homogénéité juridique reste assurée, puisque la Cour AELE est tenue de statuer conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. La pratique a montré qu’un dialogue constructif avait pu être noué entre les deux cours s’agissant de questions juridiques nouvelles dont la Cour AELE avait eu à connaître en premier[53]. L’Accord EEE prévoit en outre la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui n’a jamais été mis en pratique[54].
Sans nécessairement reproduire ce schéma, une cour supranationale instituée par l’entente tripartite paraît indispensable pour interpréter l’entente, trancher en dernier recours les éventuels litiges entre les États partis ou encore constituer cet ultime degré d’appel pour les litiges ordinaires dans le domaine de l’entente. Si l’on se fie à l’expérience EEE, une cour parallèle à la Cour suprême du Canada ne serait nullement un obstacle à la continuité juridique canadienne. Outre la mise en place d’une disposition d’interprétation conforme faisant en sorte que la juridiction supranationale aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour suprême, il serait possible de prévoir un lien organique entre les deux cours, pour mieux garantir l’uniformité d’interprétation entre les deux espaces juridiques, et que des juges de la Cour suprême du Canada y siègent. Une telle composition mixte, canadienne et québécoise, mériterait en outre d’être complétée par une composante autochtone (en comprenant par exemple un juge nommé par les collectivités autochtones concernées).
En définitive, le système EEE/AELE offre bien un modèle digne d’attention dans le cadre de l’indépendance du Québec. C’est d’ailleurs une drôle de revanche pour l'Accord EEE qui a longtemps été considéré comme une sorte de régime transitoire ou d’antichambre de l’UE[55] s’agissant des États européens frileux vis-à-vis de l’intégration communautaire, notamment après le départ de trois de ses États vers l’UE. Il est en effet revenu « à la mode » dans le cadre des débats entourant les relations futures entre un Royaume-Uni hors UE et l’UE, et nous proposons aujourd’hui de s’en inspirer pour aménager des coexistences apaisées dans un Québec indépendant.
Ceci étant, il ne faut pas non plus minimiser un des inconvénients majeurs de ce type de partenariat (qui expliqua le choix de certains des États d’en sortir à la faveur d’une pleine adhésion à l’Union européenne) : l’absence de participation à l’édiction des nouveaux actes normatifs européens qui leur sont applicables[56]. De la même façon, dans le cadre de l’entente tripartite préconisée, le Québec souverain renoncerait bien entendu à sa place dans la fédération canadienne et donc à tous ses représentants au sein des institutions fédérales, parlementaires notamment. Pourtant l’entente l’obligerait bien à appliquer sur son territoire des normes décidées sans lui au Canada dans le domaine « autochtone » de l’entente, habiliterait des tribunaux canadiens à appliquer des normes canadiennes sur son territoire et pourrait même autoriser l’administration canadienne à agir à l’intérieur de ses frontières dans le champ du bloc constitutionnel autochtone. C’est une concession de taille pour le Québec en vue de satisfaire une revendication autochtone de continuité juridique canadienne.
Ceci étant, et contrairement à l’Accord EEE, l’entente tripartite porte sur des sujets de droit particulier, les autochtones, et non pas uniquement une « matière » spécifique. Cela autorise ce faisant ces personnes à agir comme des citoyens et participer au Canada aux décisions qui les concernent.
Ainsi il nous paraît envisageable que les peuples autochtones du Québec ayant choisi la continuité canadienne puissent élire des représentants auprès du Parlement canadien. Cette audacieuse proposition répond à un impératif démocratique puisque ces citoyens autochtones pourraient voter pour des représentants québécois privés de compétence eu égard à bien des questions les intéressant directement (le domaine de l’entente), mais n'auraient pas de représentants au sein des institutions canadiennes qui prennent réellement ces décisions. Les peuples autochtones du Québec impliqués dans le traité pourraient dès lors élire au moins un député et peut-être plus, selon le nombre de peuples qui aura décidé de se prévaloir de la continuité canadienne.
L’existence de députés autochtones du Québec serait l’expression exemplaire d’une véritable responsabilité politique du Canada envers les peuples autochtones du Québec ayant choisi de conserver leur lien politique et juridique avec la fédération. Il faudrait bien sûr voir combien de peuples opteraient pour la continuité canadienne, mais le fait que le Yukon et le Nunavut aient chacun un représentant pour une population actuellement d’environ 39 000 personnes nous donne une idée de ce que le principe de représentation proportionnée pourrait tolérer à l’égard des peuples autochtones du Québec dont le nombre est en ce moment estimé à plus de 150,000 personnes.
Toutefois, l’élection de députés autochtones du Québec se heurterait peut-être à de la résistance. En effet, le représentant autochtone canado-québécois voterait bien entendu les projets et propositions de lois dans le domaine du traité, mais voterait-il aussi tous les autres projets de loi fédéraux? Cela lui donnerait un pouvoir législatif sur des affaires canadiennes sans rapport avec la continuité canadienne au Québec. Des mécanismes parlementaires ont été mis en place au Royaume-Uni pour régler ce type de difficulté causée par le fait que des députés provenant des parties du Royaume disposant d’institutions autonomes pouvaient aussi voter des lois d’intérêt purement local pour l’Angleterre[57]. Par ailleurs, il semble pertinent de mentionner qu’il existe en France depuis 2012 des députés élus dans des circonscriptions à l’étranger, alors que la plupart de législations débattues au Parlement français ont vocation à s’appliquer sur le territoire français sur lequel ne résident pas les électeurs de ces députés[58].
***
La reconduction du bloc constitutionnel autochtone canadien dans un Québec indépendant serait très conséquente, car elle entraînerait le maintien, en matière autochtone, d’un rôle important pour le droit et les institutions canadiennes sur le territoire du Québec après son indépendance. D’aucuns pourraient considérer qu’un tel engagement viendrait donc limiter une partie de l’exercice de ses compétences souveraines si tôt acquises. D’un point de vue politique, il nous paraît clair qu’un tel renoncement québécois ne devrait pas être sous-estimé. En acceptant notamment de ne plus prendre part aux décisions canadiennes dont certaines seront applicables à son territoire, il sacrifierait en quelque sorte une part du lien démocratique entre ses citoyens et le pouvoir de décision en matière autochtone.
D’un autre côté, le respect de la volonté des peuples autochtones constitue un impératif démocratique incontournable et une condition du destin commun.
De plus, d’un point de vue juridique, une telle limitation pleinement et dûment consentie dans le cadre d’un accord international ne serait qu’une manifestation de la souveraineté internationale du Québec et du choix démocratique du peuple québécois d’aménager l’exercice de cette souveraineté. Le droit international se fondant largement sur les volontés concordantes des parties aux traités, il s’en remet in fine à leur imagination juridique pour construire les arrangements utiles à leurs intérêts respectifs.
Un tel régime ne serait toutefois pas sans précédent dans l’histoire des relations internationales ou transnationales puisque les pays membres des accords de type EEE/AELE se sont pareillement autolimités en acceptant l’application directe sur leur territoire d’un corpus juridique européen qui embrasse une gamme de domaines et de questions plus amples encore que ce qui est envisagé ici. Dans l’un et l’autre des cas, l’expression de la souveraineté des États reste le fondement et la justification de dispositifs transnationaux qui en aménagent l’exercice. Par ailleurs, il sera loisible au Québec indépendant de proposer aux peuples autochtones un pacte de refondation tel qu’ils jugeraient alors que leur rattachement exclusif au Québec offre les perspectives les plus porteuses de décolonisation.
Quant aux peuples autochtones du Québec qui auront fait le choix de la continuité canadienne, la solution avancée dans cette étude ne correspondrait peut-être pas au désir sincère de certains qui préféreraient le maintien d’une relation strictement fédérale entre le Québec et le Canada, ou qui voudraient se détacher complètement d’un Québec indépendant. Lorsqu’elles ont été exprimées, toutefois, ces positions reposaient sur le postulat d’un désengagement du Canada, et donc de la perte de la relation avec la Couronne canadienne et de droits collectifs uniques fondés sur le droit canadien. La continuité canadienne viendra honorer leur volonté de conserver ce qu’ils tiennent pour des acquis historiques fondamentaux.
À plusieurs égards, l’entente évoquée dans cette étude permettrait même des avancées dignes d’intérêt pour les peuples autochtones concernés. Elle opérerait un développement de leur personnalité internationale en les reconnaissant comme de véritables protagonistes d’une entente internationale qu’ils auront négociée et signée et dont la modification et la dénonciation exigeront leur consentement. Ce faisant, ils seront à même d’infléchir de manière décisive la relation juridique entre le Québec et le Canada, mais aussi leurs propres relations avec ces États. Ils participeront de plus aux travaux du comité international mixte chargé de la gestion et du suivi de l’application de l’entente. Ils pourraient même voir un des leurs siéger d’office au sein de la Cour suprême mixte chargée de trancher en dernier recours les litiges découlant de l’entente. Sur le plan interne, l’entente internationale ayant été intégrée au droit constitutionnel, ils exerceront au Québec un véritable pouvoir constituant puisque leur accord devrait être requis pour toute révision constitutionnelle concernant la modification ou la dénonciation de l’entente.
Pour le Canada, l’entente proposée ici serait le moyen par lequel il pourrait honorer de manière exemplaire son engagement solennel de s’acquitter de ses responsabilités à l’égard des peuples autochtones dans l’éventualité d’une sécession du Québec. Il bénéficierait aussi d’un régime juridique connu et prévisible sur le territoire de son nouveau voisin dans un domaine d’un intérêt commun de première importance. La coopération entre les deux pays s’en trouverait grandement facilitée.
Certes, il se trouve des observateurs pour laisser entendre que la quête d’une entente de sécession respectueuse du cadre processuel et substantif dégagé par la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec est, en pratique, vaine puisqu’une telle entente devra par la suite être ratifiée par les acteurs constituants canadiens et que les protagonistes institutionnels du processus de modification constitutionnelle seront libres de répudier ladite entente, ce qu’ils feront assurément selon ces observateurs. Les tenants d’une impossible sécession constitutionnelle avancent par exemple que « la formule de l’unanimité viendrait retarder, voire empêcher l’aboutissement des négociations »[59]. Ce qui conforte leur affirmation selon laquelle, « une application intégrale de l’Avis de 1998 en vient pratiquement à bloquer les possibilités d’une sécession de la province du Québec du Canada »[60].
On se gardera toutefois de présumer que la constitution encadrerait si minutieusement la négociation d’une entente de sécession pour ensuite rendre la mise en oeuvre de cette entente juridiquement impossible en ouvrant toute grande la porte à des décisions arbitraires ou abusives au stade ultérieur de sa ratification[61]. Ce serait en effet permettre aux institutions de saborder allègrement le dispositif juridique mis en place par la Cour puisque les règles de révision constitutionnelle pourraient servir, alors, à empêcher des négociations par ailleurs constitutionnellement requises ou à les rendre sans objet, ce qui mettrait à mal la primauté du droit[62].
En fait, la Cour suprême indique clairement que l’obligation d’agir de bonne foi et de respecter les principes constitutionnels sous-jacents imprègne la procédure de modification constitutionnelle elle-même[63]. En définitive, les institutions constituantes auront certes une marge d’appréciation au moment de se prononcer sur un éventuel accord de sécession préalablement négocié de bonne foi, mais cette marge ne sera pas juridiquement absolue. Même s’ils ne peuvent dicter un résultat, les tribunaux jouent de longue date un rôle de « facilitateurs » lorsqu’il s’agit d’assurer la légalité des processus gouvernés par le principe de bonne foi[64]. La Cour suprême n’a pas renoncé à ce rôle relativement au processus suivant un vote favorable à la sécession du Québec[65].
Appendices
Notes
-
[∗∗∗]
Ce texte est publié parallèlement à une étude beaucoup plus approfondie. Voir Ghislain Otis et Aurélie Laurent, « L’indépendance du Québec et le choix autochtone de la continuité canadienne », (2020) 66:2 RD McGill 253. Les auteurs ont ici pour double objectif de faire la synthèse de cette étude et de présenter un argumentaire complémentaire. Les auteurs sont reconnaissants à la Revue de droit de McGill de les avoir autorisés à publier ce texte.
-
[1]
Voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217.
-
[2]
Ibid (« Le rejet clairement exprimé par le peuple du Québec de l'ordre constitutionnel existant conférerait clairement légitimité aux revendications sécessionnistes, et imposerait aux autres provinces et au gouvernement fédéral l'obligation de prendre en considération et de respecter cette expression de la volonté démocratique en engageant des négociations » au para 88). Voir aussi ibid au para 92. La Cour ajoute que « [l]es droits des autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent retirer au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecte les droits des autres ».
-
[3]
Ibid au para 90.
-
[4]
Ibid au para 139.
-
[5]
Voir notamment la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG 295 Doc off AG NU 61e session, supp. n° 49, Doc NU A/61/295 (2007) art 3. Voir aussi OÉA, Assemblée générale, 46e sess, Déclaration américaine relative aux droits des peuples autochtones, Rés AG/RES.2888 (XLVI-O/16) (2016), art III (les déclarations affirment en des termes identiques que les peuples autochtones ont « le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». L’article 3 de la Déclaration de l’ONU doit se lire en tandem avec l’article 46 qui précise qu’aucune disposition de la Déclaration n’encourage ni n’autorise « aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant ». La même limite s’applique à l’article III de la Déclaration de l’OÉA selon l’article IV de cette Déclaration).
-
[6]
Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, affirme que : « Notre position n'a pas pour but d'empêcher les Québécois de se prononcer sur leur destin, elle vise plutôt à ce qu'un peuple ne décide pas pour l'autre. » Voir Pierre Trudel, Ghislain Picard. Entretiens, Boréal, Montréal, 2009 à la p 101.
-
[7]
Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec (Bélanger-Campeau), Les aspects juridiques de la redéfinition du statut politique et constitutionnel du Québec, José Woehrling (2002) à la p 100.
-
[8]
Zebedee Nungak, Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, Montréal, Boréal, 2019 aux pp 170 –171.
-
[9]
Un acteur indépendantiste de première ligne dans de débat rappelle que «(e)n fait, toutes les nations autochtones du Québec étaient défavorables, voire énergiquement opposées, au projet de souveraineté du Québec » Voir David Cliche, Un seul Québec. Dialogue avec les Premières Nations (1978-1995), Boréal, Montréal, 2021 à la p 151.
-
[10]
Voir notamment Dalie Giroux, Dans l’oeil du maître, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020 aux pp 41–78.
-
[11]
Ibid à la p 91.
-
[12]
Voir par exemple le bilan accablant dressé dans John Borrows, « Canada’s Colonial Constitution », dans John Borrows et Michael Coyle, dir, The Right Relationship. Reimagining the Implementation of Historical Treaties, Toronto (ON), University of Toronto Press, 2017.
-
[13]
Accord sur l'Espace économique européen, 2 mai 1992, n° L1 3 à la p 522 (entrée en vigueur : 1er janvier 1994) [Accord EEE].
-
[14]
Slattery utilise l’expression « Aboriginal Constitution ». Voir Brian Slattery, « The Aboriginal Constitution » (2014) 67:9 SCLR à la p 319.
-
[15]
3 Geo III, reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 1.
-
[16]
Voir Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 91(24), reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 5. Il se pourrait qu'au moment pertinent cette disposition ait été remplacée par un régime plus moderne d'aménagement des compétences législatives
-
[17]
Voir Loi constitutionnelle de 1982, art 35, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
-
[18]
Voir Nation haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 RCS 511, 2004 CSC 73 [Nation haïda]. Voir aussi Manitoba Metis Federation Inc. c Canada (Procureur général), [2013] 1 RCS 623 au para 66, 2013 CSC 14 [MMF].
-
[19]
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, supra note 17.
-
[20]
Québec, Convention de la Baie James et du Nord québécois et Conventions supplémentaires, Publications du Québec, 2014, en ligne: <http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/conventions/lois/loi.fr.html >.
-
[21]
Voir Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique, [2014] 2 RCS 257, 2014 CSC 44. Voir aussi Première Nation de Grassy Narrows c Ontario (Ressources naturelles), [2014] 2 RCS 447, 2014 CSC 48 (il est toutefois entendu que si la loi québécoise porte atteinte à ces droits, cette atteinte devra être justifiée selon des critères dégagés par la Cour suprême dans l’affaire R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 et la jurisprudence subséquente).
-
[22]
Le Québec pourra néanmoins conclure des traités bilatéraux avec les autochtones dans la mesure où ils relèvent des attributions du Québec, donc sous réserve de la compétence canadienne aux termes de l’entente.
-
[23]
Loi sur les Indiens, LRC (1985), c I-5.
-
[24]
Voir Kent McNeil, « Aboriginal Nations and Quebec’s Boundaries: Canada Couldn’t Give What it Didn’t Have » dans Kent McNeil, dir, Emerging Justice, Essays on Indigenous Rights in Canada and Australia, Saskatoon (SK), Native Law Center, 2001.
-
[25]
Voir notamment Peter Radan, « You Can’t Always Get What You Want : The Territorial Scope of an Independent Quebec » (2003) 41:4 OHLJ 629. Voir aussi Peter W. Hogg, « Principles Governing the Secession of Quebec » (1997) 8:1 NJCL 19.
-
[26]
Robert E Hawkins, « A Duty to Discuss: The Supreme Court’s Role as Facilitator of Last Resort » (2014) 64 SCLR 397 au para 51.
-
[27]
Ce qui signifierait aussi qu’ils se sépareraient d’un grand nombre des leurs qui vivent dans les zones urbaines du Québec à l’extérieur de leur territoire traditionnel. Une nouvelle frontière internationale viendrait séparer les communautés et les familles.
-
[28]
Voir Loi constitutionnelle de 1871, 34 & 35 Vict, c 28 (R-U), art 3, reproduit dans LRC 1985, annexe II, nº 11.
-
[29]
Voir notamment Douglas Sanders, « If Quebec Secedes from Canada Can the Cree Secede from Quebec? » (1995) 29:1 UBC L Rev 143 au para 50 (Sanders reconnaît à juste titre que les autochtones n’ont pas plus le droit à la sécession unilatérale que le Québec).
-
[30]
Daniels c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), [2016] 1 RCS 99, 2016 CSC 12 au para 37. Il ne faut en effet pas perdre de vue l’évolution rapide du droit constitutionnel et ce que la Cour suprême a décrit comme « la reconnaissance grandissante du fait que les peuples autochtones et non autochtones sont des partenaires dans la Confédération ».
-
[31]
Voir Nigel Bankes et Timo Koivurova, The Proposed Nordic Saami Convention. National and International Dimensions of Indigenous Property Rights, Oxford, Hart Publishing, 2013.
-
[32]
Par exemple l’actuel Cambodge a pu être placé sous une « double vassalité » de la France et du Siam entre 1863 et 1867, on peut penser aussi à l’actuel Viet Nam (l’Annam) entre le début de la colonisation française et la fin de la vassalité chinoise entre 1874 et 1884 (le traité de Hué, signé le 6 juin 1884, est considéré comme un des « traités inégaux » et mettra en place le protectorat colonial français).
-
[33]
Kinga Gál, « Bilateral Agreements in Central and Eastern Europe: A New Inter-State Framework for Minority Protection? » (1999) 4 ECMI 1 à la p 3.
-
[34]
D’ailleurs, le Protocole nº 2 (sur le territoire d’Åland) sur l’accession à l’Union européenne de l’Autriche, la Finlande et la Suède évoque ce statut spécial des îles Åland dont elles jouissent en droit international.
-
[35]
Contrairement au reste de la Finlande qui comporte deux langues officielles, le finnois et le suédois, les îles d’Åland n’ont que le suédois comme langue officielle dans les rapports avec l’État ou dans l’éducation.
-
[36]
Voir Lauri Hannikainen, « Autonomy in Finland: The Territorial Autonomy of the Åland Islands and the Cultural Autonomy of the Indigenous Saami People » (2002) 2:1 Baltic YB Int'l L aux pp 175–197.
-
[37]
Par exemple l’Allemagne a conclu des traités d’amitié, de coopération et de partenariat avec la Bulgarie (1991), la Hongrie (1992) la Roumanie (1992), la Pologne (1991) et la République Tchèque (1992). La Hongrie l’a également fait avec cinq de ces États voisins (Ukraine en 1991, Slovénie en 1992, Croatie en 1992, Slovaquie en 1995 et Roumanie en 1996). On peut également citer les coopérations entre la Pologne et ses voisins, la Russie et le Kazakhstan ou encore l’Ukraine avec la Moldavie ou la Lituanie.
-
[38]
Par exemple le droit de s’adresser dans la langue minoritaire dans la sphère privée et publique peut ainsi être reconnu, ou celui de suivre une éducation dans la langue minoritaire (souvent sous réserve d’apprendre la langue officielle).
-
[39]
C’est le cas des Conventions entre la Hongrie et la Croatie et entre la Hongrie et la Slovénie. Voir Emma Lantschner et Roberta Medda, « Bilateral Approach to the Protection of Kin-Minorities » dans Commission européenne pour la démocratie par le droit, dir, La protection des minorités nationales par leur État-Parent, CDL, 2002 aux pp 76–92.
-
[40]
C’est le cas de la Convention entre la Roumanie et la Slovaquie. Voir ibid.
-
[41]
Gál, supra note 33 à la p 12. Il existerait de très rares exceptions, mais qui demeurent très vagues, la Convention entre la Hongrie et la Croatie évoquant une autonomie culturelle.
-
[42]
Conseil de l’Europe, Commission européenne pour la démocratie par le droit, 48e sess, Rapport sur le traitement préférentiel des minorités nationales par leur État parent, CDL-INF 019 (2001).
-
[43]
Ibid à la p 19 (« Il est légitime pour un État d’adopter des mesures législatives ou administratives concernant des citoyens étrangers sans demander le consentement préalable des pays concernés, du moment que ces lois ou réglementations ne prennent effet qu’à l’intérieur de ses frontières. Par exemple, un État peut décider de façon unilatérale d’accorder un certain nombre de bourses d’études à des étudiants étrangers méritants, qui souhaitent poursuivre leurs études dans ses universités. En revanche, quand la loi a spécifiquement des effets sur des citoyens étrangers dans un pays étranger, sa légitimité n’est pas aussi évidente. En réalité, il est inconcevable que l’État de résidence des individus concernés n’ait pas son mot à dire »).
-
[44]
Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, 4 janvier 1960, RO 1960 635 (entrée en vigueur le 1er juin 2002) [AELE].
-
[45]
La Suisse est le quatrième État de l’AELE, mais a refusé à la suite d’une votation fédérale du 6 décembre 1992 de devenir membre de l’EEE. D’autres États de l’AELE signataire du traité de Porto ont ensuite adhéré à l’Union européenne (l’Autriche, la Finlande et la Suède).
-
[46]
Voir par ex Michel Barnier, « Discours de Michel Barnier en séance plénière du Parlement européen », séance plénière, parlement européen, 18 décembre 2020, en ligne : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_2499.
-
[47]
Voir par exemple Jean-Claude Piris, « BREXIT ou BRITIN : fait-il vraiment plus froid dehors ? » (2015), en ligne (pdf) : Fondation Robert Schuman Policy Paper https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-bis-fr.pdf (dans le cadre du Brexit, l’adhésion à l’EEE est ainsi devenue une des options offertes au Royaume-Uni, on a ainsi pu parler de « modèle norvégien » à cet égard. Un accord ad hoc entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est en cours de négociation à l’heure où ces lignes sont écrites).
-
[48]
Sébastien Platon, « L’Union et les “autres Europe” » (2018) 620 Revue du marché commun et de l'Union européenne 394 aux pp 394–399.
-
[49]
Accord EEE, supra note 13.
-
[50]
Conclusions du Conseil adoptées le 16 décembre 2014, citées par Piris, supra note 47 aux pp 6–7.
-
[51]
Skuli Magnusson, « Fascicule 4000 : Cour AELE » dans JurisClasseur Europe Traité, 2011 au para 40.
-
[52]
Voir Avis de la Cour du 14 décembre 1991, 14 décembre 1991, CJCE nº 1/91 Rec p I-6079.
-
[53]
Voir Carl Baudenbacher, « The Judicial Dimension of the European Neighbourhood Policy » (2013) 8 EU Diplomacy Paper 1 à la p 1. Voir aussi Inga Kawka, « The Dialogue between the ECJ and the EFTA Court from the Perspective of the Homogeneity Principle » (2016), en ligne (pdf) : Geneva Jean Monnet Working Papers <http://www.ceje.ch/files/5914/6366/2735/Geneva_JMWP_10-Kawka.pdf> ; EFTA Court, case E 1/03, EFTA Surveillance Authority v Iceland, [2003], EFTA Court Report.
-
[54]
Voir Accord EEE, supra note 13, art 111-3. Voir aussi Carl Baudenbacher, « How the EFTA Court works – and why it is an option for post-Brexit Britain » (27 août 2017), en ligne : LSE <http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/08/25/how-the-efta-court-works-and-why-it-is-an-option-for-post-brexit-britain/>.
-
[55]
Voir Parlement européen, « Fiche thématique N° 32 - L'Espace Économique Européen (EEE) et l'élargissement de l'Union européenne » (17 novembre 1998), en ligne (pdf) : European Parliament <https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/32a2_fr.htm>.
-
[56]
Ibid (« Au début, les pays de l'AELE, à l'exception de l'Autriche, voyaient dans le futur accord EEE un moyen de bénéficier des avantages du marché unique sans être obligés pour autant de rejoindre la CE. Deux ans plus tard cependant, au terme des négociations, il était devenu clair pour la majorité des pays de l'AELE qu'une intégration économique étroite sans pouvoirs de décision n'était qu'un pis-aller par rapport à l'adhésion elle-même »).
-
[57]
Pour une évaluation critique de la solution mise de l’avant, voir Daniel Gover et Michael Kenny, « Answering the West Lothian Question? A Critical Assessment of ‘English Votes for English Laws’ in the UK Parliament » (2018) 71:4 Parl Aff 760.
-
[58]
Cette représentation politique des Français hors de France a été introduite par la révision constitutionnelle de 2008 qui a ajouté un dernier alinéa à l’article 24 de la Constitution française : « Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat » (art 24, al 5).
-
[59]
Voir Frédéric Bérard et Stéphane Beaulac, Droit à l’indépendance, Québec, Monténégro, Kosovo, Écosse, Catalogne, Editions XYZ, Montréal, 2015 à la p 117. Voir aussi ibid à la p 119 (Ils écrivent en outre qu’aucune des formules d’amendement en place « ne semble appropriée ni même convenable pour parvenir à un accord sur la sécession d’une province ») ; Benoît Pelletier, « Le face à face entre le projet sécessionniste québécois et la Constitution du Canada » (1997) 57 R du B 341 à la p 386 (Le professeur Benoît Pelletier a exprimé une opinion semblable, mais c’était avant que la Cour suprême ne rende son avis dans le Renvoi sur la sécession du Québec).
-
[60]
Bérard et Beaulac , ibid à la p 23.
-
[61]
Voir Mary Dawson, « Reflections on the Opinion of the Supreme Court of Canada in the Quebec Secession Reference » (1999) 11 Nat’l J Const L 5 aux pp 37–38. Une procureure du gouvernement fédéral concède que l’application des procédures d’amendement est elle-même contrainte par le devoir de négocier et d’agir de bonne foi.
-
[62]
Rien n’empêcherait par exemple, même pendant les négociations, une assemblée législative de voter une résolution affirmant qu’aucune résolution portant modification de la constitution pour donner effet à une éventuelle entente de sécession ne sera approuvée aux termes de la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 (supra note 17) étant entendu que l’assemblée n’acceptera jamais la sécession du Québec compte tenu du caractère sacré de l’unité canadienne. La négociation de bonne foi en vue de donner effet au vote référendaire deviendrait juridiquement caduque.
-
[63]
Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 1 au para 90. Elle intègre systématiquement son raisonnement à l’analyse du processus de révision constitutionnelle et affirme que les principes qu’elle énonce « doivent guider le processus de modification ».
-
[64]
Voir Hawkins, supra note 26 notamment aux para 64–65.
-
[65]
La Cour suprême souligne la « non-justiciabilité des questions politiques dénuées de composante juridique »; Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 1 au para 102; Voir aussi ibid paras 100–01. Elle n’a nullement renoncé à préciser les obligations juridiques des acteurs du processus de révision constitutionnelle. Cela est admis même par une juriste ayant représenté le gouvernement fédéral dans le dossier. Voir Dawson, supra note 61 à la p 38.