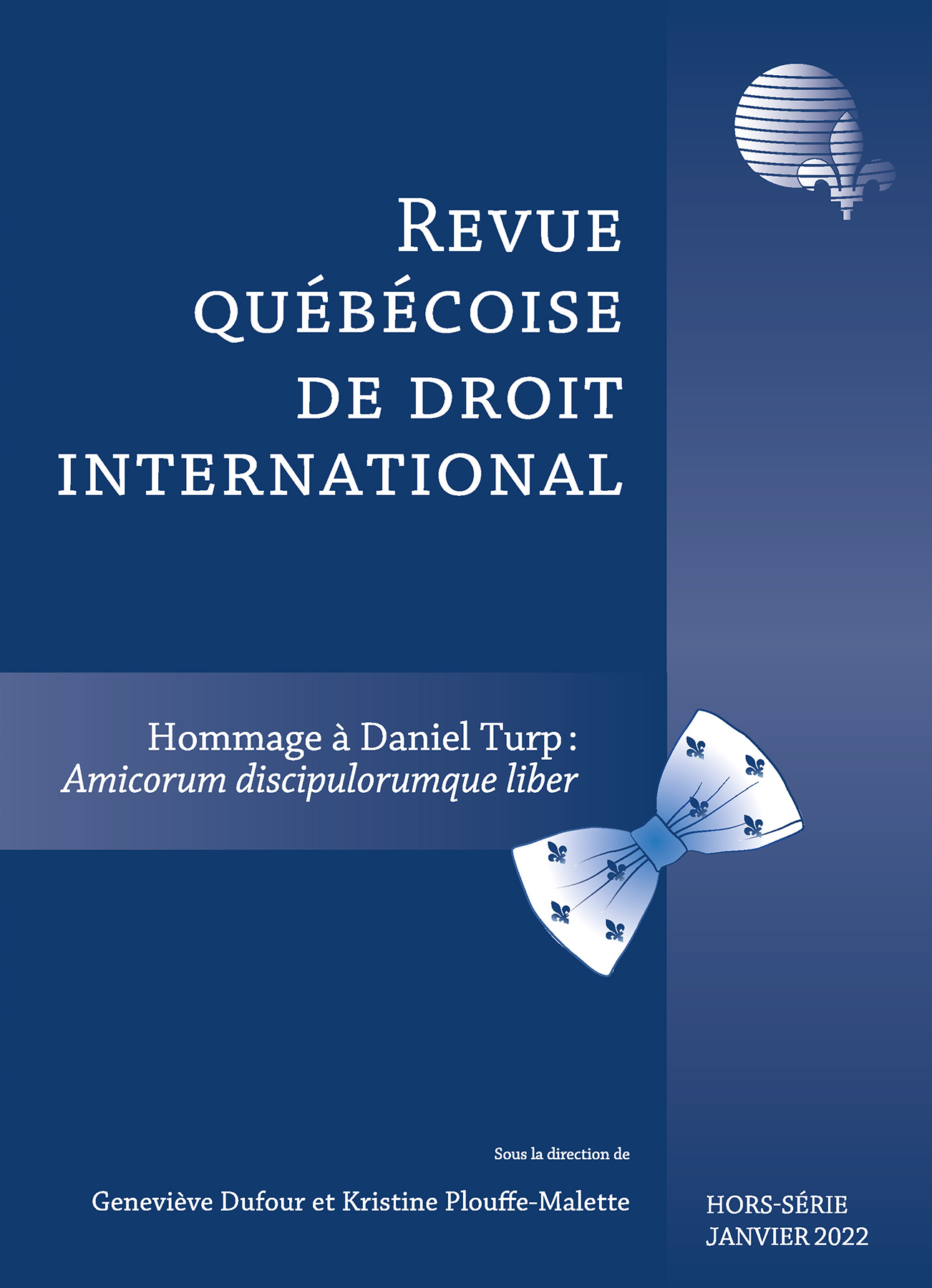Abstracts
Résumé
L’étude rédigée en toute indépendance en 1992 par cinq spécialistes de droit international à la demande de la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté de l’Assemblée nationale québécoise (et sans doute à l’instigation de Daniel Turp) a marqué les esprits. Elle établit qu’à défaut de pouvoir se prévaloir d’un droit à l’indépendance, le peuple québécois pourrait y accéder s’il établissait un pouvoir étatique effectif et que les frontières de cet État étaient, sauf accord contraire, les limites actuelles du Québec et que ce même raisonnement s’applique aux Premières Nations. Malgré certaines apparences, ces conclusions ne diffèrent pas radicalement de celles de la Cour suprême dans sa décision sur le Renvoi de 1998.
Abstract
The study written entirely independently in 1992 by five international law specialists at the request of the Parliamentary Committee to Examine Matters Relating to the Accession of Quebec to Sovereignty of the Quebec National Assembly (and out of doubt at the instigation by Daniel Turp) marked the spirits. It establishes that in default of being able to claim a right to independence, the Quebec people could achieve it if it established an effective state power and the borders of this state were, unless otherwise agreed, the current limits of Quebec, and that the same reasoning applies to First Nations. Despite certain appearances, these conclusions do not differ radically from those of the Supreme Court in its decision on the 1998 Reference.
Resumen
El estudio escrito de forma totalmente independiente en 1992 por cinco especialistas en derecho internacional a petición de la Comisión para el estudio de las cuestiones relativas a la adhesión de Quebec a la soberanía de la Asamblea Nacional de Quebec (y sin duda a instigación de Daniel Turp) dejó huella. Establece que, a falta de poder reclamar un derecho a la independencia, el pueblo de Quebec podría lograrlo si estableciera un poder estatal efectivo y que las fronteras de este estado fueran, salvo acuerdo en contrario, los límites actuales de Quebec y que el mismo razonamiento aplica a las Primeras Naciones. A pesar de ciertas apariencias, estas conclusiones no difieren radicalmente de las de la Corte Suprema en su decisión sobre la Remisión de 1998.
Article body
Quand ai-je rencontré Daniel Turp pour la première fois ? En tout cas, il y a très longtemps. Sans doute durant ses études en vue du doctorat en droit à Paris dès 1979 ou 1980. Nous étions sans aucun doute déjà amis lorsqu’il a accueilli, magnifiquement, à Québec, en 1996, la journée d’étude de la Société française pour le droit international (SFDI) sur l’Enseignement du droit international[1]. Et je soupçonne que c’est sur sa recommandation que j’ai reçu la visite en 1991, dans la maison que j’habitais alors dans la banlieue parisienne, d’André Binette, coordonnateur de la recherche en droit de la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté de l’Assemblée nationale québécoise.
J’ai un souvenir très précis de cette rencontre qui avait pour objet de me demander de réaliser une étude juridique sur diverses questions juridiques relatives à l’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de son accession à la souveraineté. Ce sujet ne pouvait que susciter l’intérêt de l’internationaliste généraliste que je suis — quand bien même je n’avais aucune idée préconçue sur l’indépendance du Québec. J’étais prêt à répondre favorablement à cette proposition, mais y ai cependant mis deux conditions :
– d’une part, conscient de l’importance de la question et des limites de mon autorité doctrinale, j’ai souhaité que l’étude à venir pût être co-signée par quelques-uns de mes plus éminents collègues ;
– d’autre part, condition sine qua non que j’impose, jusqu’à aujourd’hui, à toute demande d’expertise juridique, il devait être entendu que nous écririons en toute indépendance sans être tenus de soutenir quelque thèse que ce soit.
Les deux demandes furent acceptées sans hésitation.
Sur la première, je proposai trois noms d’amis estimés, juristes plus éminents que moi (mais comme moi professeurs, généralistes, de droit international) : Thomas M. Franck, (New York University), Rosalyn Higgins, (London School of Economics, membre du Comité des droits de l’homme) et Christian Tomuschat (Université de Bonn, alors président de la Commission du droit international des Nations Unies). André Binette, proposa d’y adjoindre Malcolm N. Shaw (Université de Leicester), qui avait déjà été consulté par la Commission[2] ce que j’acceptais très volontiers : excellent juriste, ami aussi, il était plus spécialiste que les quatre autres universitaires de ces questions.
Sur la seconde question, la réponse d’André Binette fut tout aussi positive et il me garantit la plus complète indépendance — promesse entièrement tenue par la suite. Mais me demanda-t-il : « Avez-vous [peut-être était-ce “As-tu” — au Québec, on a le tutoiement facile…] une idée sur la thèse que vous soutiendrez ? ». Ma réponse : « Oui — sous réserve bien sûr d’approfondir le sujet et de discussions avec mes co-auteurs, a priori, ma position est que ni le peuple québécois, ni les Premières nations [une expression que je rencontrais pour la première fois je crois], ne peuvent se prévaloir d’un droit à l’indépendance ; mais “advenant l’indépendance” [autre expression utilisée par mon interlocuteur], les limites actuelles devraient, en principe, être préservées — étant entendu que le même raisonnement s’appliquerait aux peuples autochtones si ceux-ci pouvaient établir dans les faits leur indépendance du Québec souverain ». Réaction un peu interloquée d’André Binette : « Eh bien ! ça va faire les manchettes ! ».
Cette première rencontre fut suivie, quelques semaines plus tard, d’une autre entre les cinq auteurs pressentis, François Geoffrion, Secrétaire de la Commission, et André Binette. Comme cela est précisé au début de l’étude, ce fut l’occasion de procéder à un premier échange de vues sur la manière d’aborder les questions posées — qui avaient été précisées entre temps[3]. À la suite de cette réunion, nous avons reçu une abondante documentation qui a grandement facilité notre tâche.
Après des échanges sur la teneur générale et le plan de l’étude il fut entendu avec mes quatre collègues que je tiendrais la plume sur la base de notes de synthèse sur certains des problèmes posés et qu’ils réagiraient à mon projet initial en proposant des améliorations. Cette façon de travailler nous a permis d’arriver à des conclusions unanimes à une très petite nuance près[4]. Notre Étude, datée du 8 mai 1992, a été publiée par la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté de l’Assemblée nationale du Québec[5]. Elle développe, pour l’essentiel, la thèse intuitive que j’avais exposée à André Binette.
L’Étude commence par souligner que les considérations juridiques ne sont qu’un élément du débat sur les frontières d’un Québec indépendant souvent obscurci par « des considérations souvent plus émotives que rationnelles »[6] alors qu’elle tente de se placer sur le seul terrain du droit international.
Sans entrer dans le détail du raisonnement (l’Étude compte 72 pages imprimées), le point de départ de celui-ci est énoncé dès le point 1.17 :
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes constitue un principe très général, “à géométrie variable”, dont les conséquences, sont toujours et partout le droit pour la communauté concernée de participer à son avenir, mais qui ne suffit à fonder le droit d’un peuple à accéder à l’indépendance au détriment de l’État auquel il est rattaché que dans des situations coloniales[7].
En revanche, comme l’« … on ne peut raisonnablement soutenir » que le peuple québécois soit un peuple colonial, ni qu’« il est privé du droit à une existence propre au sein de l’ensemble canadien ni de participer à la vie démocratique […, il] n’est pas juridiquement fondé à [invoquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes] pour justifier son éventuelle accession à l’indépendance », sans toutefois que cela l’empêche « de la revendiquer, et de l’obtenir ou de l’imposer : mais il s’agit là d’une question de pur fait que le droit international ne fonde ni ne réprouve : il en prend acte »[8]. Advenant l’indépendance effective, celle-ci se produirait dans le cadre des limites actuelles du Québec au sein du Canada. Et ce qui vaut pour le Québec vaut tout autant pour les Premières Nations dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs de celles-ci réussiraient à imposer sa souveraineté sur la partie du territoire qui lui est dévolue[9].
Comme l’avait pressenti André Binette, l’Étude a fait, en effet, les gros titres des journaux et parler d’elle assez longtemps : revenu au Québec quelques années plus tard — à l’occasion de la journée d’étude précitée de la SFDI, je suis tombé sur une émission de télévision consacrée à la « Consultation des cinq juristes » — aussi appelée « Avis des cinq juristes ou « internationalistes ».
Dans la préface du livre dans lequel il a publié l’Étude (en 2018), André Binette écrit :
Paradoxalement, l’Avis des cinq experts, qui est d’une importance historique pour le mouvement indépendantiste, a été commandé sous le gouvernement fédéraliste de Robert Bourassa. C’était l’époque où ce premier ministre, devant les sondages alors favorables à l’indépendance, laissait entendre qu’il pourrait la réaliser. Une fois au pouvoir, Jacques Parizeau cita l’Avis abondamment. Celui-ci est devenu une référence majeure dans la démarche devant mener à l’accession à l’indépendance après le référendum du 30 octobre 1995. Malgré les mises à jour nécessaires, rien de ce qui est survenu depuis 25 ans n’a remis en question fondamentalement le raisonnement de ses auteurs[10].
À vrai dire, pour autant que je puisse en juger de l’extérieur, il me semble que notre consultation a été très abondamment commentée et utilisée par les politiques de tous bords que ce soit après sa publication, à l’occasion des referendums de 1992 et de 1995[11], de la préparation et des commentaires du Renvoi relatif à la sécession du Québec de 1998[12] (le Renvoi), ou, plus tard de la discussion de la « loi sur la clarté » par le Parlement du Canada[13] et de celle sur les droits fondamentaux du peuple québécois par l’Assemblée nationale du Québec en 1999 et 2000[14].
L’Étude des cinq juristes a connu un regain d’intérêt à l’occasion du Renvoi relatif à la sécession du Québec soumis à la Cour suprême du Canada en 1998. Celui-ci comportait trois questions, à mon sens assez rhétoriques, sur la licéité de la sécession unilatérale du Québec, dont aucune ne recoupait directement celles qui avaient été posées aux cinq internationalistes, mais dont la deuxième (elle-même subdivisée en deux sous-questions) et la troisième impliquaient le même genre de problématique :
2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ?
3. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ?
Il n’est dès lors pas étonnant qu’existe une large — mais pas complète — concordance de vues entre les réponses au Renvoi et l’Étude de 1992.
Celle-ci a été citée assez abondamment durant la procédure. Elle est mentionnée dans les écritures du Procureur général du Canada[15] et, évidemment plus copieusement, dans celles de l’Amicus curiae[16]. Et je suis frappé par le fait que les réponses aux questions du Renvoi recoupent, dans une large mesure celles de l’Étude au point qu’en relisant l’une et l’autre je me suis demandé si, bien que l’Avis ne la mentionne pas expressément, certains passages de celui-ci ne sont pas davantage une réponse à celle-là qu’aux plaidoiries présentées à la Cour.
Il existe cependant des nuances entre les positions des cinq juristes et celles de la Cour suprême[17]. Mais elles relèvent peut-être davantage de l’adresse juridique dont celle-ci a fait preuve que de la science du droit — il est vrai que notre discipline est plus un « art » qu’une science :
– La Cour suprême se garde de tenter une définition du mot « peuple » puisque, de toute manière, postule-t-elle, quelle qu’elle soit, les Québécois ne possèdent pas le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada[18]. Bien que ce soit mettre la charrue avant les boeufs, comme rappelé ci-dessus, nous étions arrivés à une conclusion voisine au point 3.09 de l’Étude[19].
– L’Avis de 1998 n’aborde que très fugitivement, au paragraphe 139, la question des droits des autochtones, pour, en fait, la disqualifier alors que l’Étude lui consacre de longs développements[20] ; il n’y a cependant pas d’antinomie entre les deux positions qui ne se situent pas sur le même terrain.
– La Cour suprême reconnaît, du bout des lèvres il est vrai, « que le droit international peut fort bien, selon les circonstances, s’adapter pour reconnaître une réalité factuelle ou politique, indépendamment de la légalité des démarches qui y ont donné naissance »[21] et que “[l]a sécession d’une province du Canada, si elle réussissait sur le terrain, pourrait bien entraîner la création d’un nouvel État”[22]. Mais elle s’emploie à minimiser l’importance de l’effectivité en la frappant d’anathème juridique[23] (tout en y voyant un « principe »[24] — un « principe factuel » ?) et en mettant l'accent, davantage que l’Étude des cinq juristes, sur l’importance de la reconnaissance par les autres États[25]. C’est sans doute sur ce point que les dissonances entre les deux textes sont les plus marquées, mais elles sont, à vrai dire, plus doctrinales que réelles quant aux conclusions atteintes : dans les deux cas, il est admis que l’existence de l’État issu d’une sécession est une question de fait et que la reconnaissance par les tiers n’est qu’un facteur facilitant l’établissement du fait étatique et un élément d’appréciation de sa réalisation.
L’adresse tactique de la Cour suprême, peut-être moins exclusivement soucieuse de s’en tenir aux aspects strictement juridiques des questions posées qu’elle ne le dit, me paraît se manifester principalement à deux points de vue :
– par la mise en avant du « principe » (constitutionnel — elle n’en parle guère lorsqu’elle répond, assez succinctement, à la question 2, seule à porter exclusivement sur le droit international) de l’obligation de négocier ; et
– en jouant sur les mots lorsqu’il s’agit d’interpréter le terme « droit ».
En ce qui concerne le premier de ces points, et je dois dire que, prima facie, son raisonnement me paraît convaincant. Quant aux rapports entre le droit canadien et le droit international, j’aurais mauvaise grâce, dans la conception « perspectiviste » qui est la mienne[26], à critiquer la Cour suprême pour s’être centrée principalement sur le droit canadien : c’est sa fonction. Il reste que son esquive finale pour éviter de répondre à la question 3[27] n’est rendue possible que par son interprétation « minimaliste » du principe d’effectivité et de son interprétation restrictive des questions posées.
Comme mon regretté ami Thomas Franck et moi y avions insisté dans nos critiques des positions du Procureur général du Canada et de son expert, James Crawford — que je pleure tout autant —, la Cour suprême limite, à tort, la définition du mot « droit » à son acception la plus étroite de droit subjectif et exigible. Il est vrai qu’elle y a été conduite par la rédaction contrastée, surement volontaire, des deux premières questions : la première, qui concerne le droit constitutionnel, n’utilise pas le mot « droit », mais demande à la Cour si le Québec « peut » faire sécession ; l’éventualité d’un « droit de sécession » n’intervient que dans la question 2, posée au sujet du droit international. Or, il est très généralement admis que, comme les cinq juristes l’avaient souligné,
i) le droit international ne contient aucun droit à la sécession et, en particulier, on chercherait en vain “dans le droit positif un texte ou une pratique permettant de déduire un droit des peuples de faire sécession de leur droit à disposer d’eux-mêmes [[28]] ; […]
iii) néanmoins, il n’existe pas non plus de règle juridique faisant obstacle à la sécession…[29]
C’est que, comme l’avait bien montré T. Franck dans son rapport joint au Mémoire de l’Amicus curiae en recourant à une comparaison avec le mariage, il peut y avoir des droits sans obligations corrélatives : on a le droit (right) de se marier (lorsque les conditions légales sont remplies) ; c’est une faculté, une permission donnée par le droit (law) ; le droit ici résulte de l’absence d’une interdiction de ne pas se marier[30]. Dans cette perspective, il est clair que le peuple québécois a « le droit » de faire sécession en ce sens que, s’il réussit à imposer le contrôle effectif du territoire du Québec par un pouvoir politique indépendant du Gouvernement d’Ottawa, cette entité constituera un État au sens du droit international. Le Québec n’a pas le « droit » (subjectif) de faire sécession, mais il « peut » faire sécession sans qu’aucune règle juridique internationale s’y oppose.
Comme je l’avais relevé dans une communication présentée à un intéressant colloque organisé en 1996 par l’Association du Barreau canadien :
Le « match juridique » entre les souverainistes et les anti-indépendantistes est donc nul : le droit international ne justifie pas la sécession, fût-ce au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; il ne nie pas la réalité juridique d’une sécession qui a réussi. En d’autres termes, les Québécois ne peuvent trouver dans le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes une justification juridique à leur éventuelle volonté d’indépendance ; mais s’ils imposent celle-ci dans les faits, si le Québec réussit, avec ou sans l’accord des autorités fédérales canadiennes, à exercer effectivement et durablement les fonctions étatiques, alors, ce sera un État et le droit international en prendra acte, étant précisé que la reconnaissance par les autres États, y compris par le Canada, n’aurait qu’un effet consolidateur…[31]
Et la négociation dans tout cela ? C’est le joker, le « truc » qu’a trouvé la Cour suprême pour ménager la chèvre et le chou. Elle en affirme la nécessité (juridique) au regard du droit constitutionnel ; soit ! je n’aurai pas l’outrecuidance de contester l’Avis sur une question de droit constitutionnel canadien. Mais, éminemment souhaitable politiquement et moralement si elle évite le recours à la force par les deux parties, une négociation n’est pas obligatoire au regard du droit international : elle peut, sans aucun doute, faciliter l’établissement effectif du futur État et sa reconnaissance par les États tiers[32] ; néanmoins, comme le montrent de nombreux exemples, il ne s’agit pas d’une condition sine qua non : en dépit des affirmations assénées par James Crawford[33], ni l’indépendance du Bangladesh, ni celle de l’Érythrée, ni même celle des États issus de la dissolution de la Yougoslavie — sans parler, dans des périodes plus reculées de l’indépendance du Panama par rapport à la Colombie ou de la partition de l’Inde — ne résultent d’une négociation entre les États prédécesseurs et les États successeurs[34].
Prudemment, la Cour suprême s’est gardée d’entrer dans le détail des négociations dont elle a affirmé la nécessité : elles « porteraient sur l’acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée »,[35] mais « il incomberait aux acteurs politiques de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre »[36]. Cette présentation circonspecte lui a évité de prendre quelque position que ce soit sur le sort des frontières d’un Québec indépendant[37]. Le problème a cependant resurgi lors de la discussion de la « loi sur la clarté » devant le Parlement canadien et de celle sur les droits du peuple et de l’État du Québec adoptée en riposte par l’Assemblée nationale québécoise[38].
À cette occasion, il m’avait été demandé par le Bloc québécois, à l’initiative, je crois, de Daniel Turp, de donner un avis juridique sur l’avant-projet de loi déposé le 10 décembre 1999 à la Chambre des Communes du Canada intitulé Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, en ce qui concerne la conformité de ce texte avec les notions de majorité claire et de question claire telles qu’elles sont utilisées dans l’Avis[39]. À titre subsidiaire, j’avais été prié d’indiquer si ma lecture de l’Avis permettait de déterminer si la Cour suprême avait inclus la question des frontières comme objet des négociations visées par l’obligation de négocier sur laquelle cet Avis insiste.
Concluant ma réponse à la seconde question, j’avais indiqué qu’il m’apparaissait que « rien, selon l’Avis de la Cour, n’exclut que les négociations entre les Parties portent, le cas échéant, sur la question des frontières, étant entendu que le droit international ne l’impose pas »[40]. Ce faisant, je ne faisais que réitérer ce qu’avaient expliqué les cinq juristes sept ans plus tôt :
Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, les frontières du Québec souverain seraient les frontières actuelles et comprendraient les territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, sauf accord en sens contraire de la province avant l’indépendance ou entre les deux États après celle-ci[41].
Les opposants à l’indépendance se sont emparés de ma position pour affirmer que les négociations à mener en vue de la sécession devraient porter sur les frontières[42]. Ce n’est assurément pas ce que j’avais écrit et Daniel Turp a eu raison de remettre les pendules à l’heure lors d’une conférence de presse qu’il avait convoquée à cet effet. C’est à juste titre qu’il a souligné que je n’avais en aucune manière affirmé qu’en vertu du droit international la question des frontières devait être abordée[43] et je partage également le point de vue qu’il a exprimé à cette occasion selon lequel l’Avis de la Cour suprême « n’oblige pas le gouvernement du Québec à accepter qu’il y ait des négociations sur les frontières »[44]. Mais je n’avais pas non plus exclu (et je n’exclus toujours pas) qu’elles puissent avoir lieu… ; c’est sans doute la raison pour laquelle je n’ai plus, par la suite été consulté par le BQ ! Il est vrai que la perspective d’une majorité en faveur de l’indépendance s’estompe et que l’on semble, peut-être sagement, s’orienter, vers un approfondissement de l’autonomie, notamment linguistique[45].
Il reste, pour en revenir à la consultation de 1992, que rien dans les évolutions que le droit international a connues depuis trente ans n’est venu remettre en cause les conclusions des cinq juristes : la consolidation des indépendances des États issus des dissolutions de l’URSS et de la Yougoslavie dans le respect du principe de l’uti possidetis[46], l’accession du Soudan du sud à l’indépendance dans des frontières conformes aux limites administratives préexistantes ne font qu’illustrer l’argumentation de l’Étude. Et il en va de même de l’Avis consultatif de la CIJ du 22 juillet 2010 sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, qui, bien que portant sur des questions différentes de celles posées par le Renvoi, comme la Cour de La Haye l’a souligné[47], donne des précisions utiles (mais incomplètes) sur la licéité des déclarations d’indépendance[48], les conséquences de l’échec des négociations entre l’entité indépendantiste[49] et l’État prédécesseur ou l’existence d’une période intérimaire.
Ma longue amitié avec Daniel Turp n’a pas toujours signifié un accord complet sur la question du droit du Québec à l’indépendance, dont il est un chantre convaincu et constant alors que je l’ai analysée de l’extérieur en m’efforçant à une objectivité aussi grande que possible. Il connaissait mes thèses parfois divergentes sur les questions lui tenant à coeur. Elles ne l’ont pas dissuadé, malgré sa grande discrétion sur ce point, de me manifester une confiance sans faille. Elle a été relayée par ses compagnons politiques auxquels je me plais à rendre également hommage : jamais mes mandants n’ont exercé la moindre pression pour tenter de me faire prendre des positions contraires à mes convictions juridiques.
J’ai découvert, en préparant ces quelques pages d’hommage, que Daniel Turp était un passionné d’opéra[50], une passion que je partage. Le célébrissime Va pensiero, le choeur de lamentation des esclaves hébreux, qui a fait le succès de l’opéra de Verdi Nabucco, à propos duquel il écrivait : « Ce choeur est apprécié non seulement pour sa musique, mais aussi pour le message de liberté qu’il envoyait à l’époque aux Italiens en lutte pour leur indépendance contre l’occupant autrichien », est aussi en résonance avec son autre passion — pour la liberté du Québec :
Va, pensiero, sull ali dorate;
Va, pensée, sur tes ailes dorées ;
Va, ti posa sui clivi, sui colli,
Va, pose toi sur les coteaux et les collines
Ove olezzano tepide e molli
D’où s’exhale, tiède et humide,
L’aure dolci del suolo natal !
Le doux air du sol natal !
Del Giordano le rive saluta,
Salue les rives du Jourdain
Di Sionne le torri atterrate…
Et les tours renversées de Sion…
Oh, mia patria sì bella e perduta!
Oh ma patrie si belle et perdue !
Appendices
Notes
-
[1]
Société française de droit international, Enseignement du droit international, recherche et pratique, Paris, Pedone, 1997, 280 p.
-
[2]
Malcolm Shaw, « Avis sur la conformité au droit international de la succession d’États d’une méthode de répartition des actifs et des passifs entre le Canada et le Québec » [1991-1992] 7:1 RQDI 88.
-
[3]
Les questions étaient rédigées ainsi : « 1. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, les frontières du Québec souverain seraient-elles les frontières actuelles, qui comprendraient les territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, ou celles de la province de Québec au moment de la formation de la fédération canadienne en 1867 ? 2. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, le droit international ferait-il prévaloir le principe de l’intégrité territoriale (ou uti possidetis) sur les revendications visant à démembrer le territoire du Québec, plus particulièrement : a) les revendications des autochtones du Québec qui invoquent le droit à l’autodétermination des peuples au sens du droit international, b) les revendications de la minorité anglophone, notamment en ce qui concerne les régions du Québec où cette minorité est concentrée, c) les revendications des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec, quelle que soit l’origine ethnique de ces personnes ? » ; Les réponses aux questions figurent au point 4.02 de l’Étude.
-
[4]
Christian Tomuschat a en effet souligné que, contrairement aux quatre autres signataires (voir le para 3.04 de l’Étude), il considère que le droit à l’autodétermination équivaut au droit à l’indépendance. Cette divergence ne l’a cependant pas conduit à des conclusions générales différentes de celles auxquelles la majorité est arrivée (voir note 133bis de l’Étude).
-
[5]
« L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté » dans Assemblée nationale du Québec, Les attributs d’un Québec souverain, Exposés et études, Volume 1, 1992, aux pp 377-461 ; elle est reproduite en français et en anglais sur mon site Internet, en ligne : <https://www.alainpellet.eu/divers>. Faute que nous ayons pu la mettre à jour dans le très court délai imparti, elle n’a pas été retenue en 2012 pour figurer parmi les rapports finalement publiés (voir Bureau de coordination des études, Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, « Fiche d’identification de la mise à jour », en ligne : <https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/institutions-constitution/commission-accession-souverainete/QA-12-AlainPellet.pdf>). Elle a été publiée en 2018 sous le titre « Le territoire d’un Québec indépendant » (Éditions du Renouveau québécois, 2018, 180 p.) avec une préface de André Binette. Elle a été publiée en anglais par Anne Bayefsky (qui a eu la courtoisie de prévenir les auteurs), dans Self-Determination in International Law — Quebec and Lessons Learned, Kluwer Law International, La Haye, Londres, Boston, 2000, 241.
-
[6]
Ibid, point 1.12.
-
[7]
Voir aussi, ibid, point 3.07.
-
[8]
Ibid, point 3.09.
-
[9]
Voir notamment, ibid, point 3.31.
-
[10]
Supra note 5. La préface a été publiée par L’Autjournal (10 avril 2019), en ligne : <https://lautjournal.info/20190410/partition-du-quebec-quebec-solidaire-tout-faux#_ftn1 >.
-
[11]
Voir par ex Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 35-1, vol 34, n° 32 (25 avril 1995), en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-35-1/journal-debats/CI-950425.html > ; Jill Wherrett, Division des affaires politiques et sociales, Les peuples autochtones et le référendum de 1995 au Québec : les questions qui se posent, 1996, en ligne : <https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp412-f.htm > ; Québec, Assemblée nationale, « Déclaration ministérielle de M. Jacques Brassard, ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, concernant l’intégrité du territoire québécois », 12 novembre 1997, en ligne : <https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/positions-historiques/positions-du-qc/partie2/JacquesBrassard1997.pdf > ; Voir aussi le Gouvernement du Québec de 1997 qui, après s’être référé à l’Étude des cinq juristes, avait annoncé qu’il tiendrait un nouveau référendum s’il était réélu. La possibilité d’un nouveau référendum et les débats autour de notre avis ont aussi refait surface dans les années 2000, voir par ex Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 36-2, vol 37, n° 57 (10 avril 2002), en ligne : <www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-36-2/journal-debats/CI-020410.html>.
-
[12]
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217.
-
[13]
Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, LC 2000, c 26 et les débats y relatifs : Canada, Comité législatif chargé d’étudier le projet de loi C-20, « Intervention de M. William Johnson (président sortant, Alliance Québec) » (24 février 2000), en ligne : <https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/362/CLAR/Evidence/EV1040068/clarev10-f.htm >.
-
[14]
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple Québécois et de l’État du Québec, RLRQ, c E-20.2. Qualifiée de véritable charte des droits politiques du peuple du Québec, cette dernière affirme le droit du Québec de choisir son propre avenir politique et constitutionnel et se veut une véritable codification législative du droit du Québec à l’autodétermination. Voir les débats y relatifs : Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 36-1, vol 36, n° 42 (2 mars 1999 au 9 mars 2001) ; Québec, Assemblée nationale, Consultation générale sur le projet de loi n° 99 (8 et 9 février 2000).
-
[15]
Renvoi, supra note 12 (mémoire du Procureur général du Canada au para 163) et (Mémoire du Grand Conseil des Cris aux para 80, 83, 98-99).
-
[16]
Ibid, (mémoire au para 86) ; (réplique au para 66) ou (réponse de l’Amicus Curiae aux questions posées par la Cour suprême) ; L’Étude est notamment citée dans les réponses aux questions 5. Elle l’est aussi, logiquement, par les experts consultés par l’Amicus curiae puisque trois d’entre eux (Thomas Franck, Alain Pellet et Malcolm Shaw) étaient co-signataires de l’Étude.
-
[17]
Les deux tiers de l’Avis sur le Renvoi sont consacrés à des discussions portant sur le droit constitutionnel canadien qui sortaient largement du cadre de l’Étude des cinq juristes et des compétences de ses auteurs.
-
[18]
Renvoi, supra note 12 au para 138.
-
[19]
Dans le même sens quoique moins nuancé : Tribunal constitutionnel espagnol, 17 octobre 2017, Loi relative au référendum d’autodétermination du Parlement de Catalogne, jugement 114/2017.
-
[20]
Étude, supra note 5, points 2.8-2.14 et 3.22-3.31.
-
[21]
Renvoi, supra note 12, au para 141.
-
[22]
Ibid, au para 142.
-
[23]
Ibid, aux para 140-46 ; Voir aussi, aux para 107-108 et 110.
-
[24]
Voir notamment ibid, au para 146, consacré au « principe de l’effectivité ».
-
[25]
Voir notamment ibid, aux para 106, 142, 143 et 155.
-
[26]
Alain Pellet, « Le droit international à la lumière de la pratique : l’introuvable théorie de la réalité. Cours général de droit international public », Recueil des cours, Tome 414, au para 92 ; Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, 9ème édition, 2022, au para 342.
-
[27]
« À la lumière des réponses que nous avons données aux questions 1 et 2, il n’existe, entre le droit interne et le droit international, aucun conflit à examiner dans le présent renvoi ».
-
[28]
Citant Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, Paris, 3e éd, 1987, à la p 467 ; nous avons maintenu cette position dans la 9e édition, supra note 26, aux para 480 ou 484-485.
-
[29]
Étude, supra note 5, point 3.14.
-
[30]
T.M. Franck, Opinion Directed at Question 2 of the Reference, aux para 2.4-2.5; Voir aussi Alain Pellet, Remarques sur la Réplique de la Procureure générale du Canada et la Réponse du Professeur Crawford aux rapports d’experts produits à la demande de l’amicus curiae, points 12-15.
-
[31]
Alain Pellet, « La souveraineté et l’autodétermination — processus et conditions ; quelques remarques d’internationaliste » in Association du Barreau canadien, La loi sur la souveraineté du Québec: perspectives juridiques, Montréal, 1995, pp. 4-5.
-
[32]
Renvoi, supra note 12, au para 103.
-
[33]
Report — State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession, 19 février 1997, aux para 26-62; Response to Experts Reports of the Amicus Curiae, 8 janvier 1998, aux para 20 et 30-32.
-
[34]
Alain Pellet, Avis juridique sur certaines questions de droit international soulevées par le renvoi, 2 décembre 1997, points 41-42 ; ou supra note 31, point 28.
-
[35]
Renvoi, supra note 12, au para 151.
-
[36]
Ibid, au para 153.
-
[37]
Il n’est question (abondamment) d’intégrité territoriale dans l’Avis qu’en ce qui concerne l’État préexistant ; Voir Renvoi, supra note 12, aux para 127-131 et 153.
-
[38]
Supra note 13 et 14.
-
[39]
La question tenait au fait qu’à plusieurs reprises la Cour suprême avait recouru à des expressions comme « majorité claire en réponse à une question claire » (Renvoi, supra note 12, au para 153). Ma réponse à cette première question peut être résumée ainsi : d’une part, il n'est pas possible, selon la Cour, de procéder à une telle détermination dans l’abstrait et par avance ; d'autre part, cette détermination doit être le fait des acteurs politiques, et l'on ne saurait admettre qu'un seul d'entre eux, fût-ce le Parlement fédéral, y procède unilatéralement.
-
[40]
Avis juridique sommaire sur le projet de loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son Avis sur le renvoi sur la sécession du Québec, 13 décembre 1999.
-
[41]
Étude, supra note 5, au point 4.02, réponse à la question 1 [nos italiques].
-
[42]
Voir notamment Le Soleil ou The Hamilton Spectator du 15 décembre 1999.
-
[43]
Voir notamment The Toronto Star, The Hamilton Spectator, Montreal Gazette, « Bloc Study Contradicts Border Stand », 15 octobre 1999; « Le projet de loi fédéral “sur la clarté” s’embrouille ; Les frontières du Québec pourraient faire l’objet de négociations, mais elles ne seraient pas obligatoires », Le Devoir 15 décembre 1999.
-
[44]
Sur ces discussions autour de mon avis juridique et des positions de Daniel Turp, voir notamment Le Devoir, Le Soleil, La Presse, The Hamilton Spectator, The Toronto Star, Montreal Gazette, The Ottawa Citizen, The Edmonton Sun ou The Calgary Sun du 19 décembre 1999.
-
[45]
Voir par ex PL 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, 1ère sess, 42e lég, Québec, 2021 qui évoque la « nation québécoise ».
-
[46]
Voir par ex la Sentence arbitrale du 29 juin 2017 dans l’affaire des frontières terrestre et maritime entre la Croatie et la Slovénie (2012-04), aux para 256-326.
-
[47]
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, [2010] CIJ Rec 403 aux pp 425-426, aux para 55-56.
-
[48]
Ibid, aux pp 437-438, au para 81 : « aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil de sécurité ».
-
[49]
Ibid, aux pp 445-446, au para 105.
-
[50]
Voir le site qu’il consacre à cet art complet dont je suis également très amateur : Daniel Turp, en ligne : <https://www.danielturp.quebec/ >.